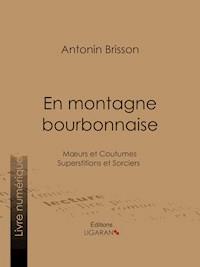
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "C'est sur ces rives escarpées, véritables falaises, que se dressent les ruines du château de Châtel-Montagne, village qui a eu son importance au Moyen-âge. Quel bon exercice on peut prendre dans cette région, en allant disputer le gibier assez abondant aux braconniers que l'éloignement des gendarmes y laisse pulluler ! Quelles jolies promenades on y fait ! Quel bon air on y respire !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J’aime ce coin de terre, dont je vais parler, parce que j’y suis né, que j’y ai vécu. Ma profession, pendant vingt-cinq ans, m’en a fait parcourir les chemins, les sentiers ; elle m’a fait pénétrer aussi dans bien des intérieurs, connaître nombre de ses habitants, dont beaucoup ont été mes clients, quelques-uns mes amis ; et pour les uns et les autres j’ai été le témoin de quelques joies, mais aussi souvent le confident de bien des peines.
On n’est pas ainsi mêlé à l’existence des gens sans apprendre leur manière de vivre, sans étudier leurs mœurs et leurs caractères.
Aujourd’hui que ma santé m’oblige à déserter mon poste, quand la neige ou les giboulées viennent fouetter mes vitres, malgré moi, aucoin du feu, je pense à toutes les intempéries que j’ai subies, et aussi à tout ce que j’ai vu et entendu au cours de ma carrière. Dans des rêveries prolongées, au milieu de la fumée de ma cigarette passent et repassent dans ma mémoire les remarques faites, les observations prises, les souvenirs recueillis.
Je les ai jetés sur le papier, sans autre but, tout d’abord, que de fournir à mon esprit une nouvelle occupation. Puis j’ai pensé que les anciens, en les parcourant, auraient peut-être quelque plaisir à se rappeler une époque pour eux déjà lointaine.
Quant aux jeunes, si ces usages que j’essaie de décrire et qu’ils qualifieront de surannés, si ces anecdotes et ces légendes que je conte pouvaient amener sur leurs lèvres un sourire, à ma plume inexpérimentée ce serait un encouragement.
Lapalisse, 10 mai 1911.
Docteur BRISSON.
Où l’œil trouvera-t-il d’aussi vertes montagnes ?
Des rivages si frais où l’air vient s’embaumer ?
Qui foulera, dis-moi, tes prés et tes campagnes ?
Oh ! qui sous ton ciel bleu passera sans t’aimer ?
FERTIAUT.
Le pays en été. – Les moyens de locomotion. – Les noces. – Les fêtes. Les Fugots. – Les Bignons. – Le Mai. – Les charriaisons. – La vie des riches. – Les courriers. – Les foires. – Le 20 juin à Arfeuilles. Les industries locales. – Les conscrits. – La première bicyclette 1870. – La garde nationale. – Le départ des pompiers. – Les professions. – Les costumes. – Le patois. – La désertion des campagnes. – Les surnoms. – Légendes d’Arfeuilles. – Les Charguerauds. – Les Pions. – Caractère du montagnard.
Quand de Vichy on se dirige sur Roanne, en passant par Lapalisse, on laisse à droite toute une partie du département de l’Allier que l’on est convenu d’appeler la montagne ; non sans raison, dans certaines géographies, on la décore du nom de Petite-Suisse, tellement ses sites sont pittoresques. Depuis quelques années, les moyens de locomotion, qui se sont multipliés, y déversent, chaque été, quantité de touristes, qui aiment à grimper sur ses cimes boisées, à traverser ses vallées profondes et riantes, toutes sillonnées de ruisseaux à eau vive, où saute la truite, où fourmille l’écrevisse. Nombre de pêcheurs viennent les taquiner pendant que le vin fraîchit dans un courant, et que la nappe étendue sur l’herbe, en un coin ombreux, annonce l’approche d’un de ces festins champêtres, où l’on manque peut-être de siège, jamais de gaîté.
Quelques-uns de ces cours d’eau attirent plus spécialement les curieux par leurs chutes rapides, véritables cascades, comme celle du Barbenant à la Pisserotte ; par leurs gours comme en a le Sichon : Gour Ghatti, Gour Noir, Gour Saillant ; d’autres encore par leur encaissement dans les rochers comme celui de la Besbre, de tous le plus important, et qui s’engage dans des gorges étroites et profondes – les Darrots – dont les bords taillés à pic donnent le vertige, et ont un aspect sauvage dont viennent jouir les baigneurs de Vichy.
C’est sur ces rives escarpées, véritables falaises, que se dressent les ruines du château de Châtel-Montagne, village qui a eu son importance au Moyen-âge.
Quel bon exercice on peut prendre dans cette région, en allant disputer le gibier assez abondant aux braconniers que l’éloignement des gendarmes y laisse pulluler !
Quelles jolies promenades on y fait ! Quel bon air on y respire ! Et pour les intellectuels, pour les professeurs qui, depuis quelque temps, y séjournent en vacances, pour les énervés aussi et les névrosés, quels charmants lieux de repos que tous ces vallons pleins d’une fraîcheur qui apaise les nerfs, que ces salons de verdure où la vue se repose, que tous ces sous-bois où l’esprit fatigué trouve le calme et le silence, troublés seulement par le murmure des eaux, le chant des oiseaux ou le tic-tac des moulins égrenés de loin en loin, le long des vallées !
Une voie ferrée traverse déjà ce coin du Bourbonnais. Elle y a apporté un peu de bien-être en facilitant l’écoulement de ses produits.
Elle aidera sans doute aussi à l’exploitation de ses richesses souterraines pour laquelle les tentatives, en raison de la cherté des transports, sont toujours restées vaines : le fer du Breuil, le cuivre d’Isserpent, le plomb argentifère de Laprugne, le kaolin de Nizerolles…, etc.
Mais, du bruit de leurs sifflets, les locomotives peuvent réveiller les échos de ses collines ou de ses rez, comme l’on dit dans le pays ; elles peuvent ternir son ciel de leurs nuages de fumée, avec ses mœurs et coutumes un peu spéciales, son langage particulier, elle conservera son cachet parce qu’elle aura toujours non seulement ses sites, ses rochers comme celui de St-Vincent, ses grottes comme celle de Ferrières, mais aussi ses ruines : Montmorillon, Montgilbert, sa belle église romane de Châtel, ses monuments druidiques comme celui de la forêt de l’Assise. Ce dernier a une légende.
Dans une de ses cuvettes, la plus grande et la plus profonde, il reste toujours une certaine quantité d’eau. Toute jeune femme qui y trempe l’index doit avoir un enfant l’année qui suit. Je ne la raconte pas sans sourire, car à la visite que je lui ai faite, étaient présents trois jeunes couples qui, tous les trois, mirent leurs doigts dans le trou, non seulement les dames, mais pour donner plus de poids à la chose, aussi les maris. Les résultats ne se firent pas attendre : avant les douze mois qui suivirent, deux bébés étaient nés. L’absence du troisième causa une déception d’autant plus grande qu’il était plus désiré. Mais une expérience qui réussit deux fois sur trois, n’est-elle pas déjà digne du plus haut intérêt ? Combien de choses dans la vie sont entreprises avec beaucoup moins de chance de succès ? Avis aux amateurs. Il est tout à fait opportun à cette époque de dépopulation, un des fléaux de la France. Sans doute un pèlerinage sur ces cimes de si haute altitude ne saurait se faire en toutes saisons ; mais on peut choisir la belle, et si, par ces routes en lacets qu’embaument les pins, la crainte d’une déception allait vous faire hésiter, montez toujours, les souvenirs que vous y cueillerez seront une compensation.
Ah ! les légendes ! on en contait autrefois ! Sur les loups-garous, les feux follets, la chasse-maligne, et combien d’autres encore ayant trait au pays ont bercé mon enfance ?
On les disait le soir sous la grande cheminée qui souvent se dressait au milieu du toit, et il en existe encore quelques spécimens. Le foyer où l’on brûlait des troncs presque entiers, à peine dépecés, était au centre de la cuisine : disposition heureuse pour les grandes familles qui l’entouraient d’un cercle qu’elle pouvait resserrer ou étendre selon leur prospérité ou le nombre des invités.
On les disait aussi durant les longues veillées d’hiver, quand tout le hameau allait se grouper chez un voisin pour y teiller le chanvre ou bien casser les noix. Ce n’est pas sans un certain émoi que les grands les écoutaient pendant que les petits, la main crispée sur la robe de grand-mère, restaient haletants, la bouche bée. En vain, ces jours-là, la vieille passait et repassait avec son sable pour en jeter dans les yeux ; ils restaient grands ouverts. Après de tels récits, on aurait bien eu trop peur d’aller se coucher seul et sans lumière.
On y voisine encore, mais beaucoup moins qu’il y a cinquante ans, époque à laquelle la vie était localisée pour ainsi dire, sans contact avec les villes que l’on ne connaissait pas, dont les échos n’arrivaient pas jusque-là, portés comme aujourd’hui par un tas de feuilles publiques qui viennent y réveiller les appétits, troubler les cœurs et faire tourner les têtes.
La mutualité, si à l’ordre du jour, y était pratiquée en grand. Le métayer était l’ami du maître qui le considérait presque comme un membre de sa famille, le recevant certains jours à sa table. Aussi les contrats qu’ils passaient entre eux étaient toujours pour ainsi dire à la vie, à la mort. On ne se quittait guère que quand cette dernière avait fauché les rangs devenus trop étroits pour continuer l’exploitation, ou bien quand des héritages occasionnaient dans le sol des divisions multiples.
On s’aidait, on se secourait, on se prêtait les objets de première nécessité que l’éloignement des fournisseurs ne permettait pas de se procurer facilement. Beaucoup de hameaux étaient habités par des gens de même nom, de même famille, véritables tribus dont les rameaux prolifiques partis d’un domaine, d’une locaterie, s’étaient progressivement étendus sur tout le voisinage.
Sans reconnaître comme celles d’Auvergne, l’autorité effective d’un chef, chacune n’en avait pas moins, à sa tête, un ancêtre dont elle recherchait les conseils, et plus d’une de ces agglomérations qu’elles ont formées, n’a encore d’autre nom que celui de ses habitants : les Becauds, les Charasses, etc.
On vivait si isolé du reste du monde que l’on avait fini par s’y croire à l’abri des lois, et quand le premier appel sous les drapeaux se fit entendre, il resta sans écho ; les chasseurs de Moulins durent traquer les conscrits dans les bois où ils se terraient comme des lapins.
Les paysans n’avaient d’autre moyen de locomotion que leurs jambes, moyen bien délaissé aujourd’hui et qu’ils dénomment ironiquement le train 11 ; cela se conçoit, il y en a tant d’autres depuis le bicycle jusqu’à l’aéroplane.
La charrette bourbonnaise avait bien déjà fait son apparition, mais à part quelques tilburys, de bien rares berlines, les gens aisés partaient à cheval avec leurs femmes en croupe, et à ces animaux surchargés que ne demandait-on pas, sinon de vitesse, mais au moins d’endurance ?
Les noces, pour éviter les ornières, les fondrières dans les chemins mal tracés, pas du tout entretenus, se faisaient parfois conduire à l’église dans des chars à bœufs ; sur ces véhicules veufs de toute suspension, le moindre cahot faisait quelquefois se choquer les visages ; et pour la jeunesse quel prétexte à rire que ces baisers d’occasion !
Après la cérémonie, pour traverser le bourg, on formait un cortège auquel des quenouilles étaient tendues au passage, par des mains amies, par des pauvres aussi qui, en cette circonstance, supputaient la générosité des mariés ; elle est facile aux gens heureux.
Ces quenouilles n’étaient que des bouquets montés sur de longs roseaux, et leur silhouette rappelait assez bien de loin celle de la quenouille chargée de sa matière textile, d’où la dénomination.
Puis, après une station à l’auberge, on regagnait le domaine ou le hameau au bruit des coups de pistolet ou de fusil tirés par les garçons d’honneur qui, à l’occasion, tuaient une poule rencontrée, cette hécatombe devant porter bonheur. Il n’était pas rare, en approchant de la maison, de trouver négligemment renversé en travers du chemin un balai que la mariée avait grand soin de ramasser pour ne pas être traitée de femme sans ordre, de mauvaise ménagère.
Enfin, autour des tables garnies, sur des chaises ou des bancs improvisés, chacun prenait une place que les vieux ne quittaient guère ; c’était leur plaisir à eux.
Une fois l’appétit calmé, quand sous l’influence des libations le sommeil avait tendance à ralentir les conversations, ils se réveillaient par une chanson, toujours la même, et qui n’a qu’un couplet :
Et avec les beuveries recommençaient les causeries le plus souvent sur les choses de la ferme ou encore sur les qualités et l’avenir des mariés.
Au dessert, invariablement apparaissaient les beignets bourrés de chanvre, surchargés d’épices qui provoquaient des grimaces amusantes.
Outre ces distractions, la jeunesse en avait d’autres. Sur la fin de l’après-midi la novie se cachait, et véritable partie de cache-mute, comme l’on disait alors, chacun des jeunes gens mettait à la trouver le premier une ardeur que l’honneur de l’embrasser devait récompenser.
Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, on portait aux jeunes époux la trempée, c’est-à-dire un bol de vin sucré avec, baignant dedans, des lèches de pain. Cette coutume existe encore. Boire au même verre, mordre au même pain est un symbole d’union. Facilement on comprend aussi son but, celui de réparer les forces, mais la pudeur des mariés s’offusquait de cette invasion de leur chambre à une heure si indue, aussi demandaient-ils presque toujours à des parents ou amis plus ou moins éloignés, une hospitalité qui arrivait parfois à dépister la curiosité.
Mais tous ces amusements n’étaient rien à côté de ceux de la danse.
En Bourbonnais :
On naît le pied en l’air et la carte en mains.
Les cartes n’étaient guère connues que dans les milieux aisés ; le paysan se contentait de jouer aux quilles et au bouchon ; mais comme les autres, il était né danseur.
Son répertoire n’était pas varié ; s’il n’ignorait pas la valse, la varsovienne, la polka, voire même le chibre-li, il les oubliait toutes pour la bourrée qui avait ses préférences ; l’interminable bourrée bourbonnaise qu’il prolongeait souvent jusqu’à la fatigue, et
Le combat cessait faute de combattants.
Toujours elle se terminait par le iou-iou traditionnel qui était pour les couples le signal de s’embrasser.
Quelquefois, on la chantait :
Beaucoup d’autres couplets doivent exister encore ; si les bourrées étaient longues, ils étaient nombreux. Je les donne comme on les disait au Breuil ; mais entendus à Arfeuilles, ou à Ferrières, ils ne sauraient être orthographiés de même.
Ainsi se passaient les noces ordinaires. Quand elles présentaient dans les conjoints de grandes disproportions d’âge, quand, par exemple, une veuve déjà mûre convolait avec un homme plus jeune, les gamins, et dans ces circonstances, il y en a de grands et de petits, sortaient armés de poêles, de vieux chaudrons, et, en tapant dessus, produisaient un vacarme qui n’a d’analogue que celui que l’on fait autour d’un essaim qui déserte sa ruche.
Avec quelque raison, on dénommait cela : le Charivari.
Il n’est pas de fête sans lendemain.
En montagne, elles avaient même souvent un surlendemain, et il n’était pas rare, dans certaines communes de voir les fêtes patronales durer huit jours. Sans attendre le printemps dont les senteurs grisent, ou le soleil des beaux jours dont l’éclat fait ressortir les toilettes, combien étaient préférées les fêtes d’hiver ! Celle du Breuil ou d’Isserpent ! Sous son blanc manteau de neige, le maître exigeant qu’est la terre laissait plus de loisirs. Au bétail accrèché, on jetait en hâte la mêlée, et, quand au village, les premiers sons de la vielle se faisaient entendre, c’était vers le bourg une envolée générale de tout ce qui est jeune. Tout l’après-midi, les sabots en cadence battaient le parquet des tentes qui y étaient dressées. De temps en temps, des couples en sortaient pour se réconforter par un vin à la française si en honneur alors, ou pour aller tenter la chance auprès des loteries, des tourniquets. On était heureux déjà quand on gagnait des biscuits ou de ces macarons desséchés que l’on méprise aujourd’hui, mais qui, à l’époque, étaient des desserts quasi nouveaux ; quelle joie plus grande, quand le propriétaire du jeu, le blanqueur, comme on l’appelait, vous tendait une jolie tasse, un pot à eau, ou mieux la pièce à choisir, une belle cruche qui, le reste de l’année, rappelait les émotions d’un jour ! Plus d’une de ces cruches ont dû se briser au retour nocturne par les chemins accidentés et rocailleux. Il faisait parfois bien froid, mais on avait pour manteau la jeunesse ; il faisait aussi bien noir, mais on n’était pas seul. Chacun, ensuite, furtivement, gagnait son lit, sans réveiller les vieux qui dormaient d’autant plus profondément que la bombance inaccoutumée y était pour quelque chose.
Et le lendemain, accrochés aux buissons des sentiers, l’on voyait souvent des lambeaux de robe, mais ce que l’on ne retrouvait plus c’étaient les illusions perdues.
On dansait aussi le dimanche des Brandons, le jour des Fugots, comme on l’appelle encore, ou autrement dit, des Feux que les Gaulois allumaient déjà, certains jours, au sommet des points culminants.
Il est des professions qui obligent à voyager la nuit. Par expérience, et une longue, j’en connais une, non des moins pénibles, qui fait de celui qui l’exerce l’homme de toutes les intempéries, de toutes les heures nocturnes et diurnes, de tous les chemins, voire même de tous les sentiers, et nul mieux que lui n’en connaît les détours.
Mais rentrer tard le jour des Brandons n’était pas une corvée. Quel plaisir de voir de tous côtés la campagne constellée de mille feux, dont quelques-uns, là-haut à l’horizon, paraissaient se confondre avec les étoiles ! Le cheval parfois avait bien un peu peur de ces lueurs soudainement aperçues aux abords des chemins ; mais le grincement des vielles, le son des musettes, les cris joyeux de la jeunesse étaient un peu de gaîté cueillie au passage, et pour un soir la monotonie de la route était rompue.
Ce n’était pas rien de préparer un fugot quand on le voulait gros, et on le voulait toujours, car sa durée pour ceux qui le faisaient était aussi la durée des plaisirs. Toute la journée, les jeunes gens du village, ceux des hameaux aussi, chacun faisant le sien, traînaient qui sur son dos, qui sur des brouettes ou des charrettes, la paille, la bruyère, les fagots, tout ce qui se brûle et que la bonne volonté des gens leur cédait en passant. À l’endroit désigné, on entassait le tout autour d’une perche géante, au sommet de laquelle pendait l’image grotesque de Carnaval.
Puis, le soir venu, on allait présenter la brande attachée de rubans aux derniers mariés de l’année qui, seuls, devaient donner le signal de la fête, en allumant le Feu.
On organisait alors des rondes échevelées, des farandoles immenses englobant tout le monde, les enfants, les vieillards, et c’était fantasque, à ces lueurs, de voir les ombres reproduire ces danses, en exagérant des uns les mouvements gracieux, les contorsions des autres.
Carnaval brûlé, on prolongeait la danse dans les salles d’auberge, souvent dans une grange. À défaut d’orchestre, des voix s’élevaient, et tous de scander la mesure du talon des sabots.
L’emplacement des Fugots était toujours à une croisée de chemins, à un carrefour. Les cendres en dessinaient la place, le reste de l’année, en larges plaques noires, sur lesquelles on avait soin de faire passer les animaux en les menant aux champs ou à l’abreuvoir.
La croyance veut encore que ce soit un moyen de les préserver des épidémies.
Le dimanche après carnaval était encore le jour où l’on faisait ces beignets fameux connus surtout sous le nom de Bignons. Par leur présence sur les tables, ils venaient en quelque sorte rehausser la fête. Cette coutume très ancienne devait avoir la même origine que celle des feux ; car, d’après Larousse, beignet vient du mot celtique « bignes », et, à n’en pas douter, le mot Bignon en descend en droite ligne.
Quelles convoitises ce nom seul ne réveillait-il pas chez les enfants ! Ils n’étaient guère gâtés, et cette friandise avait encore le grand mérite d’être rare puisqu’elle n’était qu’annuelle. Aussi la veille, quand toutes les cheminées fumaient, quand, dans le feu de l’action, et manches retroussées, les mamans étaient plongées dans la maie, en train de les pétrir, ils étaient là, eux aussi, rôdant autour d’elles ; de leurs regards chargés d’un intérêt profond ils en escomptaient par anticipation et le nombre et la qualité.
Il s’agissait bien d’aller en classe qui de temps immémorial, ce soir-là, restait déserte ! Leur concours était nécessaire, et à le prêter, quel zèle ! quel entrain !
Leur tâche consistait à aller ramasser dans les bois, dans les haies, toutes ces brindilles, toutes ces petites branches sèches indispensables pour la flambée qui devait les saisir, les dorer, les faire souffler, et le mot beignet veut dire gonflement.
L’instituteur n’avait garde de troubler une habitude si invétérée qu’approuvaient, du reste, les parents, et qui lui donnait à lui un peu de vacance ; sans parler que le lundi, chaque élève, en rentrant, apportait dans son panier la part du maître.
C’était, ce jour-là, le dessert de tous les repas, et de toutes les tables. Les quelques vraiment pauvres en recevaient des uns et des autres, et au nombre, pour eux, se joignait ainsi la variété.
On n’en était pas chiche, du reste. On aimait à se les montrer, à s’en faire part. Ensemble, on les goûtait, on les appréciait, on les admirait. C’était ensuite entre les ménagères un échange de compliments sans fin sur le tour de main, la qualité, le bel aspect, sur la forme aussi, qui variait avec le goût et le savoir de chacune, et qui était tantôt celle d’un cœur, celle d’un nœud, souvent aussi celle d’un chiffre ou d’une lettre.
Quiconque rentrait dans une maison était sûr qu’on lui offrirait des Bignons que l’on arrosait de vin, de cidre ou de boissons plus modestes. Refuser, eût été faire injure. On se laissait faire ; douce violence, car ces beignets qui ont différents noms, Beugnes à Lyon, et Bignons ici, n’en ont pas moins leur mérite.
Pâques venait ensuite avec ses cérémonies religieuses auxquelles on se rendait en famille, qui se continuaient le lundi à vêpres par la bénédiction des enfants, heureuse occasion pour les jeunes mères de produire au grand jour leur progéniture ensevelie sous des costumes que l’amour et l’orgueil avaient ornementés.
Sur le tard, on allait faire rouler les œufs.
Après les avoir teints au bois de campêche, les enfants les portaient parfois dans des fourmilières où ils se chargeaient de dessins plus ou moins variés, produits au passage des insectes par l’acide formique.
La roulée des œufs, pour la jeunesse exubérante, n’était qu’un prétexte de plus pour aller dans les prés dépenser bruyamment un peu de cette sève qui montait chez elle, comme elle montait déjà partout dans la nature.
Le soir venu, on rentrait grisé de grand air, chargé de primevères rassemblées en pelotes que les enfants se lançaient entre eux comme des balles, et les œufs brisés, pour les appétits stimulés par l’exercice, venaient à propos renforcer le repas.
Puis c’était le printemps. De tout temps on l’a fêté.
Le premier dimanche de mai, les Druides avaient la fête du Soleil, et célébraient son retour par de grands feux allumés sur les hauteurs.
Au dix-septième siècle, on plantait le mai, c’est-à-dire un arbre vert, devant l’habitation des personnes que l’on voulait honorer.
Aujourd’hui, on continue à fêter le réveil de la nature à des dates différentes, et chaque pays à sa manière, mais généralement par des danses et des chansons.
Henry Bordeaux, dans Robe de laine, a décrit une de ces fêtes :
Réveille-toi, belle endormie…
En montagne, il y a cinquante ans, on ne plantait pas le mai, on le chantait. Dans la première nuit du mois, les jeunes gens partaient en bandes, à travers les chemins embaumés d’aubépine, et, suivant les maisons, les fermes habitées par des jeunes filles, ils allaient leur donner une aubade.
À la voix des chiens donnant l’alerte, aux chansons joyeuses qu’accompagnait toujours la vielle ou la musette, les fenêtres s’ouvraient, des silhouettes se montraient en petits négligés jetés en hâte, et aux pâles rayons de la lune qui adoucit les traits, alanguit les yeux, des sourires s’échangeaient, sourires pleins de promesses…
De cette monnaie-là les jeunes gens d’alors se trouvaient largement payés.
Ceux qui suivirent, moins désintéressés, pour ces hommages réclamèrent un tribut.
Ils ne chantaient plus le mai, ils le ramassaient ; c’est encore l’expression consacrée :
Et, de leurs promenades nocturnes, ils revenaient chargés d’œufs, de lard, etc…, qu’ils mangeaient ensemble le dimanche suivant.
La galanterie y perdit de son charme.
Actuellement, seuls les conscrits ont conservé cette coutume qu’ils ont modifiée. Ils portent des bouquets aux jeunes filles de leur âge, et les parents, selon leur fortune ou leur générosité, répondent à leur politesse par une offrande en argent qui sert à payer les frais de leur banquet ; car ils ont leur banquet, comme presque toutes les classes militaires ont le leur ; comme chaque société de musique ou de sport a le sien, sans parler des banquets politiques où la plus grande cordialité ne cesse de régner, et dont la chaleur est de plus en plus communicative !
D’autres circonstances que celles que je viens de nommer apportaient encore dans la vie rurale un peu d’animation, parfois une note gaie.
La mort du cochon était un évènement important, qui nécessitait toujours la présence des proches, des amis, sinon pour prêter leur aide, mais pour manger le boudin, emporter la grillade. Quand, couvert de paille, on le faisait flamber, les enfants étaient là, et, comme autour d’un fugot, odeur à part, ils sautaient, s’amusaient. Ils avaient le temps ou, mieux, ils le prenaient avec l’accord tacite de la maman. Puis, le soir, ils portaient le présent au maître d’école qui, pas plus que le curé, n’était oublié. Sa position le mettant à même de rendre aux parents des services multiples, chacun, à sa manière et selon ses moyens, s’ingéniait à le payer de retour. La politique, par les divisions qu’elle a semées, ne le tenait pas caserné, et la neutralité scolaire n’était pas inventée.
Dans les domaines, la tonte des moutons occasionnait toujours un certain branle-bas parmi le personnel féminin surtout. À lui seul incombait le soin de la laine, celui de la vendre, de la distribuer aux domestiques qui jamais ne se louaient sans se retenir la livre de laine et la paire de sabots traditionnelles ; filer la part réservée était, pour les veillées d’hiver, une de ses principales occupations.
Les personnes aisées avaient leurs fileuses attitrées : fileuses de chanvre, fileuses de laine, toutes pauvres vieilles heureuses de tirer de ce travail quelque menu profit. Elles ne se syndiquaient pas.
La journée finie, les brebis, qui en avaient été l’unique occupation, faisaient encore au repas les frais de l’entremets, la caillette, et on la mangeait gaiement.
Tout l’hiver, les granges résonnaient du bruit cadencé des fléaux. Chaque propriétaire avait son équipe plus ou moins nombreuse, et presque toujours la même qui, l’un après l’autre, suivait ses domaines, ses locateries, battant les récoltes avec les métayers, faisant aussi les gluis indispensables aux toitures presque toutes de chaume.





























