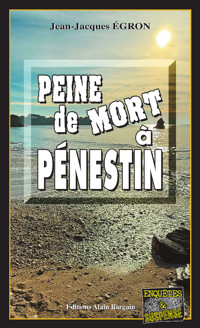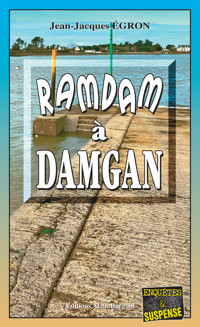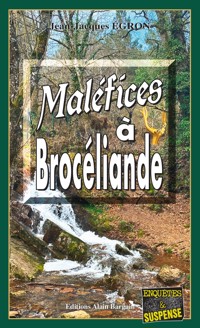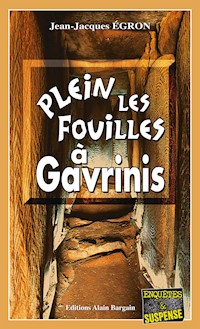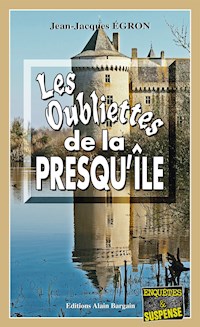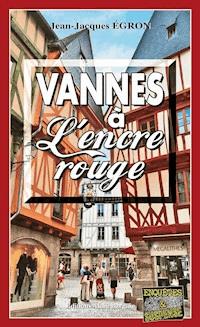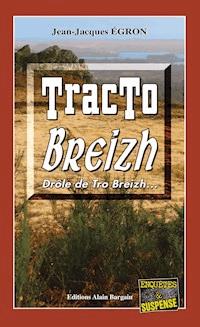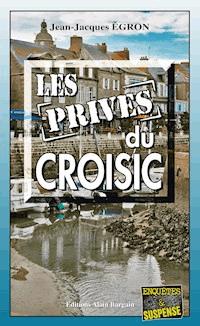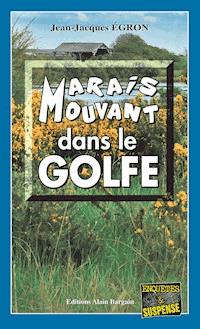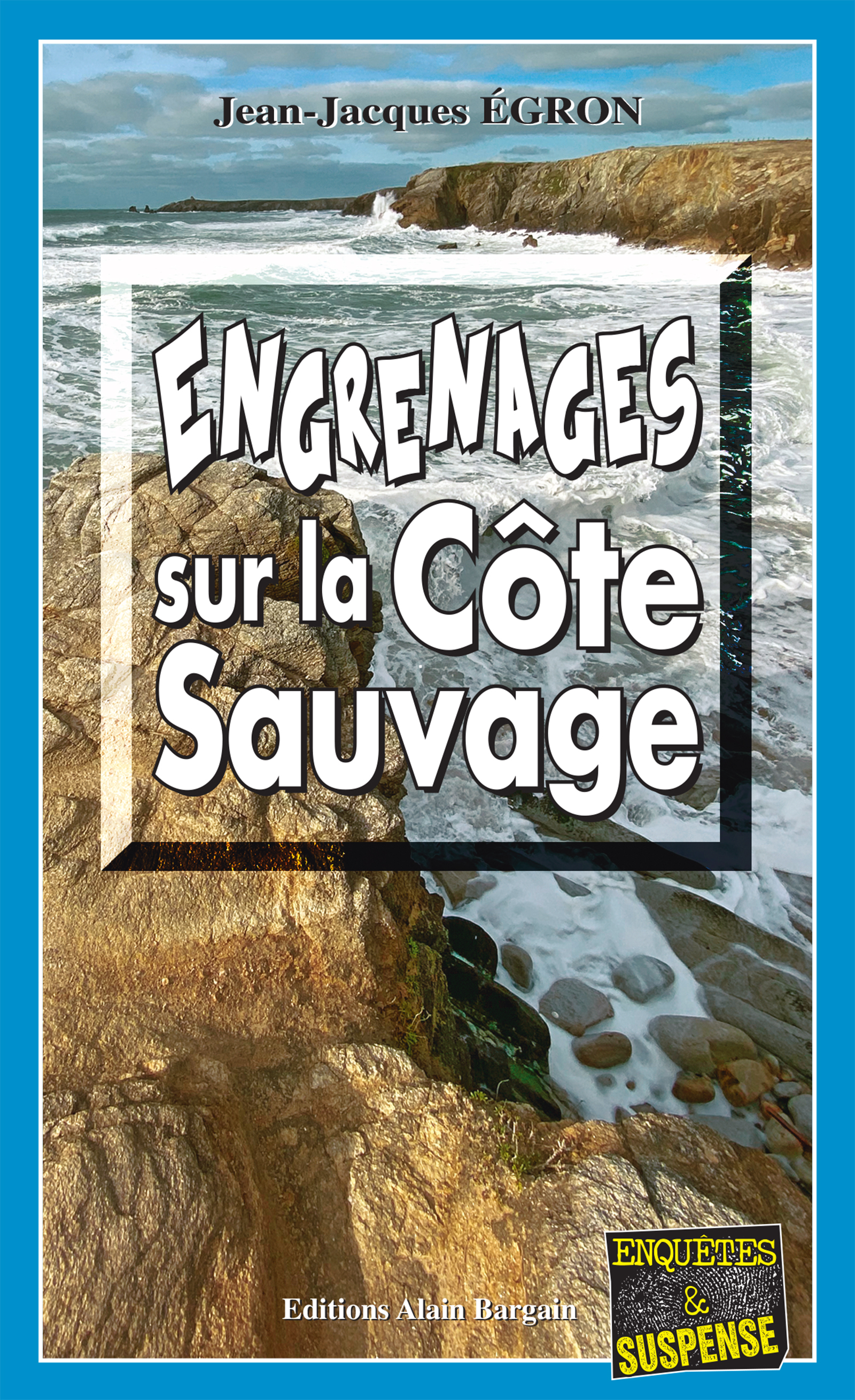
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes du commandant Rosko
- Sprache: Französisch
Victime ou coupable ? Le commandant Rosko devra découvrir laquelle de ces deux blouses convient à Magalie Marchal.
Johnny Rosko a du mal à imaginer comment l’achat d’une petite robe noire à bretelles peut entraîner son acheteuse dans une histoire criminelle. Magalie Marchal n’aurait jamais dû emprunter le Tire-Bouchon, ce fameux petit train estival qui relie Auray à Quiberon. C’est à partir de ce moment que ses ennuis vont commencer, mais est-elle la victime d’une machination redoutable ou une meurtrière aguerrie ? La Côte sauvage, Auray, Quiberon… C’est dans ces lieux magiques que Rosko et son équipe vont s’atteler à résoudre une enquête des plus énigmatiques.
Des évènements sanglants et des énigmes : voilà ce qu'attend le commandant Rosko sur le chemin entre Auray et Quiberon, dans cette sixième enquête.
EXTRAIT
La scène de crime, en ce début d’été, se situait dans un quartier de Quiberon, dans une villa cossue des années 30. Celle-ci était entourée d’un parc de plusieurs hectares, aux essences centenaires dans lequel on découvrait au hasard des allées, de nombreuses statues d’époques et de styles différents. Un banc de pierre attendait d’éventuels visiteurs, emmitouflé dans une charmille taillée au cordeau. Le soleil donnait une touche de légèreté à l’endroit malgré le souvenir d’un événement sanglant.
La police scientifique, le médecin assermenté, et plusieurs membres de la gendarmerie de Quiberon ainsi que de celle d’Auray, avaient officié. La cuisinière et femme à tout faire, Anthuse Ly, avait donné l’alerte après avoir découvert son patron, Jules Cordat, gisant sur le sol de son bureau. Le toubib avait constaté le décès, vraisemblablement provoqué par un seul coup porté dans la région du cœur. L’arme supposée du crime était un coupe-papier retrouvé près du cadavre. Le corps se trouvait sur le dos, baignant dans une mare de sang. La mort était survenue entre 16 heures et 18 heures en cette fin juin.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Paris,
Jean-Jacques Egron a passé son enfance dans le Morbihan. Après des études littéraires, il exerce diverses professions ; il est désormais retraité sur la presqu’île de Rhuys. Il a déjà publié douze romans policiers, Engrenages sur la Côte sauvage est son septième titre aux Éditions Alain Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
– À Josiane et à Carole pour leur relecture critique.
– À Bertrand pour ses conseils avisés.
I
La scène de crime, en ce début d’été, se situait dans un quartier de Quiberon, dans une villa cossue des années 30. Celle-ci était entourée d’un parc de plusieurs hectares, aux essences centenaires dans lequel on découvrait au hasard des allées, de nombreuses statues d’époques et de styles différents. Un banc de pierre attendait d’éventuels visiteurs, emmitouflé dans une charmille taillée au cordeau. Le soleil donnait une touche de légèreté à l’endroit malgré le souvenir d’un événement sanglant.
La police scientifique, le médecin assermenté, et plusieurs membres de la gendarmerie de Quiberon ainsi que de celle d’Auray, avaient officié. La cuisinière et femme à tout faire, Anthuse Ly, avait donné l’alerte après avoir découvert son patron, Jules Cordat, gisant sur le sol de son bureau. Le toubib avait constaté le décès, vraisemblablement provoqué par un seul coup porté dans la région du cœur. L’arme supposée du crime était un coupe-papier retrouvé près du cadavre. Le corps se trouvait sur le dos, baignant dans une mare de sang. La mort était survenue entre 16 heures et 18 heures en cette fin juin.
Tous les prélèvements et analyses avaient été effectués ; le ou les coupables avaient visiblement pris leurs précautions, puisqu’il restait peu de traces. Les premiers examens de la scientifique n’avaient révélé qu’une empreinte digitale exploitable sur le bureau du mort, mais elle n’avait pas matché.
Devant le cadavre, la cuisinière et bonne à tout faire, avait trouvé une femme – Magalie Marchal – en état de sidération. Elle était d’une parfaite rigidité et d’une pâleur extrême. Anthuse Ly avait tenté de lui parler, sans succès. Elle lui avait présenté une chaise, l’avait obligée à s’asseoir et était allée lui chercher un verre d’eau. Les policiers arrivés sur place l’avaient trouvée dans cette position et dans cet état. Il s’agissait d’une belle trentenaire, le teint hâlé des Bretons du bord de mer. Elle était vêtue d’une petite robe noire à bretelles très seyante.
*
Le commandant Rosko, de la police de Vannes, avait été appelé à la rescousse par le capitaine Corentin Galby, flic pur-beur ou beur pur-flic. Ce dernier lissa sa moustache qu’il entretenait comme un joyau de la couronne. Il venait de “lever” une affaire peu banale et très rare sur ses terres. Il se félicitait, en effet, que la petite ville d’Auray dans laquelle il officiait puisque par ailleurs il habitait à Carnac, ne fasse pas habituellement la une des journaux nationaux pour des faits divers sanglants. Dès les premiers moments de l’enquête, il avait dû faire face à un grave problème de déplacement : il s’était cassé la jambe et était contraint de rester chez lui.
— Pour ne pas abuser Commandant, vous serez mes yeux, ma langue et mes jambes, je ne pourrais être qu’oreille attentive à vos rapports.
— Je ferai de mon mieux mon vieux et je vous tiendrai régulièrement informé de l’avancée de cette enquête qui s’annonce passionnante, mais compliquée dans sa résolution.
Rosko détailla le physique du capitaine : grand, costaud, en costard la plupart du temps, des yeux verts de chat, une gueule, une dégaine. « Un beau mec, disaient les nanas en général, elles en mangeraient à l’occasion. » Le commandant avait glané quelques infos concernant l’Alréen qui se définissait lui-même comme un beur demi-celte. Issu d’un géniteur marocain et d’une mère bretonne de Concarneau, on imagine le résultat du mélange : explosif ! « Maman s’était faite embrochée dans une méchoui-party, puis le mec s’était barré, sans doute retourné au pays. Heureusement Maurice Galby qui passait par là, prit la dame et ce qu’il y avait dedans sans rien demander d’autre à personne. » Au bout du compte, Corentin possédait une tête dure de menhir, tel ceux des alignements de Carnac. Le flic y possède d’ailleurs une longère restaurée flanquée des éternels hortensias aux diverses nuances du bleu le plus pur au rouge le plus vif, en passant par le rose ou le violet.
Il avait fait appel à Johnny Rosko – en accord avec la hiérarchie – car la renommée du Vannetais était connue dans toute la Bretagne pour ses sens acérés, sa finesse et sa connaissance de l’âme humaine. Tous ces atouts et son professionnalisme lui avaient permis de résoudre de nombreuses affaires. C’était lui aussi un Breton pur-jus et la confrontation des deux “fortes têtes” ne manquerait pas de constituer un mélange détonant, malgré l’état de convalescence de l’un d’eux.
Le capitaine était l’antithèse du commandant. Pour le premier, à part son boulot qui lui mangeait tout son temps, le sexe, la bibine et les clopes – dans le désordre – c’était un amateur éclairé de la gastronomie bretonne. Il adorait – dans le désordre aussi – : le kouign amann*, le kig-ha-farz**, le far, l’andouille de Guémené, le pâté Hénaff, le gochtial***, les bières à l’eau de mer, les palets et si on veut être logique, les petits-beurre nantais, le cinquième département breton ! Sans oublier naturellement les crêpes et les galettes au goût inégalé de par le monde. Le second était la sobriété même et ne buvait jamais une goutte d’alcool, il avait commis suffisamment d’excès dans sa jeunesse et les conneries qui vont avec. Il n’abusait pas des femmes, vivait en éternel célibataire et pour l’instant sa seule relation suivie était son chat Tigrou, et il avait arrêté de fumer. Une légère claudication due à un accident de piscine entravait ses mouvements et il se comparait de fait à son idole chantante : Grand Corps Malade. Son deuxième modèle n’était pas moins que Talleyrand dit “le diable boiteux”, à qui il empruntait son franc-parler et son acuité dans la connaissance du genre humain.
Galby venait d’accueillir un nouvel élément dans son équipe et il s’empressa de raconter son arrivée à Rosko. Il n’espérait pas un jeune dandy avec des dents prêtes à rayer le parquet et il fut comblé en tous points. Le jeune lieutenant se tenait là, tout mignon façon Henri III, sur le quai de la gare d’Auray ; une petite lettre dans l’alphabet ou alors un point-virgule dans un texte non dégrossi.
— Ne me dites rien, vous êtes Maxime Recours…
— Et vous, le célèbre Corentin Galby, dont on m’a tant parlé.
— Foin de politesses entre nous, appelle-moi Corentin et tutoie-moi !
— Bien, chef !
Qu’on lui donne ainsi du chef fit sourire Galby. Il bomba le torse.
— Tu as fait un bon voyage, mon gars ?
— Un peu monotone…
Il arrivait tout droit de la région parisienne et Corentin se demandait ce qu’il allait lui donner à faire, vu l’oisiveté qui régnait en cette fin juin – avant que ne lui tombe dessus l’affaire qui allait occuper l’équipe un bon bout de temps. Le nouvel arrivant avisa le drapeau breton : le Gwen ha Du. Corentin lui expliqua l’origine des neuf bandes noires et blanches. Les blanches représentent les pays bretonnants de la Basse-Bretagne : Léon, Trégor, Cornouaille, Vannetais. Quant aux noires, ce sont les pays bretons gallos de la Haute-Bretagne : Rennais, Nantais, Dolois, Malouin, Penthièvre.
— Tu vas découvrir un pays fier, avec une identité forte et prononcée, qui ne lâche rien quand son honneur est en jeu.
Il lui parla de la devise bretonne : « Plutôt la mort que la souillure » et Maxime, dit Max, se demanda s’il n’avait pas fait une erreur d’aiguillage dans sa mutation, ces gars-là semblaient tellement habités de leur “pays”, qu’il se demandait quel degré de tolérance ils avaient envers un étranger.
— Le temps que tu te retournes mon gars, tu vas habiter chez moi à Carnac. Mais avant, tu vas découvrir “L’évêché”.
Il lui expliqua qu’avait été créé un GIR**** afin que travaillent ensemble police et gendarmerie.
— Nous dépendons de Vannes, mais nous sommes hébergés dans les locaux de la gendarmerie d’Auray.
Les deux hommes avaient passé la journée ensemble et Corentin avait fait découvrir à Max des petits lieux sympas, notamment le port de Saint-Goustan qui l’enchanta particulièrement. Le capitaine avait un langage assez cru, mais perçait sous l’aspect bourru du personnage, un homme attentionné et relativement chaleureux. Max revint peu à peu de son premier jugement.
***
En quelques termes, Corentin Galby expliqua à Johnny Rosko l’affaire qu’on lui avait confiée et que lui-même suivrait de loin : Elle, Magalie Marchal, 32 ans, bientôt 33, était de taille moyenne et avait un visage oblong percé de deux billes aux irisations violettes. Séparée de Daniel depuis 7 mois avec qui elle était en conflit pour la garde de Pauline, leur fille de 8 ans. Elle ne pouvait se voir, ni en peinture, ni en photo. Ça lui était douloureux, car elle se regardait constamment à travers les verres grossissants de l’intransigeance physique. Ce n’était pourtant pas l’image qu’on lui renvoyait car les hommes la trouvaient particulièrement séduisante. Sans indulgence aucune pour sa silhouette, elle évitait de se regarder dans les miroirs ! Son reflet dans les vitrines, les vitres des autos et surtout dans l’iris des autres l’exaspérait au plus haut point !
« L’iris des autres est redoutable quand il renvoie notre image sans prendre la moindre précaution. » Elle n’hésitait pas à dire que : « si elle se rencontrait dans une rue sombre, elle se ferait peur… » De plus, elle se trouvait trop grosse et avait suivi un nombre infini de régimes. Régine, sa copine, lui disait : « Arrête avec ça, tu vas perdre un os… »
Paradoxalement et peut-être pour conjurer le sort, Magalie avait rêvé d’être une actrice de cinéma depuis son plus jeune âge. Elle avait participé à un tas de castings… dans sa tête. Mais à chaque fois, elle était trop ceci, pas assez cela et le rôle lui échappait… un peu comme sa vie, sa famille, ses amis, ses amours…
Ses parents étaient des gens sans histoires, au propre comme au figuré. Ils ne lui avaient rien apporté, rien enlevé non plus si l’on veut être juste, des gens sans grande importance, en toute objectivité. Ils étaient là, potiches dans un coin de son cœur et ils n’en bougeraient pas jusqu’à la mort de leur fille. Sa famille se résumait à eux deux, à son frère Xavier – en premier lieu – et à tante Adélaïde qui avait son franc-parler.
La tante : “nature” et naturelle, tels étaient les deux adjectifs qui la caractérisaient. C’est-à-dire qu’elle se montrait la plupart du temps insupportable aux yeux de la parentèle. On ne la fréquentait que contraint et forcé, contrairement à Magalie qui l’appréciait particulièrement.
Son frère cadet, Xavier, habitait la maison voisine ; ils étaient donc très proches géographiquement, mais aussi très soudés sentimentalement. Magalie avait toujours protégé ce frêle gamin à la constitution chétive et à l’état maladif. Elle lui avait servi de seconde mère et leurs rapports étaient tellement fusionnels que certaines mauvaises langues trouvaient cela louche. Xavier vouait une véritable vénération à sa sœur qui, parfois, le trouvait encombrant, mais elle cédait à tous ses caprices.
Daniel, le mari n’avait jamais considéré cette proximité d’un très bon œil, cela – plus tout le reste – avait expliqué en partie leur séparation.
Passons vite sur Daniel, son ex, avocat de son métier, avec qui elle avait vécu de belles histoires, mais dont la dernière s’était décollée, tel un papier peint usé par une colle trop ancienne. Il était incapable de prendre la moindre décision, tout choix lui pesait et il s’en remettait à Magalie. Au début, elle avait trouvé confortable de décider de tout mais au fil du temps, elle s’était lassée. Elle aurait voulu un “homme”, pas un enfant qu’elle avait déjà.
Car entre les deux mâles, il y avait son soleil, son astre de nuit, sa poupée, sa princesse. Pauline lui avait tout donné sauf des regrets et, dès sa conception, elle l’avait su. Dès qu’elle l’avait sue dans son ventre, son existence avait pris une autre direction. Elle disait souvent : « Si j’avais su, je l’aurais eue plus tôt… » La petite représentait son refuge en cas de gros temps, son médicament lorsqu’elle allait mal.
Auray, c’était sa ville, elle y avait toujours habité. Ses parents lui avaient légué une maison, la résidence “Les Acacias”, dans la venelle du Foresto. Elle aurait pu se rendre les yeux fermés jusqu’au port de Saint-Goustan – le quartier placé sous la protection du saint patron des marins et des pêcheurs. Elle adore les deux clochers : celui de l’église Saint-Sauveur et celui de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes où elle a maintes fois arpenté la promenade de Stanguy, admirant le Loch ou la rivière du Trauray qui se transforme en rivière d’Auray. L’aménagement du port date de 1641. On agença la place Saint-Sauveur et, vers le sud, l’actuel quai Franklin. La ville, alors, importait du vin, du sel, du cuir, du fer et de l’acier. Elle exportait des céréales, du beurre, de la viande, du poisson, du drap et de la toile. Au XVIIIe siècle, c’était le premier port morbihannais pour la construction navale. Magalie en a souvent découvert des vestiges.
Mais ce jour-là, elle avait décidé de faire des emplettes à Vannes, ville qu’elle appréciait également, pour d’autres raisons. Ses pas l’avaient conduite non loin de la cathédrale, puis dans les rues piétonnes où elle s’extasia encore devant les maisons à colombage aussi nombreuses qu’à Auray et dont certaines avaient refait peau neuve autour de la célèbre sculpture en bois de Vannes et sa femme. Elle était passée par la porte Prison, avait emprunté la rue des Chanoines, la place Henri IV – l’une des plus belles – avait croisé le musée de La Cohue, pour aboutir dans la rue des Halles. Elle pouvait penser à son aise, loin des autres, « ceux qui t’empêchent d’être dans tes rêves car ils sont trop bruyants ou trop curieux. » Ses pensées lointaines l’avaient emportée là où les hommes n’avaient pas droit de cité, trop déçue la Magalie d’alors !
Elle cueillit quelques bribes de conversation :
« Alors Christophe, dépêche-toi, on va être en retard… Presse-toi Brigitte… Viens mon petit cœur, allons cueillir des lambeaux d’aube… Jeannette, arrête de te regarder dans les vitrines… Tu m’attends, je vais faire quelques achats… Viens, on va acheter un cadeau pour les gamins… Tu es sûre d’avoir rentré le chien ? »
Voleuse de mots, voilà ce qui lui vint, en s’immisçant entre ce Christophe, cette Brigitte ou cette Jeannette, dont elle ignorait l’existence quelques minutes avant. Ça la remit à sa toute petite place d’humaine parmi les 7 milliards et quelques, souvent placée entre le marteau et l’enclume. Alors qu’elle était non loin de la place des Lices au nom évocateur – amours, délices et orgues – Magalie faillit se prendre un arbre et entrer tête la première en contact avec la dure écorce. Elle venait de voir quelque chose qui pouvait lui changer la vie.
Elle la vit là, sur un mannequin, magnifique, magique, unique, la toisant, offerte à son envie. Pour les autres, elle ne payait certainement pas de mine, peut-être même ne l’auraient-ils pas remarquée. Mais à Magalie, elle faisait de l’œil, elle l’attirait de son index, si l’on peut dire… Elle s’inscrivait dans ses inévitables, ses obligatoires, et lui devint de suite indispensable. Il n’y avait pas à revenir là-dessus. Elle n’y revint pas.
Elle entra dans le magasin, timidement, comme si elle craignait de briser la vitrine. Ou alors son rêve. Et elle demeura ainsi de longues minutes, dans une posture hiératique à la regarder, mais cette fois de l’autre côté du miroir.
« Je crois n’avoir jamais ressenti un tel impératif. Je devais la toucher, la humer, puis la passer… enfin… »
La petite robe noire à bretelles.
Elle pensa au parfum de Guerlain dont la pub passait à la télé. « Le noir maigrit, dit-on. Ce vêtement me devenait vital, comme l’air à mes poumons. » Et peut-être, aussi, cacherait-elle une partie de ce corps qu’elle n’aimait pas, ou du moins lui donnerait-elle meilleure allure.
La vendeuse – c’était peut-être la patronne – avait tenté un mouvement vers Magalie, mais elle s’était vite aperçue qu’il ne fallait pas la déranger. C’était une histoire entre la femme et la robe. Cette robe prenait vie devant elle. Elle dansait, l’appelait de tous ses vœux : « Revêts-moi, je veux épouser ton corps, me réchauffer à ton être, je veux aller sur toi, je veux aller chez toi, nous sommes faites l’une pour l’autre ! » Magalie ne pouvait pas détacher les yeux du vêtement. C’était une évidence. Et tous les autres autour, n’étaient que de simples spectateurs. D’ailleurs Magalie, tout à sa fascination, ne voyait d’eux qu’un long ruban de silhouettes colorées, elle n’entendait d’eux que quelques bribes de phrases, des lambeaux de mots…
— Les cabines d’essayage sont là-bas, dans le fond.
Magalie ne s’était même pas rendu compte qu’elle avait saisi la robe, qu’elle la froissait, serrée tout contre elle. Elle la porta contre sa joue, contre son ventre, contre son sexe. Elle était si douce. Un impératif désormais : « Il me la faut ! » La petite robe noire à bretelles était à elle. Personne n’avait plus le droit d’elle. Et tout de suite, elle émit un regret : pourquoi ne pas l’avoir rencontrée plus tôt ? N’étaient-ce pas un oubli contre nature, un vide immense dans sa vie qu’elle aurait pu changer, un manque impardonnable à son existence ?
Elle se dirigea, tel un automate, vers la cabine d’essayage, au fond à droite. Il lui fallait éviter un portant de vêtements ou tout objet entravant son passage.
Elle se dévêtit posément, ne gardant que soutien-gorge et slip en satin blanc à dentelles. Elle avait jeté négligemment sur le sol ses vêtements d’avant, son ancienne peau, ceux-ci n’existaient déjà plus.
Elle la passa.
Elle était légère à son corps, elle lui allait parfaitement.
— Elle vous va comme un gant…
Elle ne s’était même pas aperçue qu’elle était ressortie de la cabine et se tenait devant la vendeuse. Magalie n’avait pas besoin de son approbation, son image reflétée dans la glace était bien suffisante. Elle et la robe étaient déjà en harmonie toutes les deux. Ensemble pour le reste de la vie – « Qui se ressemble s’ensemble », inventa-t-elle comme aphorisme.
Elle la plia délicatement, se revêtit d’avant et se rendit à la caisse.
Et là… la dure réalité lui fit perdre une partie de ses illusions. En demandant « je vous dois combien ? » elle fouillait dans son sac à la recherche de son portefeuille, mais elle eut beau le mettre sens dessus dessous, elle ne disposait d’aucun moyen de paiement. La panique s’empara d’elle, elle jeta le contenu de ce foutu sac – fourre-tout – en vrac sur le comptoir. Soit elle avait oublié son argent soit on lui avait volé son portefeuille. Elle revit les dernières heures, refit mentalement les trajets, ne trouva rien de probant dans ce qu’elle avait fait. Elle ne se voyait pas demander de faire crédit à la gérante. Elle ne pouvait pas non plus sortir sans la petite robe noire à bretelles.
La vendeuse, arrivée à la rescousse, essaya de la rassurer, « mais de quoi je me mêle ? » Magalie allait sortir de la boutique et courir à toutes jambes en laissant ses anciens habits en échange.
Elle allait mourir là, devant le comptoir, de désespoir. Même quand Daniel était parti, lorsqu’il l’avait quittée, il avait fait moins sombre, ça lui avait moins serré le cœur. Elle n’était pas loin de faire un malaise.
Et…
*
Alors qu’elle gisait au fond d’un trou noir sans possibilité d’échappatoire, un homme s’avança, surgi de nulle part. Il était vêtu d’un costume sombre, arborait un chapeau à larges bords, son cou était ceint d’une écharpe rouge à la Barbier, le journaliste. Il devait avoir entre 75 et 80 ans, mais il portait encore beau.
— Laissez, dit-il en sortant un porte-documents de sa pochette, je vous avance l’argent, vous me rembourserez plus tard, quand vous aurez recouvré vos esprits. Vous ne pouvez partir sans cette robe, elle vous va à ravir ; j’ai fait le voyeur du coin de l’œil, c’est pardonnable à mon âge, vous êtes faites l’une pour l’autre…
Magalie se sentait prise entre deux feux. D’un côté, elle voulait fuir cet homme, car elle se voyait déjà redevable. Elle détestait être redevable, surtout envers les hommes, elle avait déjà donné… Elle ne voulait être sous leur coupe ni avoir besoin d’eux. D’un autre côté, elle tenait déjà tellement à cette robe, qu’elle aurait été capable de faire quasiment n’importe quoi pour enlever le morceau. Donner son corps ? Il ne fallait tout de même pas exagérer…
Elle réussit à murmurer :
— Non, je…
Mais il avait déjà payé. Il lui avait tendu une carte de visite, elle avait juste eu le temps de lui donner la sienne avant qu’il ne sorte de la boutique. Elle essaya de le suivre du regard pour le remercier mais il s’était égayé dans la foule d’une rue adjacente. La situation était peu banale, un mec inconnu qui donne à une femme sans rien lui demander en retour. Magalie songea qu’il l’attendait certainement, adossé à l’un des arbres proches pour lui demander de coucher avec elle. C’était dans l’ordre des choses.
La patronne avait emballé la robe, Magalie vérifia qu’elle était bien là, caressant le tissu de ses doigts fins. La commerçante n’avait pas manqué de lui décocher un sourire pincé, dans le genre : « Un bien joli cadeau, il est vrai que si vous aviez été un laideron, il ne se serait vraisemblablement pas montré aussi empressé… »
Elle sortit et se mit à la recherche de son bienfaiteur, mais elle dut se rendre à l’évidence, il avait disparu sans demander son reste, son pourboire, son gage, son lot. Ce ne fut que quelques heures plus tard qu’elle lut la carte de visite : « Jules Cordat – 30, rue du Pré-aux-Clercs – 56170 Quiberon. » Et un numéro de téléphone.
*Kouign amann : spécialité culinaire de Douarnenez (kouign : gâteau - amann : beurre) en breton.
**Kig-ha-farz : spécialité culinaire du Léon (kig : viande - ha : et - farz : farine) en breton.
***Gochtial (ou gwestal) signifie gâteau en breton.
****GIR : groupe interministériel de recherches.
II
De retour chez elle, Magalie Marchal s’empressa de passer la petite robe noire à bretelles. Complètement nue pour mieux l’apprécier, elle lui glissa, légère, sur la peau. Elle se sentait encore mieux dans son habitat. Elle y était bien, quiète et c’est comme si la robe avait toujours été là, près d’elle, depuis sa naissance. Mais une ombre s’invita de suite au tableau. C’était à cet homme qu’elle la devait… tant qu’elle n’aurait pas remboursé, elle ne la considérerait pas vraiment à elle. Sans lui, elle n’aurait jamais pu la porter, car elle n’aurait pas fait la démarche de revenir au magasin, etc.
Elle le traita de salaud intérieurement, « tu m’as bien baisée, maintenant je te suis redevable pour le restant de ma vie si je n’acquitte pas rapidement ma dette. Je te hais, je te déteste, je te maudis ! » Elle le voua aux Gémonies.
Elle tourna et retourna ce problème pendant une semaine. Elle ne pouvait penser qu’à ça. Elle avait accroché sa robe à un cintre, car elle ne se sentait pas encore le droit de la porter – tant qu’elle n’aurait pas réglé sa dette. Bien qu’elle soit retournée travailler le mardi, cela lui libéra très peu l’esprit. D’habitude, elle se consacrait exclusivement à ses clientes – elle était couturière dans un atelier important – mais dans ce nouveau contexte, elle pensait peu à son travail et beaucoup à son débiteur. Sa patronne, Sidonie Laponte, fut obligée de la recadrer plusieurs fois au sujet d’ourlets mal finis ou de prises de mesures approximatives, ce qui n’arrivait que rarement.
— Méfiez-vous, ma petite, je ne tiens pas une entreprise de bienfaisance, il va falloir vous ressaisir.
Et Magalie, invariablement, lui assurait que ce n’était qu’un léger passage à vide, le temps de résoudre certains problèmes et tout rentrerait dans l’ordre.
— Je l’espère pour vous !
Il s’agissait d’une femme autoritaire, dont l’enseigne était très connue à Auray, et qui passait pour quelqu’un de rigoureux et d’exigeant. C’était une célibataire endurcie qu’aucun mâle n’avait souhaité garder, elle de son côté, faisant peu d’effort pour qu’ils restent. Magalie Marchal appréciait son professionnalisme, d’autre part c’était quelqu’un de juste et ses remarques l’avaient d’autant plus touchée.
Heureusement le soir à la maison, elle retrouvait Xavier, son frère et surtout Pauline ; la petite fille la sollicitait tellement qu’elle oubliait la robe pour un temps, jusqu’au moment où elle allait se coucher… Une fois, elle l’avait reléguée dans un cagibi, mais c’était encore pire, elle préférait l’avoir à l’œil. Et elle se remémorait ce jour qui avait été d’un bonheur total et qui devenait un véritable cauchemar. L’objet de ses sentiments devenait un sujet encombrant et il lui arrivait souvent de regretter d’être entrée dans ce foutu magasin et d’avoir convoité cette foutue robe noire.
Elle en parla à Xavier, son frère cadet, qui la rassura, le vieux était certainement plein aux as et sans doute n’attendait-il pas après cette somme ridicule pour lui de 350 euros. Magalie avait passé son temps à protéger cet enfant chétif, souffre-douleur des plus grands. Il ne parlait pas de ses souffrances à ses parents, mais uniquement à elle, sa sœur.
Même une fois adulte, le frère n’avait pu quitter sa Magalie qui le conseillait sur ses rencontres. Il avait été marié avec Mariette et ça n’avait pas duré – sa sœur lui avait pourtant déconseillé cette grande bringue aguicheuse qui n’était que dans le paraître – depuis il était resté célibataire, entièrement dévoué à sa sœur et ce n’était pas les aventures d’un soir qui y avaient changé quelque chose.
Xavier agaçait souvent sa sœur, incapable de prendre une décision quant à son avenir, mais elle ne se rendait pas compte qu’elle était pour lui une véritable castratrice.
Les deux êtres auraient dû s’éloigner pour mener deux vies parallèles, mais aucun ne parvenait à s’y résoudre.
***
La semaine suivante, le mardi précisément, ce jour resterait gravé à jamais dans sa mémoire, n’y tenant plus… Magalie Marchal avait composé le numéro sur la carte de visite. Elle avait auparavant fait des recherches concernant son bienfaiteur sur Internet et avait trouvé un article sur Wikipédia où il était fait mention du bonhomme, en tant que marchand de tableaux, il avait eu, en son temps, une certaine renommée qu’il conservait même pendant sa retraite. Il semblait désormais couler des jours heureux.
Le téléphone avait grésillé. Quelqu’un avait décroché. Elle avait entendu une respiration.
« — C’est moi… La femme à la robe. La petite robe noire à bretelles… Vous avez payé à ma place… Je vous dois de l’argent… Non, ne protestez pas, je suis votre obligée… Il est important pour moi de vous le rendre. Vous préférez que je le fasse en chèque ou en espèces ? »
La personne au bout du fil ne répondait toujours pas. Magalie le maudit de rester ainsi silencieux. « J’ai l’air de “deux” imbéciles, ce ne sont pas des choses à faire. Ce ne sont pas des choses à “me” faire. » Elle ne sut pas pourquoi une angoisse inexplicable vint l’envahir alors.
Au bout d’un temps qui lui parut une éternité, l’homme finit par lui fixer un rendez-vous la semaine suivante… Le jour, l’heure, le lieu – naturellement le même que celui inscrit sur la carte de visite – dans un quartier de Quiberon.
Dès lors, cela devenait impératif pour Magalie, aussi impératif que l’achat de la robe, de rembourser son créancier. C’était une condition sine qua non pour pouvoir continuer à vivre.
Elle essaya de se rappeler l’apparence du vieil homme, mais rien ne vint de conséquent, seulement quelques détails : des cheveux grisonnants et une mise vieille France. Après tout, il n’était qu’un vecteur qui lui avait offert une robe, ce qu’elle regrettait finalement.
Elle aurait dû trouver une autre solution, par exemple appeler son frère à l’aide ou demander à la commerçante de lui faire crédit – elle aurait pu laisser un gage – ou alors, et c’était la meilleure : ne pas acheter ce vêtement. La robe lui aurait composé un très beau rêve, une possibilité lointaine, elle n’aurait pas dû se laisser aller à cet élan destructeur.