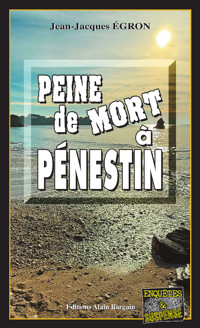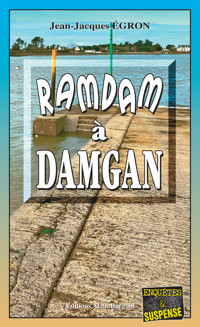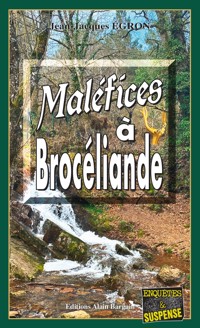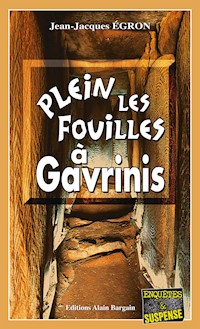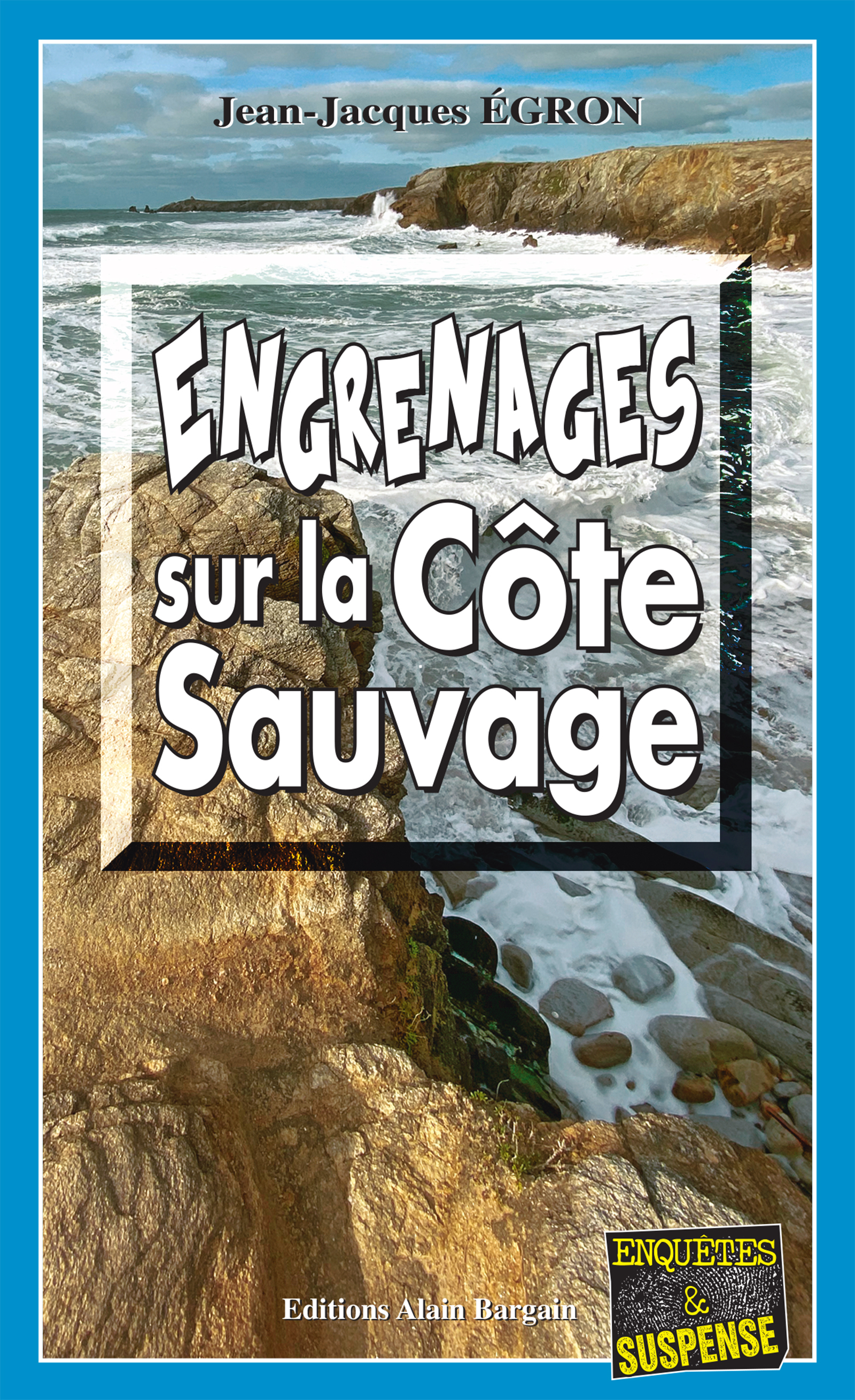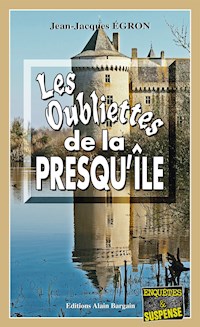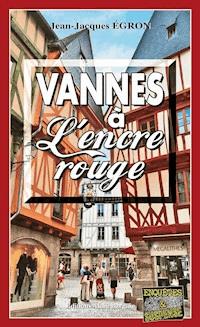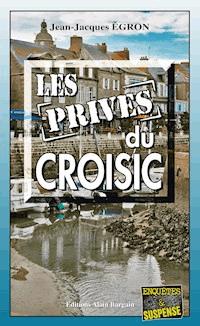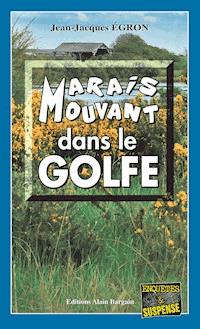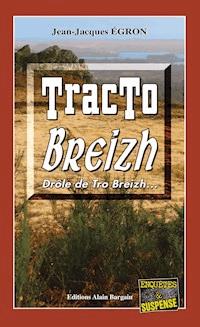
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Rosko
- Sprache: Französisch
Les enquêtes du commandant Rosko le mènent à un pélerinage aussi inattendu que morbide
Jean Landrezac, un paysan à la retraite, a promis à sa femme Francine de faire le Tro Breizh, afin qu’elle ne brûle pas en enfer. Il commence alors, à partir de La Vraie-Croix, son tour de Bretagne en… tracteur. Il va se rendre sur les traces des sept saints fondateurs en passant par Vannes, Quimper, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol-de-Bretagne. Et toutes les villes intermédiaires.
La folle équipée sur Bienvenu, le Massey Fergusson, se déroule en compagnie de Francine (dans son cadre) et du chien Camembert, et amène le paysan à bien des rencontres des plus insolites, voire même « miraculeuses »…
Mais à chaque étape, on découvre un cadavre. Jean Landrezac est-il coupable ou victime d’une machination ? Géraldine Buisson, une détective privée, et Johnny Rosko, un commandant de police, tentent de percer ce mystère. Il leur faudra beaucoup de persévérance pour trouver le mystérieux assassin à la dent de herse…
Le premier tome des enquêtes du Commandant Rosko vous entrainera à la suite d'un duo atypique dans une intrigue policière palpitante !
EXTRAIT
Je commençais à prendre de l’âge, moi Jean Landrezac, dit Jeannot pour les intimes ; soixante-trois ans, ça vous amène tout droit à la retraite et courbé. Comme dans une côte, plus on approche du but, plus ça grimpe et il ne faut pas regarder vers le haut, car le plus dur reste à faire. Par contre, pour Francine, elle était arrivée plus vite que prévu au bout du chemin, elle a fait une chute du haut de ses soixante-cinq ans, dans les escaliers, ce n’est quand même pas de chance. De toute façon, elle y serait passée, parce qu’elle avait atteint un cancer et qu’elle n’avait pas pu s’en débarrasser. Cette sale bête s’accroche comme le coq à son clocher et on ne sait pas encore le faire descendre. C’est la vie, la mort. Son frangin, Daniel Chicoine, un pas marrant, m’en veut toujours. Il pense que c’est moi qui ai poussé sa sœur pour le grand saut, et il n’en démord pas.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Né à Paris,
Jean-Jacques Égron a passé son enfance dans le Morbihan. Après des études littéraires, il exerce diverses professions ; il est désormais retraité sur la presqu’île de Rhuys. Il a déjà publié cinq romans policiers,
Tracto Breizh est son second titre aux Éditions Alain Bargain.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce roman se déroule en 1979, dans l’ancien Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, désormais désaffecté. Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
— À Josiane BERNARD pour ses remarques de bon sens.
— À Bertrand DAVID pour ses conseils avisés.
Le Tro Breizh de Jean Landrezac
AVANT-PROPOS
Cet ouvrage ne décrit pas le Tro Breiz classique ni le Tro Breizh moderne, mais celui de Francine et de Jeannot qui l’effectuent comme bon leur semble, au gré des rencontres ou des paysages. Il faut donc se laisser porter par leur bon vouloir.
Je signale pour les puristes qu’il existe une association du Tro-Breiz officiel qui donne toutes les étapes, les marches, les manila vraie-croixations etc. et je vous invite à la mettre en regard. Les coordonnées :
Association “Les chemins du Tro Breiz” - BP 118 - 29250 Saint-Pol-de Léon - Tél. : 02 98 69 11 80 - email : [email protected]
Site : http://www.trobreiz.com/
I
Je commençais à prendre de l’âge, moi Jean Landrezac, dit Jeannot pour les intimes ; soixante-trois ans, ça vous amène tout droit à la retraite et courbé. Comme dans une côte, plus on approche du but, plus ça grimpe et il ne faut pas regarder vers le haut, car le plus dur reste à faire. Par contre, pour Francine, elle était arrivée plus vite que prévu au bout du chemin, elle a fait une chute du haut de ses soixante-cinq ans, dans les escaliers, ce n’est quand même pas de chance. De toute façon, elle y serait passée, parce qu’elle avait atteint un cancer et qu’elle n’avait pas pu s’en débarrasser. Cette sale bête s’accroche comme le coq à son clocher et on ne sait pas encore le faire descendre. C’est la vie, la mort. Son frangin, Daniel Chicoine, un pas marrant, m’en veut toujours. Il pense que c’est moi qui ai poussé sa sœur pour le grand saut, et il n’en démord pas.
J’habite une ferme, Le Minio, sur la commune de La Vraie-Croix. Je suis paysan ou fermier ou agriculteur ou laboureur, comme ça vous chante, quand je dis… je suis, c’est plutôt… j’étais, maintenant, je ne suis plus rien. Il me reste encore “quéques” bêtes pour faire mon beurre, parce que la retraite du paysan c’est mince comme une ficelle de lieuse. J’élève une chèvre, Francette, deux cochons, Napo et Léon, des poules et des lapins. Je ne parle pas du chien Camembert qui n’est pas une vraie bête, il va sur ses dix ans et il a eu bien du chagrin quand on a perdu Francine, faut le comprendre. Au beau temps, j’élevais des vaches laitières et les dernières étaient parties à l’abattoir.
Ce jour-là, j’étais au café “Chez Armand”, quand j’ai entendu deux “étrangers” qui parlaient entre eux. Normalement, on ne fait pas attention aux inconnus, vous savez ce que c’est : on est plus intéressé par la rigole qui déborde dans sa cour que par un tsunami au loin. Ce n’est pas que j’ai écouté leur conversation, mais on ne peut pas empêcher ses oreilles de traîner.
— J’ai fait le Tro Breizh à pied, avec un copain ; ne plus avoir les femmes sur le dos, tu parles d’une sinécure ! ils disaient comme ça… deux messieurs distingués avec des vestes à carreaux, des cravates de couleur et des pantalons blancs, un des deux était chauve et l’autre roux.
Ils ont continué à bavarder entre eux pendant des kilomètres, moi, pour une fois, j’étais seul à boire mon… mes muscadets, notre blanc breton, de chez les voisins des Pays de Loire. D’habitude, je suis avec Yvon qui n’est pas un fainéant pour lever le coude. Quand ils sont partis et qu’ils nous ont laissés entre nous, je suis allé voir le patron, il s’appelle Armand comme son bistrot, qui m’a expliqué la signification de leur discours.
Armand est gros et gras, avec du cholestérol partout pour boucher ses artères, il se nourrit avec nos verres et il en entend tellement qu’il en raconte au moins deux fois plus. Mais il ne faut pas lui en vouloir, il s’ennuie catastrophique derrière son comptoir. Il faut dire que sa femme, Mathilda, qui venait d’Espagne depuis des temps, s’en est allée au bras d’un client. Alors, depuis, il rumine des pensées sombres comme le derrière de la lune.
Armand m’a expliqué :
— Le Tro Breizh, Jeannot, c’est le Tour de Bretagne, un pèlerinage pour prier les sept saints fondateurs de notre pays, une boucle qui relie sept villes.
Et il m’a tout cité. Paraît que si t’es breton et que tu ne l’as pas fait de ton vivant, tu seras condamné dans l’au-delà, à avancer de la longueur de ton cercueil, une fois tous les sept ans, ce qui ne nous avance pas beaucoup. C’est à peu près pareil que celui de La Mecque pour les Musulmans.
À ce régime-là, la pauvre Francine, elle allait germer sur place et elle n’était pas près d’arriver au Paradis. En vrai, je ne crois pas aux bondieuseries, mais tout de même, on ne sait jamais. Elle se promenait toujours avec un crucifix ou un chapelet dans sa poche, pour se rapprocher du Paradis, alors il vaut mieux faire les choses comme il faut.
Francine passait tous ses dimanches dans l’église de notre village et elle en revenait à chaque fois, toute retournée comme mon champ de “La lande Bergero”, au temps de ma splendeur. Ce n’est pas qu’elle voyait le Bon Dieu, ça, ce n’est pas possible, sauf à Lourdes ou dans des coins comme ça et on ne s’appelle pas tous Bernadette, mais elle l’imaginait dans la loupiote rouge et ça lui faisait des frissonnements partout.
— Tâte mes poils, ils sont tout hérissés !
Moi, je venais la chercher en voiture et je la ramenais ici dans la chapelle d’Armand où j’avais suivi la messe en l’attendant et en prenant l’apéritif du dimanche, elle un grenache, moi un pastis, si elle était de bonne humeur ; sinon, on mangeait de la soupe à la grimace à la maison en rentrant direct.
Tout ce que m’a dit Armand, plus le film que j’ai vu à la “tévé”, où un vieux gars allait rejoindre son frère, au loin, sur une tondeuse, ça m’a donné envie de faire son affaire à Francine.
* * *
J’ai donc tout préparé en douce, je l’ai sortie avec son cadre où elle est en photo et j’y ai montré mon installation par la fenêtre.
— J’ai lavé le tracteur ! Il va t’emmener faire le Tro Breizh !
Je l’appelle Bienvenu, il est tout vert, de race Massey Fergusson.
— Et j’ai attelé la remorque bâchée derrière, comme ça, on pourra dormir la nuit sans avoir froid, toi et moi, sans oublier Camembert, même si tu ne l’aimais pas.
J’avais installé un réchaud à gaz, une table rivée au sol et quatre chaises pliantes, au cas où on aurait des invités, et puis un lit de camp que j’ai descendu du grenier. Sans oublier le ravitaillement.
J’allais lui faire voir du pays à Francine, parce que depuis qu’elle m’avait connu, elle n’avait guère fait que le tour de nos terres qui ne prend pas bien longtemps, si j’exagère un peu.
Je me suis dit : en faisant le Tro Breizh, je vais voir de quoi il retourne dans leur religion. À quoi ça sert et pourquoi ils y croient dur comme fer ? Peut-être au bout de la boucle, j’aurai des réponses…
Je suis parti début juin pour un bon mois. Je préférais ne pas avoir tous les touristes dans les pattes, parce qu’ils empêchent de bien voir, ils s’agglutinent avec leurs appareils photo et nous bousculent pour faire clic-clac au lieu de regarder avec leurs yeux.
II
Géraldine Buisson avait fait des études de droit, elle voulait devenir avocate, mais elle s’était aperçue très vite qu’elle ne pouvait défendre des assassins, c’était contraire à ses principes. Elle avait rencontré Mirta avec qui elle vivait depuis cinq ans. Cependant, à vingt-six ans, elle n’était pas encore fixée totalement sur ses tendances sexuelles, l’exemple qu’elle avait de ses parents ne la confortait ni dans un sens ni dans l’autre.
Ses parents avaient vécu côte à côte depuis sa naissance, mais sans passion, rigidifiés dans une sorte d’étiquette de morale et de convenance. Son père avait quitté sa mère à la cinquantaine pour vivre… avec un homme. Quand elle avait rencontré Mirta lors d’une éclipse de lune, un courant était passé.
Une association d’amateurs avait organisé pour cet événement, une séance d’observation. C’est en marchant toutes les deux, le nez en l’air, qu’elles s’étaient “télescopées” – jeu de mots qu’elles employèrent par la suite – Géraldine chutant lourdement sur le sol. Mirta était alors partie à rire de façon irrépressible, tandis qu’elle relevait l’accidentée. Remise sur pied, elle regarda sa “tamponneuse” de façon furibarde, ce qui eut pour effet d’augmenter encore le rire de l’autre. Géraldine, outrée, lui donna une claque. Le rire de Mirta cessa, mais elle avait affiché une telle moue sur son visage que ce fut Géraldine qui prit le relais en pouffant. Elles se retrouvèrent toutes les deux, un verre de champagne à la main et se confièrent dans une farandole de bulles et de magie météorologique. De ce jour, elles ne se quittèrent plus.
Le métier d’avocate ne lui disant rien, elle se rappela un stage qu’elle avait effectué chez un détective privé, Childebert Lucas, un noble sans quartier de noblesse, au langage fleuri et aux vêtements excentriques, qui lui avait communiqué sa passion. Elle travailla un an auprès de lui, apprit ce qu’il fallait pour s’en sortir dans ce métier et s’abîma les yeux en études parallèles. Puis elle monta sa propre agence. Ne pouvant se payer le luxe d’embaucher, elle s’entourait régulièrement de stagiaires et elle se dit qu’avec le dernier, elle avait touché le gros lot.
Conrad Turq était un étudiant d’une trentaine d’années qui cherchait encore sa voie. Il vivait chez papa maman et ce Tanguy avait tâté de petits boulots sans jamais se fixer à un patron.
Il avait trouvé la maîtresse de stage jolie et charmante, totalement en phase avec sa façon de penser, quand elle lui avait dit :
— Je ne pourrai jamais vous proposer un CDI. Il fuyait ce gros mot comme la peste, plutôt adepte de la flexisécurité à la mode ces derniers temps.
— Topons-là !
L’affaire fut conclue. Conrad Turq serait payé par Pôle emploi, tout le monde y trouvait son compte. C’était un personnage singulier à l’aspect lunaire, semblant tout droit sorti d’un album de BD.
Le cabinet de Géraldine Buisson atteignait difficilement l’équilibre, elle n’avait eu jusque-là à traiter que quelques affaires de divorces et de successions, à peine assez pour se tirer un salaire. Mirta apportait le complément, elle était pharmacienne.
Désireuse malgré tout de se libérer un jour du joug financier de son amie, elle avait écouté avec attention un grand dadais aux tempes grisonnantes qui parlait avec les mains en lui expliquant avec force gestes ce qu’il attendait d’elle.
— Je voudrais que vous suiviez quelqu’un…
— C’est mon métier.
— Toutefois, vous ne devez pas avoir souvent l’occasion de pister un assassin.
Géraldine Buisson ne montra pas son intérêt piqué au vif, elle joua les indifférentes. L’autre continua ses explications :
— J’ai un beau-frère, j’avais une sœur, elle est morte ou plutôt… il l’a tuée.
— Vous vous êtes trompé d’adresse… Voyez la police. Le poisson allait-il s’éloigner de l’hameçon ?
— Justement, j’ai contacté les flics, mais ils ne disposent que d’une main courante ; une enquête administrative des plus légères a conclu à un accident ou à un suicide.
— Expliquez-vous…
— Jean Landrezac… c’est mon beau-frère… affirme qu’elle est tombée dans l’escalier. En fait, il l’a poussée. Elle avait un cancer, mais je sais qu’elle ne s’est pas suicidée, elle tenait trop à la vie, et elle ne lui a pas demandé non plus de mettre fin à ses jours. Voilà ce qu’elle m’a écrit peu avant sa mort…
Daniel Chicoine sortit une lettre froissée de sa poche et la tendit à Géraldine Buisson.
« S’il m’arrivait quelque chose, je veux que tu cherches les causes exactes de ma mort… »
À peine eut-elle lu la première phrase qu’il lui reprit brutalement le papier des mains.
— Le reste est personnel et ne regarde que moi.
— Avez-vous montré ce document à la police ?
— Ils ont mis la photocopie dans un dossier, le dossier dans un tiroir, cela ne représente pas un indice suffisant pour ouvrir une enquête criminelle. On m’a prévenu officieusement que ma sœur était âgée et malade, en gros, qu’elle allait mourir de toute façon et que son “accident” n’avait fait que précipiter les choses. Que ça ne servait à rien de se torturer davantage.
Géraldine Buisson flaira la bonne affaire ; d’une part, elle pouvait avoir l’occasion d’aider à coffrer un assassin, d’autre part, le client lui assurait “une note de frais ouverte”. C’était largement suffisant pour accepter l’offre.
Elle ouvrit un grand cahier à spirale et nota les renseignements.
— Mon beau-frère Jean Landrezac, le mari de ma sœur Francine, il habite Le Minio à La Vraie-Croix et il a décidé de faire le Tro Breizh. Il faut que vous le suiviez et que vous découvriez pourquoi il a eu cette dernière idée bizarre ; aurait-il des remords d’avoir tué sa femme ? Je compte sur vous.
C’est ainsi que Géraldine Buisson se lança, flanqué de Conrad Turq, le stagiaire, sur sa première affaire d’importance où, elle le supputait, elle n’était pas au bout de ses surprises.
III
Le tracteur a toussé un peu par habitude, mais il a réussi à démarrer. Il a une histoire personnelle comme chacun ; il vivait chez une femme tombée enceinte qui travaillait seule sur ses terres et à force de trépidations, elle a accouché dessus, un beau bébé tout neuf avec le cordon et tout. Quand je le lui ai acheté, je l’ai appelé Bienvenu, eu égard. Il appartient au “Crédit Patates”, le bon sens près de chez vous.
Il a remplacé mon cheval, “Lamy”, un bai fort comme un Turc, avec des fesses qui s’agitaient et se balançaient de droite à gauche. Il ne comprenait que quelques mots : « Hue, ho, dia… » mais ce que j’ai pu lui en raconter !
Dès les premiers kilomètres – je suis parti dans l’après-midi – je me suis senti le roi de la fête. J’étais devant, dans la cabine, Francine souvent à côté de moi, dans son cadre, et des fois sur la table dans la remorque, Camembert toujours fourré entre nous pour sentir qu’on l’aime. Il ne faut pas déroger les règles, sinon tout fout le camp. Tiens, vous soufflez un grain de sable dans le désert et y’en a cent qui éternuent au bout du monde…
Le jour 1, j’ai pris les petites routes qui ont bien le droit d’exister aussi, pour ne pas être embêté par les voitures qui n’aiment pas les escargots. Je suis passé à côté de la cathédrale de Vannes, mais je n’y suis pas entré, car je l’avais réservée pour la fin du voyage. J’ai juste mesuré si les églises sont accessibles au tracteur, ici c’était non, j’ai dû laisser Bienvenu assez loin.
Auray. J’ai traversé le Loch pour le port de Saint-Goustan, mignon comme tout, qui gît dans un bas-fond. Je me suis garé sur un parking. J’ai laissé l’église Saint-Sauveur, puis le Pont-Neuf jeté entre la rivière et la mer, avec la maison de l’octroi où il fallait payer pour passer. De nombreux promeneurs admiraient les maisons avec le mélange de pierre et de bois, et l’eau qui s’avance dans la ville.
Je m’étais préparé des galettes de sarrasin sur la galettière de Francine. Je n’ai pas son tour de main, il fallait la voir manier sa rozell… mais elle m’a appris : faut qu’elles soient fines, en dentelle et qu’elles craquent quand on les croque. À la nuit tombante, je me suis régalé sous les étoiles, j’ai donné la dernière – on appelle ça le galichan, c’était pour les pauvres, il en reste encore – à Camembert qui a remué la queue en signe de contentement. Là-dessus, je me suis enfilé une bouteille de cidre pétillant comme du champagne, j’en ai ravitaillé une bonne trentaine en réserve pour la soif. Ça m’a fait tout drôle, car j’ai revu le mouvement de ses mains sur le manche. Du coup, ça m’a donné des envies après le repas, c’est comme si je m’étais approché de son lit.
— T’aurais pas une petite place ?
Elle m’aurait filé une beigne ou quelque chose comme ça, car à la fin, elle avait trop de rhumatismes et elle commençait à perdre la tête. Moi, pour la chose, je dois dire que je ne suis pas feignant, dame gast non ! Mais faut au moins être deux pour ça.
Avant de m’endormir, j’ai pensé au temps où on se faisait plaisir et à mes bêtes restées là-bas, à la ferme. Yvon, le voisin d’à côté – c’est un copain avec qui on fait des bonnes parties – s’en occupe, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance, il n’a pas toujours les yeux en face. Mais je n’en avais pas d’autre sous la main.
De là, j’ai pensé aux enfants et aux petits-enfants, on a une fille Marie-Françoise, et son fils Yoann, et un garçon Ange qui a Arthur. Mes deux petits bouts m’ont modifié les hormones et le cerveau, ça rappelle avant quand on était père. Je ne peux pas penser à deux choses sans qu’il y en ait une pour eux. Les lardons des lardons c’est pratique, car ça continue notre nom après notre mort, comme ça, on peut avoir l’impression de vivre encore. « Si j’avais su tout le bonheur qu’ils apportent, je les aurais eus avant », comme raconte l’aimant que Francine avait collé sur le Frigidaire. Quand je les évoque, je fonds n’importe où je suis ; je les emporte toujours sur moi, dans un coin de mon cœur.
IV
Géraldine Buisson avait récupéré l’étrange équipage après Vannes et l’avait suivi de loin. Elle pensa qu’un mec qui part ainsi en voyage sur son tracteur, sa veuve dans un cadre, ne doit pas être très net et qu’il a des choses à cacher. Elle avait envoyé Conrad Turq faire une enquête de voisinage, un gars tel que lui, qui passe inaperçu, suscite les confidences. Elle avait pris quelques renseignements sur le bonhomme ; ce fameux Jeannot Landrezac n’était pas dépourvu de personnalité, il aimait les plaisirs de la vie et avait vécu longtemps auprès de sa femme sans qu’on lui connût quelque aventure. Le couple allait cahin-caha, avec des engueulades dans la moyenne. Il semblait toutefois que Francine, qui avait vécu autre chose que la condition paysanne avant de le rencontrer, rêvait de nouveaux horizons. Aurait-elle employé sa retraite à voyager, à découvrir des terres inconnues, n’aurait-elle pas laissé tomber son Jeannot complètement attaché à la sienne, à ses bêtes, à ses copains, à son hameau ? La femme, avant son accident d’escalier, semblait en totale rémission de son cancer, elle avait encore de belles années à vivre.
Elle en était là de ses rêveries lorsque le tracteur s’arrêta, le conducteur avait décidé de bivouaquer à Auray. Vingt bornes en une journée, les frais d’essence seraient limités, c’était déjà ça ! Par contre, elle détestait la campagne ; ce qu’elle en avait vu ne l’avait guère enthousiasmé et ne présageait rien de bon pour la suite. La nuit serait tranquille, elle décida de rejoindre Conrad Turq dans son bureau de Vannes pour un débriefing.
Quand elle arriva dans le quartier de Kerlann, le stagiaire somnolait sur une chaise longue. C’était un jeune dégingandé aux cheveux blonds, attachés en catogan, qui lui donnaient un air d’ailleurs, d’habitant d’une autre planète.
— Alors Conrad, as-tu appris des choses intéressantes ?
— Le café Chez Armand, à “Vera Cruz”, est une mine, on y apprend tout ce qui se passe dans le bled, pas grand-chose… Jean Landrezac y campe souvent avec ses potes Yvon ou le patron du bar, un certain père Jules les rejoint de temps en temps, rien de palpitant.
— Et sa femme Francine ?
— Une vraie bigote, elle se rendait quasiment tous les jours à l’église, on raconte qu’elle y rencontrait un jeunot qui n’avait pas encore fait ses vœux et qui était là en immersion.
— Comme toi… elle appuya sa phrase d’un sourire charmeur.
Géraldine Buisson était une blonde aux yeux bleus, de petite taille, mais elle dégageait une telle énergie qu’il avait du mal à la suivre. Conrad était amoureux de sa patronne en silence. Il était d’ailleurs amoureux de plusieurs femmes en même temps, plus qu’il n’en pouvait honorer, un cœur gros comme ça ! Même s’il l’avait vue plusieurs fois avec Mirta dans des attitudes qui ne laissaient aucun doute. Toutefois, il ne renonçait pas tout à fait. Resté dans l’adolescence, il convoitait chaque femme comme une friandise.
— Tu veux dire qu’elle pourrait avoir eu une histoire avec le curé ?
— Pas encore curé… séminariste. Ça se raconte. À sa mort, il est reparti chez lui, du côté de Rennes. Je me suis laissé dire qu’il avait jeté sa robe au diable, une litote pour dire qu’il avait rompu ses vœux. Apparemment, la Francine s’ennuyait ferme, sans mauvais jeu de mots, et son mari ne la regardait plus avec le même œil.
— C’est intéressant ce que tu m’apprends là. Quant à moi, j’ai suivi… euh… le tracteur… Il faut faire preuve de doigté et de patience pour rester dans le sillage sans attirer l’attention ! Tu me rejoindras sur la route quand je te le dirai, avant que je devienne folle… Pour l’instant, le possible criminel n’a montré aucun signe de malveillance.
Ils devisèrent encore quelque temps et chacun regagna ses pénates, lui chez papa maman, elle auprès de Mirta, ce que Conrad regretta. Ses parents étaient sympas, mais ils ne pouvaient pas lui apporter ce qu’il recherchait avec véhémence : l’amour d’une femme.
V
Johnny Rosko était commandant au commissariat de police à Vannes. Il se lissa la moustache, se recula dans son fauteuil et s’installa en position quasi horizontale. C’est toujours ainsi qu’il réfléchissait le mieux et prenait les décisions importantes. Ses parents étaient originaires de Roscoff, d’où son patronyme, et lui avaient accolé ce prénom, à cause des Johnnies, ces marchands d’oignons roscovites qui partaient bon an mal an, vendre leur production outre-Manche. Il était en outre affublé d’une boite-rie, comme Grand corps malade qu’il vénérait, occasionnée par un accident : sa tête avait violemment heurté le bord d’une piscine. Il était resté plusieurs mois paralysé et n’avait dû sa récupération qu’à sa volonté et à sa constitution d’athlète. Depuis, on le surnommait “Le diable boiteux”, en référence à Talleyrand avec qui, pourtant, il avait peu de ressemblance physique, mais il partageait son caractère bien trempé. Il avait hérité de l’homme d’état l’habileté dans les négociations, les reparties cinglantes, pour peu qu’on l’attaquât de front. Non seulement, il ne s’offusquait pas de la filiation que beaucoup auraient trouvé encombrante, mais il la revendiquait plutôt.
Il était sobre, ne fumait pas, restait droit dans sa tête et ne s’accordait aucun écart.
Son supérieur, le divisionnaire Eugène Lerabeau, moins intelligent, n’avait pour lui que mépris et jalousie. Autant l’un brillait par son esprit, autant l’autre, par sa suffisance et ses lacunes professionnelles – il avait habilement manœuvré pour en arriver à ce poste. Les deux hommes avaient du mal à travailler ensemble, ils étaient à l’affût du moindre coup tordu pour mettre l’autre dans la difficulté.
* * *
Quand Rosko arriva sur les lieux, des collègues de la gendarmerie avaient déjà balisé la scène de crime et une nuée d’officiants s’affairaient dans le périmètre. On avait trouvé un homme assassiné à l’extérieur de la cathédrale de Vannes, rue des Chanoines, caché derrière un bosquet d’hortensias.
Le jardinier avait découvert le corps aux aurores. Il gisait sur le sol, dos contre terre, un genou replié et surtout une corolle de sang dans la région du cœur. Le médecin légiste ne fit aucun mystère sur les causes de la mort : elle avait été provoquée par à un coup violent porté par un objet contondant. Rosko appréciait ce plus que cinquantenaire bougon avec qui il avait déjà travaillé plusieurs fois.
— Alors Doc, vos conclusions ?
— Il n’est pas difficile de conclure : une lame ou un objet pointu a perforé le muscle cardiaque.
Alfred Ducroq en avait déjà vu pas mal tout au long de sa carrière et il était blasé ; il venait de la région parisienne où ces genres de faits divers sont légion. Il se considérait en préretraite dans le Morbihan.
Des badauds se tenaient à distance, ne voulant pas rater une miette du spectacle. Rosko donna des ordres à son second Julien Destrac, un jeune lieutenant de police.
— Tu prends une équipe et vous lancez l’enquête de voisinage, je veux tout savoir sur le mec depuis le berceau, jusqu’à ses tendances sexuelles, ses fréquentations, le “menu” habituel… Moi, je dois passer par mon rapport à “l’autre” – il nommait ainsi le commissaire Lerabeau, souhaitant lui voler jusqu’à son identité.
* * *
Il était revenu au “block” et entra sans frapper dans le bureau du boss qui l’attaqua d’emblée :
— Rosko, je n’irai pas par quatre chemins, vous m’emmerdez, cette affaire m’emmerde, c’est pour cela que je vous la confie.
— Je n’en attendais pas moins de vous.
Le commandant lui balança les premiers éléments dont il disposait.
— Le mort, Ludovic Méchin, était diacre à l’église Saint-Patern, il venait souvent à la cathédrale. On ne lui connaissait pas d’ennemis.
— Ça fait mauvais genre, éructa Lerabeau, l’évêché est en émoi, il a alerté la mairie et les autorités. Je vous conjure de mener rondement cette affaire… si vous en êtes capable.
Après des échanges veloutés, Johnny Rosko tourna les talons, moins il voyait le singe, mieux il se portait. Il regagna son bureau pour écrire le PV des premières constatations. Julien Destrac le rejoignit deux heures plus tard. Ce dernier était une récente recrue de 25 ans qui vouait à son hiérarchique une admiration sans bornes, mêlée à une crainte de le voir exploser à chaque instant.
— Lambert décortique sa vie, il a pour consigne de noter le moindre frémissement de poil ou de clignement de cil. Il va bientôt me rendre compte de ses recherches. J’ai rencontré plusieurs personnes, elles sont unanimes : la victime était on ne peut plus discrète et faisait peu parler d’elle. À part ses apparitions comme diacre, c’était “L’homme invisible”.
Rosko tenait son équipe en haute estime, elle faisait toujours le job de façon très pro. Il se félicita d’avoir intégré le nouvel élément qu’il avait jugé d’emblée très brillant.
— Bon, tu continues, je vais m’occuper de la veuve et des orphelins.
Ils se dirigèrent vers la machine et le commandant proposa un café à son second.
— Les histoires de fric, de fesses, c’est de la routine, mais là, y’a le frac… la religion, et ça risque d’être plus délicat.
Destrac en convint aisément. Tout en faisant la grimace, Rosko éructa :
— Bordel, faudra changer de fournisseur, cette machine dégueule du café de basse classe !
Ce n’était pas une raison pour donner un grand coup de pied dedans, qui résonna jusque dans sa jambe malade. Elle se faisait rarement oublier.
VI
Le lendemain de ma première nuit agitée, déjà loin du Minio, j’ai pensé à Francine… Elle avait de l’embrun dans les yeux, car elle est native de Penvins sur la Presqu’île de Rhuys, ce n’est qu’après, qu’elle a émigré à la ville. Sur la fin, c’était une forte tête qui ne me laissait jamais tranquille. Si elle ne s’était pas cassé la pipe, Dieu sait quelles misères elle m’aurait faites !
J’ai évité les quatre-voies qui sont gratuites chez nous, à cause d’Anne qui avait le cœur sur la main et pas intéressée pour faire payer les voyageurs. Les paysages se ressemblaient, mais ils étaient différents ; si on n’aime pas les bruyères, les landes et les genêts, faut pas venir en Bretagne.
Après Landevant, je suis arrivé dans le pays de Lorient.
J’ai dépassé le port d’Hennebont, la ville des anciennes forges, maintenant à Inzinzac-Lochrist. J’ai admiré le château et ses fortifications. Après le pont de pierre avec plein d’arches, je n’ai pas pu m’empêcher d’acheter un kouign-amann débordant de beurre et qui tient au corps, et je l’ai mangé sur les bords du Blavet.
Y’a une promiscuité sur un tracteur, c’est comme sur un bateau, ça passe ou ça casse, et je voulais voir jusqu’où je pouvais aller avec Francine là et pas là, comme ça, j’aurais mesuré combien elle était encore vivante. Parce qu’on a beau avoir été mariés ensemble plus de vingt ans, on avait quand même du mal à se supporter dans la même maison.
En longeant une route départementale, j’ai vu un laboureur dans son champ, alors vous savez ce que c’est, quand un tracteur rencontre un autre tracteur… N’importe où dans le monde, on reconnaîtrait entre mille ceux qui travaillent la terre, à cause des mains, des ongles, des corps, des vêtements, des façons de se tenir et de causer.
On a parlé mécanique, lui, il avait un trente tonnes, un Lamborghini, il m’a dit que le Massey, je pouvais le mettre à la casse, « mais c’est pas sûr qu’ils le prennent, peut-être tu devras payer ! » J’ai regardé Bienvenu et je ne l’ai pas trouvé si piteux d’état que ça, l’autre devait être jaloux. En tout cas, il était bavard comme une pie, c’était le genre de gars, tu lui demandes l’heure et il te raconte sa vie. Et sa vie c’était dans les champs infinis, il ne connaissait que ça comme ligne d’horizon.
Je n’aurais jamais dû m’arrêter, car j’ai eu un mal de chien à repartir, c’est toujours pareil avec les bavards, ils te prennent la tête et ne la lâchent plus. « Mal de chien », ça m’a fait penser à Camembert qui dormait dans la remorque, lui les paysages, il n’est pas intéressé, c’est une affaire d’hommes. C’est une boule de poil qui n’a pas de race, sauf que c’est un chien à vaches qui n’avait pas de pareil à les rassembler ou les faire rentrer, un vrai métier. Il courait après l’une et après l’autre, et finissait toujours par gagner. Francine disait souvent : « Bien que ce soit ton chien, il est intelligent. » C’est vrai qu’on dirait qu’il parle avec les yeux. « Il ne lui manque que la parole », dit Yvon, mon copain, et il sait de quoi il parle, il est presque muet, alors ça l’impressionne. Il bégaie, parce qu’un jour, quand il était gosse, il s’est trouvé enfermé dans la cave et tous ces bras et ces yeux dans le noir, qui le guettaient, ça lui a donné des peurs bleues. Camembert tient à moi comme le bateau à la mer. Le soir, je l’attache à la remorque et faudrait pas que quelqu’un vienne à attaquer, il défendrait mieux que des armes.
* * *
Arrivé à Larmor-Plage, je suis tombé nez à nez avec l’océan. Tu peux le regarder dans les yeux, ce n’est pas lui qui les baissera. Il a des odeurs particulières avec l’iode, le goémon et les chiures d’oiseaux, tu ne peux pas te tromper, t’es en Bretagne ! Faut pas chercher à savoir combien l’océan contient de litres d’eau ni ce qu’il ramène de ses voyages, il faut le laisser faire et il apporte plein de bonnes choses. Francine adorait se promener à son bord, elle ramenait toutes sortes de saloperies, des laisses de mer, et elle fabriquait des objets avec, ou des bijoux en coquillage, je ne lui disais pas que c’étaient des ramasse-poussière, vu que c’est elle qui faisait le ménage. Elle disait, je me rappelle, c’était beau : « Devant lui, t’as pas envie de le vider, mais de vider ton sac, oui, de lui confier tes peines et tes chagrins, il noie tout ça dans son liquide. » C’était une penseuse, Francine ; dans son autre vie d’avant moi, elle était commerçante, et ces gens-là sont habitués à parler avec les gens et à penser aussi. Si je ne l’avais pas détournée, elle serait devenue quelqu’une.
Du coup, avec des larmes dans les yeux à cause du vent qui naît toujours sur la mer, je l’ai invitée au restaurant. Je l’ai installée à côté de moi sur une chaise, la serveuse a dû me prendre pour un fou, mais pas grave, dame gast non ! Et je nous ai commandé une choucroute de la mer. Le restaurant s’appelait le “Mor Braz” et la taulière était sympa comme une porte de prison, mais la cuisine était bonne. Moi, je lorgnais surtout la petite serveuse qui était mignonne comme un bouchon et qui n’avait pas froid aux yeux, gast ! et qui avait des jambes musclées comme un cycliste et des nichons qu’on aurait dit les deux mamelles de la France.
J’y ai questionné :
— Comment allez-vous ?
Elle a répondu :
— Un jour ça va, un jour ça va pas, ça fait deux jours de passés.
Elle était rigolote la cocotte, alors quand elle m’a demandé :
— Qu’est-ce qu’il va prendre, le monsieur ?
J’y ai dit :
— La serveuse, si c’est possible…
Elle a rigolé torride.
Vous auriez vu les yeux de Francine, pire que des grands yeux de vache, ronds comme des ballons et tueurs comme des fusils de chasse. Alors pour me faire pardonner, je me suis offert une coupe de champagne, y’avait pas de raison, gast ! Et j’ai bu à sa santé. Ce n’est pas tous les jours qu’on fait le Tro Breizh. Et puis de fil en aiguille, on… j’ai bu la bouteille entière, si bien qu’on… que je commençais à confondre le jour et la nuit. Je crois que c’est à cause des bulles que, ce soir-là, Francine m’a raconté notre rencontre.
Son père s’est barré quand elle était toute jeune, si bien qu’elle est restée boiteuse un bon bout de temps. Elle a épousé son premier mari très jeune et il ressemblait un peu à son père, elle voulait recoller les morceaux, ce qui n’est pas facile quand on n’a pas le plan du départ, il lui manquait le schéma de montage. Ils ont été heureux dans leur magasin parisien, mais dix ans plus tard, il a atteint un infractus qui l’a tué ; elle s’est dit : Voilà que ça recommence, il se barre aussi ! Elle a mis du temps à faire son deuil, car ça ne se fait pas comme ça, je suis là pour témoigner. Et puis, elle est revenue en Bretagne pour calmer sa douleur et il y a eu le coup de la panne, sa voiture a versé au fossé sur la route glissante, au bout du chemin de chez moi.
Elle m’a trouvé sympa avec mes bottes vertes et mon air ahuri, merci Francine ! Elle a eu pour ainsi dire le coup de foudre quand j’ai volé à son secours avec Lamy, mon cheval, qui l’a tirée de là. Moi, je l’ai bien aimée aussi dès le début, faut dire qu’on ne voit pas grand monde à la campagne et surtout pas des belles femmes. Après, on a eu des coups de foutre et ça n’est pas désagréable non plus. Ce qui nous a mis deux enfants au monde, un gars et une fille : Marie-Françoise, l’aînée, et Ange, le cadet, qui sont de beaux enfants qu’on nous a livrés et qu’on a aimés comme on a pu.
J’ai eu l’impression, dans l’alcool, que ses yeux verts se sont accrochés aux miens et c’était comme si on avait de la pluie dedans, dites donc ! Elle a posé sa main sur ma main et elle m’a dit en mangeant sa crème brûlée, pour ainsi dire :
— Je suis bien avec toi.
Alors je ne savais plus ce qui était vrai et faux ; est-ce qu’on était sur le chemin du Tro Breizh ou quoi ? Est-ce qu’il n’y avait pas des inventions ? Est-ce que ma tête tournait bien rond ? Je me suis retrouvé, “chépa” comment, dans la remorque à rêver.
Francine avait revécu. Elle était revenue du cimetière avec des fleurs et elle les a posées sur la table. D’ailleurs, ce n’était pas une table, c’était l’établi dans la loge à battre. D’ailleurs, ce n’étaient pas des fleurs, c’étaient des bouquets d’enfants qu’elle m’avait lancés à la figure. « Tiens, les voilà, ceux que tu m’as faits ! » Elle criait dans mes oreilles et moi, j’aurais préféré écouter le bruit de la mer ou des branches qui craquent dans le vent. Et puis, tout a disparu, on était sur la lande, la nuit. Et y’avait quelqu’un, je crois que c’était l’Ankou, qui a dit : « Ça y est, il est temps de repartir ! Francine, je suis revenu te chercher ! » J’ai essayé de la retenir en lui offrant des fleurs et des enfants, mais elle a suivi le squelette en rigolant de moi : « Tu ne me mérites pas, je rejoins les miens, là-bas. » Je suis resté triste et seul, avec la quéquette basse, et je me suis allongé sur la terre et j’ai pleuré, gast, en étant piqué de partout par la lande, j’ai pleuré et je n’arrivais pas à m’arrêter, tellement mes épaules étaient secouées. Et alors, la petite serveuse du restaurant est arrivée, elle m’a pris dans ses bras en disant : « Faut pas pleurer comme ça, une de perdue, dix de retrouvées ! » et on a fait l’amour sur la lande, mais ce n’était pas dur, c’était comme un lit de fleurs et au moment où… Paf ! Je me suis réveillé tout en sueur sur mon lit de camp… C’est souvent qu’on n’arrive pas aux meilleurs moments.
VII
Ce Jeannot Landrezac avançait à un train de sénateur et Géraldine Buisson avait tout le temps de le suivre. Il n’avait pas rencontré grand monde, quelques saluts à des personnes de passage. La détective privée était une femme urbaine. Elle aimait les monuments, flâner dans les rues, le nez en l’air, et humer les parfums de pollution. Le fumier, le purin, l’odeur du foin coupé, non merci… Elle avait jeté son dévolu sur Vannes, une ville moyenne, mais dès que ses moyens le lui permettraient, c’est à Paris qu’elle irait s’établir quand son affaire lui aurait rapporté assez d’argent, Mirta était prête à la suivre.
Le retraité s’était arrêté au bord du Blavet où il s’était empiffré d’un kouign-amann pour prendre soin de son cholestérol. Ensuite, elle se força à établir le contact avec Robert Lamourier, un paysan qui cultivait son champ. Il se répandit facilement, n’ayant pas trouvé de répondant avec ce gars qui circulait en tracteur et qui n’appartenait déjà plus à son monde.
— Qu’est-ce qu’il vous a dit au juste ?
Il était partagé entre le désir d’envoyer promener cette bien curieuse et de faire un brin de causette avec une belle plante à qui il aurait volontiers conté fleurette.
— Ça vous regarde ?
— Naturellement ! Je suis journaliste et je projette un reportage sur ce voyageur qui fait le Tro Breizh en tracteur.
— Il m’a rien dit… seulement qu’il était à la retraite et qu’il se dégourdissait les guiboles. On a parlé surtout mécanique.
— Et comment l’avez-vous trouvé ?
— Vous voulez mon avis ?
— Naturellement !
— Je passerai dans le journal ?
— Naturellement.
— Un peu barré. Il avait une photo dans un cadre auprès de lui et il m’a pas renseigné quand je lui ai posé la question de savoir.
— C’est sa femme… elle est morte… elle a chuté dans l’escalier.
— Je vais vous dire, il ne serait pas étranger à l’affaire que ça ne m’étonnerait pas.
— Pourquoi dites-vous ça ?
— Il lorgnait de temps en temps sur le cadre avec un air de pas être innocent.
— Vous êtes marié ?
— Naturellement !
— Et vous, votre femme, vous l’auriez tuée ?
Géraldine Buisson dut décamper avant que Robert Lamourier ne descende de son tracteur et ne sorte de ses gonds. Il était tout rouge de colère et elle se dit que ce n’était plus le moment de causer paysannerie. Elle suivit Jean Landrezac jusqu’au soir, tandis qu’il dînait au Mor Braz, un restaurant pour touristes, à Larmor-Plage.
« Il a pas froid aux yeux le Jeannot. Il a fait du gringue à la petite serveuse. Il a vite oublié sa femme, celui-là ! Et si son beauf, le Daniel Chicoine, avait raison ? Curieux bonhomme, il va falloir creuser… »
Elle termina sa salade composée et commanda un café. L’autre se goinfrait avec sa choucroute de la mer. Elle voyait ses lèvres remuer comme une obsession. Un lourdaud, un rustre, un paysan. Décidément, elle ne les portait pas dans son cœur. Mais elle ne devait pas se laisser aller à ses préjugés.
Il dormit dans sa remorque. Elle dormit dans sa voiture, loin des bras chauds de Mirta. On ne peut pas tout avoir.
VIII
Après Guidel, j’étais vers l’anse du Pouldu. J’ai juste regardé la bouche de la Laïta qui aurait bien des choses à dire et qu’on voit du pont Saint-Maurice, et les plages et les dunes avec encore des blockhaus du mur de l’Atlantique. C’était le Finistère : Penn-ar-Bed, le bout du bout et la fin de tout, à en croire les anciens.