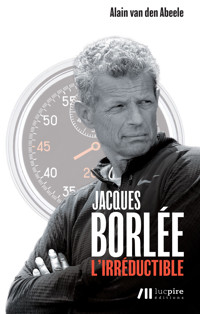Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luc Pire
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le nom suffit à la lui-même. Ferrari. Pourtant, derrière le mythe entretenu savamment, bien des détails restent dans l’ombre. Les riches heures de l’histoire de la marque dissimulent des moments troubles qu’Enzo Ferrari, en personne, a soigneusement occultés dans le but d’embellir l’histoire, son histoire.En effet, les témoignages existants montrent que tout ne fut pas parfait au sein de la Scuderia et dans le monde gravitant autour de Maranello.Les pilotes, les ingénieurs, les journalistes, les mécaniciens, le monde politique et les happy fews ayant côtoyé cet univers hors du commun, tous en parlent avec un curieux mélange de respect et d’embarras.Ce livre raconte l’histoire de l’homme. Ses débuts, son ascension, son implacable volonté de réussite, parfois au détriment de ceux qui l’ont approché. Tout est analysé avec sérieux et replacé dans le contexte historique des diverses époques traversées, tant politiquement qu’économiquement. Ferrari, un homme de lumière et d’ombre. Un géant qui a changé l’histoire de l’automobile, mais un géant au caractère impitoyable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enzo
Ferrari
Éditions Luc Pire [Renaissance SA]
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
fÉditions Luc Pire
www.editionslucpire.be
Photo de couverture : © AGE Fotostock/Belgaimage
Couverture et mise en pages : Philippe Dieu (Extra Bold)
isbn : 978-2-50705-513-4
© Éditions Luc Pire, 2017
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
L’éditeur a tenté de joindre tous les ayants droit au copyright des illustrations figurant dans cet ouvrage. Les ayants droit qui constateraient que des illustrations ont été reproduites à leur insu sont priés de prendre contact avec l’éditeur.
ALAIN VAN DEN ABEELE
Enzo
Ferrari
l’homme derrière
la légende
« Nelle vene
quell’acqua
d’argento »
Dans les veines de ce fleuve d’argent
Il passe, inlassable, dans la vallée brumeuse du nord de l’Italie. Il descend du mont Viso, où il est né dans l’air pur des alpages nuageux perchés à plus de 2000 mètres. Il fouille la plaine dans une longue course vers l’Adriatique, bercé par les arias de Verdi, insensible au bruissement d’une Italie industrieuse. Identifié à l’Éridan par Aristote, si peu connu par les Grecs qu’Hérodote doutait de son existence, ce fleuve majestueux, aux crues monstrueuses, aux brumes soudaines, porte le nom de Pô. Turin se mire dans ses eaux. Écoutez-le raconter ses histoires, lui qui a vu passer Hannibal et ses éléphants en 218 avant Jésus-Christ et qui a reflété l’image de Jules César bousculant l’Italie 49 ans avant notre ère. Il murmure entre chien et loup, quand le jour s’apaise sur ses rives et que seuls retentissent les cris plaintifs des poules d’eau.
Introduction
La vie d’un homme n’est pas simple. Et celle d’Enzo Ferrari encore moins. J’aime raconter des histoires. Celle du maître de Maranello m’a toujours intrigué.
Si je devais résumer Enzo Ferrari en un mot, je le définirais comme un collectionneur. Collectionneur de victoires, de défaites, de pilotes, de voitures, d’ingénieurs, de mécaniciens mais également de sentiments, d’émotions et de moments antagonistes. Maniaque aussi? Sans doute. Il excellait dans son domaine et ne lésinait sur aucun effort pour mener ses desseins à bien.
Alors, la vérité sur Ferrari? Quelle vérité? Comme dans toutes les entreprises humaines de grande envergure, elle se dissimule sous des couches d’affirmations, de contradictions, de paradoxes et, chez Ferrari, de légendes et de rêves. Il a réussi à créer un monde de rêves, le sien, et cela mérite en soi quelque admiration.
Enzo Ferrari s’est de tout temps présenté à l’aune de la subjectivité, celle voulue par un ego impressionnant. Cela ne simplifie pas le travail de celui qui veut reconstituer la mosaïque de son existence.
Écrire sur Ferrari est une tâche exaltante et intéressante. Ce nom touche à un certain degré de « mystique », à la façon de Bugatti, un autre constructeur automobile de légende. Comme pour ce dernier, l’œuvre de Ferrari est celle d’un homme. Les deux hommes se ressemblaient d’ailleurs sur bien des points. Ils engageaient leurs voitures d’usine en compétition, vendaient des voitures concurrentielles à des privés et étaient, l’un comme l’autre, individualistes dans la conception de leurs bolides, ne produisant jamais des copies de modèles réalisés par d’autres compagnies. Ils étaient tous deux autocratiques et aimaient les femmes. Bugatti mort, Ferrari demeura le dernier des géants de l’automobile.
Le moteur automobile n’est pas très ancien. Il est issu de toutes les connaissances techniques et scientifiques acquises par les générations successives. Nous sommes aujourd’hui leurs descendants et les héritiers de leurs travaux parfois inspirés, parfois laborieux. Il en va de l’automobile comme de toute autre forme d’entreprise.
Il n’est pas erroné d’écrire qu’Enzo Ferrari descend en droite ligne des précurseurs, de ces inventeurs qui ont ouvert la voie à la locomotion terrestre et développé l’automobile: Cugnot, Watt, Trevithick, les familles Stephenson et Bollée, Daimler, Benz, Maybach, Panhard, Levassor, de Dion et Peugeot. Enzo Ferrari est leur fils spirituel et le créateur d’une dynastie à nulle autre pareille.
On peut constater combien Enzo Ferrari a été, à certains égards, indifférent à son propre intérêt. Il était lié à une idée, à une grande cause, à une patrie aussi, et s’est épuisé, sans s’épargner une seconde, pour que s’accomplisse un destin plus grand que sa volonté. Cela valait pour ses bolides de compétition et plus encore pour l’ensemble de sa vie.
En cela il peut être comparé à Ettore Bugatti, le légendaire constructeur d’automobiles alsacien. Ils ont marqué, l’un comme l’autre, l’histoire de l’automobile. Ils ont fabriqué des machines à la beauté intemporelle et dédié leur existence à leur idéal. Ils étaient tous deux Italiens et le sont restés jusqu’à leur disparition même si Bugatti s’était installé en France, à Molsheim, pour travailler. Ils avaient, tous les deux, des fils intelligents et doués qui sont morts tragiquement. Jean Bugatti, qui était responsable du dessin des carrosseries, est mort dans un accident de voiture en voulant éviter un cycliste, en 1939. Alfredo « Dino » Ferrari avait une santé fragile. Il n’a pas succédé à son père et s’est éteint, en 1956, à l’âge de 26 ans, des suites d’une leucémie. Les deux pères ne se sont jamais remis de la disparition de leur fils. Ettore Bugatti est mort sept ans plus tard sans plus avoir créé des voitures exceptionnelles et Enzo Ferrari a été profondément affecté par la disparition de « Dino » durant toute sa vie.
La grande différence entre ces deux personnages réside dans le fait que Bugatti était un créateur qui dessinait et imaginait les composants de ses voitures. Enzo Ferrari était un passionné de moteurs et un organisateur qui s’associait à des talents reconnus.
Nietzsche écrivait dans Le Crépuscule des idoles:« L’homme libre est un guerrier. À quoi mesure-t-on la liberté, chez les individus comme chez les peuples? À la résistance qu’il faut surmonter, à la peine qu’il en coûte pour garder le dessus. » Le personnage de Ferrari répond-il à cette description?
Chapitre 1
L’Europe industrielle à la fin
du XIXe siècle
La plupart des machines-outils sont inventées à la fin du XVIIIe siècle, mais c’est au cours du XIXe siècle, et particulièrement après 1830, qu’elles vont se répandre et transformer l’industrie. Dès le début du XIXe siècle, les ingénieurs anglais prennent de l’avance et développent les tours à fileter les vis et les boulons, les tours à mortaises et les machines à encocher. Ils sont également les maîtres de la machine à vapeur. La marine anglaise est la première à profiter de ces progrès. Les nouvelles méthodes de production qui en découlent améliorent le travail des ouvriers, désormais regroupés dans des usines où ils effectuent des tâches qui ne demandent pas beaucoup de qualifications.
L’Angleterre deviendra ainsi la première puissance industrielle à développer les filatures alimentées par le coton venu des États-Unis, les mines, la marine à vapeur et les chemins de fer rendus nécessaires par le transport du charbon depuis les lieux d’extraction vers les ports ou les lieux d’utilisation.
À la fin du XIXe siècle, le moteur à vapeur fait fonctionner l’ensemble des machines-outils désormais reliées entre elles par un système d’arbres, de poulies et de courroies. L’invention de l’électricité améliore le rendement. Chaque machine est bientôt équipée de son propre moteur. Cela diminue le nombre d’accidents, réduit la consommation d’énergie et améliore les conditions de travail des ouvriers.
Les machines-outils accomplissent des opérations très complexes: mouvements de la broche, avance de l’outil, avance des pièces, blocage et verrouillage grâce à des cames qui provoquent le déclenchement des fonctions selon le cycle d’usinage préétabli.
Cette révolution industrielle, qui se développe rapidement à partir des années 1880, repose sur deux sources d’énergie relativement nouvelles : le pétrole et l’électricité, même si le charbon est encore dominant. Tout est en place pour l’arrivée d’un nouveau moyen de transport: l’automobile.
Chapitre 2
Les maîtres des forges
En 1885, dans un atelier rudimentaire de Bad Cannstatt, en Allemagne, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach jettent les bases du moteur automobile à partir des recherches menées par leur compatriote August Otto, lui-même inspiré par le cycle à quatre temps pensé par le Français Alphonse Beau de Rochas. Les recherches des deux ingénieurs allemands permettent de résoudre quantité de problèmes: utilisation du carburant liquide, allumage, distribution, vilebrequin, cylindre, refroidissement, cartel étanche… Ils déposent quantité de brevets ayant trait à leurs travaux.
Mais ils ne sont pas les seuls à imaginer la future automobile. À quelques kilomètres de là, Carl Benz travaille sur le même projet. Fait étonnant, Daimler et Benz ne se connaissent pas et, plus étonnant encore, ils ignorent tout de leurs recherches respectives.
Après avoir expérimenté leur premier moteur sur une moto archaïque, l’« Einspur » (monotrace), Daimler et Maybach développent leur concept sur la première voiture à quatre roues tandis que Benz installe son propre moteur, dérivé également des recherches d’Otto, dans un tricycle. Les essais des uns et de l’autre vont bon train. Benz fait rouler son engin dès la fin de l’année 1886.
Daimler et Maybach parcourent leurs premiers kilomètres dans leur voiture en mars 1887. Une fois les résultats concluants, ils décident de vendre leur moteur à qui s’intéresse à cette automobile encore bredouillante. Un Français, Édouard Sarrazin, rencontre Daimler et obtient une licence d’exploitation pour la France. Malheureusement, Sarrazin décède quelque temps plus tard, en 1887. Sa veuve, Louise, reprend la licence et obtient un rendez-vous chez un grand industriel, Émile Levassor, associé à son ami René Panhard, son condisciple de l’École centrale. Les deux hommes s’intéressent aux moteurs à gaz depuis 1875. Louise Sarrazin convainc les deux entrepreneurs de l’intérêt du moteur à essence Daimler. Saisissant l’opportunité, ils se tournent vers la fabrication d’automobiles équipées du moteur Daimler.
Un autre industriel français, installé dans le Doubs, qui dispose de trois usines importantes de moulins à poivre et à café ainsi que de vélos, s’intéresse également à ce tout nouveau moyen de transport. Il s’appelle Armand Peugeot. Ayant acquis à son tour le moteur Daimler, Peugeot construit une quatrième usine et se lance dans la fabrication d’automobiles. Il sera rapidement imité par le fantasque et aimable comte de Dion qui, lassé des expériences décevantes sur des moteurs à vapeur menées avec Bouton et Trépardoux, ses associés de la première heure, construit sa première automobile à essence en 1895.
Les moteurs mono- et bicylindres en V de Daimler entrent dans l’histoire et ouvrent la voie aux constructeurs automobiles.
Chapitre 3
Les condottieres
L’automobile s’installe partout en Europe. Imaginée en Allemagne, industrialisée en France, elle tisse un réseau, ténu mais solide, en Belgique, en Hollande, en Autriche, en Suisse, s’ouvre difficilement mais irrémédiablement en Grande-Bretagne et dans certains pays de l’Est comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce à leurs propres inventeurs, tels Pope, Winton et Ford.
Curieusement, un pays n’a pas encore répondu à l’appel du cheval-vapeur : l’Italie. La Péninsule se remet d’une période de cristallisation du mouvement nationaliste. L’unification italienne est achevée en 1870, après récupération de la Vénétie des mains de l’empire d’Autriche et cession à la France de la Savoie et du comté de Nice.
Il faudra attendre le 23 octobre 1898 pour que naisse la société Ceirano et Faccioli, créée pour la fabrication de « prototypes automobiles ». Le retard industriel de la jeune nation italienne sur ses voisins français et allemand est criant. Le pays est essentiellement agricole. Mais la réunion à Turin de quelques entrepreneurs audacieux en juillet 1899 va modifier le cours de l’histoire de la Péninsule.
Ces visionnaires ont pour noms Giovanni Ceirano, Felice Nazzaro, Vincenzo Lancia, Ludovico Scarfiotti, Carlo Biscaretti di Ruffia et Giovanni Agnelli. Ce dernier est à la base de la réunion au Palazzo Bricherasio afin de porter sur les fonts baptismaux la « Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino », autrement dit la Fiat. Nous sommes le 11 juillet 1898.
L’idée d’Agnelli est de constituer rapidement une industrie automobile dont les voitures seront utilisables par le plus grand nombre. Désireux de ne pas perdre de temps ni de dilapider l’argent des financiers turinois qui ont été convaincus par ses arguments, il se tourne vers le modèle mis au point par Ceirano et Faccioli. La toute nouvelle société Fiat rachète les brevets de la société Ceirano et dispose d’un modèle de 3,5 ch, aussitôt lancé en production. Poursuivant son plan de dynamisation d’une industrie naissante, la Fiat sous-traite la fabrication des pièces à des entreprises soigneusement sélectionnées qui constituent la base d’une industrialisation du nord de l’Italie.
L’automobile italienne prend son essor, avec un peu de retard, certes, mais avec un dynamisme remarquable.
Deux pilotes d’usine assurent la réputation de la marque en course automobile : Felice Nazzaro et Vincenzo Lancia.
Nazzaro est appelé le « roi de la vitesse » par ses compatriotes. On le dit capable de parcourir deux miles à la minute. Il symbolise une forme de réussite exemplaire : apprenti entré à 18 ans dans la petite usine de Giovanni Ceirano, il y rencontre un autre passionné de mécanique, venu d’un milieu aisé : Vincenzo Lancia. La vie permet parfois des rapprochements qui déclenchent des étincelles magiques…
Lors de la reprise de Ceirano par la Fiat, les deux jeunes hommes se retrouvent naturellement sur les feuilles de paie du tout nouveau groupe.
Nazzaro escalade les échelons en se faisant remarquer comme mécanicien hors pair, mais aussi comme chauffeur doué. La famille Agnelli fait régulièrement appel à ses services pour conduire des amis issus de familles aisées. De fil en aiguille, Felice Nazzaro se retrouve au volant d’une Fiat de compétition et, en 1905, il prend le départ de la Coupe Gordon Bennett avec Lancia et Alessandro Cagno, où il termine deuxième derrière son camarade Lancia.
Nazzaro remporte ensuite d’éclatantes victoires pour la marque turinoise, dont les trois plus importantes courses en 1907 : la Targa Florio en Italie, la Coupe de l’Empereur en Allemagne et le Grand Prix de France à Dieppe. Il est adulé dans son pays. La presse conte ses exploits avec une verve toute latine. Son mariage est un événement national.
Nazzaro s’éteindra le 21 mars 1940 à Turin, à l’âge de 59 ans, après une vie bien remplie marquée par la perte tragique de sa jeune femme en 1923, dans un accident d’automobile.
Vincenzo Lancia est né à Fobello le 24 août 1881. Après avoir fait des études au collège de Varello, son père l’inscrit à l’école technique de Turin où il suit des cours de comptabilité. Son père possède une maison à Turin, sise 9 Corso Vittorio Emanuele, où la famille Lancia séjourne en hiver. Dans la cour de cette maison, un petit atelier composé de deux pièces est loué par un constructeur de bicyclettes, Giovanni Ceirano. Ce même Ceirano qui aborde la construction d’automobiles de la marque Welleyes en 1898… Inutile de préciser que le jeune Lancia ne se sent pas attiré par la comptabilité, mais se découvre un amour profond pour la soudure, le tour et la mécanique avec Ceirano. Il parvient à convaincre son père d’entrer dans la « Fabbrica di Velocipedi e Vetture Automobili Giovanni Ceirano » en qualité de… comptable.
Lancia est âgé de 17 ans. Il assimile et synthétise si bien les problèmes de la mécanique qu’il surprend le peu d’initiés que compte cette époque. Comme son compagnon Nazzaro, il jouit d’une telle renommée que le chevalier Giovanni Agnelli n’hésite pas à l’engager lorsque la jeune entreprise Fiat reprend l’atelier Ceirano.
Fiat forme ensuite une équipe réunissant ses meilleurs essayeurs dans le but avoué d’engager ses voitures en course automobile: Lancia et Nazzaro en font partie, aux côtés de Cagno et de Luigi Storero. Lancia développe un style de conduite très personnel, puissant, d’une hardiesse calculée. Il est irrésistible quand la voiture n’a aucun problème mécanique. Le jeune homme, pilote remarquable aux nombreuses victoires (plus de vingt), a cependant d’autres idées en tête. Il est ambitieux. Il ne va pas tarder à décider de voler de ses propres ailes et fonde, en novembre 1906, à l’âge de 25 ans, sa propre entreprise automobile, aidé par Claudio Fogolin, avec qui il s’est lié d’amitié durant les années passées chez Fiat. Il inaugure sa première usine à Turin en 1906, sorte de grand atelier aux baies vitrées d’où sortiront les voitures portant son nom.
Pendant ce temps, la Fiat entame, parallèlement à la production d’automobiles, celle d’autobus, de trams, de moteurs marins et aéronautiques. Les exportations d’automobiles atteignent la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche, l’Amérique et l’Australie.
Chapitre 4
L’enfant paraît
Enzo Anselmo Ferrari naît le 18 février 1898 dans la petite ville de Modène, en Italie. En raison d’une tempête de neige, sa naissance n’est enregistrée que deux jours plus tard. Son frère, qui porte le prénom d’Alfredo comme leur père mais que l’on surnomme Dino, est de deux ans son aîné. Femme discrète, sa mère, Adalgisa, veille sur la famille, attentive comme toutes les mamma au bien-être de ses trois hommes. En grandissant, le jeune Enzo s’aperçoit bien vite, dès que ses petites jambes peuvent le porter, qu’il évolue dans un environnement impressionnant. Son père est à la tête d’une petite entreprise de construction métallique qui emploie une trentaine de personnes. Dans cet atelier, au-dessus duquel vit la famille Ferrari, sont assemblées des pièces de ponts et des structures de toitures de gare pour le compte des chemins de fer italiens.
Le rythme de construction des chemins de fer de la jeune République italienne est soutenu autour des années 1870. Grâce au ministre Cavour, l’Italie se dote d’un réseau national. Dans un premier temps, les principales villes de la plaine du Pô sont reliées entre elles, tandis que le reste de la Péninsule est maillée de réseaux isolés disposant tous d’un débouché maritime. La garantie des investissements de l’État dans le domaine des voies ferrées assure l’avenir de l’entreprise paternelle. On peut en déduire que la famille Ferrari n’est pas dans le besoin. Le père est propriétaire d’une des premières voitures en Italie, une De Dion-Bouton, qui hypnotise le petit Enzo.
Le décor est planté. Modène est située près de Milan. Rien n’échappe au grand fleuve pourvoyeur d’une riche agriculture, du Lambrusco, du vinaigre balsamique et du Culatello, ce jambon vieilli lentement aux vapeurs des brouillards s’élevant au-dessus des eaux paresseuses du Pô.
La famille Ferrari est heureuse. Enzo respecte ses parents et adore son frère aîné, avec lequel il partage une réelle complicité. On imagine les deux garçons s’inventant des jeux tournant autour de cet atelier vibrant au rythme des coups de marteau et à l’éclat des étincelles des soudeurs. La beauté du diable se dissimule dans les recoins de cet antre où règne leur père. Les deux frères jouent, comme tous les enfants de leur âge, au ballon, aux petits soldats, avec des jouets en bois si fréquents en Italie à cette époque. Une chose est sûre : Enzo ne collectionne pas les petites Ferrari!
Alfredo Ferrari espère que ses fils reprendront l’entreprise qu’il a développée et qui pourvoie largement au bonheur familial. L’enfance est le temps des rêves, celui où l’on tire sa poudre aux moineaux dans la cour de récréation ou dans les jeux inventés avec les camarades prompts au rire et à la galéjade. C’est le temps des billes et des courses-poursuites.
Le jeune Enzo se dit qu’il aimerait embrasser la carrière de journaliste ou de chanteur d’opéra. Pourquoi l’opéra? Nous ignorons s’il a accompagné son père au Teatro Regio de Turin à l’une ou l’autre occasion, peut-être pour écouter Puccini qui y a crééLa Bohème le 1er février 1896, mais la musique classique est, à l’époque, réservée aux salles de concert. Le phonographe n’est pas encore répandu. Quant à la radio, malgré les expérimentations par voies hertziennes de Guglielmo Marconi à la Villa Griffone dès 1895, elle reste dans les limbes. Cette vocation de chanteur d’opéra semble donc mystérieuse. Les journaux relatent abondamment les représentations les plus cotées de Turin ou de Milan. Ces mêmes journaux que le père lit in extenso pour y retrouver les résultats et les commentaires des courses automobiles qui l’intéressent tout autant que le bel canto, à tel point qu’il décide d’emmener ses deux fils assister à une course locale, la Targa Bologna, le 6 septembre 1908.
Enzo, protégé par une vie familiale bien réglée et peu habitué à de tels déplacements, est intrigué, mais il n’imagine pas une seconde ce qui l’attend. Il est alors âgé de 10 ans.
Dès le premier des dix tours, lorsque passent les voitures de compétition, il ressent un choc violent. Il est projeté dans le monde de la course automobile à la vitesse d’un boulet de canon. Les bolides hauts sur pattes qui foncent en un vacarme assourdissant, vibrant et pétaradant, ont sur lui un effet magnétique. Il est hypnotisé par ces hommes-silhouettes, ces pilotes assis derrière leur volant, le visage noirci par la poussière, le regard invisible derrière les verres des lunettes en cuir aux reflets argentés. Il tente de suivre du regard les traits de lumière, les carrosseries rouges, vertes, bleues qui passent en un arc-en-ciel dansant. Pour lui, c’est le sommet de la bravoure. Ce sont des téméraires qui domptent des monstres rétifs portant des noms qui font se pâmer les foules massées sur les trottoirs: Fiat, Mors, Itala, Clément-Bayard, Lorraine-Dietrich. Les spectateurs citent leurs favoris en les pointant du doigt lorsqu’ils passent dans un nuage de poussière (Lancia, Wagner, Gabriel, Minoia) et frémissent, proches de l’extase, au passage du grand Nazzaro qui file vers la victoire après le recul de son équipier Lancia, alors en tête mais retardé par des ennuis mécaniques.
Le soir venu, assis dans la De Dion-Bouton familiale, l’une des premières voitures roulant dans la Botte au début du nouveau siècle, ébloui, secoué, fatigué, le jeune homme retrouve la maison, des images plein les yeux. Il est interloqué. Il comprend qu’il a vu un sport réservé aux audacieux, des pilotes élevés au rang de vedettes. La vitesse… voilà une vraie vie d’homme! Il comprend, de façon un peu confuse, qu’il est des circonstances, dans la vie, qui font que plus jamais on ne ressemblera à celui qu’on a été. Le soir, dans son lit, le regard perdu au plafond, il se dit que l’art lyrique n’est peut-être pas une si bonne idée. Il lui reste un amour certain pour la littérature. Il dévore, au fil de ses jeunes années, D’Annunzio, Stendhal et aborde, plus tard, la philosophie et plus particulièrement Nietzsche.
Tandis que le fils cadet rêve, le père, satisfait de la journée, garde à l’esprit sa volonté de voir ses fils lui succéder. Il inscrit son aîné dans une école d’ingénierie mécanique. Dino se plie à la volonté paternelle de bonne grâce. Enzo, toujours à l’école, se prend pour Nazzaro et pilote à la récréation des Fiat imaginaires, poursuivi par ses camarades au volant de voitures rivales en des courses débridées. Il lit, à son tour, les journaux à la recherche des résultats des compétitions automobiles et assiste, dès qu’il le peut, à l’une ou l’autre course.
Lorsqu’arrive le moment d’entrer à la grande école où il doit apprendre les mystères des ateliers mécaniques, il n’apprécie pas les bancs, les machines-outils et les leçons. Rêveur dans l’âme, il laisse filer le temps en étant convaincu de devenir pilote, fasciné par la vitesse, le risque et ce sport automobile en plein essor.
Le mois d’août 1914 met un terme provisoire à ses desseins. Enzo est âgé de 16 ans. L’Italie entre en guerre.
Chapitre 5
La Grande Faucheuse
Celle qu’on appellera la Grande Guerre, ravageuse là où elle porte sa fureur destructrice, avale la jeunesse, laissant derrière elle des pays exsangues. Dino Ferrari est appelé sous les drapeaux en 1915. Il se retrouve pilote d’ambulance au front ou mécanicien dans une escadrille aérienne 1. Ceci a son importance.
La famille Ferrari est frappée par un terrible malheur. Alfredo Ferrari meurt brutalement d’une pneumonie. Enzo et sa mère doivent faire face à la faillite : les commandes étant réduites par la guerre, l’entreprise, sans patron et sans ouvriers, éparpillés par la tempête, périclite irrémédiablement. Les Ferrari ont à peine le temps de se remettre de ces deux chocs qu’un nouveau drame survient : Dino décède au front d’un accès de fièvre typhoïde. Ainsi, en moins d’un mois, l’existence paisible de la famille Ferrari est réduite à néant. Enzo, pour survivre et aider sa mère, accepte des petits boulots mal rémunérés.
Mais la guerre a soif de sang et de chair fraîche. Enzo est à son tour appelé sous les drapeaux en 1917. Il est affecté à une unité de montagne équipée de mulets, la 3e division d’artillerie alpine, dans laquelle il se rend compte que son nom est inconnu des officiers. Le soldat Ferrari est un plouc parmi les ploucs. Il vit un calvaire dans les montagnes en hiver, servant de maréchal-ferrant improvisé, dans un régiment qui guerroie au front.
Dans ce climat, les hommes souffrent plus que de raison. Enzo est atteint de pleurésie, une maladie fatale dans la majorité des cas. Il est hospitalisé à Bologne, dans ce qui n’est qu’un immense mouroir pour les cas désespérés.
Jeté (plutôt que déposé) dans un lit, il vit des nuits et des jours cauchemardesques. Il grelotte. L’oreiller est brûlant dès qu’il y pose la tête. Il gît là, dans ce temple renié par les bien-portants. Il croit voir des nonnes, des bonnes sœurs noires, blanches. Il délivre, le pauvre soldat abandonné à son sort... Il erre dans un brouillard torride, rougeâtre.
Mais il refuse de mourir. Il n’est pas comme les autres, offerts à la Camarde. Il se bat pour revoir la lumière du jour, hors de cette folie puant l’abdication de l’âme. Les nuits et les jours coulent.
Il survit miraculeusement et l’armée italienne le libère. « Qui sa come finira? »
Il retrouve la vie, faible, ruisselant de sueur, tremblant sur ses jambes. Il regarde le ciel stupéfiant de beauté, rosi par les derniers feux du crépuscule. Il se révolte. Il ne subira plus jamais l’indifférence de ce monde. Il va lui faire voir ce dont il est capable. Il va réclamer sa part.
C’est un jeune homme de 20 ans, brisé physiquement et mentalement, qui arpente les rues de la ville en 1918. Amer, il comprend de façon confuse qu’il doit se créer un avenir dans cette Italie ruinée. La guerre est terminée. La famine guette à chaque coin de rue. Les gens font la queue à la soupe populaire, l’économie est réduite à néant, le peuple a besoin de redonner un sens à la vie. Ferrari se met en marche. Il prend le train pour Turin. Turin, c’est la grande ville. Turin, c’est la Fiat. La Fiat, c’est du travail. Or, il a en poche une lettre de recommandation de son colonel de régiment.
À peine débarqué à la gare, il se rend sans perdre une minute au siège de l’entreprise, celle qui fabrique les voitures de course de Nazzaro, le cœur empli d’espoir. Il est accueilli dans un petit bureau par un ingénieur à qui il présente fièrement son précieux papier. L’homme, affable, secoue la tête d’un air triste. La recommandation n’a aucune valeur en ces lieux. Il explique à Ferrari que la ville est envahie par des gens sans emploi, des malheureux ruinés par la guerre, des anciens soldats. Il n’a pas de travail à proposer au jeune homme sans aucune qualification dans le domaine de la mécanique.
Ferrari est momentanément frappé d’aphasie. Choqué, il sort du bureau à reculons, en proie à d’étranges sensations. Le plancher vacille sous ses pieds. Après un court moment d’émotion, il s’éloigne en pressant le pas, à la recherche de la porte de sortie. Une fois à l’air libre, il se retourne et regarde avec colère cette maison qui n’a pas voulu de ses services en lui lançant à la figure qu’il n’est qu’un inutile parmi les inutiles. Ses yeux brillent de lueurs étranges. On peut voir dans son regard monter une rage violente.
Il marche sans but. Il avise un banc dans un square, s’y assied. Sentant sa tête prête à éclater sous l’effet de la tension nerveuse, il se met à pleurer.
Autour de lui tournoient les phares blancs des autobus, les lumières des rares voitures. Les gens pressent l’allure sur les trottoirs gris, formant un ballet éphémère d’ombres chinoises reflétées par les vitrines piteusement éclairées des magasins. Personne ne prête attention au jeune Enzo Ferrari, revenu d’entre les mourants, ombre parmi les ombres, sans famille, sans argent, sans projet, perdu dans une ville étrangère.
Chapitre 6
La carrière en déchantant
Dans le chaos, des forces nouvelles apparaissent. Un nouveau pouvoir s’installe dans le pays, qui a l’humeur maussade. C’est le fascisme, créé à Milan en 1918 par un dénommé Benito Mussolini. Celui-ci a rassemblé les Squadristi, les chemises noires, des anciens combattants, des déçus de la vie, des envieux, des ennemis du régime en place, qui se rendent coupables de violences physiques et verbales. Mussolini cherche à se forger une stature internationale et fait occuper les principales villes italiennes par les squadristes en 1922. Avec ses cohortes, Mussolini marche sur Rome cette même année, entraînant un changement formidable dans le pays. Le roi Victor-Emmanuel III lui remet les clefs du pouvoir le 30 octobre, avec la bénédiction des officiers supérieurs et des industriels du nord du pays. Un mois plus tard, il reçoit les pleins pouvoirs économiques et administratifs. Sa réussite suscite de violentes réactions. Il sera l’objet d’une série d’attentats pendant une dizaine d’années. Le régime fasciste naît dans la tourmente et la génère. Mussolini, triomphant, prend le titre officiel de Duce en 1926.
Les fascistes regroupent des éléments nationalistes, syndicalistes, expansionnistes, réclamant tous le progrès social. La lutte contre le communisme a commencé. Mussolini entend redresser l’économie de son pays et l’amener à l’autosuffisance agricole. Il frappe les esprits en asséchant les marais pontins pour gagner des terres et organise une reprise en main des industries chancelantes ; grâce aux accords du Latran, il résout la Question romaine entre l’ex-royaume d’Italie et le Saint-Siège en 1929. La suite sera moins glorieuse.
Pendant ce temps, Ferrari sèche ses larmes. Il est orgueilleux. Il jure de venger cet affront et voue la famille Agnelli aux gémonies. Il se promet de leur rendre la monnaie de leur pièce un jour ou l’autre.
Il finit par trouver un travail de chauffeur pour une entreprise transformant des châssis de camions militaires légers en voitures. Son job est de les conduire à Milan, l’autre grande ville industrielle du nord de l’Italie, où ils sont carrossés puis vendus. Milan, où est née une autre marque automobile de la volonté d’un Français, Alexandre Darracq, qui souhaitait vendre ses voitures en Italie.
En 1906, en raison des barrières douanières, celui-ci choisit d’installer sa propre usine dans la Péninsule, à Naples puis à Milan. L’affaire tourne court. En 1909, un groupe d’industriels et de financiers rachète l’entreprise et constitue, le 24 juin 1910, la société Alfa, pour « Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ». La toute première Alfa voit le jour en 1911, mais la jeune société ne dégage aucun bénéfice malgré l’accueil chaleureux du public. La guerre entraîne la faillite. Un institut d’État confie la gestion du dossier Alfa à Nicola Romeo, un industriel milanais qui a obtenu de grosses commandes dans le domaine militaire. L’usine du Portello, nom donné à l’usine Alpha Romeo, abandonne les automobiles pour les munitions et les moteurs d’avions. Les profits ne tardent pas et Romeo intègre Alfa à son propre empire industriel. La guerre finie, il l’appelle Alfa Romeo. Avisé, sans états d’âme, Romeo – et c’est un miracle pour Alfa Romeo – aime l’automobile et met en chantier une petite production en 1919. Son ingénieur en chef, Merosi, travaille à une nouvelle voiture, une RL à moteur six cylindres. Cette magnifique machine lancera l’aventure Alfa Romeo, deviendra sa vitrine dans le monde entier et remportera la Targa Florio en 1923.
Mais revenons à Enzo Ferrari, qui fait des allers-retours entre Turin et Milan en caressant toujours le rêve de devenir journaliste sportif ou pilote. Il fréquente assidûment les bars des deux villes, au hasard de ses pérégrinations. Il sait où se retrouvent les passionnés d’automobile et de course. Une fraternité qu’il apprend à connaître rapidement et avec laquelle il établit des liens.
À Milan, il se noue d’amitié avec un ancien motocycliste de compétition devenu essayeur pour la marque CMN, Ugo Sivocci.
CMN (« Costruzioni Meccaniche Nationali »), marque lancée en 1919, entend engager des voitures quatre cylindres en ligne à la Targa Florio et charge Sivocci de diriger les opérations. Pour disputer l’épreuve sicilienne, il conduit la voiture lui-même et prend Ferrari comme assistant. Il l’installe dans l’un des deux baquets. Ferrari raconte une histoire étonnante et un peu fantastique à propos de cette course 2 : ils décident de se rendre au départ par la route de Milan à Naples pour embarquer sur un bateau en partance pour la Sicile. Ils sont retardés par un incident: alors qu’ils traversent les Abruzzes, ils sont poursuivis par des loups et doivent utiliser le pistolet que Ferrari emporte toujours avec lui avant d’être secourus par des hommes armés de torches et de fusils de chasse! La course en elle-même est une succession d’aventures : réservoir d’essence détaché, arrêt obligé à Campo Felice pour le discours du président du Conseil… Quand CMN rejoint l’arrivée à la neuvième place, il n’y a plus de spectateurs. Ils ont tous pris le dernier train pour Palerme. Seul un carabinier les attend, chargé de noter les résultats.
La petite marque CMN doit faire face à deux puissances grandissantes, la Fiat et Alfa Romeo, dont l’ambitieux programme de compétition a de quoi l’inquiéter. De plus, une autre maison a pris son essor en 1914, juste avant la guerre, rue Pepoli à Bologne, et commence aussi à faire parler d’elle : c’est la Société anonyme des usines Alfieri Maserati, dans laquelle se retrouvent sept frères (dont le père était, comme le père Ferrari, actif dans l’industrie du chemin de fer). Alfieri Maserati, l’un des frères, a travaillé chez Isotta Fraschini dès 1903. Il s’affirme comme un technicien doué et un pilote hors pair. C’est lui qui dessine et construit les moteurs sportifs pour Isotta. Une fois installés dans leur atelier de Bologne, les Maserati vont préparer des voitures de compétition.
De fait, tous les constructeurs se lancent dans la course automobile et CMN n’a pas les reins assez solides pour suivre le mouvement, ce qui précipite sa faillite en 1923.
À cette époque, Enzo Ferrari rencontre Laura Domenica Garello, une femme mystérieuse de 21 ans qui hante les cafés et trattorias fréquentés par la faune des amateurs de courses automobiles. Elle devient rapidement sa confidente, puis ils ne se quittent plus. Elle tient un rôle d’éminence grise dès le début de leur relation amoureuse.
Les témoignages sur ses origines diffèrent. Certains disent qu’elle est issue d’un milieu turinois aisé, d’autres sources affirment que c’est une professionnelle arpentant les rues de la ville. Il est sage de dire que sa vie, avant sa rencontre avec Ferrari, reste un mystère. Toujours est-il qu’elle le suit sur tous les circuits, dans le moindre de ses déplacements. Ils se présentent comme une couple officiel. Ils partagent une trépidante vie commune avant de se marier en 1923.
Curieusement, quelques mois plus tard, Enzo Ferrari reprend sa vie sociale comme s’il était toujours célibataire, ne se privant pas d’apparaître dans des soirées ou des réceptions en compagnie de femmes habituées à fréquenter le milieu de la course automobile.
Selon l’un de ses vieux amis, le carrossier Sergio Scaglietti, Ferrari est un incorrigible coureur de jupons : « C’était un homme. Pourquoi n’aurait-il pas pu aimer une jolie femme? Oui, il aimait les femmes et quand elles étaient belles, il les aimait encore plus! »
Ferrari exprimera assez clairement ses sentiments quant à la gent féminine. « Je n’ai guère affaire avec les femmes que l’on trouve dans le stand Ferrari. Je sais que tous nos pilotes ont un ou deux supporters du beau sexe, mais je préfère ne pas les voir. Dans ce monde de la course automobile, il y a déjà assez de complications comme cela sans faire venir les femmes ou en apporter d’autres 3. »
En fait, après un peu plus d’une année de vie commune, Enzo et Laura ne s’entendent plus. Leur quotidien à la maison est constellé de disputes. Ferrari suit sa route, imperturbable. Il ne veut aucune entrave, rien qui soit susceptible de freiner son ascension, qu’il forge à coup d’audaces et de réflexions profondes. Il a un but et il le poursuit sans relâche, avec une volonté de fer: réussir et prendre une revanche sur ceux qui, jadis, lui ont fait comprendre qu’il n’était rien.
Chapitre 7
En gagnant son pain
Enzo Ferrari parvient à se faire engager chez Alfa Romeo en tant que pilote d’essai. Il demande à Sivocci de le suivre. Ils font partie des pilotes d’usine qui sont, avant tout, des « essayeurs ». L’usine leur confie des voitures de course avant d’engager celles-ci dans les épreuves.
Enzo Ferrari participe à dix-neuf courses dans lesquelles, selon les archives de l’Automobile Club d’Italie, il se classe, mais il y a contestation sur le nombre précis de courses effectivement disputées. Quoi qu’il en soit, entre 1920 et 1931, il mène des voitures dans plusieurs compétitions de seconde importance, à de rares exceptions près. La naissance de son fils Dino mettra fin à sa carrière de pilote en 1932.
En réalité, Ferrari n’est pas un grand pilote. L’équipe Alfa Romeo du début des années 1920 comporte quelques grands noms qui lui sont intrinsèquement supérieurs: Antonio Ascari, Giuseppe Campari, Sivocci et, surtout, les nouveaux venus, anciens pilotes de motos, Tazio Nuvolari et Achille Varzi. Face à ces vrais talents, dont les deux derniers ne tarderont pas à devenir professionnels, il donne l’image d’un joyeux dilettante à qui on ne confie pas les nouvelles Alfa Romeo P2. La seule fois où il a l’occasion de prendre part au Grand Prix de France, à Lyon en 1924, au volant d’une P2, il est malade et doit renoncer. Maladie de circonstance ou peur de se mesurer aux « gros bras » dans de réelles conditions de compétition internationale? La question reste posée.
L’année précédente, Ferrari a acquis la confiance de ses employeurs au point de devenir une sorte d’organisateur du service compétition. Est-ce dans les années 1920 que ses aptitudes sont repérées par la direction d’Alfa Romeo