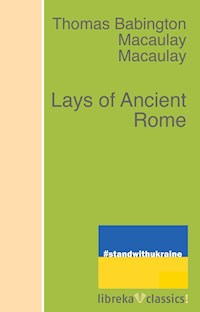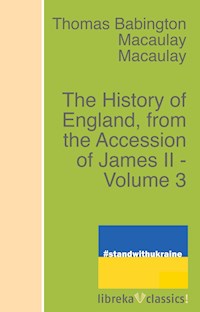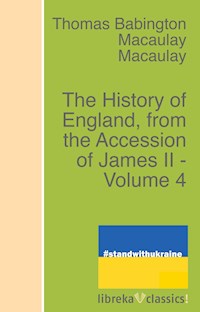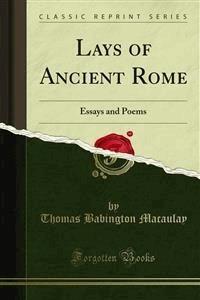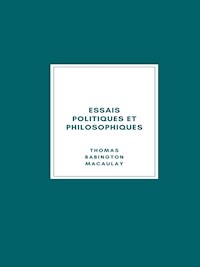
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ceux qui ont accordé quelque attention aux pratiques de notre tribunal littéraire se sont assurément aperçus qu’au moyen de certaines fictions légales semblables à celles de Westminster-Hall, nous arrivons souvent à prendre connaissance d’affaires qui ne rentrent pas strictement dans les limites de notre compétence primitive. Nous avons donc à peine besoin de dire que, dans le cas présent, M. Périer est uniquement un Richard Roe 1dont il ne sera plus fait mention dans aucune des phases successives de la procédure et dont le nom n’est introduit ici qu’à seule fin d’amener Machiavel devant la Cour. Nous doutons que, dans l’histoire littéraire, aucun nom soit aussi généralement odieux que celui de l’homme dont nous nous proposons aujourd’hui d’examiner le caractère et les écrits.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ESSAIS POLITIQUES ET PHILOSOPHIQUES
PAR LORD MACAULAY
TRADUITS PAR
GUILLAUME GUIZOT
Traduction autorisée par l’auteur
Machiavel et l’Italie. — Lord Bacon et sa philosophie. — De la papauté. — Des rapports de l’Église et de l’ État. Des incapacités politiques des Juifs. — M. James Mill et les théories utilitaires en matière de gouvernement.
© 2020 Librorium Editions
Tous Droits Réservés
MACHIAVEL — MARS 1827. — Œuvres complètes de Machiavel, traduites par J, V. Périer. PARIS, 1825.
Ceux qui ont accordé quelque attention aux pratiques de notre tribunal littéraire se sont assurément aperçus qu’au moyen de certaines fictions légales semblables à celles de Westminster-Hall, nous arrivons souvent à prendre connaissance d’affaires qui ne rentrent pas strictement dans les limites de notre compétence primitive. Nous avons donc à peine besoin de dire que, dans le cas présent, M. Périer est uniquement un Richard Roe 1dont il ne sera plus fait mention dans aucune des phases successives de la procédure et dont le nom n’est introduit ici qu’à seule fin d’amener Machiavel devant la Cour. Nous doutons que, dans l’histoire littéraire, aucun nom soit aussi généralement odieux que celui de l’homme dont nous nous proposons aujourd’hui d’examiner le caractère et les écrits. Les expressions qu’on emploie d’ordinaire pour le désigner semblent impliquer qu’il a été le tentateur, le mauvais esprit, le révélateur de l’ambition et de la vengeance, l’inventeur original du parjure, et qu’avant la publication du Prince, son œuvre fatale, il n’y avait jamais eu ni un hypocrite, ni un tyran, ni un traître, ni une vertu simulée, ni un crime utilitaire. Un auteur assure gravement que Maurice de Saxe avait appris dans cet exécrable volume toute sa politique frauduleuse. Un autre a remarqué que, depuis la traduction de ce livre en turc, les sultans se sont beaucoup plus adonnés que par le passé à l’usage d’étrangler leurs frères. Lord Lyttelton rend le pauvre Florentin responsable des trahisons répétées de la maison de Guise et du massacre de la Saint-Barthélémy. Divers écrivains ont donné à entendre que la conspiration des poudres doit être principalement attribuée à ses doctrines, et ils semblent penser que son effigie devrait être substituée à celle de Guy Faux, dans ces processions par lesquelles la spirituelle jeunesse de l’Angleterre célèbre l’anniversaire de la conservation des trois pouvoirs. L’Église de Rome a maudit ses ouvrages ; et quant à nos compatriotes, ils ne sont point restés en arrière dans leur façon de manifester ce qu’ils pensent de ses mérites. Ils ont pris son nom de famille pour en forger une épithète à l’adresse des fourbes, et ils ont donné son nom de baptême pour synonyme à celui du Diable 2.
Il est en effet presque impossible à ceux qui ne sont pas bien instruits de l’histoire et de la littérature italiennes, de lire sans horreur et sans stupéfaction le célèbre traité qui a attiré tant d’attaques sur le nom de Machiavel. Un tel étalage d’une perversité si nue, et pourtant si peu honteuse d’elle-même, une atrocité à ce point froide, judicieuse, réduite en science, paraissent être d’un démon plutôt que d’un homme, fût-il le plus dépravé des hommes. Des principes que le scélérat le plus endurci oserait à peine invoquer par un sous-entendu, devant le mieux éprouvé de ses complices, ou qu’une s’avouerait point à lui-même sans les déguiser sous quelque sophisme atténuant, sont professés sans la moindre circonlocution et pris pour axiomes fondamentaux de la science politique tout entière.
Il n’est pas singulier que les lecteurs ordinaires considèrent l’auteur d’un tel livre comme la plus dépravée et la plus éhontée des créatures humaines. Mais les hommes sages ont toujours été enclins à regarder de près, et d’un œil très-méfiant, les anges et les démons que fait la multitude ; et dans le cas qui nous occupe, diverses circonstance sont conduit des observateurs même superficiels à mettre en question la justice de la décision vulgaire. Il est notoire que Machiavel fut, pendant toute sa vie, un zélé républicain. Dans le cours de l’année même où il composa son manuel de l’art de régner, il subit l’emprisonnement et la torture pour la cause des libertés publiques. Il semble inconcevable que le martyr de la liberté ait pu se poser, de propos délibéré, en apôtre de la tyrannie. Aussi, plusieurs auteurs éminents ont ils cherché à découvrir, dans cette œuvre malheureuse, un sens caché, plus conciliable avec le caractère et la conduite de l’auteur que le sens qui se révèle à première vue.
Une des hypothèses consiste à dire que Machiavel a voulu user envers le jeune Laurent de Médicis d’une ruse semblable à celle que Sunderland employa, dit-on, contre notre Jacques II, et qu’il a poussé son disciple à des mesures violentes et perfides, parce que ce moyen lui semblait le plus sûr pour accélérer le moment de la délivrance et de la vengeance. D’autres ont supposé, et lord Bacon paraît appuyer cet avis, que ce traité était purement une œuvre d’ironie grave, destinée à mettre les nations en garde contre les artifices des ambitieux. Il serait aisé de montrer que ni l’une ni l’autre de ces solutions ne s’accorde avec un grand nombre de passages du livre lui-même. Mais la réfutation la plus décisive, est fournie par les autres ouvrages de Machiavel. Dans tous les écrits qu’il a donnés au public, et dans tous ceux que les recherches de ses éditeurs ont mis au jour depuis trois siècles, dans ses comédies destinées au divertissement de la multitude, dans ses Commentaires sur Tite-Live écrits à l’usage des patriotes florentins les plus enthousiastes, dans son Histoire dédiée à l’un des plus aimables et des plus estimables d’entre les papes, dans ses dépêches publiques, dans ses notes particulières, partout on discerne plus ou moins cette même déviation du principe moral qui est si sévèrement reprochée au Prince, et nous doutons qu’il soit possible de découvrir, dans la volumineuse collection de ses œuvres, une seule expression d’où l’on puisse conclure que la trahison ou la feinte ait jamais produit sur lui l’effet d’un acte déshonorant.
Cela dit, il peut sembler ridicule d’affirmer que nous connaissons peu d’écrits où se manifeste une aussi grande élévation de sentiments que dans ceux de Machiavel, un zèle aussi pur et aussi chaleureux pour le bien public, des vues plus justes sur les devoirs et les droits des citoyens. C’est pourtant un fait, et nous pourrions extraire du Prince même bien des passages à l’appui de cette, remarque. Une telle inconséquence est parfaitement propre à mettre aux abois un lecteur de notre temps et de notre pays. L’homme tout entier, en Machiavel, semble n’être qu’une énigme, un grotesque assemblage de qualités incongrues. Égoïsme et générosité, cruauté et bienveillance, ruse et simplicité, bassesse abjecte, et héroïsme romanesque. Voilà une phrase qu’un vétéran de la diplomatie écrirait à peine en chiffres pour l’instruction de son espion le plus confidentiel ; et tout de suite après, en voici une autre qui semble extraite d’un discours composé sur la mort de Léonidas par un ardent écolier. Un acte d’adroite perfidie et un acte de dévouement patriotique provoquent la même sorte et la même mesure de respectueuse admiration. Le sens moral de l’écrivain semble à la fois maladivement émoussé et maladivement aiguisé. Deux natures de tout point dissemblables sont unies en lui. Elles ne sont pas seulement jointes, elles sont entrelacées. L’une est la chaîne, l’autre est la trame de son esprit ; et leur combinaison, comme celle des fils variés dans le taffetas chatoyant, donne à tout le tissu une apparence mobile et multiple. L’explication serait facile à donner si Machiavel avait été un homme très faible ou très-affecté. Mais il n’était évidemment ni l’un ni l’autre. Ses œuvres prouvent sans réplique que son intelligence était puissante, son goût pur, et son sens du ridicule fin jusqu’à être exquis.
Cela est fort étrange ; mais voici qui est plus étrange encore. Il n’y a aucune raison de croire que ceux parmi lesquels il a vécu aient vu dans ses écrits quoi que ce soit de choquant ou d’inconvenant. On a conservé d’abondantes preuves de la haute estime où ses œuvres et sa personne étaient tenues par les plus respectables de ses contemporains. Clément VII fut, lors de leur publication, le patron de ces mêmes livres que le Concile de Trente devait, à la génération suivante, déclarer impropres à être lus par des chrétiens. Quelques membres du parti démocratique blâmèrent le Secrétaire d’avoir dédié le Prince à un patron qui portait le nom impopulaire de Médicis. Mais il ne paraît pas qu’aucune réserve ait été faite contre ces doctrines immorales qui ont suscité plus tard une répréhension si sévère. Le cri qui s’éleva contre elles prit naissance de l’autre côté des Alpes, et semble avoir été entendu d’abord avec étonnement en Italie. Celui qui les attaqua le premier fut, si nous ne nous trompons, un de nos-compatriotes, le cardinal Pôle. L’auteur de l’Anti-Machiavel fut un protestant français.
C’est donc dans l’état des sentiments moraux parmi les Italiens du temps que nous devons chercher l’explication vraie de ce qui semble le plus mystérieux dans la vie et les écrits de cet homme remarquable, et comme c’est là un sujet qui suggère beaucoup de considérations intéressantes, tant en politique qu’en métaphysique, nous ne nous excuserons pas de le discuter un peu longuement.
Pendant les siècles sombres et désastreux qui suivirent la chute de l’Empire romain, les tracés de l’ancienne civilisation restèrent beaucoup plus marquées en Italie que dans tout le reste de l’Europe occidentale. La nuit qui vint sur elle fut comme une nuit d’été au pôle arctique. Le crépuscule commença à reparaître avant que les derniers reflets du soleil couchant se fussent effacés à l’horizon. C’est au temps des Mérovingiens de France et de l’Heptarchie saxonne que l’ignorance et la férocité semblent avoir été à leur comble. Alors même, cependant, les provinces napolitaines qui reconnaissaient l’autorité de l’empereur d’Orient, conservaient quelque chose du savoir et des raffinements orientaux. Rome, protégée par le caractère sacré de ses pontifes, jouissait d’une sécurité et d’un repos au moins relatifs, et jusque dans les régions où les sanguinaires Lombards avaient établi leur monarchie, il y avait incomparablement plus de richesse, d’instruction, de bien-être matériel et d’ordre social qu’en Gaule, en Bretagne ou en Germanie.
Ce qui distingua surtout l’Italie des pays voisins, ce fut l’importance que la population des villes commença de très-bonne heure à y acquérir. Quelques cités avaient été fondées dans des positions retirées et sauvages, par des fugitifs qui avaient échappé à la rage des barbares. Telles furent Venise et Gênes, qui durent leur liberté à leur obscurité jusqu’au jour où elles furent capables de ne la devoir qu’à leur force. D’autres cités paraissent avoir gardé, sous les dynasties sans cesse changeantes des envahisseurs, sous Odoacre et Théodoric, sous Narsès et Alboin, les institutions municipales qui leur avaient été conférées par la politique libérale de la grande République. Dans les provinces que le gouvernement central était trop faible pour protéger ou pour opprimer, ces institutions acquirent graduellement de la stabilité et de la vigueur. Les citoyens, défendus par leurs murs, gouvernés par leurs propres magistrats et leur propre droit coutumier, avaient une large part d’indépendance républicaine. Ainsi fut mis en œuvre un esprit démocratique très-puissant. Les souverains carlovingiens furent trop faibles pour le dompter. La politique généreuse d’Othon l’encouragea. Peut-être une coalition étroite entre l’Église et l’Empire aurait-elle pu l’étouffer. Mais leurs disputés l’entretinrent et le fortifièrent. Au douzième siècle, il avait atteint sa pleine vigueur, et, après une lutte longue et d’abord douteuse, il triompha de l’habileté et du courage de la maison de Souabe.
L’appui du pouvoir ecclésiastique avait grandement contribué au succès des Guelfes. Ce succès, pourtant, n’aurait été qu’un bonheur fort douteux, s’il n’avait eu pour effet que de substituer une servitude morale à une servitude politique, et de grandir les Papes aux dépens des Césars. Heureusement l’esprit public en Italie portait depuis longtemps en son sein le germe des opinions libres, germe qui se développa bientôt rapidement sous la féconde influence des institutions libres. Les hommes de ce pays avaient observé trop longtemps, et de trop près pour en être dupes, tout le mécanisme de l’Église, ses saints et ses miracles, ses prétentions hautaines et ses splendides cérémonies, ses bénédictions inutiles et ses innocentes malédictions. Les Italiens étaient dans la coulisse, derrière la scène que d’autres contemplaient avec un effroi et un intérêt puérils. Ils assistaient au jeu des poulies et à la fabrication des tonnerres. Ils voyaient les visages naturels, ils entendaient les voix naturelles des acteurs. Les nations lointaines regardaient le Pape comme le vicaire du Tout-Puissant, l’oracle de la Sagesse éternelle, l’arbitre dont les décisions, dans les disputes des théologiens ou des rois, devaient être souveraines et sans appel pour un chrétien. Les Italiens, dans le Pape, connaissaient l’homme ; ils connaissaient toutes les folies de sa jeunesse et tous les artifices malhonnêtes par lesquels il était arrivé au pouvoir. Ils savaient combien de fois il s’était servi des clefs de l’Église pour se délier lui même des engagements les plus sacrés, et des biens de l’Église pour rassasier ses maîtresses et ses neveux. Ils traitaient avec un décent respect les doctrines et les rites de la religion établie. Mais tout en s’appelant encore catholiques, ils avaient cessé d’être papistes. Ces armes spirituelles, qui portaient la terreur dans les palais et les camps des plus fiers souverains, n’excitaient que le mépris dans le voisinage immédiat du Vatican. Alexandre III, lorsqu’il somma Henri II de se soumettre à recevoir la discipline devant l’a tombe d’un sujet rebelle, était lui-même en exil. Les Romains, craignant qu’il ne nourrît de mauvais desseins contre leurs libertés, l’avaient chassé de leur cité ; et bien qu’il promît solennellement de se renfermer à l’avenir dans les limites de ses fonctions spirituelles, ils refusaient encore de l’admettre de nouveau.
Dans tout le reste dé l’Europe, une classe privilégiée, nombreuse et puissante, écrasait le peuple et défiait le gouvernement. Mais dans les parties les plus florissantes de l’Italie, la noblesse féodale était relativement réduite à l’insignifiance. Dans quelques districts les nobles allaient chercher un abri sous la protection des puissantes républiques contre lesquelles ils n’étaient pas en état de lutter, et peu à peu ils se confondaient avec la masse des bourgeois. Ailleurs ils possédaient une grande influence ; mais c’était une influence bien différente de celle qu’exerçait l’aristocratie d’un royaume transalpin. Ce n’étaient pas de petits princes, c’étaient des citoyens éminents. Au lieu de fortifier leurs donjons dans les montagnes, ils embellissaient leurs palais sur la place du marché. L’état social, dans les provinces napolitaines et dans celles de l’Église, ressemblait davantage à celui des grandes monarchies occidentales. Mais les gouvernements de Lombardie et de Toscane conservaient, à travers toutes leurs révolutions, un caractère fort différent. Un peuple, quand il est rassemblé dans une ville, est bien plus formidable pour ses maîtres que lorsqu’il est dispersé sur une grande étendue de pays. Les plus arbitraires des Césars sentirent la nécessité de nourrir et de divertir aux dépens des provinces les habitants de leur incommode capitale. Les citoyens de Madrid ont plus d’une fois assiégé leur souverain dans son propre palais, et lui ont extorqué les concessions les plus humiliantes. Les sultans ont été souvent contraints d’apaiser la populace furieuse de Constantinople, par la tête d’un vizir impopulaire. Pour la même cause, il y avait une certaine teinte de démocratie dans les monarchies et les aristocraties de l’Italie septentrionale.
C’est ainsi que la liberté, une liberté imparfaite et peu durable sans doute, vint de nouveau visiter l’Italie ; et avec elle le commerce et l’empire, la science et le goût, toutes les jouissances, tous les ornements de la vie. Les croisades, qui ne rapportèrent aux habitants des autres pays que des reliques et des blessures, amenèrent pour les républiques naissantes de l’Adriatique et de la mer Tyrrhénienne, un grand accroissement de richesse, de pouvoir et de savoir. La situation morale et géographique de ces républiques leur permit de profiter à la fois de la barbarie occidentale et de la civilisation orientale. Des vaisseaux italiens couvraient toutes les mers ; des comptoirs italiens s’élevaient sur toutes les côtes. Les tables des changeurs italiens s’établissaient dans toutes les cités. Les manufactures florissaient. Des banques se fondaient. Les opérations commerciales étaient facilitées par des inventions ingénieuses et utiles. Je doute qu’aucun pays en Europe, si ce n’est le nôtre, ait atteint aujourd’hui le degré de richesse et de civilisation auquel certaines parties de l’Italie étaient parvenues il y a quatre cents ans. Les historiens descendent rarement à ces détails qui seuls peuvent donner une idée de la condition réelle d’un État. La postérité est ainsi souvent trompée par les vagues hyperboles des poëtes et des rhétoriciens, qui prennent la splendeur d’une cour pour la félicité d’un peuple. Heureusement Jean Villani nous a donné un exposé à la fois ample et précis de l’état de Florence, au commencement du quatorzième siècle. Le revenu de la république s’élevait à trois cent mille florins, somme qui équivaut au moins à six cent mille livres sterling (si nous tenons compte de la dépréciation des métaux précieux), somme supérieure à celle que l’Angleterre et l’Irlande fournissaient annuellement à Elisabeth il y a deux siècles. L’industrie de la laine occupait seule deux cents établissements et trente mille ouvriers. Les tissus produits annuellement se vendaient en moyenne douze cent mille florins, ce qui représente au moins deux millions cinq cent mille livres sterling. Quatre cent mille florins étaient annuellement frappés. Quatre vingts banques dirigeaient les opérations commerciales, non-seulement de Florence, mais de l’Europe entière. Les affaires entreprises par ces établissements avaient parfois une grandeur qui pourrait surprendre les contemporains eux-mêmes des Barings et des Rothschilds. Deux maisons avancèrent à Edouard III d’Angleterre plus de trois cent mille marcs, à une époque où le marc renfermait plus d’argent que cinquante de noschellings, et où la valeur de l’argent était au moins quatre fois plus grande qu’aujourd’hui. La cité et ses environs renfermaient cent soixante-dix mille habitants. Dix mille enfants apprenaient à lire dans les diverses écoles ; douze cents étudiaient l’arithmétique ; six cents recevaient une éducation libérale.
Le progrès des arts et des lettres était proportionné à celui de la prospérité publique. Sous les despotiques successeurs d’Auguste, tous les champs de l’intelligence avaient été changés en déserts arides, divisés encore par les vieux bornages, portant encore les traces d’une ancienne culture, mais ne produisant plus ni fleurs ni fruits. Le déluge de la barbarie arriva. Il renversa toutes les divisions. Il effaça toute trace de culture. Mais il fertilisa en dévastant. Lorsque le flot se retira, le désert devint comme le jardin de Dieu. Partout des réjouissances, des rires, des battements de mains, une production abondante et spontanée de tout ce qui brille, de tout ce qui parfume, de tout ce qui nourrit. Un nouveau langage, que caractérisent à la fois une simple douceur et une simple énergie, avait atteint la perfection. Jamais idiome n’avait fourni à la poésie des teintes plus vives et plus magnifiques, et bientôt se présenta un poëte digne de les manier. Le commencement du quatorzième siècle vit apparaître la Divine Comédie, sans comparaison la plus grande œuvre d’imagination, depuis les poëmes d’Homère. La génération suivante ne produisit pas, il est vrai, un second Dante ; mais elle se distingua, au plus haut degré, par une activité intellectuelle générale. L’étude des écrivains latins n’avait jamais été tout à fait négligée en Italie. Mais Pétrarque introduisit une érudition plus profonde, plus libérale, plus élégante, et il communiqua à ses concitoyens cet enthousiasme pour la littérature, l’histoire et les antiquités de Rome, qui le disputa, dans son propre cœur, à une glaciale maîtresse et à une Muse plus glaciale encore. Boccace attira leur attention vers les modèles plus sublimes et plus gracieux de la Grèce.
A partir de cette époque, le culte des lettres et du génie devint presque idolâtre parmi les Italiens. Les rois et les républiques, les cardinaux et les doges comblaient Pétrarque d’honneurs et de flatteries, à l’envi les uns des autres. Les ambassadeurs des États rivaux sollicitaient l’honneur de ses instructions. Son couronnement agita la cour de Naples et le peuple de Rome aussi profondément que les plus grandes questions politiques. Réunir des livres et des antiques, fonder des chaires, patronner des hommes de lettres, ce fut une mode presque universelle parmi les grands. L’esprit de curiosité littéraire s’associait à l’esprit d’entreprise Commerciale. Tous les lieux où les principaux marchands de Florence étendaient leur gigantesque trafic ; depuis les bazars du Tigre jusqu’aux monastères de la Clyde, étaient fouillés pour y découvrir des médailles et des manuscrits. L’architecture, la peinture, la sculpture étaient magnifiquement encouragées ; si bien qu’il serait difficile de nommer un Italien de quelque importance, à l’époque dont nous parlons, qui n’ait pas au moins affecté l’amour des lettres et des arts.
Le savoir et la prospérité publique continuèrent à marcher du même pas. Ils furent à leur apogée au siècle de Laurent le Magnifique. Nous ne pouvons résister à la tentation de reproduire l’admirable passage, dans lequel le Thucydide toscan décrit l’état de l’Italie à cette époque : « Ridotta tutta in somma pace e tranquillità, coltivata non meno ne’luoghi più montuosi e più sterili che nelle pianure e regioni più fertili, ne sottoposta ad altro imperioche de’suoi medesimi, non solo era abbondan-tissima d’abitatori e di ricchezze ; ma illustrata sommamentedalla magnificenza di molti principi, dallo splendore di moite nobilissime e bellissime città, dalla sedia e maestà della religione, fioriva d’uomini prestantissiminell’amministrazione delle cose pubbliche, e d’ingegnimolto nobili in tulle le scienze, ed in qualunque arte preclara ed industriosa 3. » Quand on parcourt cette description si magnifique et si exacte, on a peine à se convaincre qu’il s’agit d’un temps pendant lequel les annales de l’Angleterre et de la France ne présentent que d’effroyables spectacles de pauvreté, de barbarie et d’ignorance. Après avoir assisté à la tyrannie de maîtres illettrés et aux souffrances de paysans dégradés, il est délicieux de tourner son regard vers les États opulents et éclairés de l’Italie, vers ces vastes et magnifiques cités, ces ports, ces arsenaux, ces villas, ces musées, ces bibliothèques, ces marchés remplis de tous les éléments du luxe et du bien-être, ces manufactures fourmillant d’ouvriers, ces Apennins couverts jusqu’à leurs sommets de riches cultures, ce Pô portant les moissons de la Lombardie aux greniers de Venise, et amenant en retour dans les palais de Milan, les soies du Bengale et les fourrures de la Sibérie. Tout esprit cultivé doit surtout reposer sa vue avec un plaisir particulier sur la belle, l’heureuse, la glorieuse Florence, sur les salles que fit retentir la gaieté de Pulci, sur la cellule où scintilla là lampe de Politien, sur les statues que le jeune Michel Ange dévora du regard avec la frénésie d’une inspiration parente de celle qui les avait créées, sur les jardins où Laurent composa des chants étincelants pour accompagner, le premier de mai, les danses des vierges étruriennes. Hélas ! il faut pleurer sur cette belle cité ! Hélas ! il faut pleurer sur l’esprit et le savoir, le génie et l’amour !
« Le donne, e i cavalier, gli affanni e gli agi, Che ne’nvogliava amore e cortesia, Là dove i cuor son fatti si malvagi 4. »
Le temps était proche où les sept coupes de l’Apocalypse allaient être versées et secouées sur ce charmant pays, temps de massacre, de famine, de misère, d’infamie, d’esclavage, de désespoir.
Dans les États italiens, comme dans beaucoup de corps naturels, une décrépitude prématurée fut la peine d’une maturité précoce. C’est à la même cause, c’est à la prépondérance que les villes avaient acquise dans le système politique, qu’il faut attribuer principalement et leur jeune grandeur et leur jeune déclin.
Dans une société de chasseurs et de bergers, tout homme devient aisément et nécessairement un soldat. Les occupations habituelles sont parfaitement compatibles avec tous les devoirs du service militaire. Quelque lointaine que soit l’expédition dont il est chargé, il trouve facile de transporter avec lui le capital d’où il tire sa subsistance. Tout le peuple est une armée, toute l’année est une marche. Tel fut l’état social qui facilita les conquêtes gigantesques d’Attila et de Tamerlan.
Mais un peuple qui vit de la culture du sol, est dans une situation très différente. Le paysan est lié à la terre qu’il laboure. Une longue campagne serait une ruine pour lui. Cependant les travaux auxquels il se livre sont de nature à donnera son tempérament cette faculté énergique d’agir et de souffrir qui est nécessaire au soldat. Et d’ailleurs ces travaux n’exigent pas de lui, au moins dans l’enfance de la science agricole, une constante attention. A certaines époques de l’année, il a du loisir, et il peut, sans se faire tort, trouver le temps nécessaire à de courtes expéditions. C’est ainsi que les légions de Rome se formaient dans les premières guerres. La saison pendant laquelle les champs ne réclamaient point la présence des cultivateurs, suffisait à de courtes incursions et à une bataille. Ces opérations, trop souvent interrompues pour produire des résultats décisifs, servaient cependant à entretenir dans le peuple un degré de discipline et de courage, qui non-seulement lui donnait la sécurité, mais le rendait formidable. Les archers et les piquiers du moyen âge, qui, portant sur leurs dos des provisions pour quarante jours, quittaient les champs pour les camps, étaient des troupes de même nature.
Mais lorsque le commerce et l’industrie commencent à fleurir, un grand changement se produit. Les habitudes sédentaires que l’on contracte devant un bureau ou derrière un métier, rendent insupportables les travaux et les fatigues de la guerre. Les affaires des négociants et des artisans demandent une présence et une attention constantes. Dans une telle société, il n’y a point de temps superflu ; et il y a au contraire un grand superflu d’argent. On en vient donc à louer quelques membres de la communauté pour affranchir les autres d’une tâche incompatible avec leurs habitudes et leurs occupations.
L’histoire de Grèce est, sur ce point comme sur tant d’autres, le meilleur commentaire de l’histoire d’Italie. Cinq cents ans avant l’ère chrétienne, les citoyens des républiques de la mer Égée formaient peut-être la plus belle milice qui ait jamais existé. Mais à mesure que la richesse et le luxe se développèrent, le système subit une altération graduelle. Les États ioniens furent les premiers dans lesquels le commerce et les arts grandirent, et les premiers dans lesquels l’ancienne discipline déchut. Quatre-vingts ans environ après la bataille de Platée, c’étaient des troupes mercenaires qui partout se, chargeaient des batailles et des sièges. Au temps de Démosthènes, il était à peine possible d’entraîner ou de contraindre les Athéniens à servir au dehors. Les lois de Lycurgue proscrivaient le commerce et les manufactures. Aussi les Spartiates conservent-ils une armée nationale, longtemps après que leurs voisins eurent commencé à louer des soldats. Mais leur esprit militaire déclina en même temps que leurs singulières institutions. Au second siècle avant Jésus-Christ, la Grèce ne contenait plus qu’une seule nation de guerriers, les sauvages montagnards de l’Étolie, dont la civilisation et l’intelligence étaient de plusieurs générations en retard sur leurs compatriotes.
Toutes les causes qui produisirent ces effets parmi les Grecs, agirent avec plus de force encore sur les Italiens modernes. Au lieu d’une puissance essentiellement militaire comme Sparte, ils avaient, au milieu d’eux, un État ecclésiastique essentiellement pacifique. Dans les sociétés où les esclaves abondent, tout homme libre est poussé par les motifs les plus impérieux à se familiariser avec l’usage des armes. Les républiques italiennes ne fourmillaient pas, comme la Grèce, de ces milliers d’ennemis intérieurs. Et enfin la manière de faire la guerre, au temps de la prospérité italienne, était particulièrement défavorable à la formation d’une milice efficace. Des hommes bardés de fer de la tête aux pieds, armés de lances pesantes, montés sur d’énormes coursiers, voilà ce qu’on regardait comme le nerf d’une armée. On ne faisait relativement que fort peu de cas de l’infanterie, et on la négligeait tant, qu’elle perdait en effet toute valeur. Cette lactique resta, pendant des siècles, maîtresse du terrain dans la plus grande partie de l’Europe. Les hommes de pied passèrent pour être incapables de résister aux charges de la grosse cavalerie, jusqu’au jour où, vers la fin du quinzième siècle, les rudes montagnards de la Suisse rompirent le charme, et renversèrent les idées des généraux les plus expérimentés, en recevant le choc si redouté de la cavalerie sur une forêt impénétrable de piques. Le maniement du javelot grec, de l’épée romaine, de la baïonnette moderne, n’est point trop malaisé à apprendre. Mais un exercice quotidien et prolongé pouvait seul former l’homme d’armes à porter toute sa massive panoplie, et à brandir sa lourde lance. Dans toute l’Europe, cette branche importante de la guerre devint une profession à part. Au delà des Alpes, il est vrai, c’était une profession, ce n’était pas un trafic ; c’était le devoir et le plaisir des gentilshommes ; c’était le service que leur imposaient leurs fiefs, et le divertissement qui, en l’absence de toute ressource intellectuelle, charmait leurs loisirs. Mais, comme nous l’avons déjà fait remarquer, la puissance croissante des villes avait, dans l’Italie septentrionale, transformé cette classe d’hommes, partout où elle ne l’avait pas anéantie. L’usage d’avoir recours aux bras des mercenaires y devint donc universel, à une époque où cet usage était presque inconnu dans les autres pays.
Quand la guerre devient le métier d’une classe particulière, le parti le moins dangereux que puisse prendre un gouvernement, c’est de transformer cette classe en armée permanente. Il est presque impossible que des hommes passent leur vie au service d’un État, sans prendre intérêt à sa grandeur. Ses victoires sont leurs victoires. Ses défaites sont leurs défaites. Le marché perd quelque chose de son caractère vénal. Le soldat en vient à prendre ses services pour les effets d’un zèle patriotique, et sa solde pour le tribut de la reconnaissance nationale. Trahir le pouvoir qui l’emploie, ou même mettre quelque négligence à le servir, cela devient ses yeux le plus atroce et le plus déshonorant des crimes.
Quand les princes et les républiques d’Italie commencèrent à prendre des troupes à bail, ils auraient dû les organiser en corps séparés. Malheureusement ils n’en firent rien. Les guerriers mercenaires de la Péninsule, au lieu d’être attachés au service de telle ou telle puissance, étaient regardés comme une propriété commune à toutes. Le lien entre l’État et ses défenseurs se réduisait au trafic le plus simple et le moins dissimulé. L’aventurier venait offrir sur le marché son cheval, ses armes, sa force, son expérience. Peu lui importait de conclure avec le roi de Naples ou avec le duc de Milan, avec le Pape ou avec la seigneurie de Florence. La préférence était acquise aux gages les plus élevés et au plus long bail. Quand la campagne pour laquelle il avait traité était terminée, il n’y avait pour lui ni loi ni point d’honneur qui l’empêchassent de tourner immédiatement ses armes contre ses derniers maîtres. La personne du soldat et celle du citoyen ou du sujet étaient parfaitement distinctes.
Les conséquences naturelles s’ensuivirent. La guerre était conduite par des hommes sans dévouement pour ceux qu’ils défendaient et sans haine pour ceux qu’ils combattaient, souvent plus attachés à l’armée ennemie qu’à leur maître, toujours intéressés à la prolongation de la lutte. La guerre changea de nature. Tout homme prenait la campagne avec le sentiment que, peu de jours après, il pourrait être à la solde de la puissance contre laquelle il dirigeait ses coups, et batailler contre ses camarades dans les rangs de ses ennemis. Les intérêts les plus puissants concouraient avec les sentiments les plus puissants à mitiger l’hostilité réciproque de ceux qui avaient été frères d’armes et qui pouvaient le redevenir. Leur profession commune formait entre eux un lien qu’ils ne pouvaient oublier, même lorsqu’ils étaient au service de belligérants opposés. Aussi jamais l’histoire n’a-t-elle raconté des opérations plus languissantes et moins décisives. Des marches et des contre-marches, des contrées mises au pillage et des blocus, des capitulations et des rencontres sans la moindre effusion de sang, c’est là toute l’histoire militaire de l’Italie, pendant le cours de deux siècles. D’énormes armées combattent du lever du soleil à son coucher ; de grandes victoires se gagnent ; des milliers de soldats sont faits prisonniers ; et c’est à peine s’il y a mort d’homme. Les batailles rangées étaient vraiment moins dangereuses que les troubles civils les plus ordinaires.
Le courage n’était pas nécessaire pour faire un soldat. Des hommes vieillissaient sous le harnais, et acquéraient le plus grand renom par leurs exploits guerriers, sans avoir eu à braver une seule fois un danger sérieux. Les conséquences politiques de ce fait ne sont que trop connues. La partie la plus riche et la plus éclairée du monde resta sans défense contre les envahissements de tous les barbares, contre la brutalité de la Suisse, contre l’insolence de la France, contre. la férocité rapace de l’Aragou. Les effets moraux qui résultèrent de cet état de choses furent plus remarquables encore.
Au sein des rudes nations qui habitaient de l’autre côté des Alpes, la valeur était indispensable. Sans elle, point de grandeur, point de sécurité. La couardise était donc naturellement regardée comme la plus ignominieuse des hontes. Parmi ces Italiens si policés, enrichis par le commerce, soumis à l’empire des lois, et passionnément attachés aux lettres, tout s’accomplissait par la supériorité de l’esprit. Leurs guerres elles-mêmes, plus pacifiques que la paix de leurs voisins, demandaient plutôt des qualités politiques que des qualités militaires. Aussi, de même que le courage était le point d’honneur dans les autres pays, l’habileté devint le point d’honneur en Italie.
Deux systèmes opposés de moralité élégante sortirent de ces principes par des procédés exactement semblables. Dans la plus grande partie de l’Europe, les vices qui sont particuliers aux tempéraments timides et qui sont la défense naturelle des faibles, la fraude et l’hypocrisie, ont toujours passé pour les plus déshonorants. Les excès des caractères entreprenants et hautains ont toujours au contraire excité l’indulgence et même un certain respect. Les Italiens appréciaient avec une complaisance correspondante les crimes qui exigent un certain empire sur soi-même, de l’adresse, de la promptitude d’esprit, une invention fertile, et une profonde connaissance du cœur humain.
Un prince comme notre Henri V devait être l’idole du Nord. Les folies de sa jeunesse, l’égoïste ambition de son âge mûr, les Lollards brûlés à petit feu, les prisonniers massacrés sur le lieu du combat, le bail expirant de l’autorité cléricale prolongé de cent ans, une guerre sans cause et sans espoir léguée à un peuple qui n’y avait aucun intérêt, tout est oublié sauf la bataille d’Azincourt. François Sforza, c’est là, d’un autre côté, le modèle des héros italiens. Il fit également servira sa fortune ses maîtres et ses rivaux. II commença par écraser ses ennemis déclarés, à l’aide d’alliés sans foi ; puis il s’arma contre ces alliés des dépouilles arrachées à ses ennemis. Avec une incomparable dextérité, il s’éleva de la situation précaire et dépendante d’aventurier militaire au premier trône d’Italie. A un tel homme ses compatriotes pouvaient beaucoup pardonner, et les amitiés trompeuses, et les lâches inimitiés, et la foi violée. Voilà les erreurs opposées auxquelles les hommes se livrent, lorsque la moralité est pour eux affaire, non de science, mais de goût, et lorsqu’ils abandonnent les principes éternels pour des fantaisies accidentelles.
Nous avons emprunté à l’histoire des exemples destinés à nous faire comprendre. Nous allons en trouver dans la fiction. Othello tue sa femme ; il donne l’ordre de tuer son lieutenant ; il finit par se tuer lui-même. Et pourtant, dans le Nord, il ne perd ni l’estime ni l’affection des lecteurs. Son caractère intrépide et ardent rachète tout. Le confiant abandon avec lequel il écoute son conseiller, l’angoisse avec laquelle il se débat contre la pensée de la honte, l’orage de passion au milieu duquel il commet ses crimes, le courage hautain avec lequel il les avoue, tout crée en sa faveur un intérêt extraordinaire Iago est au contraire l’objet de la malédiction universelle. Beaucoup de gens vont même jusqu’à penser que Shakspeare s’est laissé entraîner à une exagération qui ne lui est point habituelle, et qu’il a créé un monstre sans exemple dans la nature humaine. Je crois qu’un auditeur italien du quinzième siècle aurait senti tout différemment. Othello ne lui aurait inspiré que de l’horreur et du mépris. La folie avec laquelle il se confie aux protestations amicales d’un homme dont il a dérangé l’avancement, la crédulité avec laquelle il accepte pour des preuves évidentes des conjectures sans base et des circonstances triviales, la violence avec laquelle il repousse la justification, jusqu’au moment où la justification ne peut qu’aggraver son désespoir, auraient excité l’horreur et le dégoût des spectateurs. Ils auraient sans doute condamné la conduite de Iago ; mais ils l’auraient condamnée comme nous condamnons celle de sa victime. Un certain intérêt, un certain respect se seraient mêlés à leur improbation. La présence d’esprit du traître, la netteté de son jugement, l’habileté avec laquelle il pénètre les dispositions d’autrui et cache, les siennes propres, lui auraient assuré une part de leur estime.
La différence entre les Italiens et leurs voisins était grande, on le voit. Il y avait eu des différences de même nature entre les Grecs du second siècle avant Jésus Christ, et leurs maîtres les Romains. Braves et résolus, fidèles à leur parole et dominés par le sentiment religieux, les conquérants étaient à la fois ignorants, arbitraires et cruels. Les vaincus avaient seuls le dépôt des arts, de la science et de la littérature dans le monde occidental. Ils étaient sans rivaux en poésie, en philosophie, en peinture, en architecture, en sculpture. Leurs manières était polies, leur esprit était pénétrant, inventif, prompt ; ils étaient tolérants, affables, humains, mais absolument dépourvus de courage et de sincérité. Le plus grossier centurion se consolait de son infériorité intellectuelle, en remarquant que le savoir et le goût ne semblaient produire que des athées, des poltrons ; et des esclaves. La séparation resta longtemps marquée, et elle fournit un admirable sujet aux impitoyables sarcasmes de Juvénal.
Le citoyen d’une république, italienne était à la fois le Grec du temps de Juvénal et le Grec du temps de Périclés. Timide, souple, artificieux et vil, comme le premier, il avait, comme le second, une patrie dont l’indépendance et la prospérité lui étaient chères ; son caractère, dégradé par les crimes les plus bas, était en même temps ennobli par un certain esprit public, et par une honorable ambition.
Un vice que l’opinion générale sanctionne n’est qu’un vice ; c’est un mal qui prend fin avec soi. Mais un vice que l’opinion générale condamne produit sur le caractère les effets les plus pernicieux. Le premier n’est qu’une maladie locale ; le second est un poison qui infecte toute la constitution. Quand le coupable est perdu de réputation, il lui arrive souvent de rejeter dans son désespoir tout ce qui lui reste de vertu. Le gentilhomme montagnard de l’Écosse qui vivait, il y a un siècle, en levant contribution sur ses voisins, commettait le crime pour lequel Wild fut poursuivi jusqu’à Tyburn par les huées de deux cent mille personnes. Et pourtant, il n’est pas douteux que c’était un homme bien moins dépravé que Wild. Le fait pour lequel madame Brownrigg fut pendue n’est rien en comparaison de la conduite du Romain qui donnait en offrande au public la vie de deux cents gladiateurs ; Et cependant, nous ferions grand tort au Romain, en le soupçonnant d’avoir été, par nature, aussi cruel que madame Brownrigg. Dans notre pays, une femme se perd de réputation par un acte qui, chez un homme, n’est communément regardé que comme une honorable distinction, ou tout au plus comme un péché véniel. La conséquence est évidente. Les principes moraux d’une femme sont fréquemment bien plus entamés par une seule faute que ceux d’un homme par vingt années d’intrigues. L’antiquité classique nous fournirait des exemples plus frappants encore, si possible, que ceux auxquels nous avons eu recours.
Il faut appliquer ce principe au cas que nous examinons. De notre temps et dans notre pays, l’habitude de la dissimulation et du mensonge imprime sans doute au front d’un homme la marque de la corruption et de l’infamie. Mais il ne s’ensuit point qu’un jugement semblable soit équitable lorsqu’il s’agit des Italiens du moyen âge. Chez eux, au contraire, nous trouvons souvent les défauts que nous sommes habitués à regarder comme les indices de la dépravation, en compagnie de bonnes et grandes qualités, de la générosité, de la bienveillance, du désintéressement. Palamèdes, dans l’admirable dialogue d’Hume, aurait pu tirer d’un tel état social des arguments aussi frappants en faveur de sa thèse que ceux que lui présente Fourli. Ce ne sont point là, je le sais, les leçons que les historiens se montrent en général le plus jaloux de donner, et les lecteurs d’entendre. Mais elles n’en sont pas moins utiles. Comment Philippe a-t-il disposé ses troupes à la bataille de Chéronée ? En quel lieu Annibal a-t-il traversé les Alpes ? Marie a-t-elle ou non fait sauter DarnIey ? Siquier a-t-il tué Charles XII ? Questions sans importance ! Problèmes amusants dont la solution ne peut nous rendre plus sages ! Celui-là seul sait lire l’histoire qui, observant combien les circonstances agissent sur les passions et les opinions des hommes, combien le vice est pris souvent pour la vertu et le paradoxe pour l’axiome, apprend à distinguer, dans la nature humaine, ce qui est accidentel et transitoire, de ce qui est essentiel et immuable.
Aucune histoire ne peut suggérer à ce sujet des réflexions plus importantes que celle des républiques de la Toscane et de la Lombardie. A première vue, le caractère d’un homme d’État italien paraît un ensemble impossible de contradictions : fantôme aussi monstrueux que la portière de l’enfer dans Milton, moitié divinité, moitié serpent, il est majestueux et beau dans les parties supérieures, il est rampant et venimeux par en bas. Nous voyons un homme dont les pensées et lés paroles n’ont aucun lien entre elles, qui n’hésite jamais à prêter un serment lorsqu’il veut séduire, qui ne manque jamais d’un prétexte lorsqu’il est disposé à trahir. Ses cruautés ont pour principe, non la chaleur du sang ou la démence d’un pouvoir sans contrôle, mais de profondes et froides méditations. Ses passions, comme des troupes exercées, sont impétueuses par discipline, et n’oublient jamais, dans leur plus opiniâtre furie, la règle à laquelle elles se sont soumises. Des plans d’ambition vastes et compliqués occupent toute son âme, et cependant il n’a sur son visage et dans son langage qu’une modération philosophique. La haine et la vengeance dévorent son cœur, et chacun de ses regards contient un sourire cordial, chacun de ses gestes est une caresse familière. Jamais il n’excite le soupçon de son ennemi par de petites provocations. Son dessein ne se dévoile que lorsqu’il est accompli. Son visage est calme, ses discours sont courtois jusqu’au jour où la vigilance s’endort, où l’adversaire se découvre, où l’occasion de viser sûrement se présente, et alors il frappe pour la première et la dernière fois. Quant au courage militaire, l’orgueil du lourd Allemand, du frivole et bavard Français, de l’arrogant et romanesque Espagnol, il ne l’a pas, il ne l’estime pas. Il évite le danger, non parce qu’il est insensible à la honte, mais parce que, dans la société où il vit, la timidité a cessé d’être honteuse. Faire le mal ouvertement n’est pas moins coupable à ses yeux, tout en étant moins utile, que de le faire secrètement. Pour lui, les moyens les plus honorables sont les plus sûrs, les plus prompts, les plus ténébreux. Il ne saurait comprendre qu’on hésite à tromper ceux qu’on n’hésite pas à détruire. Il se regarderait comme un sot de déclarer ouvertement la guerre à des rivaux qu’il peut poignarder au milieu d’un embrassement amical, ou empoisonner dans une hostie consacrée.
Et cependant, cet homme noirci des vices que nous regardons comme les plus odieux, traître, hypocrite, poltron, assassin, n’était nullement dénué de ces vertus qui nous paraissent en général les indices d’une élévation de caractère tout à fait supérieure. Ces barbares guerriers qui, sur les champs de bataille et sur la brèche, n’avaient point de rivaux, étaient de beaucoup ses inférieurs en courage civil, en persévérance, en présence d’esprit. Ces dangers mêmes qu’il évitait avec une prudence presque pusillanime, ne troublaient jamais son jugement, ne paralysaient jamais son esprit d’invention, n’arrachaient jamais un secret à sa langue toujours muette, à son front toujours impénétrable. Ennemi dangereux, complice plus dangereux encore, il pouvait être néanmoins un magistrat juste et bienfaisant. En même temps que sa politique était profondément injuste, il avait, à un degré rare, de la justice dans l’esprit. Indifférent à la vérité dans les affaires de la vie, il recherchait honnêtement la vérité dans les méditations spéculatives. Il n’était pas cruel de gaieté de cœur. La susceptibilité de ses nerfs et l’activité de son imagination le portaient à entrer en sympathie avec les émotions d’autrui et à trouver son plaisir dans les aimables délicatesses de la vie sociale. Descendant sans cesse à des actions qui paraissent porter la marque d’un esprit profondément perverti, il avait cependant un sentiment exquis de tout ce que la nature ou la morale offrent de sublime, de tout ce qui est gracieux ou élevé dans l’ordre intellectuel. L’habitude des petites intrigues et de la dissimulation aurait pu le rendre incapable de vues grandes et générales, si l’influence élargissante de ses études philosophiques n’avait triomphé de cette tendance à se rétrécir. L’esprit, l’éloquence, la poésie lui procuraient les joies les plus vives. Les beaux arts profitaient également de la sévérité de son goût et de la libéralité de son patronage. Les portraits des Italiens les plus remarquables de cette époque sont en parfaite harmonie avec cette description. Des fronts larges et majestueux, des sourcils noirs et accentués qui ne se froncent jamais, des yeux dont le regard calme et plein n’exprime rien et semble tout voir, des joues pâlies par la pensée et par une vie sédentaire, des lèvres d’une délicatesse féminine, comprimées avec une fermeté plus que masculine, tous ces traits indiquent des hommes à la fois entreprenants et timides, aussi habiles à démêler les intentions d’autrui qu’à dissimuler les leurs propres, ennemis formidables, amis peu sûrs, mais en même temps d’humeur douce et équitable, et d’un esprit assez grand et assez fin pour les rendre aussi éminents dans la vie active que dans la vie contemplative, et aussi propres à gouverner l’humanité qu’à l’instruire.
Chaque temps, chaque nation a certains vices caractéristiques qui prévalent presque universellement, que chacun hésite à peine à avouer ; et que les moralistes les plus rigides ne censurent que mollement. Les générations qui se succèdent changent de mode en morale, comme en chapellerie et en carrosserie. Elles prennent sous leur patronage de nouveaux genres de perversité, et elles s’étonnent de la dépravation de leurs ancêtres. Ce n’est pas tout ; la postérité, cette cour suprême d’appel qui ne se lasse jamais de louer sa propre justice et son propre, discernement, agit, en semblable circonstance, comme un dictateur romain après une sédition générale. Trouvant les délinquants trop nombreux pour les punir tous, elle prend au hasard quelques hommes parmi eux, et fait porter sur leur tête tout le poids d’une offense dont ils ne sont pas plus coupables que ceux qui échappent. Je ne sais si la décimation est un bon mode de châtiment militaire, mais je proteste contre son introduction dans la philosophie de l’histoire.
Dans le cas dont il s’agit, le sort est tombé sur Machiavel, homme dont la conduite publique fut loyale et honorable, dont les vues sur la morale, si elles diffèrent de celles qui étaient professées autour de lui, diffèrent en mieux, et dont la seule faute est d’avoir exposé plus clairement et exprimé plus fortement que tout autre écrivain, les maximes qui étaient généralement reçues de son temps et qu’il avait adoptées.
Après avoir un peu blanchi, je l’espère, le caractère personnel de Machiavel, je passe à l’examen de ses ouvrages. Comme poëte, il n’a pas droit à une grande place ; mais ses comédies méritent l’attention.
La Mandragore, en particulier, est supérieure aux meilleures pièces de Goldoni et n’est inférieure qu’aux meilleures de Molière. C’est l’œuvre d’un homme qui, s’il s’était consacré au drame, aurait probablement atteint les plus hauts sommets de l’art, et qui aurait produit un effet durable et salutaire sur le goût national. C’est là un jugement que nous fondons sur le genre plutôt que sur la mesure de son mérite. Il est des œuvres qui indiquent encore plus de talent, et qu’on lit avec plus de plaisir encore, mais d’où nous aurions tiré une tout autre conclusion. Les livres qui n’ont aucune valeur me font aucun tort aux lettres, et le signe certain de la décadence générale d’un art, c’est le retour fréquent, non pas de certaines fautes Choquantes, mais de certaines beautés déplacées. En thèse générale, la tragédie est viciée par l’éloquence, la comédie par l’esprit.
Le but véritable du drame est de mettre en spectacle les caractères de la nature humaine. Ce n’est pas là, à nos yeux, une règle arbitraire, qui doive son origine à un concours de circonstances locales et temporaires, comme les règles qui décident quel nombre d’actes doit contenir une pièce ou quel nombre de syllabes doit renfermer un vers. Toute autre règle est subordonnée à cette loi fondamentale. Les situations qui permettent le mieux à un caractère de se développer, fournissent la meilleure trame. La langue naturelle des passions est le meilleur style.
Bien compris, ce principe n’interdit au poëte aucune grâce de composition. Il n’est pas de style dans lequel, telle circonstance étant donnée, un homme ne puisse avoir à s’exprimer. Il n’est donc pas de style que le drame rejette ; il n’est pas de style qu’à telle heure il ne puisse exiger. Ce qui manque aux artistes d’un ordre inférieur, c’est de savoir discerner le lieu, le moment et la personne. La rapsodie fantastique de Mercutio, la déclamation travaillée d’Antoine sont naturelles et agréables là où Shakspeare les a placées. Mais Dryden aurait mis dans la bouche de Mercutio, lorsqu’il défie Tybalt, des hyperboles aussi fantastiques que celles qu’il emploie pour décrire le chariot de Mab. Corneille nous aurait représenté Antoine grondant et cajolant Cléopâtre avec toute l’éloquence mesurée d’une oraison funèbre.
Personne n’a fait : plus de mal à la comédie anglaise que Congreve et Sheridan. Tous deux étaient des hommes d’un esprit brillant et d’un goût élégant. Malheureusement, tous leurs caractères sont faits à leur propre image. Leurs œuvres ressemblent au vrai drame comme un transparent ressemble à un tableau. Point de touches délicates, de nuances se fondant imperceptiblement les unes dans les autres ; le tout brille d’un éclat universel. Les contours et les teintes sont oubliés dans la lumière éblouissante qui illumine le tout. Les fleurs et les fruits de l’esprit y abondent, mais c’est l’abondance d’un fourré, non d’un jardin, abondance malsaine, étourdissante, inutile par excès de richesse, nauséabonde par excès d’odeur. Tous les fats, tous les rustres, tous les valets sont gens d’esprit. Les dupes et les plastrons eux-mêmes, Tattle, Witwould, Puff, Acres, éclipsent l’hôtel Rambouillet. Pour prouver combien est erroné dans son ensemble le système de cette école, il suffit d’employer le procédé qui fit évanouir Florimel et ses enchantements, de mettre la vraie Thalie en présence de la fausse, d’opposer les caractères les plus célèbres retracés par les écrivains dont nous parlons, au bâtard du roi Jean, ou à la nourrice de Roméo et Juliette. Ce n’était sûrement pas par manqué d’esprit que Shakspeare avait adopté une manière, si différente. Bénedicket Béatrice jettent dans l’ombre Mirabel et Millamant. On aurait pu, sans rien gâter dans le seul rôle de Falstaff, effacer tous les bons mots prononcés dans les facétieuses maisons d’Absoluté et de Surface. Ce fécond génie aurait facilement pu donner à Bardolph et à Shallow autant d’esprit qu’au prince Hal, et semer de brillantes épigrammes les discussions de Dogberry et de Verges. Mais il savait qu’une prodigalité si banale allait, pour nous servir de son admirable langage, « contre le but de la comédie qui, jadis comme aujourd’hui, a servi et sert, pour ainsi dire, à tenir le miroir en face de la nature. ».
Cette digression aidera mes lecteurs à comprendre ce que j’entends quand je dis que, dans la Mandragore, Machiavel a prouvé qu’il comprenait parfaitement la nature de l’art dramatique, et possédait des facultés qui lui auraient permis d’y exceller. Par sa peinture correcte et vigoureuse de la nature humaine, il sait produire l’intérêt sans intrigue habile ou agréable ; il fait rire sans viser à l’esprit. L’amant, qui n’est ni bien délicat ni bien généreux, et son conseiller le parasite, sont vivement peints. Le confesseur hypocrite est un portrait admirable. Il est, si je ne me trompe, l’original du père Dominique, le meilleur rôle comique de Dryden. Mais le vieux Nicias est le chef-d’œuvre de la pièce. Je ne me rappelle rien qui lui ressemble. Les sottises que Molière couvre de ridicule sont les sottises de l’affectation, non de la fatuité. Son gibier, ce sont lès freluquets et les pédants, non les francs imbéciles. Shakspeare a une belle collection de sots ; mais, si ma mémoire ne me trompe pas, on n’y rencontre pas l’espèce exacte dont je parle. Shallow est un sot. Mais son entrain naturel remplace l’esprit jusqu’à un certain point. Sa conversation est à celle de Sir John ce que l’eau de Seltz est au vin de Champagne. Elle a l’effervescence sans avoir ni le corps ni le parfum. Slender et Sir Andrew Aguecheek sont des sots, poursuivis par un vague sentiment de leur sottise, sentiment qui produit chez le dernier la douceur et l’humilité, chez le premier, la maladresse, l’entêtement et la ruine. Cloten est un sot arrogant, Osric un sot faquin, Ajax un sot féroce, mais Nicias est, comme l’est Patrocle au dire de Thersite, un sot tout court. Son âme n’est occupée d’aucun sentiment vigoureux ; elle reçoit toutes les empreintes sans en conserver aucune ; son aspect varie, non par l’effet des passions, mais par des semblants dépassions, faibles et transitoires ; fausse joie, fausse peur, faux amour, faux orgueil qui courent les uns après les autres sur sa surface comme des ombres, et s’évanouissent des qu’ils ont paru. Il est tout juste assez idiot pour exciter, non la pitié ou l’horreur, mais le ridicule. Il ressemble un peu à ce pauvre Calandrino dont les mésaventures, racontées par Boccace, ont fait rire toute l’Europe pendant plus de quatre siècles. Il ressemble peut-être encore plus à Simon de Villa, auquel Bruno et Buffalamacco promettent l’amour de la comtesse Civillari. Comme Simon, Nicias appartient à une profession savante ; et la dignité avec laquelle il porte la robe de docteur, rend ses absurdités infiniment plus grotesques. Le vieux langage toscan convient admirablement à un tel personnage. La grande simplicité de cet idiome donne au raisonnement le plus solide et à l’esprit le plus brillant un air enfantin, presque toujours charmant, mais parfois un peu risible pour un lecteur étranger. Les héros et les hommes d’État ont l’air de bégayer quand ils en font usage. Il convient à Nicias d’une façon incomparable, et rend sa niaiserie infiniment plus niaise encore.
J’ajoute que les vers qu’on rencontre çà et là dans la Mandragore, me paraissent être ce que Machiavel a écrit de plus animé et de plus correct en poésie. Il était évidemment de cet avis ; car il en a replacé plusieurs dans d’autres endroits de ses ouvrages. Les contemporains de l’auteur ne méconnurent pas les mérites de cette remarquable pièce. On la joua à Florence avec le plus grand succès. Léon X était au nombre de ses admirateurs, et par son ordre elle fut représentée à Rome 5.
La Clizia est une imitation de la Casina de Piaule, qui est elle-même une imitation des $grec$ de Diphile qui sont perdus pour nous. Plaute est incontestablement l’un des meilleurs écrivains latins ; mais la Casina n’est pas une de ses meilleures pièces, et n’offre pas non plus de grandes facilités à un imitateur. L’intrigue est aussi étrangère aux habitudes de la vie moderne que la manière dont elle est développée est étrangère aux règles de la composition moderne. L’amoureux reste à la campagne et l’héroïne reste dans sa chambre pendant toute la durée de l’action, et ils laissent décider de leur sort par un père parfaitement sot, une mère très-rusée, et des serviteurs corrompus. Machiavel s’est acquitté de sa tâche avec jugement et bon goût. Il a accommodé l’intrigue à un état de société différent, et l’a très adroitement rattachée à l’histoire de son propre temps. Le récit du tour joué au vieil amoureux radoteur est parfaitement drôle. Il est bien supérieur au passage correspondant de la comédie latine, et cède à peine le pas au récit que fait Falstaff de son plongeon.
Deux autres comédies sans titre, l’une en prose, l’autre en vers, sont comptées au nombre des œuvres de Machiavel. La première est très-courte, assez animée, mais sans grande valeur. Quant à la dernière, nous avons peine à croire qu’elle soit authentique. Ni ses mérites ni ses défauts ne nous rappellent le célèbre auteur. Elle fut imprimée pour la première fois en 1796, d’après un manuscrit découvert dans la célèbre bibliothèque des Strozzi. On m’a assuré que son authenticité né reposait que sur la similitude des écritures. Ce qui confirme nos soupçons, c’est que ce manuscrit contenait également une description de la peste de 1527, qui, en conséquence, a été ajoutée aux œuvres de Machiavel. Quant à celle dernière composition, c’est à peine si les preuves matérielles les plus plausibles pourraient nous amener à l’en croire coupable. On n’a jamais rien écrit de plus détestable, pour le fond et pour la forme. Les narrations, les réflexions, les plaisanteries, les lamentations sont de la plus mauvaise école, à là fois vulgaires et affectées ; ce sont de vraies guenilles tirées des boutiques de fripiers littéraires. Un mauvais écolier pourrait écrire une pareille pièce, et croire, en la relisant, qu’il a fait quelque chose de beaucoup plus beau que l’incomparable introduction du Décaméron. Mais on ne saurait concevoir qu’à près de soixante ans, un grand homme d’État, dont les premiers ouvrages se font remarquer par la virilité du style et de la pensée, ait pu s’abaisser à une pareille puérilité.
La petite nouvelle de Belphégor est agréablement conçue, et agréablement dite. Mais l’extravagance de la satire nuit en quelque mesure à son effet. Machiavel était malheureux en ménage, et dans son désir de venger sa propre cause et celle de ses compagnons d’infortune, il s’est laissé entraîner hors des bornes permises à la fiction. Jonson semble avoir combiné quelques données de cette nouvelle avec d’autres tirées de Boccace, dans l’intrigue de sa pièce Le diable est un âne, pièce qui, sans avoir le fini de ses autres compositions, est peut-être celle où il a montré le plus de génie.
La correspondance politique de Machiavel, publiée pour la première fois en 1767, est incontestablement authentique et très-précieuse. Les malheureuses circonstances où son pays se trouva placé pendant la plus grande partie de sa vie publique étaient de nature à développer extraordinairement les talents diplomatiques. A dater du jour où Charles VIII descendit des Alpes, le caractère de la politique italienne changea complètement. Les gouvernements, de la Péninsule cessèrent de former un système indépendant. Attirés hors de leur ancien orbite par la puissance des corps supérieurs qui s’approchaient d’eux, ils devinrent de purs satellites de la France et de l’Espagne. L’influence étrangère décida de toutes leurs disputes, au dedans comme au dehors. Les intérêts des factions rivales se discutaient, non plus dans la salle du Sénat ou sur la place du marché, mais dans l’antichambre de Louis et de Ferdinand. Dans de telles circonstances, la prospérité des États italiens dépendait beaucoup plus de l’habileté de leurs agents étrangers que de la conduite de ceux qui étaient chargés de l’administration intérieure. L’ambassadeur avait à remplir des fonctions bien plus délicates que celle de transmettre des ordres de chevalerie, de présenter des touristes ou d’envoyer à ses collègues l’hommage de sa haute considération. C’était un avocat chargé de veiller aux plus chers intérêts de ses clients, un espion revêtu d’un caractère inviolable. Au lieu de se borner à maintenir, par ses manières réservées et son style ambigu, la dignité de ceux qu’il représentait, il devait se plonger dans toutes les intrigues de la cour où il résidait, découvrir et flatter toutes les faiblesses du prince ; celles du favori qui gouvernait le prince, et celles du valet qui gouvernait le favori. Il fallait flatter la maîtresse et gagner le confesseur, louer ou supplier ; rire ou pleurer, s’accommoder à tous les caprices, apaiser tous les soupçons, recueillir tous les on-dit, faire tous les métiers, remarquer tout, supporter tout. A quelque degré que fût parvenu l’art de l’intrigue politique en Italie, le temps en réclamait tout l’emploi.