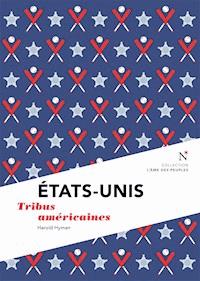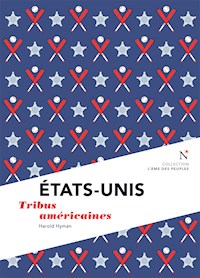
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Comment mieux comprendre les Américains d'aujourd'hui et les différents mouvements et sous-groupes d'un pays divisé ?
Les États-Unis d’aujourd’hui ne se résument ni à la déferlante Trump, ni à l’American way of life, ni à une succession de fascinants paysages. Doté d’une incomparable créativité, ce pays est le berceau de tribus bien identifiées, soudées par des codes qui transcendent les frontières des États, les reliefs et le cosmopolitisme des grandes mégapoles.
Ces tribus américaines se regroupent autour de professions emblématiques, de croyances religieuses, d’orientations sexuelles et, bien sûr, au gré des clivages ethniques que la présidence de Barack Obama a permis de revisiter. Sans ces tribus, l’Amérique et son goût effréné du succès ne serait pas ce melting-pot si inégal, ce creuset des rêves les plus fous, cette patrie de l’audace entrepreneuriale, mais aussi ce carcan si pesant de l’argent roi.
Ce petit livre n’est pas un guide. C’est un décodeur. Il raconte les États-Unis de l’intérieur, au fil des rencontres, pour mieux en dépeindre les moeurs, les miracles et les illusions. Parce que connaître les Américains est, plus que jamais, indispensable pour les comprendre.
Décodez les croyances et idéologies qui composent les Etats-Unis grâce à une analyse profonde et passionnante.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Auteur et expert en géopolitique, Harold Hyman a longtemps été éditorialiste sur BFM TV, et aujourd’hui à Opinion Internationale. Franco-Américain, baigné par les deux cultures, il n’a pas son pareil pour ausculter les ressorts de cet empire qu’il connaît si bien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
L’ÂME DES PEUPLES
Une collection dirigée par Richard Werly
Signés par des journalistes ou écrivains de renom, fins connaisseurs des pays, métropoles et régions sur lesquels ils ont choisi d’écrire, les livres de la collection L’âme des peuples ouvrent grandes les portes de l’histoire, des cultures, des religions et des réalités socio-économiques que les guides touristiques ne font qu’entrouvrir.
Ponctués d’entretiens avec de grands intellectuels rencontrés sur place, ces riches récits de voyage se veulent le compagnon idéal du lecteur désireux de dépasser les clichés et de se faire une idée juste des destinations visitées. Une rencontre littéraire intime, enrichissante et remplie d’informations inédites.
Précédemment basé à Bruxelles, Genève, Tokyo et Bangkok, Richard Werly est le correspondant permanent à Paris et Bruxelles du quotidien suisse Le Temps.
Retrouvez et suivez L’âme des peuples sur
www.editionsnevicata.be
@amedespeuples
Carte
AVANT-PROPOS Pourquoi les États-Unis ?
Le subtil cocktail américain fait de racines anglo-saxonnes, de foi en l’avenir et d’accueil aux immigrés est secoué par de sérieuses convulsions. Oublié Barack Obama, 44e président, homme d’ouverture et de modernité ! L’Amérique a connu le séisme de Donald Trump. C’est cette mutation que l’auteur franco-américain que je suis espère, au fil de ce livre, parvenir à expliquer tout en restant convaincu du formidable pouvoir d’attraction et de séduction des États-Unis.
Cette réalité politique est, selon moi, le fruit d’une rupture. L’ancien équilibre entre Anglo-Saxons protestants et les diverses minorités a vécu, même si on l’admet difficilement aux États-Unis. Un nouveau triptyque de la colère a surgi au fil des deux mandats de Barack Obama et s’est pleinement développé lors de la présidence Trump : il oppose, pour faire simple, les Blancs des classes moyennes et populaires, les Noirs, et les jeunes « socialistes ». En version électorale, cela donne, dans l’ordre, le camp de Donald Trump et du Tea Party, celui du mouvement Black Lives Matter1 et celui des partisans de l’ex-candidat aux primaires démocrates Bernie Sanders. La société américaine est plus que jamais menacée par des fractures idéologiques, économiques et raciales. E Pluribus Unum (de la multitude à l’unité) demeure la devise officielle des États-Unis. Mais reste-t-elle pertinente ? J’avoue m’interroger.
Le changement est désormais acquis, et le scénario de l’avenir n’exclut pas la guerre civile. Or les graines de cette dramaturgie étaient en place depuis une génération, dopés par deux puissants moteurs : un certain essoufflement du rêve américain d’une part, et l’émergence d’une nouvelle tribalité d’autre part. Car on ne comprend pas les États-Unis sans percevoir ces tribus qui, au fil de l’histoire, ont tissé et façonné le pays. Je les observe pour ma part depuis mon enfance franco-américaine à Manhattan dans les années 1960-1970. Ce « tribalisme » m’est ensuite apparu évident lors de ma découverte de l’Amérique profonde. Plus encore aujourd’hui, il s’impose comme une évidence.
Les États-Unis ont toujours paru être une nation solide, dont la principale blessure reste la calamiteuse guerre de Sécession2 qui conduisit, d’après les calculs de l’époque, plus de 617 000 jeunes hommes à la mort ! Mais ce cliché, comme d’autres, mérite d’être corrigé. Exemple ? La république américaine n’est pas un « pays jeune » comme Barack Obama aimait le répéter. Et elle n’a pas toujours été Great comme dit Donald Trump. Sa fondation remonte, rappelons-le, à 1776, soit avant la Révolution française. Cette nation est superpuissante seulement depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa culture populaire, littéraire, technologique, consumériste, juridique et politique est partout connue et souvent directement émulée. C’est sa dynamique interne qui a changé. Lorsque j’étais jeune à New York, le sentiment était que notre ville attirait les talents du monde entier, tandis que les moins chanceux allaient en Californie. Comme tout New-Yorkais je me moquais des Californiens, à l’instar de Woody Allen et de son fameux « À Los Angeles il faut une voiture pour aller au parking ». Il va de soi que je ne me risque plus à ce genre de plaisanterie, il y a des bicyclettes à Los Angeles et à New York.
L’État et la nation américaine sont bien installés dans leurs traditions, et heureusement. Les institutions incarnent cette continuité démocratique que seule une poignée de peuples connaissent. Le changement majeur en train de se produire sous nos yeux n’est donc pas politique. Il est profondément social. Ce « vieux pays » du point de vue de ses institutions est devenu le théâtre d’une confrontation de plus en plus violente entre l’ancienne Amérique et la nouvelle. Voilà le dilemme.
Barack Obama en échec
La société américaine est en train de muer bien plus vite qu’en Europe autour de trois lignes de fractures. Celle qui oppose, depuis longtemps déjà, les Blancs d’un côté et les Noirs et les Hispaniques de l’autre. Celle qui renvoie dos à dos les riches et les pauvres. Et celle qui, désormais, sépare les chrétiens (surtout blancs) des musulmans. Conséquence : tout le monde ou presque, à commencer par les innombrables catégories d’élus, s’est installé dans la confrontation. Élu président, Barack Obama a tenté de transcender ce clivage. Mais il n’y est pas parvenu. Et il s’est retrouvé, en fin de mandat, dans la position du chef d’un des deux clans : celui de l’Amérique nouvelle. Celle contre laquelle s’érigent avec véhémence les partisans de Donald Trump, qui survivent à la défaite électorale de leur idole.
Je suis né à New York, comme mon père et ses parents. Ma mère étant Française, j’ai passé douze ans sur les bancs du Lycée français (primaire, collège, lycée, bac) de cette ville. Étudiant en lettres à l’Université Columbia, j’ai acquis vers 21 ans quelques solides clés de compréhension de la société new-yorkaise, sans prétendre à la splendide maîtrise du sujet de Tom Wolfe dans Le Bûcher des vanités, roman fondamental pour comprendre le New York ambiance 1975-903. Or quatre décennies plus tard, je regarde la société américaine avec angoisse.
L’anti-intellectualisme rampant, que j’avais vu à l’œuvre dès les années 1980, s’est transformé en vague de fond. Et Donald Trump, devenu sa figure de proue au fil de la campagne présidentielle, est absolument parfait dans ce rôle de pourfendeur des élites tant sa biographie est l’épopée d’un anti-intellectuel et d’un darwiniste social (que Darwin me pardonne, car son nom a été très injustement collé au phénomène). Les New-Yorkais s’en souviennent : en 1980, notre homme n’eut, malgré ses promesses publiques, aucun scrupule à détruire l’ancien immeuble Art Déco qui occupait autrefois l’emplacement de l’actuel Trump Tower ! Du passé et du bon goût, le promoteur issu du Queens affichait déjà son désir de faire table rase.
À l’opposé du spectre politique, il y a une coalition progressiste et gauchiste, lancée par Bernie Sanders en 2016, qui a fait des avancées presque aussi spectaculaires que celles de Trump parmi les jeunes. Il faut s’attarder sur le personnage Sanders pour comprendre l’Amérique. Soixante-huitard américain aux antipodes de Trump, celui-là incarne une épopée anticapitaliste bien new-yorkaise, réimplantée dans le petit État rural et tendance du Vermont où il a fini sénateur ! Soit l’exception absolue aux États-Unis. Sanders a dû rallier Hillary Clinton au terme des primaires, mais il a fait bouger les lignes du Parti démocrate. Se représentant en 2020, il figea sa campagne devant la percée inattendue de Joe Biden, et devant la déferlante de la Covid-19 qui exposait selon lui ses militants à un danger sanitaire. Il est aujourd’hui largement en passe d’être rattrapé par la nouvelle avant-garde de la gauche démocrate menée par la députée de New York, Alexandria Ocasio-Cortez.
Des identités multiples
L’Amérique nouvelle est plus que jamais celle des tribus américaines. J’emploie ici le mot « tribu » au sens de groupe lié par des convergences affectives, historiques, confessionnelles, géographiques, professionnelles et, bien sûr, ethniques et raciales. Mais il ne faut pas s’y méprendre, le critère ethnique n’est plus le seul pertinent. D’autres tribus émergent et inquiètent, souvent constituées autour de facteurs religieux ou idéologiques. De ce point de vue, les clivages de la campagne présidentielle de 2016 n’ont pas disparu, et se maintiennent dans l’opposition depuis l’investiture de Biden. Donald Trump se retrouve à la tête d’une opposition durable.
Les Américains, si divers soient-ils, sont également détenteurs d’une aspiration inégalée dans le monde : le rêve américain. Une promesse mystique, aux mille implications, l’expression American Dream est sur toutes les lèvres tout en signifiant des choses radicalement différentes selon les circonstances. L’on ne trouve aucun « rêve » en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, ou partout ailleurs dans le monde occidental. Or le type de rêve proposé par chacun des candidats en dit long sur les fractures qui divisent l’Amérique.
Donald Trump a, lui, martelé sa volonté de restaurer la grandeur et l’attractivité de l’Amérique (Make America great again). D’abord en éliminant la criminalité rampante et la menace terroriste de Daesh. Peu importe qu’il n’y soit pas parvenu, il a accrédité le mythe de l’obstruction de la part à la fois des Démocrates et des Républicains timorés. Il devait restaurer la prospérité américaine grâce au rapatriement des industries délocalisées en Chine ou au Mexique, ce qui est très loin d’être le cas. Il a présidé à une relance économique impressionnante, moyennant un creusement de déficit de 300 milliards $, dont on ne connaîtra pas la longévité potentielle, la Covid-19 ayant chamboulé les repères. Il a impulsé des changements sociétaux d’envergure, telle l’inversion des acquis en matière de droits personnels (avortement), l’attaque infructueuse contre la couverture médicale, dite Obamacare (de son vrai nom Affordable Care Act), et la fin des programmes d’aide explicite aux minorités défavorisées. Trump a pu nommer trois nouveaux juges de la Cour suprême conservateurs et moralisateurs. Un comble pour ce grand hédoniste new-yorkais, qui en est à son troisième mariage dont deux fois avec des mannequins d’Europe centrale. Le « darwinisme social » de Trump peut se résumer ainsi : que les plus forts prospèrent, et que les autres les admirent. Que les forts abusent des faibles en affaires, cela va de soi. Rien de bien neuf là encore. Adolescent, j’entendais parler des fournisseurs et prestataires lésés par le milliardaire : il ne les payait pas, ou pas en totalité, puis trouvait des arguties juridiques pour rejeter les doléances.
Joe Biden a été très idéologique de son côté. Jouissant d’une réputation de modération, originellement peu attiré par les programmes d’ingénierie sociale tel la discrimination positive (affirmative action), il s’est fait le champion de la classe moyenne tout en devenant parfaitement politiquement correct, un genre de Bernie Sanders sociétal mais sans la composante « socialiste » de ce dernier.
Bernie Sanders avait en effet parlé de « révolution politique » et d’écrasement de « l’oligarchie de la classe des milliardaires », ceux qui sont encore plus riches que Donald Trump.
Crise identitaire