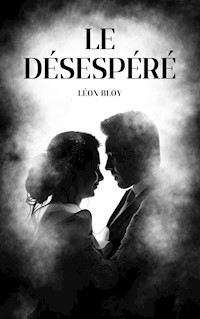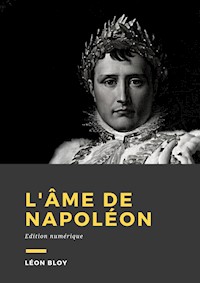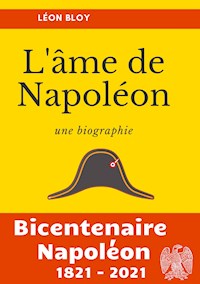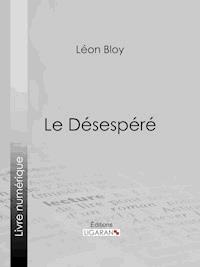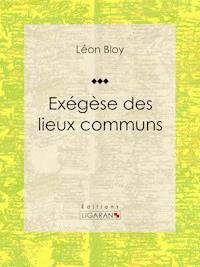
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Marie, esclavage, Etats-Unis, Bonnin de la Bonninière de Beaumont, G"Exégèse des lieux communs est un livre fascinant de l'écrivain français Léon Bloy. Publié en 1902, cet ouvrage est une véritable exploration de la pensée et de la condition humaine à travers une série de réflexions profondes et incisives.
Bloy, connu pour son style provocateur et sa vision pessimiste de la société, se livre ici à une analyse minutieuse des clichés et des idées reçues qui imprègnent notre quotidien. Il remet en question les conventions sociales, les valeurs morales et les préjugés qui régissent notre existence, nous invitant ainsi à une réflexion profonde sur notre propre condition.
Avec une plume acérée et un langage percutant, Bloy déconstruit les lieux communs pour mieux révéler leur absurdité et leur vacuité. Il nous pousse à remettre en question nos certitudes et à chercher une vérité plus profonde, plus authentique.
Exégèse des lieux communs est un livre qui ne laisse pas indifférent. Il suscite la réflexion, provoque des débats et remet en question nos convictions les plus profondes. C'est un ouvrage qui nous pousse à sortir de notre zone de confort intellectuel et à explorer de nouvelles perspectives.
En somme, Exégèse des lieux communs est un livre essentiel pour tous ceux qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure et à se questionner sur leur place dans celui-ci. Léon Bloy nous offre ici une œuvre puissante et intemporelle, qui continue de résonner avec force dans notre société contemporaine.
Extrait : ""Je commence aujourd'hui, 30 septembre, sous l'invocation de saint Jérôme, auteur de la Vulgate, appariteur de tous les Prophètes, inventoriateur plein de gloire des Lieux Communs éternels. Est-ce là manquer de respect à cet étonnant docteur que l'Eglise honore du titre de Maximus, et que le Concile de Trente a implicitement déclaré le Notaire de l'Esprit-Saint ? Je ne le crois pas."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335002225
©Ligaran 2014
Rappelez-vous, cher ami, notre petite chapelle de Sainte-Anne et de Saint-René, si humble et si pauvre, là-bas, près de l’Océan. En souvenir de cette chapelle et de l’hospitalité de Ker Saint-Roch, je vous prie d’accepter la dédicace de ce livre, plus grave et plus douloureux qu’il n’en a l’air, où j’ai montré, comme il m’a plu, le mal dont on meurt.
Votre nom affronté au mien, dès cette première page, vous condamne à partager mes disgrâces. Ami de l’écrivain mal famé que vous osâtes nommer un vivant, comment échapperiez-vous à votre destin ?
Notre rencontre fut un miracle appelé par la Douleur et on ne manquera pas de vous dire que la persistance de notre amitié en est un autre. Le plus étonnant prodige n’est-il pas qu’un homme se soit évadé avec enthousiasme des Lieux Communs où l’on dîne pour venir héroïquement ronger avec moi des crânes d’imbéciles dans la solitude ?
Lagny, 31 décembre 1901.
Léon Bloy.
Je commence aujourd’hui, 30 septembre, sous l’invocation de saint Jérôme, auteur de la Vulgate, appariteur de tous les Prophètes, inventoriateur plein de gloire des Lieux Communs éternels.
Est-ce là manquer de respect à cet étonnant docteur que l’Église honore du titre de Maximus, et que le Concile de Trente a implicitement déclaré le Notaire de l’Esprit-Saint ? Je ne le crois pas.
De quoi s’agit-il, en effet, sinon d’arracher la langue aux imbéciles, aux redoutables et définitifs idiots de ce siècle, comme saint Jérôme réduisit au silence les Pélagiens ou Lucifériens de son temps ?
Obtenir enfin le mutisme du Bourgeois, quel rêve !
L’entreprise, je le sais bien, doit paraître fort insensée. Cependant je ne désespère pas de la démontrer d’une exécution facile et même agréable.
Le vrai Bourgeois, c’est-à-dire, dans un sens moderne et aussi général que possible, l’homme qui ne fait aucun usage de la faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir été sollicité, un seul jour, par le besoin de comprendre quoi que ce soit, l’authentique et indiscutable Bourgeois est nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules.
Le répertoire des locutions patrimoniales qui lui suffisent est extrêmement exigu et ne va guère au-delà de quelques centaines. Ah ! si on était assez béni pour lui ravir cet humble trésor, un paradisiaque silence tomberait aussitôt sur notre globe consolé !
Quand un employé d’administration ou un fabricant de tissus fait observer, par exemple : « qu’on ne se refait pas ; qu’on ne peut pas tout avoir ; que les affaires sont les affaires ; que la médecine est un sacerdoce ; que Paris ne s’est pas bâti en un jour ; que les enfants ne demandent pas à venir au monde ; etc., etc., etc., » qu’arriverait-il si on lui prouvait instantanément que l’un ou l’autre de ces clichés centenaires correspond à quelque Réalité divine, a le pouvoir de faire osciller les mondes et de déchaîner des catastrophes sans merci ?
Quelle ne serait pas la terreur du patron de brasserie ou du quincaillier, de quelles affres le pharmacien et le conducteur des ponts et chaussées ne deviendraient-ils pas la proie, si, tout à coup, il leur était évident qu’ils expriment, sans le savoir, des choses absolument excessives ; que telle parole qu’ils viennent de proférer, après des centaines de millions d’autres acéphales, est réellement dérobée à la Toute-Puissance créatrice et que, si une certaine heure était arrivée, cette parole pourrait très bien faire jaillir un monde ?
Il semble, d’ailleurs, qu’un instinct profond les en avertisse. Qui n’a remarqué la prudence cauteleuse, la discrétion solennelle, le morituri sumus de ces braves gens, lorsqu’ils énoncent les sentences moisies qui leur furent léguées par les siècles et qu’ils transmettront à leurs enfants ?
Quand la sage-femme prononce que « l’argent ne fait pas le bonheur » et que le marchand de tripes lui répond avec astuce que, « néanmoins, il y contribue », ces deux augures ont le pressentiment infaillible d’échanger ainsi des secrets précieux, de se dévoiler l’un à l’autre des arcanes de vie éternelle, et leurs attitudes correspondent à l’importance inexprimable de ce négoce.
Il est trop facile de dire ce que paraît être un lieu commun. Mais ce qu’il est, en réalité, qui pourra le dire ?
Pourquoi, autrement, me serais-je recommandé à saint Jérôme ? Ce grand personnage ne fut pas seulement le consignataire pour toujours de la Parole qui ne change pas, des Lieux Communs pleins de foudres de la Très Sainte Trinité. Il en fut surtout l’interprète, le commentateur inspiré.
Avec une autorité beaucoup plus qu’humaine, il enseigna que Dieu a toujours parlé de Lui-même exclusivement, sous les formes symboliques, paraboliques ou similitudinaires de la Révélation par l’Écriture, et qu’il a toujours dit la même chose de mille manières.
J’espère que ce Docteur sublime daignera favoriser de son assistance un pamphlétaire de bonne volonté qui serait si heureux de mécontenter, une fois de plus, la populace de Ninive, éternellement « incapable de distinguer sa droite de sa gauche », – et de la mécontenter à un tel point que des colères inconnues se déchaînassent.
Ce résultat serait obtenu, sans doute, si la céleste douceur ne m’était pas refusée d’établir, en l’irréfutable argumentation d’une dialectique de bronze, que les plus inanes bourgeois sont, à leur insu, d’effrayants prophètes, qu’ils ne peuvent pas ouvrir la bouche sans secouer les étoiles, et que les abîmes de la Lumière sont immédiatement invoqués par les gouffres de leur Sottise.
Quelle épigraphe pour un commentaire du Code civil ! Plaisanterie trop facile et qu’il faut laisser charitablement à MM. les journalistes ou clercs d’huissiers. Le cas est grave.
N’est-ce pas une occasion de stupeur de songer que cette chose est dite, plusieurs millions de fois par jour, à la face conspuée d’un Dieu qui « demande » surtout à être mangé ! Le marchandage perpétuel impliqué par ce Lieu Commun a ceci de troublant qu’il rend manifeste le manque d’appétit d’un monde affligé cependant par les famines et réduit à se nourrir de son ordure.
Il serait puéril de faire observer qu’en cette formule, bien plus mystérieuse qu’on ne croirait, tout porte sur le mot tant, dont l’abstraite valeur est toujours à la merci d’un étalon facultatif qui n’est jamais divulgué. Cela dépend naturellement de l’étage des âmes.
Mais, comme la pente de toute négation est vers le néant, il n’est pas téméraire de conclure que l’imprécise demande de Dieu équivaut à rien, et que ce Dieu n’ayant plus rien à demander, en fin de compte, à des adorateurs qui peuvent indéfiniment rétrécir leur zèle, il n’a que faire désormais de son Être ou de sa Substance et doit nécessairement s’évanouir. Il importe, en effet, aussi peu que possible, qu’on ait telle ou telle notion de Dieu. Lui-même n’en demande pas tant, et voilà le point essentiel.
Quand j’exhorte ma blanchisseuse, Mme Alaric, à ne pas prostituer sa dernière fille comme elle a prostitué les quatre aînées ou que, timidement, je propose à mon propriétaire, M. Dubaiser, l’exemple de quelques Saints qui ne crurent pas indispensable à l’équilibre social de condamner à mort les petits enfants, et que ces dignes personnes me répondent : – Nous sommes aussi religieux que vous, mais Dieu n’en demande pas tant…, je dois reconnaître qu’elles sont fort aimables de ne pas ajouter : au contraire ! bien que ce soit évidemment, nécessairement, le fond de leur pensée.
Elles ont raison, sans doute, car la logique des Lieux Communs ne pardonne pas. Si Dieu n’en demande pas tant, il est forcé, par une conséquence invincible, d’en demander de moins en moins, je le répète, et finalement de tout refuser. Que dis-je ? En supposant qu’il lui reste alors un peu d’existence, il se trouvera bientôt dans la plus pressante nécessité de vouloir enfin qu’on vive comme des cochons et de lancer le reliquat de son tonnerre sur les purs et sur les martyrs.
Les bourgeois, d’ailleurs, sont trop adorables pour n’être pas devenus eux-mêmes des Dieux. C’est à eux qu’il convient de demander, à eux seuls. Tous les impératifs leur appartiennent et on peut être certain que le jour où ils demanderont trop sera précisément le jour même où ils commenceront à s’apercevoir qu’ils ne demandent pas tout à fait assez…
– Moi, je demande vos peaux, sales canailles ! leur dira Quelqu’un.
Corollaire du précédent. La plupart des hommes de ma génération ont entendu cela toute leur enfance. Chaque fois qu’ivres de dégoût nous cherchâmes un tremplin pour nous évader en bondissant et en vomissant, le Bourgeois nous apparut, armé de ce foudre.
Nécessairement, alors, il nous fallait réintégrer le profitable Relatif et la sage Ordure.
Presque tous, il est vrai, s’y acclimatèrent, par bonheur, devenant, à leur tour, des Olympiens.
Savent-ils, pourtant, ces buveurs d’un sale nectar, qu’il n’y a rien de si audacieux que de contremander l’Irrévocable, et que cela implique l’obligation d’être soi-même quelque chose comme le Créateur d’une nouvelle terre et de nouveaux cieux ?
Évidemment, si on donne sa parole d’honneur que « rien n’est absolu », l’arithmétique, du même coup, devient exorable et l’incertitude plane sur les axiomes les plus incontestés de la géométrie rectiligne. Aussitôt, c’est une question de savoir s’il est meilleur d’égorger ou de ne pas égorger son père, de posséder vingt-cinq centimes ou soixante-quatorze millions, de recevoir des coups de pied dans le derrière ou de fonder une dynastie.
Enfin, toutes les identités succombent. Il n’est pas « absolu » que cet horloger qui est né en 1859, pour l’orgueil de sa famille, n’ait aujourd’hui que quarante-trois ans et qu’il ne soit pas le grand-père de ce doyen de nos emballeurs qui fut enfanté pendant les Cent Jours, – de même qu’il serait téméraire de soutenir qu’une punaise est exclusivement une punaise et ne doit pas prétendre aux panonceaux.
En de telles circonstances, on en conviendra, le devoir de créer le monde s’impose.
Ici, je l’avoue, mon titre m’accable et je suis furieusement tenté de descendre de ma chaire. Exégèse signifie, hélas ! explication, et voici un monstre de Lieu Commun qui vient au-devant de moi sur la route de Thèbes. Jamais, sans doute, une énigme plus difficile ne fut proposée à un Œdipe.
Voyons cependant.
Si le Mieux est l’ennemi du Bien, il faut nécessairement que le Bien soit l’ennemi du Mieux, car les abstraits philosophiques ne connaissent pas plus le pardon que l’humilité. Un homme peut répondre à la haine par l’amour, une idée jamais, et plus cette idée est excellente, plus elle récalcitre.
On affirme donc, implicitement, que le Bien a horreur du Mieux et qu’une haine farouche les divise. C’est à qui mangera l’autre, éternellement. Mais alors, qui est le Bien et qui est le Mieux et quelle fut l’origine de leur conflit ? Que nous veut ce manichéisme grammatical ?
Est-il bien, par exemple, d’être un sot et mieux d’avoir du génie ? Quand on dit que Dieu a tout fait pour le Mieux, dois-je entendre qu’il n’a rien fait pour le Bien ? Dans quelle caverne métaphysique ce comparatif et ce positif se sont-ils déclaré la guerre ? C’est à en devenir fou.
Je prends ma tête à deux mains et je me donne à moi-même des noms très doux : – Voyons ! encore une fois, mon cher ami, mon trésor, mon petit lapin bleu ! un peu de calme, nous retrouverons peut-être le fil. Nous avons dit ou entendu dire que le Mieux est l’ennemi du Bien, n’est-ce pas ? Or, qu’est-ce que l’ennemi du Bien, sinon le Mal ? Donc le Mieux et le Mal sont identiques. Voilà déjà un peu de lumière, semble-t-il…
Oui, mais si le Mieux est vraiment le Mal nous allons être forcés de reconnaître que le Bien, à son tour, est aussi le Mal, d’une façon très incontestable, puisque tous les hommes avouent qu’il est lui-même mieux que le Mal qui est le Mieux et que, par conséquent, il est mieux que le Mieux qui serait alors le Pire ! ! ! ? ? ?
Zut ! Ariane me lâche et j’entends mugir le Minotaure.
Celui-là, – ai-je besoin de le dire ? – est une antiphrase. Le toujours suave et rafraîchissant Bourgeois utilise volontiers cette forme grecque de la glose confabulatoire. Nous aurons plus d’une fois l’occasion de le remarquer.
Il faut donc lire fermement : L’hôpital est fait pour les chiens. En ce sens, qui est le vrai, le Bourgeois parle comme un Dieu. De simples hommes ne pourraient pas si bien dire.
J’ouvre la Sylva allegoriarum du Frère Hieronymus Lauretus, savant in-folio, imprimé à Lyon, en 1622, aux frais de Barthélémy Vincent, sous le signe de la Victoire, et je trouve ceci au mot Canis : « Le chien est un animal au service de l’homme pour le réjouir de sa compagnie et de ses caresses. Il aboie contre les étrangers. Il est immonde, plein de rage et d’une extrême lubricité. Il est le gardien du troupeau et le chasseur des loups. Il est vorace et carnivore et retourne à son vomissement. »
La science moderne, à qui le genre humain est redevable de tant de découvertes utiles, présume en outre que le chien est quadrupède et que la voix articulée lui manque. Mais il n’y a pas lieu de s’arrêter à ces hypothèses. D’ailleurs, il y a chien et chien, c’est bien connu.
Le chien pour qui l’hôpital est fait, c’est le carnivore, l’immonde carnivore, devenu vieux ou infirme, dont la compagnie a cessé de plaire, incapable désormais d’aucune sorte de fureur, qui n’a plus la force d’aboyer, que le troupeau, à son tour, est obligé de garder et que menace la dent des loups.
À quel autre, je le demande, seraient ouverts ces admirables asiles où on crève, avec tant de consolation, dans les bras de l’Assistance publique ? Le vrai, le seul, l’authentique chien, c’est celui, – quel que soit le nombre de ses pattes ou la force de son coup de gueule, – qui ne peut plus être profitable. C’est pour celui-là, exclusivement, que fonctionne l’Administration aux mamelles crochues qui s’allaite elle-même du sang des agonisants. Le juste Bourgeois l’a voulu ainsi.
N’est-il pas le Maître ? N’est-il pas le Dieu des vivants et le Dieu des morts ? Depuis que le Code Napoléon l’a promu au remplacement de Jéhovah, nul ne le juge et il fait exactement ce qui lui plaît. Or, il lui plaît d’être, comme cela, le Bon Dieu des chiens.
Autre antiphrase. Voudriez-vous m’apprendre, ô mon aimable propriétaire, ce qui peut-être vice ou crime, si la pauvreté ne l’est pas ?
Je crois l’avoir beaucoup dit ailleurs, la pauvreté est l’unique vice, le seul péché, l’exclusive noirceur, l’irrémissible et très singulière prévarication. C’est bien ainsi que vous l’entendez, n’est-ce pas, précieuses Crapules qui jugez le monde ?
Qu’on le proclame donc une bonne fois, la pauvreté est si infâme que c’est le dernier excès du cynisme ou le cri suprême d’une conscience au désespoir d’en faire l’aveu, et qu’il n’y a pas de châtiment qui l’expie.
Le devoir de l’homme est tellement d’être riche que la présence d’un seul pauvre clame vers le ciel, comme l’abomination de Sodome, et dépouille Dieu lui-même, le forçant à s’incarner et à se promener scandaleusement sur la terre, vêtu seulement de la guenille de ses Prophéties.
L’indigence est une impiété, un blasphème atroce dont il n’est pas possible d’exprimer l’horreur et qui fait reculer du même coup les étoiles et le dictionnaire.
Ah ! que l’Évangile est mal compris ! Quand on lit qu’« il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux », faut-il être aveugle pour ne pas voir que cette parole n’exclut, en réalité, que le chameau, puisque tous les riches, sans exception, sont certainement assis sur des chaises d’or dans le Paradis et que, par conséquent, il leur est tout à fait impossible, en effet, d’entrer dans un endroit où ils sont installés déjà, depuis toujours ! C’est affaire aux chameaux d’enfiler des aiguilles devant la porte et de se débrouiller comme ils pourront. Il n’y a pas lieu de s’en préoccuper autrement.
Ce Lieu Commun atteste, plus qu’un autre, la pudeur sublime du Bourgeois. C’est un voile qu’il jette bonnement, avec le divin sourire des garçons d’amphithéâtre, sur le chancre le plus horrible de l’humanité.
Esculape Nuptial, s’étant assuré que le vieillard avait reçu un nombre suffisant de coups de couteau et qu’il avait certainement exhalé ce qu’on est convenu d’appeler le dernier soupir, songea tout d’abord à se procurer quelque divertissement.
Cet homme judicieux estima que la corde ne saurait être toujours tendue, qu’il est sage de respirer quelquefois et que toute peine vaut son salaire.
Il avait eu la chance de mettre la main sur la forte somme. Heureux de vivre et la conscience délicatement parfumée, il allait çà et là, sous les marronniers, ou les platanes, respirant avec délices l’odorante haleine du soir.
C’était le printemps, non l’équivoque et rhumatismal printemps de l’équinoxe, mais le capiteux renouveau du commencement de juin, lorsque les Gémeaux enlacés reculent devant l’Écrevisse.
Esculape, inondé d’impressions suaves et les yeux mouillés de pleurs, se sentit apôtre.
Il désira le bonheur du genre humain, la fraternité des bêtes féroces, la tutelle des opprimés, la consolation de ceux qui souffrent.
Son cœur, plein de pardons, s’inclina vers les indigents. Il répandit dans des mains tendues l’abondante monnaie de cuivre dont ses poches étaient encombrées.
Il entra même dans une église et prit part à la prière en commun que récitait un troupeau fidèle. Il adora Dieu, lui disant qu’il aimait son prochain comme lui-même. Il rendit grâces pour les biens qu’il avait reçus, se reconnaissant tiré du néant.
Il demanda que fussent dissipées les ténèbres qui lui cachaient la laideur et la malice du péché, fit un scrupuleux examen de conscience, découvrit en lui des imperfections tenaces, de persistantes broutilles : mouvements de vanité, impatiences, distractions, omissions, jugements téméraires et peu charitables, etc., mais surtout la paresse et la négligence dans l’accomplissement des devoirs de son état.
Il termina par un bon propos d’être moins fragile désormais, implora le secours du ciel pour les agonisants et les voyageurs, demanda, comme il convient, d’être protégé pendant la nuit, et, pénétré de ces sentiments, courut au plus prochain lupanar.
Car il tenait pour les joies honnêtes. Ce n’était pas un de ces hommes qui se laissent aller facilement aux dissipations frivoles. Il penchait plutôt du côté de la rigueur et ne se défendait qu’à peine d’une gravité ridicule.
Il tuait pour vivre, – comme la plupart des honnêtes gens, – parce qu’il n’y a pas de sot métier. Il aurait pu, à l’exemple de tant d’autres, s’enorgueillir des dangers d’une si chatouilleuse profession. Mais il préférait le silence. Pareilles au convolvulus, les fleurs de son âme ne s’épanouissaient que dans la pénombre.
Il tuait à domicile, poliment, discrètement et le plus proprement du monde. C’était, on peut le dire, de la besogne joliment exécutée.
Il ne promettait pas ce qu’il était incapable de tenir. Il ne promettait même rien du tout. Mais ses clients ne se plaignirent jamais.
Quant aux langues venimeuses, il n’en avait cure. Bien faire et laisser dire, telle était sa devise. Le suffrage de sa conscience lui suffisait.
Homme d’intérieur avant tout, on ne le rencontrait que très rarement dans les cafés, et les malveillants eux-mêmes étaient forcés de lui rendre cette justice qu’en dehors du bordel, il ne voyait à peu près personne.
Dans cette demeure hospitalière, il avait fixé sa dilection sur une jeune fille légèrement vêtue qui faisait prospérer l’établissement et que sa précocité de virtuose désignait à l’enthousiasme. À peine au sortir de l’enfance, de nombreux salons l’avaient admirée déjà.
L’heureux Esculape avait eu l’art de s’en faire aimer, et le temps paraissait « suspendre son vol », quand ces deux êtres étaient penchés l’un vers l’autre, sur le lac mystique.
La ravissante Loulou ne voulait plus rien savoir aussitôt qu’apparaissait son petit Cucu, et, souvent, celui-ci fut contraint de la ramener, d’une main ferme, au sentiment professionnel de son art, quand les vieux messieurs s’impatientaient. Elle lui donnait, en retour, des indications précieuses…
Enfin, ils plaçaient avec discernement d’assez jolies sommes. Loulou n’usait presque rien, l’air et la lumière suffisant à sa toilette quotidienne qui était toujours très simple et d’un goût parfait.
Déjà même, ils entrevoyaient la récompense, l’heureux avenir qui les attendait à la campagne, dans quelque chaumière enfouie sous les lilas et les roses, qu’ils achèteraient un jour, et la vieillesse paisible dont la Providence rémunère ceux qui ont bravement combattu.
Oui, sans doute, mais, hélas ! qui pourra dire combien sont vaines les pensées des hommes ?
Ce qui va suivre est excessivement douloureux.
Cette nuit-là, Esculape ne parut pas. La maison en souffrit plus qu’on ne peut dire. La pauvre Loulou, d’abord fébrile, puis agitée, et enfin hagarde, cessa de plaire.
Un notaire belge, qui avait apporté les fonds de ses clients, reçut une retentissante paire de claques dont les passants s’étonnèrent.
Le scandale fut énorme et le décri parut imminent. Mais elle ne voulait « entendre à rien ni à personne ». Son inquiétude montant au délire, elle poussa le mépris des lois jusqu’à ouvrir une fenêtre demeurée close, depuis le dernier 14 juillet, et appela son Cucu d’une voix terrible, dans le grand silence nocturne.
Quelques pasteurs protestants prirent le large, non sans avoir exprimé leur indignation, et, dès le lendemain, les journaux graves pronostiquèrent tristement la fin du monde.
Dois-je le déclarer ? Esculape faisait la noce, Esculape avait rencontré un serpent.
Comme il rentrait sagement au bercail d’amour, il fut accosté par un camarade d’enfance qu’il n’avait pas vu depuis dix ans et qui parvint à le débaucher, pour la première fois de sa vie.
J’ignore les sophismes que déploya cet ami funeste pour le détourner de l’étroite voie qui mène au ciel, mais ils se soûlèrent à ce point que, vers l’aurore, l’amant désorbité de la gémissante Loulou prit une voiture pour aller chercher un Combat spirituel qu’il se souvenait d’avoir oublié, la veille, chez son macchabée, et qu’il jugeait tout à fait indispensable à son progrès intérieur.
Le fidèle compagnon de sa nuit le conduisit, comme par la main, jusque dans la chambre du mort, où le commissaire de police l’attendait obligeamment.
Et voilà comment une seule défaillance brisa deux carrières.
On n’est pas parfait.
Et les honnêtes gens, donc ! Quelqu’un pense-t-il que la lumière les rassure ? Ah ! si elle était encore à créer, je ne sais pas ce que feraient les coquins, mais je sais bien ce que ne feraient pas les honnêtes gens.
On ne voit pas déjà très clair sur notre planète où les plus clairvoyants vont à tâtons. Il paraît cependant que c’est encore trop, puisque tout le monde se cache. Qu’arriverait-il si la Science, tant admirée par Zola et si digne de l’admiration d’un tel cerveau, venait à lancer un rayon neuf qui éclairât les antres des cœurs ?
N’est-il pas évident que toute affaire, à l’instant, deviendrait impraticable, impossible ? Plus de commerce, plus d’industrie, plus d’alliances politiques, plus de médecine, plus de pharmacie, plus de cuisine, plus de procès, plus de mariages, ni d’enterrements, ni de testaments, ni de « bonnes œuvres » d’aucune sorte. Enfin plus d’amour. Les honnêtes gens cesseraient de naître… Il ne resterait pour vaquer au grouillement humain que ceux qui « redoutent la lumière » et qu’on nomme les malhonnêtes gens. Quel désordre étrange !
Il est vrai que ceux-là succomberaient bientôt à leur tour, étant devenus eux-mêmes, par la force des choses, des honnêtes gens pour succéder aux disparus, et les deux espèces qui font la totalité du genre disparaîtraient, successivement exterminées par la lumière, – comme ces couleurs fraîches et brillantes que le soleil mange, dit-on, à son déjeuner.
Espérons que ces malheurs n’arriveront pas et que les malhonnêtes gens aussi bien que les honnêtes, ceux qui « redoutent » la lumière non moins que ceux qui se bornent à la trouver indiscrète, continueront à se repousser sous le bleu du ciel, à se faire valoir les uns par les autres dans le cadre poétique des huissiers, des gendarmes et des verdures. L’universelle harmonie l’exige.
M. Paul Bourget, eunuque par vocation et l’un des adeptes les plus illustres du Lieu Commun, a pris la peine de recommander celui-là. Je ne ferai pas à mes lecteurs l’outrage de leur rappeler le titre du livre puissant vertébré par cette formule.
Il paraît bien certain, en effet, que les enfants n’en demandent pas tant. C’est leur manière de confiner à l’état divin et c’est par là, sans doute, qu’ils peuvent plaire quelquefois à l’âme religieuse du Bourgeois qui adore par-dessus tout qu’on ne lui demande rien.
Je l’avoue, la seule idée d’un enfant qui demanderait à naître a quelque chose de troublant, et je comprends mieux le prophète Jérémie déplorant que sa mère ne fût pas demeurée grosse de lui éternellement, sans pouvoir jamais l’enfanter. Cependant, s’il s’agit de naître Bourgeois… ou Psychologue, l’impatience, à la rigueur, se peut concevoir.
Ce Lieu Commun ne me paraît donc pas recevable en tant qu’axiome et je crains que Paul ne se soit laissé entraîner plus loin qu’il n’aurait fallu sur la piste d’un receveur des contributions ou d’un chef de bureau de l’État civil trop téméraire. Je suis même peu éloigné de croire, avec le fétide Schopenhauer, que tous les enfants, sans exception, demandent à naître et que c’est ainsi que se peuvent expliquer les transports déraisonnables de l’amour.
Il va sans dire que je m’interdis absolument d’effleurer, en cette occasion, l’idée religieuse, impliquant des choses telles que la Prescience divine ou la Prédestination, que le perspicace Bourgeois dédaigne. Saint Colomban, dit-on, entendait les cris des petits enfants qui l’appelaient du sein de leurs mères. Mon coiffeur n’a jamais entendu rien de semblable, et tout ce surnaturel est surabondamment démenti par la bicyclette.
Pour m’en tenir à l’hypothétique allégation du cuistre précité, j’estime bienséant de conjecturer que si les enfants, même de bourgeois, ne demandent pas positivement à naître, ils suggèrent du moins à leurs parents l’horreur instinctive d’une virginité ou d’une continence qui s’opposerait à leur entrée dans la vie… Je ne sais si je me fais bien comprendre. En tout cas cela, suffit pour invalider la formule.
Mais lorsqu’un notaire affirme, en s’accompagnant d’une gesticulation bilatérale, que « les enfants ne demandent pas à venir au monde », cela ne peut signifier pratiquement que deux choses : ou qu’il faut renoncer à en faire, ou qu’il faut les tuer avant qu’ils naissent, dans l’intérêt des familles et dans l’intérêt bien compris des hoirs. Jamais, au grand jamais, dussent crouler les cieux, il ne devra être entendu, par exemple, qu’un petit bâtard tombé du ventre d’une gueuse a des droits quelconques à la pitié d’un procréateur qu’il est toujours interdit de rechercher. Et voilà tout, exactement tout.
Essayez de vous dire, après cela, que ce joli monde a été racheté, il y a dix-neuf siècles, par un Enfant qui avait demandé à naître, depuis toute l’Éternité !
– Je ne demande pas mieux que de manger, dit un pauvre diable, bien que la vie ne me soit pas douce, mais encore faut-il que j’aie quelque chose à me mettre sous la dent. Tous les chiens mangent et vivent. Ceux qui n’ont pas la chance d’être servis par un maître se nourrissent tout de même d’excellentes ordures qui suffisent à leur vie de chiens. Moi, je ne peux pas. J’ai le malheur d’appartenir à la race humaine et d’être avantagé d’un front sublime qui doit continuellement fixer les astres. Je manque de flair et la charogne me reste sur l’estomac…
J’ai entendu dire qu’autrefois il y avait une Viande pour les pauvres et que les mourants de faim avaient la ressource de manger Dieu pour vivre éternellement. Dans les très vieux temps, on se traînait, en pleurant les larmes du Paradis, d’une chapelle de confesseur à une crypte de martyr et d’un sanctuaire miraculeux à une basilique pleine de gloire, sur des routes encombrées de pèlerins qui mendiaient le Corps du Sauveur. Cet aliment unique suffisait à quelques-uns qui étaient des Bienheureux dont la langueur avait le pouvoir de guérir toutes les langueurs et, quelquefois, de ressusciter les morts. Tout cela est loin, terriblement loin…
Aujourd’hui, c’est le Bourgeois qui a remplacé Jésus, et les truies même reculeraient devant son corps !
In-con-tes-ta-ble-ment. Et c’est si vrai que, quand on en manque, on est forcé de prendre celui des autres. Cela peut se faire, d’ailleurs, avec beaucoup de loyauté.
– Je ne force personne, fait observer affablement un prêteur à cent cinquante pour cent, mais j’ai des risques et il faut que l’argent travaille. Vivre sans argent est aussi inconcevable pour cet homme juste que vivre sans Dieu pour un solitaire de la Thébaïde. Et ces deux viveurs ont raison, puisque leur objet est identique, inexprimablement identique.
Ayant déjà tellement prouvé qu’il est impossible de vivre sans manger, il est à peu près oiseux d’entreprendre la démonstration de la vitale nécessité de l’argent. Manger de l’argent ! hurlent en cœur les pères de famille. Quel trait de lumière que cette locution métonymique !
Eh ! que pourrait-on manger, dites-le moi, si on ne mangeait pas de l’argent ? Existe-t-il dans le monde une autre chose qui soit mangeable ?
N’est-il pas clair comme le jour que l’Argent est précisément ce même Dieu qui veut qu’on le dévore et qui seul fait vivre, le Pain vivant, le Pain qui sauve, le Froment des élus, la Nourriture des Anges, mais, en même temps, la Manne cachée que les pauvres cherchent en vain ?
Il est vrai que le Bourgeois, qui sait presque tout, ne pénètre pas ce mystère. Il est vrai aussi que le sens du mot « vivre » ne lui est pas clair, puisque l’argent sans lequel il soutient généreusement qu’on ne peut pas vivre est, néanmoins, pour lui, une Question de vie ou de mort…
N’importe, il le possède, voilà l’essentiel. S’il ne le mange pas lui-même, d’autres le mangeront après lui, c’est sûr.
Mais quand il profère ces mots redoutables, j’ose le mettre au défi de ne pas ressembler à un vrai prophète et de ne pas affirmer Dieu avec une force infinie. Trahitur sapientia de occultis.
On vient de le voir, ce Lieu Commun sort du précédent comme l’abeille sort de la fleur. Le précepte ressassé de faire travailler l’argent est théologique, au fond, beaucoup plus qu’économique, par une suite nécessaire de l’identité que je viens d’inscrire.
Travailler, dans le sens du latin laborare, c’est souffrir. On fait donc souffrir l’Argent qui est Dieu. On le fait souffrir, naturellement, avec la plus abondante ignominie. À l’exception des crachats, – car le Bourgeois « ne crache pas sur l’argent », – aucun opprobre ne lui est épargné. On le fait même suer. On lui fait suer le sang des pauvres dans l’agonie des labeurs de mort.
Il y a des peuples qui crèvent dans les usines ou les catacombes noires pour velouter la gueule des vierges engendrées par des capitalistes surfins, et aussi pour que « le mystérieux sourire de la Joconde » ne leur soit pas refusé. C’est ce qui s’appelle faire travailler l’argent !
… Et la Face pale du Christ est plus pâle au fond des puits et dans les fournaises.
De tous les Lieux Communs, ordinairement si respectables et si sévères, je pense que voici le plus grave, le plus auguste. C’est l’ombilic des Lieux Communs, c’est la culminante parole du siècle. Mais il faut l’entendre et cela n’est pas donné indistinctement à tous les hommes. Les poètes, par exemple, ou les artistes le comprennent mal. Ceux qu’on nomme archaïquement des héros ou même des saints n’y comprennent rien.
L’affaire du salut, les affaires spirituelles, les affaires d’honneur, les affaires d’État, les affaires civiles même, sont des affaires qui pourraient être autre chose, mais ne sont pas les Affaires qui ne peuvent être que les Affaires, sans attribution ni épithète.