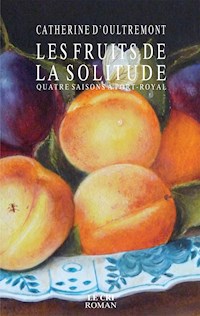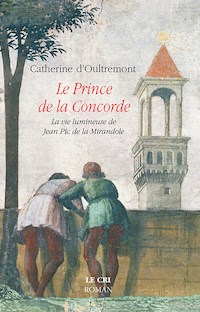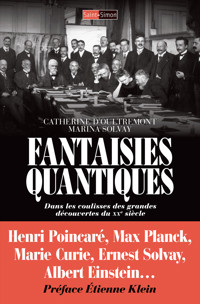
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Simon
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
"Tissé dans la trame de l’histoire du xxe siècle, ce récit retrace la grande épopée de la Science moderne avec la naissance de la mécanique quantique dans le berceau des Conseils Solvay. Grâce à son mécénat, Ernest Solvay, né en 1838, capitaine d’industrie belge passionné de sciences, a permis de démêler l’écheveau dans lequel s’engluait la physique à l’aube du xxe siècle.
De l’émergence de l’atome et ses particules à la conception de l’univers en expansion et à la théorie du Big Bang, ce livre raconte les amours, les amitiés, les bonheurs, les souffrances des plus éminents scientifiques qui ont révolutionné la Science : Albert Einstein, Marie Curie, Henri Poincaré…
Les recherches pointues de Marina Solvay associées à l’écriture fluide de Catherine d’Oultremont nous offrent un témoignage historique inédit de cette remarquable aventure qui se lit comme un roman.
Outre les Instituts de Physique Solvay, créés en 1911, et de Chimie, créés en 1922, cet empire à caractère familial fondé il y a plus de 150 ans est devenu aujourd’hui une multinationale. La société Solvay emploie près de 25 000 personnes dans 62 pays. Solvay, c’est aussi la Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM), une faculté d’économie et de gestion rattachée à l’ULB (Université Libre de Bruxelles).
À PROPOS DES AUTRICES
Catherine d’Oultremont, née en 1955, passe son enfance et sa jeunesse en Catalogne avant de s’établir en Belgique. De formation artistique, elle apporte sa contribution à des revues traditionnelles et philosophiques et a écrit plusieurs romans, dont Le Prince de la Concorde et Sèves (éd. Le Cri).
Marina Solvay est l’arrière-arrière-petite-fille du grand industriel et fondateur de l’empire Solvay. Elle se consacre depuis de nombreuses années au monde de la musique et des sciences. Depuis 8 ans, elle accompagne les activités des Instituts de Physique et de Chimie Solvay, notamment en revalorisant leur patrimoine scientifique et historique, répertoriant leurs archives, réalisant des interviews de savants et de prix Nobel célèbres, afin de les faire connaître au grand public.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Élevez-vous, d’une aile hardie, au-dessus du cours de votre temps.
Que déjà, dans votre miroir, commence à poindre le siècle futur.
FRIEDRICH VON SCHILLER.
Le plus infime atome renferme des mondes inconcevables…
LOUIS CATTIAUX.
Préface
Comme j’aimerais qu’il existe une île peuplée uniquement d’hommes sages et de bonne volonté ! on m’y verrait devenir, moi aussi, un fervent patriote.
ALBERT EINSTEIN
Le premier Conseil Solvay eut lieu en octobre 1911 dans le centre historique de Bruxelles, place de Brouckère, à l’hôtel Métropole. Ce somptueux palace n’a rien perdu de sa superbe : colonnes, vitraux, arcades, miroirs et dorures presque partout, plafonds à caissons, lustres gigantesques, bronze, stuc, bois précieux, fer forgé… Il faut dire qu’Alban Chambon, l’architecte qui le conçut, avait allègrement mélangé les styles, s’inspirant de la Renaissance française pour le vestibule, de l’italienne pour la grande salle des fêtes, de l’art hindou pour le salon de réception, du style anglais pour le bureau et son long comptoir de teck. La salle de réunion où s’était tenu le premier Conseil se situe au premier étage. Comparée au reste, elle ne paie pas de mine : une quarantaine de mètres carrés, un peu de marbre aux murs, une longue table au milieu. Pourtant, c’est entre ses murs que s’écrivit l’une des plus fameuses pages de l’histoire de la physique du XXe siècle. De cette conférence internationale d’un genre nouveau – la première d’une longue et prestigieuse série –, la seule image qui subsiste est une célèbre photo de groupe qui juxtapose vingt savants de tout premier plan : Albert Einstein, Max Planck, Hendrik Lorentz, Jean Perrin, Ernest Rutherford, Paul Langevin, Arnold Sommerfeld, Henri Poincaré… Dix de ces hommes avaient reçu ou allaient recevoir le prix Nobel, et une femme, la physicienne Marie Curie. Corécipiendaire du prix Nobel de Physique en 1903, elle apprendrait le mois suivant que le prix Nobel de Chimie 1911 lui était aussi attribué.
C’est Ernest Solvay, figure belge emblématique du XIXe siècle, qui avait réuni la crème de la physique d’alors. Né en 1838 dans un village proche de Bruxelles, cet autodidacte inventif avait bâti sa fortune en développant un procédé de fabrication de la soude. Il était de ces industriels libéraux, laïques et philanthropes qui plaçaient toute leur confiance dans le progrès scientifique et technique. Une grave maladie l’avait empêché de suivre des études universitaires, mais il était sincèrement fasciné par la science, en laquelle il voyait un moyen d’émancipation spirituelle autant que matérielle, un guide autant qu’un outil. « Être en contact avec les savants, confia-t-il, devenir un peu savant soi-même si possible, envisager la révision des données physiques, dévoiler ainsi le réel, le définitif, fut le rêve doré de toute ma vie*. »
Au printemps 1910, Walther Nernst, professeur de physique-chimie à l’université de Berlin, était venu lui proposer d’organiser et de financer une conférence internationale sur la « nouvelle physique », précisément sur « la théorie du rayonnement et les quanta ». Les idées de Planck et d’Einstein, ces deux fers de lance d’une nouvelle physique, devaient être diffusées, et reconnues par tous les physiciens. Ernest Solvay sauta sur l’occasion qui lui était donnée de rencontrer les meilleurs esprits scientifiques de son temps. Dans Un tout petit monde, David Lodge a décrit la futilité de l’exercice ritualisé du colloque, comble du maniérisme académique : on écoute, sans écouter, l’orateur lire un papier (ou, aujourd’hui, commenter un fichier PowerPoint) qu’on aurait pu lire bien plus confortablement chez soi ; quelques questions polies ou tordues suscitent quelques réponses érudites ou vagues dans l’indifférence générale, puis on laisse la place à l’orateur suivant. Mais le premier Congrès Solvay et ceux qui suivraient furent tout à fait autre chose. Dans l’enceinte de l’hôtel Métropole régnait une attention particulière, une fièvre partagée. La physique, en plein bouleversement depuis quelques années, traversait une crise profonde, donc enthousiasmante. Les expérimentateurs présents savaient que leurs résultats pouvaient donner lieu à la reformulation par les théoriciens d’arguments en faveur d’une interprétation nouvelle. Les théoriciens n’ignoraient pas que les expérimentateurs pouvaient mettre par terre leurs théories chéries. Un nouveau monde s’ouvrait, prodigieusement incertain. Un monde où les credo les plus illustres pouvaient être contestés. On se disputait à coups de thèses et d’antithèses, d’arguments et d’objections. La pagaille était courtoise et inventive. En résumé, il y avait des nouveautés dans tous les domaines et partout du pain sur la planche. L’atome, découvert depuis peu, venait de révéler, grâce aux travaux d’Ernest Rutherford, qu’il était en réalité un édifice composite, constitué d’un noyau très dense autour duquel s’agitent des électrons. Par quels mécanismes pouvait-il émettre ou absorber de la lumière ? À cette époque, les physiciens connaissaient en tout et pour tout deux particules élémentaires : l’électron, dont la découverte, attribuée à Joseph Thomson, remontait à 1897, et le proton, que le même Ernest Rutherford venait d’identifier. Le « grain de lumière » inventé par Einstein en 1905 provoquait encore des résistances. Comment la lumière, si elle était composée de corpuscules, pouvait-elle produire les phénomènes d’interférence ? se demandait-on dans l’hémicycle de l’hôtel Métropole. Par quelle bizarrerie comportementale des photons ajoutés à des photons pourraient-ils engendrer tantôt plus de lumière, tantôt de l’obscurité, c’est-à-dire une absence totale de lumière ? Le congrès fut l’occasion de débattre avec passion de tout cela et de bien d’autres sujets.
Avant de poser pied à l’hôtel Métropole, la plupart des scientifiques présents ne se connaissaient que de nom. Ce colloque était une grande première sur tous les plans : « Chacun de nous a une baignoire privée et des toilettes dans sa chambre, écrivit Arnold Sommerfeld à son épouse. Je prends un bain tous les matins. Nous sommes les invités de M. Solvay, y compris aux repas. Pas moins de cinq plats à chaque dîner ! C’est fou. […] Hier soir, j’avais un Français à ma droite, un Anglais à ma gauche et je leur parlais tour à tour ! » Ernest Solvay venait de créer une nouvelle manière de faire de la science : confortable, conviviale, internationale, peu soucieuse des considérations politiques. À l’époque toutefois, nulle langue, comme l’anglais aujourd’hui, ne faisait office de lingua franca scientifique. Par chance, c’était le Néerlandais Hendrik Lorentz, grand spécialiste de l’électromagnétisme, qui présidait les réunions. Polyglotte talentueux, habile diplomate, il traduisait à la volée et facilitait les échanges, passant du français à l’allemand, de l’anglais au néerlandais, et il invitait même le conférencier à clarifier son propos quand celui-ci devenait obscur. Les théoriciens, eux, bénéficiaient d’une langue commune, les mathématiques : ils parlaient des idiomes gorgés d’équations.
Ernest Solvay avait déjà rencontré Albert Einstein en juillet 1909, à Genève, lorsqu’ils avaient l’un et l’autre été proclamés docteurs honoris causa de l’université de Genève, à l’occasion de la célébration du trois cent cinquantième anniversaire de la fondation Calvin. Einstein avait failli manquer la cérémonie car il avait jeté au panier son invitation, colorée comme une publicité, libellée au nom de « M. Tinstein ». Grâce à Solvay, il put trouver sa vraie patrie, celle des esprits frères, celle des équations et des concepts qui traduisent la réalité physique, celle aussi de la joie de penser dans toutes les langues, comme si les frontières n’existaient pas. C’est à Bruxelles, dans ce QG du cosmopolitisme scientifique naissant, qu’il fit son entrée officielle dans sa communauté de cœur, à l’âge de trente-deux ans. Cinq des douze rapports qui furent présentés se réfèrent explicitement à ses travaux révolutionnaires de 1905. Dès les premières discussions, Einstein fascina les membres du Conseil par l’étendue de ses connaissances et la profondeur de ses analyses, tout en donnant l’impression de s’amuser, et même de jubiler. Ce congrès ressemble à un « sabbat de sorcières », écrivit-il à son ami Michele Besso. Des sorcières bienveillantes, car tous ces savants étaient, en un certain sens, les compatriotes d’un pays situé au-delà de l’histoire et de la géographie, celui du réel véritable et de ses lois les plus intimes.
À l’hôtel Métropole, Einstein renforça ses liens d’amitié avec Marie Curie, notamment, dont il admirait la vivacité et l’intelligence. De retour en France, elle fut violemment attaquée par une partie de la presse pour sa liaison présumée avec Paul Langevin, qui était séparé de son épouse : « l’étrangère », la « Polonaise », « la veuve adultère »… Comme si, aux antipodes de l’esprit qui venait de souffler à l’hôtel Métropole, la patrie n’était jamais que le sol, l’ancrage, les racines, l’« origine ». « Si cette racaille s’occupe encore de vous, cessez simplement de lire ces sottises. Laissez-les aux vipères pour qui elles ont été fabriquées », lui écrirait Einstein de Prague, le 23 novembre. Le père de la relativité ne savait pas encore combien ce conseil lui serait utile quelques années plus tard, lorsqu’il serait lui-même vivement attaqué par la presse nazie.
À en croire un cliché tenace, tout savant (homme ou femme) serait un être a-géographique, au sens où le contexte de sa localisation serait neutre pour lui. Pourtant, aussi absorbé soit-il dans ses pensées, aussi indifférent soit-il à ce qui l’entoure, l’homme de science demeure toujours rivé à quelque point de l’espace-temps. Il est toujours de quelque part, vit en un certain lieu, à une certaine époque, et son environnement ne cesse d’influer sur lui. Au point qu’une idée neuve, lorsqu’elle surgit, est toujours enrobée d’un halo contextuel qui la sous-tend, voire la détermine en partie. Aussi universelle soit-elle encline à devenir, elle advient toujours en portant (en emportant) la marque de ses conditions de naissance, notamment de leur géolocalisation.
C’est pourquoi, en nous racontant avec force détails et anecdotes les différents Conseils Solvay qui furent si importants, Marina Solvay et Catherine d’Oultremont participent de la culture scientifique la plus authentique et la plus aboutie. Car la culture scientifique vraiment désirable n’est pas seulement celle des principes, des équations, ou des résultats d’expériences : c’est aussi celle qui met en scène les passions singulières qui les ont produits, les circonstances qui les ont rendus possibles, les lieux qui les ont vus naître.
À sa manière, ce livre démontre merveilleusement une loi fondamentale : pour saisir le souffle entier de la science, il faut, sinon sortir de l’œuvre scientifique proprement dite, du moins la relier au contexte de sa genèse. Y a-t-il lieu de s’en désoler ? Nullement, car c’est en sondant sa périphérie, en débordant de ses contours, en visitant les topos où elle éclôt que l’on rend vraiment justice à la science, à ceux qui l’inventent, aux lieux et aux circonstances qui l’inspirent.
Étienne KLEIN
Physicien,Docteur en philosophie des sciences
* Ernest Solvay, « Jubilé du chimiste Ernest Solvay », in Notes, lettres et discours d’Ernest Solvay, vol. 2, Bruxelles, Lamertin, 1929, p. 429.
Avant-Propos
Un après-midi de septembre gris et pluvieux, Arman, mon petit-fils, le visage sérieux auréolé de boucles blondes, me pose une question : « Est-ce qu’Einstein est le responsable de la bombe atomique ? » La question de ce sphinx de six ans m’interpelle et je prends le temps de réfléchir avant de lui répondre.
Marina. — Tu sais, Arman, Einstein a surtout découvert la relativité, ce qui a permis aux scientifiques d’explorer l’espace et les étoiles. Grâce à sa théorie, un jour, un prêtre physicien du nom de Georges Lemaître a pu raconter au Conseil Solvay de 1958 comment s’était passé le commencement de notre univers, ce qu’aujourd’hui on appelle « le Big Bang ».
Arman. — C’est quoi les Conseils Solvay ?
Marina. — Mon arrière-arrière-grand-père, Ernest Solvay, a réuni les plus grands savants d’Europe au début du XXe siècle à Bruxelles pour discuter de leurs recherches. En 1911, la première réunion s’intitulait : « Rayonnement et quanta », et Einstein y participait à côté de Marie Curie, une fameuse scientifique dont tu as peut-être entendu parler. En 1913, on y a parlé de l’atome et de ses électrons, et plus tard on a quantifié cet atome et discuté du noyau qu’on y avait découvert, et des forces qui se trouvaient dans cet atome et puis de toutes les particules qui existaient et qu’on appelait « particules élémentaires ».
Ces réunions, appelées Conseils Solvay, se tiennent encore aujourd’hui tous les trois ans (une année consacrée à la physique, une à la chimie).
Et c’est avec une nouvelle théorie, la mécanique quantique, qui est née et qui a grandi au fil des nombreux Conseils Solvay, que l’on a pu calculer comment l’atome était construit, parce qu’il était trop petit pour être observé, même par les microscopes de l’époque.
Arman. — Alors, c’est là que l’on a fabriqué la bombe atomique ?
Marina. — Non, c’est le « projet Manhattan » qui a construit la bombe atomique à cause de la guerre. Tu as entendu parler d’Hitler ?
Arman. — Oui, c’était un affreux dictateur qui a voulu exterminer les Juifs.
Marina. — Il a commencé par les chasser d’Europe, ce qui fut le cas d’Einstein qui était juif. Les nazis ont mis sa tête à prix et il a été forcé de partir. D’autres scientifiques qui se réunissaient régulièrement aux Conseils Solvay ont aussi dû quitter l’Europe pour les États-Unis. Mais ceux qui sont restés, comme le physicien allemand Heisenberg, ont choisi de travailler pour l’Allemagne.
Et puis Hitler a envahi l’Europe et a fait construire par les savants allemands des armes de guerre très puissantes. De nombreux physiciens arrivés aux États-Unis ont mis leur science au service du gouvernement américain. L’un d’eux, un émigré hongrois du nom de Leo Szilard, est allé trouver Einstein qui était professeur à Princeton. Il lui a fait part de son inquiétude au sujet de ces armes de guerre que fabriquaient les Allemands. Il savait que certains d’entre eux avaient poussé leurs travaux très loin. Il craignait que les Allemands ne fabriquent une bombe atomique. Einstein était pacifiste et n’aimait pas se mêler d’armement, mais il a quand même écrit une lettre au président Roosevelt pour l’avertir du danger.
Arman. — Alors, ce sont les Allemands qui ont construit la bombe atomique ?
Marina. — Ils ont essayé mais ils n’avaient pas les matériaux nécessaires et peut-être pas assez de connaissances pour le faire. Alors le gouvernement américain, très inquiet, a créé le projet Manhattan. Ce projet consistait en une équipe de scientifiques de toutes nationalités qui travaillaient dans le désert dans le plus grand secret sur le procédé de la bombe atomique. Leur chef de projet était un physicien américain qui s’appelait Robert Oppenheimer, qui participerait plus tard lui aussi aux Conseils de physique Solvay.
Arman. — Mais pourquoi n’ont-ils pas lancé la bombe sur Hitler ? Marina. — Les Russes, les Américains et les Anglais avaient gagné la guerre en Europe avant que la bombe atomique soit au point. Mais l’Amérique se battait encore avec le Japon et des milliers de soldats américains mouraient au combat. Les aviateurs japonais kamikazes s’écrasaient sur les bateaux et les porte-avions américains pour les détruire.
L’Amérique avait un nouveau président, Truman, qui voulait à tout prix arrêter cette guerre. Et dès qu’Oppenheimer lui a dit que ses bombes étaient prêtes, il en a fait lancer une sur Hiroshima et une sur Nagasaki. Et l’empereur du Japon s’est rendu aux Américains sans condition.
Est-ce par curiosité scientifique ou par vanité qu’Oppenheimer a voulu expérimenter le fruit du projet que son pays lui avait confié ? Le pauvre homme a été consterné par les conséquences dues à ses bombes. Il a déclaré aux journalistes : « Je suis la Mort, le destructeur des mondes. » Et plus tard, il a refusé de participer à la construction de la bombe H, encore plus puissante. Est-ce pour cette raison qu’on lui a fait un procès l’accusant de déloyauté à son pays ? Il ne s’en est pas remis et est mort d’un cancer quelques années plus tard. Qui est le responsable, d’après toi ?
Arman. — Je crois que « le » responsable, c’est la guerre.
Marina. — Tu as raison, les scientifiques cherchent des réponses aux questions que leur pose le fonctionnement du monde mais leurs découvertes finissent malheureusement parfois par être utilisées pour faire la guerre.
Arman s’en est allé rejoindre ses cousins et je me suis retrouvée seule devant mon bureau avec cette énigme.
Qu’aurait pensé mon aïeul de la bombe atomique ?
À son époque, Ernest Solvay a su que le chimiste Fritz Haber, après avoir procuré les engrais chimiques à la population affamée, avait inventé et utilisé l’horrible gaz ypérite qui a fait tant de victimes pendant la Grande Guerre. Fritz Haber, pour la fabrication de ces engrais, a reçu le prix Nobel en 1918, ce qui a scandalisé la communauté scientifique.
Je n’ai pas retrouvé d’écrits au sujet des opinions d’Ernest concernant l’attribution de ce prix Nobel, mais je sais que jusqu’à sa mort en 1922, il a perpétué son œuvre, créant même cette année-là les Conseils de chimie.
Sa vieille amie Marie Curie comparait le scientifique à « un enfant fasciné par les phénomènes naturels comme par des contes de fées ».
Ce même sentiment m’habite depuis l’enfance et m’a permis de mesurer l’importance du legs de mon aïeul. Je prends aujourd’hui ma place de témoin de l’histoire des Conseils Solvay car j’aimerais transmettre aux générations suivantes la beauté de cette aventure.
Mon projet a séduit mon amie Catherine d’Oultremont, romancière. Elle aime les histoires et les écrit joliment. Elle s’est plongée pendant trois ans dans la physique, la chimie, et la mécanique quantique, et a offert à ce sujet très dense quelque peu de légèreté en parsemant le récit de réflexions philosophiques inspirées par celles des grands physiciens, et d’anecdotes tirées de la vie de ces hommes et de ces femmes.
Ernest Solvay considérait la science comme son « cinquième enfant » et l’a confié à sa descendance.
À son décès, son fils Armand est devenu le représentant familial au sein des Instituts de physique et de chimie. Ernest-John, qui a succédé à Armand, a réussi à insuffler un élan vital aux Conseils après la Seconde Guerre mondiale. En 1958, son fils Jacques a assuré la présidence des Instituts de physique et de chimie (rassemblés en 1963 sous la même houlette) avec enthousiasme et excellence pendant cinquante-deux ans. Cette même année, il a été rejoint par le brillant nouveau directeur des Instituts, Ilya Prigogine, qui s’exprima en ces mots : « Aujourd’hui la tâche des Instituts est plus difficile. La science s’est énormément diversifiée, les réunions scientifiques se sont multipliées. C’est la raison pour laquelle, en tant que directeur depuis 1958, j’ai cherché à développer également l’aspect de la recherche des Instituts Solvay, ce qui était d’ailleurs conforme aux vœux du fondateur. »
Marc Henneaux est devenu le directeur éclairé des Instituts en 2004, et y assure toujours l’excellence. Mon frère Jean-Marie a succédé à notre père, Jacques, avec la même passion pour la Science.
Aujourd’hui, les Conseils de physique et de chimie Solvay ont plus de cent ans et ont acquis une telle réputation qu’une invitation ne s’y refuse pas.
Marina SOLVAY
Ire partieLa genèse d’un grand projet
Ce dont la science a besoin, c’est d’imagination, mais d’imagination dans une terrible camisole de force, la connaissance.
RICHARD FEYNMAN.
La physique joue un rôle important dans le développement de la pensée philosophique générale non seulement parce qu’elle contribue à une meilleure et plus solide connaissance de la nature dont nous faisons partie, mais aussi parce qu’elle offre des possibilités toujours nouvelles d’examiner et d’améliorer nos instruments conceptuels.
NIELS BOHR.
Le savant n’est pas l’homme qui fournit de vraies réponses, c’est celui qui pose les vraies questions.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
1.Ernest Solvay chez lui
En cette aube d’octobre 1910, à La Hulpe, petit hameau situé dans le Brabant, le brouillard enveloppait les travailleurs matinaux. Il flottait sur l’étang du château où dormaient encore les colverts et leurs petites familles.
Au château, les volets s’ouvraient, les domestiques s’affairaient. Au sous-sol, la cuisine bruissait comme une ruche. On préparait le petit-déjeuner. Des feux avaient été allumés dans les cheminées pour couper l’humidité de la nuit avant le lever des maîtres. Dans la salle à manger, tout était prêt pour les accueillir.
Le château, situé en bordure de la forêt de Soignes, à une vingtaine de kilomètres du centre de Bruxelles, était la résidence d’été d’une famille d’industriels. Les Solvay, à la recherche d’un lieu de villégiature, avaient acheté en 1893 ce domaine de plusieurs centaines d’hectares au baron de Roest d’Alkemade.
Depuis dix-sept ans, Ernest et Adèle Solvay y venaient dès les beaux jours. Le vert tendre qui habille les arbres au printemps réjouissait le cœur d’Adèle et redonnait à Ernest l’envie de promenades introspectives. Ils y séjournaient tout l’été. Les longues journées estivales étaient l’occasion d’organiser des garden-parties. Leurs enfants et petits-enfants venaient aussi profiter de l’air de la campagne. Adèle se plaisait à réunir toute sa famille autour d’elle en ce lieu bucolique. Mais lorsque flambaient les derniers feux de la nature et que la forêt se couvrait d’or, il fallait songer au départ… Le temps était venu de rentrer à Bruxelles pour passer l’hiver. Ernest allait suivre ses affaires d’un peu plus près, et Adèle retrouver ses œuvres caritatives.
Ernest Solvay aimait se lever avant l’aube pour travailler dans son bureau quand il n’y avait encore aucun bruit dans la maison. Après le sommeil, ses idées étaient claires, presque cristallines. Elles sonnaient juste, lui accordant des intuitions qui se brouillaient un peu par la suite, quand interféraient dans son esprit les soucis du quotidien. C’est la raison pour laquelle il notait toujours ses idées… Au petit matin, il pouvait réfléchir tranquillement au rôle de la science dans sa vie et à toutes ces grandes questions qui le taraudaient depuis l’adolescence : le pourquoi et le comment du monde, de la matière et de l’homme. « Quelle est l’énergie qui fait tourner le monde ? Quelle est son organisation ? Qu’est-ce qui constitue la matière ? » Ces questions étaient pour lui existentielles. Car la science avait pour but la quête de la vérité et, grâce au progrès technologique qu’elle apportait à l’homme, celui-ci disposait de plus de temps pour cette recherche fondamentale.
Bien qu’il ne fût pas à proprement parler un scientifique de formation, il côtoya la science de très près durant toute sa vie. La physique était sa passion, en particulier l’observation de la matière et de ses phénomènes. Ne sont-ce pas des lois physiques qui régissent le monde ? La physiologie l’intéressait aussi. Cette nouvelle discipline, née au XIXe siècle et résolument tournée vers l’expérimentation, l’attirait. « Il faut connaître le monde et son contenu en le soumettant au contrôle de l’expérience. C’est valable pour tout, estimait-il. Aussi bien pour les organismes vivants, pour les lois physiques, que pour les sociétés humaines. » La chimie, il la pratiquait tous les jours dans son entreprise, puisque sa réussite économique découlait d’une réaction chimique entre deux substances : le chlorure de sodium et l’ammoniaque.
Pendant qu’Ernest s’habillait, son esprit voguait sur les ailes du vent nouveau qui soufflait sur le siècle naissant. Un vent de progrès et de découvertes, cruciales et passionnantes, qui s’enchaînaient les unes aux autres. Un vent qui décoiffait les anciens savants emperruqués du siècle des Lumières pour laisser la place à de nouveaux cerveaux. Il se passionnait pour le progrès technique et l’évolution des idées. Maintenant que son empire industriel tournait bien et qu’il n’avait plus besoin de s’en occuper quotidiennement ni de se préoccuper de contingences matérielles, comme à ses débuts avec son frère Alfred, Ernest se laissait aller à imaginer des expériences, qu’il essayait de mettre en pratique dans son laboratoire privé, rue des Champs-Élysées. En 1882, il avait pris la décision de monter chez lui son propre laboratoire, après avoir vu celui de Ludwig Mond, un de ses partenaires industriels passionné de chimie. C’était un peu son antre secret. Solvay aimait y passer de longs moments pour discuter avec les jeunes scientifiques qu’il engageait pour approfondir ses théories et mener à bien ses expériences.
En descendant à la salle à manger, il s’arrêta devant la fenêtre pour contempler le parc embrumé. Des silhouettes émergeaient de l’ombre, celles des arbres, dont le faîte perçait la ouate en suspension. Au ras du sol, où les contours des choses étaient encore flous, il devait être facile, pour un promeneur solitaire, de perdre toute notion de l’espace et du temps. Une notion qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des siècles et sur laquelle bien des savants se sont penchés. De quoi sont-ils faits ? Sont-ils liés entre eux, enchevêtrés l’un dans l’autre ? Tant de questions auxquelles ils ont essayé de répondre.
Ce ne sont pas tant ces considérations sur le temps qui intéressaient Ernest Solvay ce matin-là que la loi de gravitation, qu’il considérait comme « l’une des lois les plus sûres de la physique », cette science avec un grand S, que les anciens appelaient aussi philosophie naturelle et qui s’occupe des causes et des effets observables à partir de phénomènes expérimentables.
Ce brouillard qui se dissipait montrait encore une fois la plasticité de la matière, qui change d’état lorsqu’elle est soumise à un changement de température. Elle se transforme constamment. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, rien n’est arbitraire dans tout cela. L’ordre éternel conjure sans cesse l’anarchie en appliquant sa loi.
« Rien ne se perd dans l’immensité du monde… Il n’y a que transformations de mouvements atomiques du fluide éthéré, une substitution d’un état de mouvement à un autre état, sans jamais le moindre déchet, sans la plus minime déperdition… », écrit Ernest Solvay dans ses notes.
La lumière est un domaine dans lequel les scientifiques ont eu beaucoup de mal à s’accorder. Certains, à la suite de Newton, ont dit qu’elle était formée de corpuscules, et d’autres, comme Christiaan Huygens et Augustin Fresnel, ont prétendu que c’était une onde qui se déplaçait dans l’« éther luminifère », comme le son se propage dans l’air. Faraday introduisit l’idée d’un éther électromagnétique parcouru de lignes de force*. Les travaux de Fresnel, ainsi que ceux d’Hippolyte Fizeau, sont venus démontrer la nature ondulatoire de la lumière, un point de vue qui fut accepté en 1860. Il apparut ensuite, en 1865, grâce aux recherches de Maxwell**, qui unifia les lois de l’électricité et du magnétisme, que l’éther électromagnétique permettait la propagation d’ondes à une vitesse sensiblement égale à celle de la lumière. Il raffermit l’idée d’une nature ondulatoire de la lumière. Vingt ans plus tard, les travaux de Hendrik Lorentz confirmèrent cette vision des choses, car ce savant hollandais fit le lien entre la lumière et les ondes électromagnétiques. En 1895, il démontra que les multiples propriétés de la lumière pouvaient être déduites grâce à des équations établies par Maxwell. On croyait la question réglée, mais des rebondissements n’allaient pas tarder à remettre les choses en question…
Dans le calme de son bureau, le matin avant de s’occuper de ses affaires ou bien tard dans la nuit, quand son épouse dormait, l’industriel tâchait de se tenir au courant de toute théorie naissante. Il lisait les publications de nombreux scientifiques français comme Brillouin, Poincaré, Marie Curie, Jean Perrin.
L’étude de la thermodynamique, science de la chaleur, en plein essor au début du siècle, avait relancé aussi l’intérêt pour l’atome. En ce début de vingtième siècle, l’atome en dérangeait encore beaucoup. Comment croire à ce qu’on ne peut pas voir ? Max Planck lui-même, expert en thermodynamique et père du premier quantum d’énergie, avait déclaré un jour que l’atome était « un ennemi du progrès ».
Le concept de matière composée d’atomes n’était cependant pas nouveau. On en parlait déjà durant l’Antiquité. Aristote le Grec et Lucrèce le Latin n’ont pas eu les mêmes vues sur la question. Aristote supposait la matière inerte, mais en elle toutes choses se trouvaient en puissance à condition qu’une cause motrice les actionne. Lucrèce réfutait les idées d’Aristote, et formulait l’hypothèse d’un atome dans la matière : ces atomes sont le principe des choses, ils sont agités d’un mouvement continuel et divers.
Il y avait donc des polémiques entre, d’une part, les « atomistes », dont faisait partie le physicien autrichien Ludwig Boltzmann, qui défendait farouchement leur existence, soutenant que la matière était composée de molécules et d’atomes pouvant interagir entre eux en se combinant et en se dissociant, pour former ainsi des réactions chimiques ; d’autre part, les « anti-atomistes », tel Wilhelm Ostwald, qui ne croyaient pas à l’atome et prétendaient que tous les phénomènes pouvaient être expliqués sans son intervention. Ils pensaient pouvoir développer un nouveau modèle physique de la nature à partir de la thermodynamique. Comme ils rejetaient l’hypothèse atomique et prônaient la doctrine énergétique, on finit par les appeler « les énergétistes ».
La radioactivité, une nouvelle découverte, semblait pourtant démontrer que les atomes existaient bel et bien, mais qu’ils perdaient de petites parties d’eux-mêmes dans certaines circonstances, ce qui voulait dire qu’ils n’étaient point insécables* comme on aurait pu le croire en raison de leur nom. Mais cela ne prouvait rien encore.
En 1908, les recherches de Jean Perrin changèrent les données du problème. Les expériences du physicien français relatives aux émulsions permettaient d’observer la réalité moléculaire d’une manière indirecte, confirmant l’existence effective des atomes. Face à ce constat, Ostwald s’inclina, mais d’autres scientifiques persistèrent à nier l’atome.
L’atome restait donc quelque chose de mystérieux, de nébuleux, sa structure n’étant pas encore connue… L’étude de tout ce qui concerne la structure de l’atome deviendrait un des sujets les plus importants pour les physiciens du XXe siècle.
Ernest Solvay était passionné par tout cela. En témoignent ses propres notes : « Les atomes sont les constituants cubiques universels et indestructibles dont sont constituées les molécules. »
Pour sa part, en tant qu’homme d’action, Solvay s’intéressait plus particulièrement à l’énergie**, cette « force en action » – comme l’indique l’étymologie du mot – capable de produire un travail, de la lumière ou de la chaleur. Le premier principe de la thermodynamique dit en effet que « l’énergie n’est ni créée ni détruite, elle se transforme ». Solvay était d’avis que tout phénomène pouvait se rapporter à des transformations énergétiques.
Pour le vieil industriel, la physique était la base de tout. Mais il pensait que manquaient dans cette branche des théoriciens sachant prendre un peu de hauteur par rapport à la matière proprement dite. Il s’efforçait lui-même d’apporter sa pierre à l’édifice, en tentant d’établir une théorie personnelle à laquelle il avait donné le nom de « théorie gravito-matérialitique », qui concernait la matière et ses aspects énergétiques, en relation avec la gravitation. Un de ses collaborateurs, Édouard Herzen, écrivit en 1911 : « M. Solvay a été préoccupé de tout temps par le problème de la constitution de la matière. Sa gravito-matérialitique témoigne de sa préoccupation constante depuis 1887. Cette conception implique une variation d’énergie non d’une façon continue, mais par sauts et degrés*. »
Il souhaitait soumettre sa théorie à des physiciens de renom lorsqu’elle serait mûre mais, pour le moment, il n’avait pas en main toutes les clés pour l’établir. Il y travaillait pour essayer d’en dégager une synthèse cohérente.
Le XIXe siècle avait vu l’émergence de nouvelles études scientifiques dans les universités européennes. La Belgique n’avait pas encore suivi le mouvement de ses voisins. Les études de physique n’y étaient guère développées, on ne comptait aucun physicien de renom dans le royaume et le seul chimiste sortant du lot était J. Servais Stas, mort en 1891.
Avec les moyens dont il disposait, Ernest Solvay faisait son possible pour promouvoir la science dans son pays. Il soutenait financièrement des chercheurs pour qu’ils puissent mettre en œuvre leurs expérimentations. Mais il était temps d’aller plus loin, pensait-il. Il fallait créer des institutions scientifiques en Belgique. Pour cela, il devrait trouver la personne adéquate pour s’en charger. L’Exposition universelle de 1910 à Bruxelles venait tout juste de se clôturer. Elle avait été un succès et avait attiré beaucoup de monde dans la capitale belge. En tant que président d’une section du Congrès mondial des Associations, Ernest Solvay y avait rencontré plusieurs personnes intéressantes, dont le chimiste germano-balte Wilhelm Ostwald. Ce dernier, qui avait reçu un prix Nobel de Chimie l’année précédente, rêvait de réorganiser cette branche au niveau international. Il formait des plans ambitieux. En rencontrant Ernest Solvay, il vit en lui un potentiel allié de poids dans ce domaine, étant lui-même un passionné de science. Allaient-ils unir leurs forces pour atteindre leur but ?
En effet, la physique se trouvait à la croisée des chemins. Vers quelle dimension se tournerait cette science dans le futur ? L’infiniment grand ? L’infiniment petit ? On ne pouvait le prédire, tout était encore flou comme le parc noyé de brume autour du château de La Hulpe… Elle était à l’aube d’un nouvel essor qui allait sans doute bousculer les idées reçues. Avec les nouvelles théories qui voyaient le jour, le temps et l’espace devenaient élastiques et s’interpénétraient. Cela créait une grande confusion dans les cerveaux non préparés à ces bouleversements, mais ouvrait en même temps tous les champs du possible dans celui des scientifiques des générations à venir*.
Pour beaucoup, l’Univers était encore environné par l’éther de Maxwell. Le Nouveau Larousse illustré en sept volumes, publié en 1903, en donnait la définition suivante : « On appelle “éther” un élément invisible, impalpable et impondérable, répandu partout, aussi bien dans le vide que dans les corps transparents ou opaques, et dont l’existence, longtemps hypothétique, semble avoir revêtu désormais tous les caractères de la certitude scientifique. »
Ernest Solvay était plus attiré par les secrets enclos dans la matière mais, comme tous les esprits curieux de son temps, il s’interrogeait : en quoi consiste l’éther de Maxwell ? Ce n’est pas une matière, puisqu’il est impalpable et impondérable, mais c’est pourtant un support pour la diffusion de la lumière et du son. Difficile pourtant d’imaginer un support immatériel : ces deux mots ne sont-ils pas antinomiques ? Cette notion bien ancrée d’éther serait difficile à effacer malgré les évidences expérimentales.
Il se souvenait de l’agitation qu’avait provoquée, six mois plus tôt, l’observation d’une grande comète visible à l’œil nu dans certaines parties de globe. L’approche de cette boule de feu, crevant le ciel terrestre, avait été suivie par tous les astronomes. Selon leurs calculs, la Terre allait traverser dans sa course la queue de l’astre errant mais, comme personne ne savait quel gaz toxique il pouvait entraîner dans son sillage, semaine après semaine l’inquiétude grandissait.
Ces phénomènes lumineux ont toujours rempli les petits humains que nous sommes à la fois d’effroi et d’admiration. Au Moyen Âge, on y voyait la main de Dieu ou du Diable, c’était selon ce qu’on avait dans le cœur… Une phrase assez poétique de Maxwell illustre l’idée que beaucoup de scientifiques se faisaient de l’Univers à l’époque : « Dans l’espace, il n’existe pas de bornes kilométriques… Nous nous trouvons dans une mer sans vagues et sans étoiles, sans boussole ni soleil, sans vent ni marée, et nous ne pouvons dire dans quelle direction nous allons. »
Promenade en forêt
Dans le parc du château, les arbres étaient maintenant visibles. Un ciel bleu pâle s’ouvrit peu à peu. Dans une des allées, le jardinier quitta des yeux son tas de feuilles et porta son regard vers la façade du château, comme s’il avait senti la présence du maître à la fenêtre. Sa silhouette massive se dessinait derrière le carreau, immobile et sombre comme la statue du Commandeur. Il souleva sa casquette en signe de salut et reprit son travail.
Le frou-frou d’une robe se fit entendre dans le dos de l’homme à la fenêtre qui, perdu dans ses pensées, fut un peu surpris de sentir une main légère sur son épaule. Il se retourna. Adèle lui souriait.
— Alors mon ami, tu rêvais ?
— Non, ma chère, je réfléchissais en t’attendant.
Ernest ne se considérait pas comme un rêveur. Sa pensée voguait vers du concret. Vers la matière et ses transformations.
Prenant son épouse sous le bras, il l’entraîna dans l’escalier.
— Allons prendre notre petit-déjeuner.
La journée serait belle. Ernest se promit de faire une promenade dans la forêt. Il emmènerait Ernest-John, son petit-fils. Le garçon adorait les arbres.
Bras dessus, bras dessous, les époux Solvay arrivèrent à la salle à manger, où Firmin était en train de régler les détails de ce premier repas. Les lambris foncés qui recouvraient les murs donnaient à la pièce un aspect sombre, une impression encore renforcée par l’imposant buffet de style Renaissance qui occupait l’un des côtés. Pour égayer la salle à manger, il y avait de grands bouquets d’hortensias. Les derniers de la saison… Les massifs plantés près du château croulaient encore sous le poids des fleurs opulentes que les premiers gels allaient bientôt ternir. Le vieux domestique avait aussi allumé deux chandeliers. En voyant entrer ses maîtres, il se voûta davantage, en signe de déférence. Adèle lui sourit pour le mettre à l’aise.
Malgré la vie de château, Adèle Solvay restait une femme simple. Femme de tête, elle s’occupait de l’intendance et tenant la comptabilité des dépenses ménagères et familiales. Elle connaissait la valeur de l’argent, et se souvenait des années de vaches maigres où son mari essayait de développer son usine. Ernest avait d’ailleurs failli échouer. Grâce à de l’argent prêté par la famille et des amis, qui croyaient au projet, Alfred et lui avaient pu persévérer. Et lorsque la famille avait commencé à douter de la viabilité de la petite entreprise qui avait du mal à décoller, il y eut l’appui d’hommes prêts à y croire. Eudore Pirmez, un avocat d’affaires, avait apporté son aide aux Solvay et investi de l’argent. Comme il avait amené dans son sillage une série d’autres investisseurs, les affaires des Solvay avaient enfin pris leur envol.
— Bonjour, Firmin ! dit-elle.
— Bonjour. Madame et Monsieur ont-ils passé une bonne nuit ?
— Excellente, mon bon Firmin, excellente, répondit Ernest en s’asseyant face à son épouse et en dépliant sa serviette.
— Et vous ? demanda Adèle au vieil homme penché vers elle avec sa théière fumante.
— Pas trop mauvaise, Madame, mais avec l’humidité de ces derniers jours, mes douleurs dans le dos me font souffrir…
— Je vous ferai préparer des cataplasmes de chou, cela vous soulagera, déclara Adèle.
— Madame est trop bonne…
— Voyez cela à la cuisine cet après-midi, j’aurai parlé avec la cuisinière.
Les époux Solvay s’assirent à leur place respective. Leur petit-fils Ernest-John dormait encore. Il était en convalescence au château après une mauvaise grippe. Le domestique s’affaira autour de la table en acajou sur laquelle étaient disposés le thé et le café, avec les toasts, le beurre et les marmelades. Il versa du café fumant dans la tasse d’Ernest.
— Réjouis-toi, Firmin ! Nous aurons aujourd’hui une belle journée, lui dit Ernest.
Ernest le tutoyait, car il connaissait Firmin depuis des années. Ils avaient à peu près le même âge. L’homme était aussi natif de Rebecq, berceau de la famille Solvay. À l’âge de huit ans, ils jouaient ensemble au ballon dans un terrain vague. Firmin avait une mauvaise santé, raison pour laquelle il ne fit que l’école primaire. La vie les avait séparés pendant près de vingt ans. Mais lorsque sa réussite économique s’était affirmée, Ernest, fidèle en amitié, lui avait proposé d’entrer à son service. C’est ainsi que Firmin devint le domestique de son ami d’enfance, après avoir essayé plusieurs jobs dans l’empire naissant de l’industriel, avant de trouver la place qui lui convenait le mieux. Depuis, il l’avait toujours servi avec fidélité. Ernest aimait évoquer avec lui leurs souvenirs d’enfance à Rebecq. Aujourd’hui, il était obligé de constater que sa santé se détériorait rapidement en raison d’une arthrose sévère. Le pauvre homme avait les articulations qui commençaient à se déformer. Il ne pourrait bientôt plus travailler. Quand l’heure serait venue pour lui de s’arrêter, il l’installerait dans une petite maison près du château, pour qu’il puisse jouir d’une retraite tranquille.
Après son petit-déjeuner, Ernest Solvay empoigna les journaux que Firmin avait déposés sur la table. Comme Adèle mangeait lentement et buvait plusieurs tasses de thé à petites gorgées, il avait pris l’habitude de parcourir les grands titres et de les commenter à son épouse, ce qui faisait naître entre eux des conversations sur l’actualité.
— Que dit la presse aujourd’hui ? lui demanda Adèle comme chaque matin.
— Écoute ceci : « Pour un franc cinquante refusé par leur compagnie, les ouvriers des Chemins de fer du Nord ont commencé à débrayer. Pour l’instant, la circulation des trains n’est pas affectée, mais on voit mal comment les motrices vont pouvoir acheminer longtemps des voyageurs si elles ne sont pas approvisionnées en charbon. »
Fourrageant dans sa barbe, il grommela, mécontent :
— J’espère que cette grève ne durera pas ! Elle pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’industrie. À Paris, Aristide Briand, le chef du gouvernement, s’insurge et parle d’entreprise criminelle, de violence, de désordre et de sabotage. Il entend faire cesser cette grève rapidement.
— Pourquoi la compagnie ne leur accorde-t-elle pas tout simplement cette augmentation ? demanda Adèle. On n’en parlerait plus… Tout travail doit être rémunéré à sa juste valeur, non ?
— Le problème, ma bonne amie, est de déterminer la juste valeur du travail humain. Le point de vue du chef d’entreprise n’est pas le même que celui de l’ouvrier, tu en conviendras… Mais en gros tu as raison. On ne doit pas sous-estimer les revendications des travailleurs, surtout dans des domaines pénibles où l’homme fournit une importante dose d’énergie. Mais en même temps, il ne faut pas accepter toutes les revendications sociales. Tu te rends compte de l’effet boule de neige que cela peut provoquer ?
— Heureusement, le monde industriel a fait de gros progrès depuis vingt ans… Il a évolué depuis Germinal.
— Comme tu le sais, je m’efforce de défendre des idées modernes et progressistes, mais toutes les mentalités ne sont pas prêtes aux changements dans ce domaine. J’ai parfois du mal à me faire entendre parmi mes pairs.
Ernest continuait à feuilleter le journal.
— En Iran, à Chiraz, le quartier juif a été complètement dévasté par une foule en colère qui rendait les juifs responsables du meurtre d’une jeune musulmane. Il y a eu douze morts, cinquante blessés graves et deux cent soixante maisons détruites…
— Pauvres gens ! Toujours pris comme boucs émissaires… Et que dit-on à propos du Portugal ? Le roi Manuel est-il en sécurité ?
— Oui, il s’est réfugié à Londres… Mais la nouvelle République laïcise le pays. Elle a expulsé plusieurs congrégations religieuses et supprimé l’enseignement religieux dans les écoles. Le mariage civil devient le seul valable devant la loi.
— Mon Dieu ! Où allons-nous ? s’écria Adèle. Pourquoi ce rejet de la religion ?
La porte de la salle à manger s’ouvrit à ce moment-là pour livrer le passage à un jeune homme mince aux cheveux bien peignés. Après avoir salué son grand-père, il vint s’asseoir à côté de sa grand-mère, qu’il embrassa.
— As-tu bien dormi, mon chéri ? Je vois à ta mine que tu vas mieux… Ta convalescence est bientôt finie.
— Il est grand temps qu’il retourne à ses études, renchérit Ernest.
Ernest-John était le fils d’Armand, leur fils aîné. C’était un garçon intelligent. Il suivrait sans doute les traces de son père et de son grand-père. Le vieil homme se sentait apaisé quant au futur, sa relève serait assurée… Armand avait déjà repris une bonne partie des affaires familiales. Après sa disparition, l’entreprise resterait dans la famille et serait bien gérée.
Ernest et Armand partageaient la même vision entrepreneuriale, ce qui n’était pas le cas d’Edmond, son deuxième fils, qui n’en avait pas hérité de son père. Aujourd’hui, le vieil industriel fondait beaucoup d’espoirs sur ce jeune homme à peine sorti de la puberté, curieux de tout, sportif et aimant la nature. Il l’observa alors qu’il discutait avec sa grand-mère. La vie s’ouvrait à peine devant lui. Il serait bien dommage qu’en raison d’une mauvaise grippe le garçon ratât son année scolaire, ce qui hypothéquerait son futur. Lui-même avait vu son espérance se briser à la suite d’une maladie qu’il avait contractée à l’âge de dix-sept ans et qui l’avait empêché d’aller à l’université. Depuis lors, Ernest avait pris l’habitude de faire de grandes marches pour renforcer ses poumons. Il avait même pris goût à l’alpinisme, qu’il pratiquait souvent en Suisse.
Ernest jeta un œil à sa montre à gousset. Huit heures trente. Il se leva pour se retirer dans son bureau, où il allait répondre à son courrier. Il voulait aussi lire quelques articles scientifiques.
— Adèle, je te laisse ton petit-fils pendant une petite heure. Qu’il vienne ensuite me rejoindre dans mon bureau. Nous irons nous promener dans les bois avant qu’il ne retourne dans sa chambre pour étudier.
— Promets-moi de ne pas trop le fatiguer, Ernest, il est encore convalescent…
— Allez, allez, ne le couve pas de la sorte, sinon il va devenir un mollasson.
— Comptez sur moi, Grandad, je me sens bien aujourd’hui.
Ernest Solvay et son petit-fils empruntent l’allée de gravier qui conduit vers la forêt. Après sa claustration forcée, l’air vif donne au jeune homme l’envie de se dépenser, de courir, de sauter, mais il adapte son allure à celle de son aïeul, qui marche d’un pas régulier, battant la mesure de sa canne à tête de canard. Malgré son âge, son pas était encore vif. C’est un homme habitué aux longues randonnées en montagne et cela se voit dans le rythme soutenu de sa marche. Ernest-John ressent beaucoup d’admiration pour son grand-père. Son parcours de vie ne laisse personne indifférent. Sa pugnacité. Sa droiture. Sa vision du futur. « Il est vrai qu’il est parfois un peu trop sentencieux, se dit le jeune homme intérieurement. Il nous assène des leçons de morale condensées dans des petites phrases lapidaires. Avec les cousins, on se garde bien de faire des commentaires, mais on n’en pense pas moins… » À côté de cela, le jeune homme doit reconnaître qu’il apprend plein de choses à son contact. Sa curiosité pour les sciences s’est fortement développée grâce à son aïeul.
Du haut de ses quinze ans, le garçon est déjà bien conscient des privilèges et des charges qui l’attendent. Ayant seulement deux sœurs, il est le seul fils du fils aîné du fondateur. De ce fait, il sera sans doute l’héritier de la belle propriété dont ils sont en train d’arpenter les chemins. Le jour où il se retrouvera à la tête du domaine, Ernest-John compte faire des transformations dans le parc, planter de jeunes arbres, en couper d’autres devenus trop vieux… Il n’ose pas en parler à son grand-père, comprenant qu’il est trop âgé pour entreprendre de grands travaux d’aménagement. Quant à son père, cela ne l’intéresse qu’à moitié. Il est plus tourné vers la ville, où il se fait bâtir par l’un des meilleurs architectes du moment un magnifique hôtel particulier.
Tout en parlant, les deux promeneurs pénètrent sous la haute futaie de la forêt de Soignes, qui leur offre sa palette de couleurs vermeilles.
Voyant l’humeur méditative de son grand-père, le jeune homme le pousse à évoquer des souvenirs. Puis il lui demande comment il voit l’avenir.
— L’avenir se fera par le biais de grandes associations et à travers d’importantes communautés d’intérêts.
— Comment cela ?
— On pourrait imaginer, par exemple, plusieurs pays d’Europe unir leurs intérêts, un peu comme aux États-Unis d’Amérique… Tâcher d’avoir une politique sociale commune pour éviter des conflits… Répartir un peu mieux les richesses… Donner la parole au peuple par le scrutin universel… Bref, les possibilités d’améliorer la société ne manquent pas, mais il faut que la volonté politique suive, et c’est cela qui est difficile. Pour nous, les États-Unis d’Amérique sont une sorte de laboratoire politique…
— Mais les souverains d’Europe sont beaucoup trop jaloux de leurs prérogatives pour penser comme vous, ne croyez-vous pas, Grandad ?
— Sans doute… Leur place est sur le trône, mais cela ne devrait pas les empêcher d’écouter un peu plus ce qui se passe à l’étranger ou dans la rue. Le monde change…
Du bout de sa canne, il écarte une branche gênant leur passage.
— Pourtant, je suis convaincu que c’est à ce prix que se forgera l’avenir du progrès technique et scientifique, ainsi que le bien-être de chacun. Depuis que nous avons posé ces nouveaux jalons dans cette direction, grâce, entre autres, à l’industrie qui oblige à entretenir des relations avec les pays étrangers, beaucoup d’exemples tendent à nous prouver que c’est la direction à suivre. Le monde industriel fait évoluer la société. Lui-même évolue au rythme du progrès scientifique. Il nous conduit vers une intelligence mûrie par l’application de nouvelles méthodes de travail et par leur perfectionnement journalier*.
Ernest Solvay était clairvoyant sur la route à suivre, tant dans la marche des affaires que dans l’évolution de la société. Il avait bien manœuvré sa barque, tout en respectant ses idées progressistes. Après les années de galère et de souffrances qui avaient ruiné sa santé et celle de son frère, la prospérité était au rendez-vous. Cela lui donnait le temps de réfléchir sur l’avenir.
Alfred y avait laissé sa vie, ce qu’il ne se pardonnait pas… Toute sa famille, particulièrement ses parents et son épouse Adèle, avait dû faire des sacrifices pour que l’entreprise arrive à se développer. Si elle était maintenant devenue leur fierté, il était néanmoins primordial de conserver cet acquis et d’inculquer de saines idées à la jeune génération montante. Son petit-fils Ernest-John était destiné à lui succéder un jour. Mais le jeune homme n’avait pas connu les années difficiles, comme Alfred et lui-même. Il était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il était donc important qu’il n’oublie pas ses origines et le travail fourni par ses aînés ni les efforts et les privations endurés par ses prédécesseurs, qui lui offraient aujourd’hui une vie facile.
— La justice sociale est primordiale pour maintenir un bon équilibre entre les classes. N’oublie pas ça, mon garçon !
Considérant qu’il avait fait son devoir de père de famille et de citoyen en offrant à son pays de belles réalisations dont il était fier, le vieil homme pouvait maintenant s’occuper de ce qu’il appelait en riant « son cinquième enfant » : la science. En pleine mutation, elle avait besoin de fonds. Il lui allouait donc une partie de sa fortune.
Le monde intérieur d’Ernest Solvay
À l’industrie, Ernest Solvay avait consacré sa jeunesse et sa maturité. Il avait créé un empire industriel, grâce au développement d’un procédé de fabrication de carbonate de soude (procédé Solvay), avec du sel (chlorure de sodium), du calcaire (carbonate de calcium) et de l’ammoniaque, mis au point avec son frère Alfred. Cet empire est devenu aujourd’hui une multinationale à caractère familial, la société Solvay.
À la science, on le sait peut-être moins, il avait consacré son temps libre et sa vieillesse. Lors d’un discours qu’il prononça en 1893, il se présenta lui-même comme un autodidacte :
« Homme de science, je n’ai pas le bonheur de l’être, je n’ai pas reçu d’éducation classique, les problèmes de l’industrie ont absorbé tout mon temps ; mais il est vrai que je n’ai cessé de poursuivre un but scientifique parce que j’aime la science et j’attends d’elle le progrès de l’humanité. »
L’année 1909 fut une année importante pour Ernest Solvay. On lui remit deux distinctions honorifiques. Une juste récompense pour son zèle scientifique. En juillet, il reçut le titre de docteur honoris causa de physique à l’université de Genève, un titre prestigieux. Quelques années auparavant, il avait soutenu Charles Guye, de l’Institut de Genève, en contribuant financièrement au Journal de chimie et physique. Ce fut donc une juste reconnaissance pour un acte généreux. Ensuite, à Berlin, il fut décoré de la médaille Leibniz sur proposition des chimistes allemands W. Nernst et E. Fischer, ce qui aurait une répercussion dans l’histoire qui va suivre…
C’est durant cette année faste qu’il écrivit cette phrase qui réunit ses principales préoccupations : la physique, la chimie et la sociologie.
« J’ai entrevu dans les voies nouvelles de la science trois directions que j’ai suivies, trois problèmes qui, en réalité, n’en font qu’un seul à mes yeux. C’est d’abord un problème de physique générale : la constitution de la matière dans le temps et dans l’espace ; puis un problème de physiologie : le mécanisme de la vie depuis ses manifestations les plus humbles jusqu’au phénomène de la pensée ; enfin, en troisième lieu, un problème complémentaire des deux premiers : l’évolution de l’individu et celle des groupes sociaux*. »
Ernest Solvay, dans la lignée de Saint-Simon et d’Auguste Comte, considérait la science et l’industrie comme le moteur du progrès et de la prospérité. Il aurait pu faire sienne la devise du positivisme, un courant philosophique du milieu du XIXe siècle qui valorisait les sciences : « Savoir pour pouvoir afin de pourvoir**. » Au mur de son bureau, il avait accroché un grand tableau reprenant les portraits des penseurs et savants qui l’avaient influencé tout au long de sa vie. On y retrouvait Kant, Schopenhauer, Hegel, Stuart Mill, Darwin, Berthelot, Faraday et bien d’autres… Il l’appelait son « tableau de chevet ».
Son aisance financière lui avait permis d’acheter du bon matériel pour son laboratoire et de s’entourer efficacement de scientifiques. Parmi eux, Charles Lefébure, qui devint son secrétaire personnel, et Émile Tassel, professeur de physique à l’Université Libre de Bruxelles. Il avait aussi engagé des collaborateurs qui travaillaient à plein temps dans son laboratoire, des personnes compétentes pour effectuer des expériences qui pouvaient servir, le cas échéant, à corroborer ses théories personnelles.
Il accorda aussi des fonds à des laboratoires qui souhaitaient acquérir de nouveaux instruments de précision pour affiner leurs recherches. Car le XIXe siècle, appelé le « siècle des machines », vit l’arrivée d’un grand nombre d’inventions, d’appareils de mesure et d’observations. Les laboratoires devaient donc se moderniser. Il y avait aussi tout ce qui concernait « la fée électricité », et le couple qu’elle forme avec le magnétisme. Ensemble, ils produisent quelque chose de fascinant, qui ouvre d’énormes possibilités : « l’électromagnétisme ». Monter un laboratoire coûtait donc de plus en plus cher et Ernest Solvay en était conscient.
On doit à la famille Solvay l’institutionnalisation des sciences en Belgique. Ernest a créé un Institut de physiologie, dont il a confié la direction à son médecin personnel, le docteur Paul Héger. Puis il a fondé un Institut de sciences sociales et une École de commerce, qui se sont développés sous la houlette de l’ingénieur Émile Waxweiler. Son frère Alfred Solvay, qui avait les mêmes aspirations créatrices que son aîné, a fondé quant à lui un Institut d’hygiène, de bactériologie et de thérapeutique pour étudier les maladies infectieuses. Il fallait absolument développer l’hygiène médicale pour enrayer les épidémies, mais aussi l’hygiène personnelle de la population pour éviter la prolifération de bactéries. « À quoi bon moderniser une société qui ne sait pas se laver ? pensaient les deux frères. La saleté n’est-elle pas source de maladies ? » Ces différents instituts fondés par les Solvay virent le jour dans ce qu’on appelait à l’époque la « Cité scientifique du parc Léopold », où de grands bâtiments furent construits pour les abriter. Leur but était de réunir dans un espace proche les sciences humaines et les sciences exactes, afin de les pousser à s’enrichir mutuellement. Telle était l’idée cohérente des Solvay. Ces différents instituts furent par la suite rattachés à l’Université Libre de Bruxelles.
Hélas, les grands projets des frères Solvay dans ce domaine furent freinés par la force du destin… Quelques mois après cette fondation, lors d’un séjour à Nice en janvier 1894, Alfred contracta une grave maladie qui l’emporta en quelques jours.
Quand Ernest apprit l’état précaire de son frère, il partit pour Nice, mais il arriva trop tard pour le revoir vivant. Alfred n’avait que cinquante-quatre ans, deux ans de moins qu’Ernest. Ensemble, les deux frères avaient mis au point le procédé chimique de fabrication de la soude, ensemble ils avaient créé leurs premières usines, ensemble ils avaient développé l’affaire familiale. Comme amputé d’une moitié, l’aîné des Solvay eut beaucoup de mal à se remettre de la disparition de celui qui partageait ses visions. Ils auraient pu faire encore de grandes choses ensemble. Devant le corps sans vie de son frère cadet reposant pour toujours, il gémit en le secouant comme s’il voulait le ramener à la vie :
— Pourquoi me laisses-tu seul ? Comment ferai-je sans toi, désormais ?
À la suite de ce drame, Ernest commença à nourrir un sentiment de culpabilité qui le mina à petit feu. Il se faisait des reproches, répétant à ses proches :
— Alfred s’est tué à la tâche, et c’est de ma faute…
Il traversa ensuite une période de profond abattement. Sa neurasthénie le rendait taciturne et ombrageux. Paul Héger essaya de le convaincre d’aller voir un médecin spécialiste des troubles de l’humeur et de la dépression. Sans succès. Tous ceux qui essayaient d’aborder le sujet de sa santé se heurtaient à un mur de silence. L’homme, blessé, se terrait le plus souvent dans son bureau, se contentant de lever les épaules d’un air buté quand on s’inquiétait de lui.
La mort d’Alfred avait réveillé en lui de vieux démons, mais il continuait à nier son mal-être. Déjà avant la disparition de son frère, il souffrait d’angoisses récurrentes qui, paradoxalement, s’aggravaient à chaque succès, comme s’il était habité d’une éternelle crainte de l’échec. Ernest Solvay, derrière son aspect de roc inébranlable, cachait quelques fêlures. Bourreau de travail, il ne se ménageait pas et souffrit de plusieurs périodes de ce qu’on appellerait aujourd’hui un burn-out*. Chaque victoire sur l’adversité lui faisait craindre un retour de manivelle car, à ses yeux, s’il fallait suer sang et eau pour obtenir la réussite, avoir la chance de la conserver demandait autant d’efforts. Il écrivit un jour à son fils Armand : « Rien n’est acquis dans la vie, même quand on est dans un fromage Solvay & Cie, fromage qui finira par couler comme tous les fromages**. »
Après l’avoir vu quelques mois dans cet état son épouse cessa de le plaindre et commença à le bousculer pour qu’il réagisse enfin et qu’il se soigne.
— N’est-ce pas toi, mon ami, le premier à prôner le bon usage de la science ? lui dit-elle. Quand on est malade, il faut voir un homme de science.
— Mais je ne suis pas malade, répondait-il en bougonnant, je suis juste un peu abattu, cela passera… J’ai trop de travail.
— Le travail ne t’a jamais fait peur ni mis dans des états pareils, même aux moments les plus durs de ta carrière. Tu es un peu surmené, certes, mais tu es aussi neurasthénique…
— Neurasthénique, moi ? Tu lis trop… Laisse la neurasthénie aux héroïnes de roman !
À force de persuasion, elle finit cependant par obtenir gain de cause. Son mari accepta de consulter un spécialiste. Ils firent le voyage à Paris pour voir un médecin réputé. En peu de temps, grâce à une cure appropriée, Ernest retrouva son tonus et sa curiosité intellectuelle. Un séjour prolongé dans une station thermale compléta sa guérison, et lui procura le repos dont il avait besoin.
À peine de retour à Bruxelles, il se replongea dans ses recherches scientifiques avec la rage du désespoir, ce qui l’aida à retrouver toute sa forme physique et le jugement sûr dont il avait toujours fait preuve. Par la suite, pour entretenir cet équilibre psychique et renforcer sa santé fragile, il consacra plus de temps à la marche en forêt et à l’alpinisme, qu’il pratiquait avec Charles Lefébure, son secrétaire, amateur lui aussi d’escalade. Il accompagna aussi quelquefois le roi Albert Ier dans ses expéditions en montagne.
La science restait pour Ernest Solvay la chose qui comptait le plus. Elle était source de progrès. Dans le domaine de la santé, mais aussi dans celui de l’énergie et de la technique. L’humanité ne pourrait se développer et se civiliser davantage qu’en augmentant ses connaissances scientifiques et sociologiques. Quand l’homme est en bonne santé et qu’il doit moins peiner physiquement pour travailler, n’a-t-il pas plus de temps pour réfléchir et se cultiver ?
Le XXe siècle a vu émerger quelque chose de nouveau dans l’histoire des hommes : la culture du loisir et des vacances, jusqu’à en arriver à l’instauration des congés payés, chose que les Solvay instaurèrent très tôt pour leurs travailleurs. Peu à peu au cours du siècle, le progrès technologique commença à offrir au travailleur ou à la ménagère des moments de liberté volés aux durs travaux de l’existence. Pensons seulement à l’apparition du tracteur ou de la machine à laver !
L’objectif était donc d’essayer de gagner du temps pour soi. Mais à quoi utiliser ce temps nouveau ? À s’élever, à se cultiver. Henri Poincaré a écrit dans son introduction à La Valeur de la science : « La recherche de la vérité doit être le but de notre activité […]. Si nous voulons de plus en plus affranchir l’homme des soucis matériels, c’est pour qu’il puisse employer sa liberté reconquise à l’étude et à la contemplation de la vérité. »
Ernest Solvay, quant à lui, ne pouvait que souscrire à l’avis de Poincaré. Comme beaucoup de chercheurs de son temps, il espérait qu’on découvrirait un jour une loi unique qui expliquerait tout l’Univers*. Il écrit à ce propos dans ses notes : « Voilà près de trente ans que mon action scientifique est dominée par une grande préoccupation philosophique, celle de trouver à la science de l’Univers une interprétation simple, par voie de déduction, à partir de postulats parfaitement établis tels que celui qui régit la gravitation universelle**. »
Au faîte de sa carrière industrielle, mais déjà sur la pente de l’âge, l’industriel suivait de près l’actualité scientifique. Son empire international prospérait grâce à la bonne gestion des hommes dont il avait su s’entourer intelligemment. Il profitait de ce temps précieux pour lire ce qui se publiait en matière scientifique et réfléchir à ses conclusions en la matière, dont il s’efforçait de tirer une quintessence. Il cherchait à établir sa propre théorie universelle, une théorie qu’il voulait soumettre un jour à « un corps savant autorisé ».