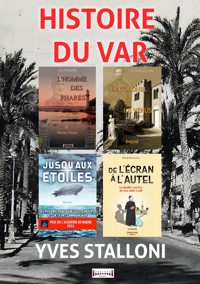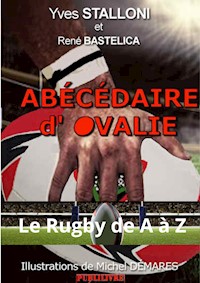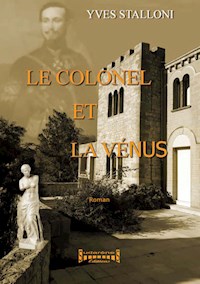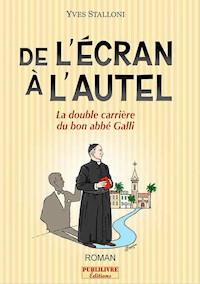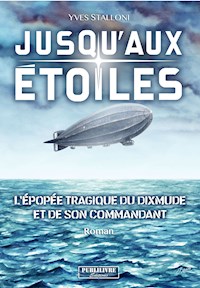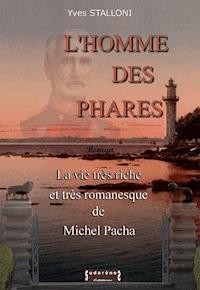Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sudarènes Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jean Aicard, le célèbre auteur de Maurin des Maures, poète avant d’être romancier, dut à la providence de rencontrer, dans sa quarante-cinquième année, une jeune et jolie genevoise de dix-sept ans, Violette Pictet. De là devait naître une liaison clandestine aussi passionnée que tumultueuse dont une abondante correspondance privée porte témoignage. À partir de ces lettres auxquelles l’auteur a eu accès, ce roman, se tenant au plus près de la vérité historique, se propose de raconter et parfois d’imaginer les moments forts de cette aventure sentimentale entre le futur Académicien et celle qu’il nomme la « sylphide » et craint de reconnaître comme « la fille aînée de ses illusions », selon une expression empruntée à Chateaubriand. Au fil des pages, le lecteur partagera la vie professionnelle de l’écrivain, retrouvera certaines de ses œuvres, il découvrira son histoire personnelle, il visitera les lieux qui lui sont chers, Toulon, La Garde et la bastide les Lauriers-Roses, Solliès-Ville…; il s’interrogera aussi sur ses tourments d’amant et de père, et sur les raisons d’un échec amoureux qui fait contraste avec une incontestable réussite littéraire et une célébrité que le temps a en partie estompée.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Yves Stalloni, universitaire de formation, ancien professeur de Khâgne à Toulon, conférencier, membre titulaire de l’Académie du Var, est l’auteur de plus de cinquante ouvrages dans des genres divers. Converti à l’écriture de fiction, il privilégie des romans en rapport avec le Var, comme dans
Eudoxe ou une initiation toulonnaise,
L’Homme des phares, autour du personnage de Michel Pacha,
De l’écran à l’autel, inspiré de la vie du chanoine Galli,
Jusqu’aux étoiles, sur l’épopée du Dixmude et
le Colonel et la Vénus, sur Olivier Voutier et Hyères.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yves Stalloni
FILLE AÎNÉE DE MES ILLUSIONS
Le grand amour secret
de Jean Aicard
Roman
Sudarenes Editions
Ce roman est inspiré de faits et de personnages réels. L’auteur a utilisé, pour leur redonner vie, divers documents et archives ainsi que des correspondances privées auxquelles il emprunte des passages ou des phrases. De nombreuses citations sont tirées des œuvres de Jean Aicard. Les ressources de l’imagination ont parfois été sollicitées pour ajuster l’ensemble.
Conception de la couverture : Véronique Toussaint
Dessin de la quatrième de couverture : Louis Imbert
© Éditions Sudarènes
www.sudarenes.com
19 chemin des Cigalons - 83400 - Hyères
Il me semble que je vois sortir des flancs du Saint-Gothard ma sylphide des bois de Combourg. Me viens-tu retrouver, charmant fantôme de ma jeunesse ? as-tu pitié de moi ? Tu le vois, je ne suis changé que de visage ; toujours chimérique, dévoré d'un feu sans cause et sans aliment. […] Cette tête, que ces cheveux qui tombent n'assagissent point, est tout aussi folle qu'elle l'était lorsque je te donnai l'être, fille aînée de mes illusions, doux fruit de mes mystérieuses amours !
CHATEAUBRIAND
Mémoires d’outre-tombe, Livre 36, ch. 11
Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, T. II, p 582
1
Quand, depuis la fenêtre du train, il commença à voir les contours brumeux de la vieille ville de Genève d’où émergeait la flèche de la cathédrale Saint-Pierre, le poète retrouva peu à peu sa bonne humeur. Il avait quitté Paris contrarié, irrité par le peu d’empressement que mettait Georges Patinot, le directeur du Journal des débats politiques et littéraires, à faire paraître en feuilleton son nouveau roman intitulé L’Ibis bleu.
Peut-être le titre manquait-il de force suggestive, peut-être n’était-il pas assez vendeur pour ce marchand de papier, peut-être avait-il le défaut de ne pas annoncer clairement le sujet de l’intrigue, une histoire d’adultère dans l’esprit du chef d’œuvre russe qui venait d’être traduit en France, l’admirable Anna Karénine. Certes le nom de Jean Aicard était moins célèbre que celui de l’immense Léon Tolstoï (qui, conquis par cette côte varoise chère au poète, avait fait un long séjour à Hyères où son frère s’était éteint), mais il était loin d’être inconnu. Le roman précédent, Le Pavé d’amour, dont l’action se passait à Toulon, la ville natale d’Aicard, avait été particulièrement bien accueilli, y compris à Paris où, pourtant, on considérait avec réserve les tentatives romanesques d’un auteur surtout connu en tant que poète, éventuellement de dramaturge. Près de vingt recueils de vers suffisaient à illustrer les priorités littéraires de cet écrivain venu de Provence. Se mettre au roman à plus de quarante ans ressemblait à une trahison qui pouvait déconcerter le public.
Ce que lui avait fait comprendre Patinot qui, malgré tout, et bien conscient de tenir avec Aicard un auteur populaire, avait consenti à fixer une date pour la parution des premiers chapitres : le dimanche 30 avril 1893, c’est-à-dire dans une vingtaine de jours. Et l’ensemble de la publication devait courir jusqu’à l’été, en huit livraisons, façon d’arriver à l’échéance retenue pour la publication en volume chez Ernest Flammarion, à la fin du mois de juin.
Pour l’instant, Jean, que tout le monde continuait à appeler « le poète », arrivait à Genève sans qu’aucune ligne de son nouveau livre ait pu être parcourue par les lecteurs suisses ni français. L’objet de sa visite tournait pourtant autour de cet Ibis bleu dont la presse locale commençait à parler et dont l’auteur devait assurer le lancement et la promotion. Il lui faudrait utiliser les manuscrits et créer le désir par la lecture d’extraits bien choisis. Jean avait confiance dans ses moyens de séduction et dans son éloquence.
Ce voyage en Suisse pouvait être, d’après ses calculs, le cinquième. Le premier avait eu lieu en 1878 – l’année de ses trente ans – à l’occasion de sa traduction poétique de l’Othello de Shakespeare dont cinq comédiens du Français étaient venus jouer certaines scènes sur les bords du Léman. Il gardait aussi le souvenir de l’accueil très favorable que ses conférences sur le sujet avaient reçu à Genève, à Neuchâtel et à Lausanne, selon un circuit qui deviendrait rituel. Pour la circonstance, il avait été élu membre honoraire de la très respectable Société des Belles-Lettres de la ville de Lausanne.
Jean Aicard se sentait comme chez lui en Suisse, et s’y était fait des amis, comme le poète neuchâtelois Philippe Godet qui lui avait envoyé le poème « L’Areuse », texte prometteur qu’il allait se charger de placer dans une revue. Ou le professeur Raoul Pictet, physicien reconnu et homme de culture, qu’il avait rencontré par hasard à l’occasion d’un dîner en 1879. Sans doute allait-il revoir l’un et l’autre à l’occasion de ce nouveau séjour.
Le train approchait de la gare de Cornavin, en plein centre de la capitale du pays lémanique. Le voyage avait été assez long, sans péripétie particulière, dans cet express de première classe qui avait quitté Paris à 20 heures 40. Les conditions de voyage nocturne s’étaient révélées plutôt confortables, un peu moins après l’étape de Mâcon, vers six heures du matin, quand le rapide avait pris la direction de Genève où l’arrivée était prévue à 10 h 35. On venait de dépasser onze heures depuis une dizaine de minutes, un retard peu compatible avec la ponctualité helvétique mais que l’on pouvait juger acceptable et qui ne contraria guère le programme du voyageur.
Celui-ci commençait à ranger ses affaires, et notamment ses papiers et ses notes qu’il se préparait à glisser dans un large portefeuille de cuir. Deux ou trois feuillets remplis de sa belle écriture laissaient deviner un alignement de vers, ceux qu’il avait composés en redécouvrant, depuis la fenêtre du compartiment, les somptueux paysages enneigés qui, indiscutablement, méritaient une célébration poétique. Il pourrait les lire devant les assemblées de connaisseurs venus l’écouter : l’hommage aux montagnes était toujours un thème reçu avec enthousiasme en ces lieux proches des Alpes.
Il prit garde à ne pas oublier le grand chapeau à larges bords, ni l’ample manteau dans lequel il aimait à s’envelopper – la Suisse, même en avril, ne permettait pas de sortir en veste ou en chemise, comme il l’aurait fait en Provence où il retournerait bientôt. Sa canne en ébène et son sac de voyage (rempli de livres à offrir à ses hôtes) complétaient son bagage.
Le train arrivait à son terminus. Un représentant de la Société des Arts, l’institution à l’origine du déplacement, était chargé de venir l’accueillir à la gare. Grâce à des portraits, la physionomie de Jean Aicard était familière, même à ceux qui ne l’avaient jamais rencontré : un visage bien proportionné, un peu anguleux, encadré d’une barbe fournie s’achevant en double pointe, une chevelure abondante au-dessus d’un front légèrement dégarni, bouclée, du même noir que la barbe, plutôt désordonnée. Un regard clair, une prestance noble et avantageuse, un pas assuré, une distinction souriante. Le poète ne pouvait pas passer inaperçu. Bien qu’il ait changé, un peu épaissi au regard de sa représentation, en compagnie de confrères artistes, dans le célèbre tableau de Henri Fantin-Latour, Un Coin de table. Plus de vingt ans déjà.
Alors qu’il se dispose à quitter son compartiment, Jean semble avoir oublié sa morosité parisienne, un sentiment qui, d’ailleurs, n’avait pas de justification sérieuse. Patinot était finalement un bon professionnel et L’Ibis bleu devait paraître à une date qui n’empêcherait pas son auteur d’aller prendre, comme il en avait l’habitude, ses quartiers d’été dans le midi. Le poète pourrait trouver refuge, dès la mi-juillet, à La Garde, près de Toulon, aux Lauriers, cette chère bastide entourée de verdure où il aimait à venir se reposer et, plus encore, à trouver la tranquillité propice à l’écriture. Le séjour, cette année, devrait se prolonger jusqu’en octobre, puisque le poète avait été sollicité par son ami le docteur Ségard pour prononcer le discours d’accueil à l’occasion de la visite de la flotte russe à Toulon, en présence du Président Sadi Carnot. Aicard était devenu, sans le vouloir, le spécialiste des harangues officielles.
Mais nous en sommes encore loin, et un homme en redingote à l’allure sévère s’approche de lui : le délégué de la Société des Arts est là qui lui souhaite la bienvenue et l’entraîne vers la sortie. Le poète doit être impatient de regagner son hôtel pour prendre un peu de repos et préparer l’intervention du lendemain, 5 avril, annoncée dans le Journal de Genève du 30 mars dont l’homme grave lui remet un exemplaire et que Jean parcourt avec un frisson de vanité : « Parmi les écrivains français contemporains, il en est peu dont le nom soit plus populaire à Genève que le poète Jean Aicard. Il y compte de nombreux amis personnels et beaucoup plus encore d’admirateurs. Notre génie national, individualiste et spiritualiste, lui sait gré de sa fière indépendance à l’égard des coteries et des écoles, et du courage avec lequel il a toujours revendiqué, en face du naturalisme dans lequel s’est trop longtemps complu la littérature française, les droits de la justice, de l’idéal, de toutes les grandes idées qui font la valeur de la vie et la noblesse de l’humanité. » Suivaient quelques rappels des précédents séjours en Suisse : « On n’a pas oublié les visites qu’il nous fit à deux reprises, et tous ceux qui l’ont entendu lire sa belle traduction d’Othello ou le gracieux poème de Miette et Noré se rappellent comment il sait, en les disant, faire vivre ses œuvres et quel relief leur donnent sa physionomie expressive et sa voix flexible, tour à tour vibrante et caressante. Aussi tous nos lecteurs accueilleront-ils avec une vive satisfaction la bonne nouvelle qu’il nous donne lui-même en tête du feuilleton, signé de son nom, que nous publions aujourd’hui, de son prochain retour parmi nous. M. Aicard se propose de lire dans deux conférences, qui auront lieu entre le 5 et le 12 avril, à l’Athénée, un roman idéaliste inédit : L’Ibis bleu et plusieurs poésies, également inédites. Nous pouvons lui prédire un entier succès. »
« Voilà qui me change de la rudesse de la presse parisienne, se dit pour lui-même le poète. C’est toujours agréable d’être attendu avec impatience et d’être apprécié. Presque huit ans que je ne mets pas les pieds en Suisse, et on se souvient toujours de moi ! Je devrais venir plus souvent. »
Le Palais de l’Athénée, siège de la Société des Arts, est situé au cœur de la ville historique, rue de l’Athénée, à proximité de la Place-Neuve, du Consulat de France, de l’Université de Genève, de la Bibliothèque d’art et d’archéologie et du Musée d’art et d’histoire. La conférence que doit prononcer le poète français se tiendra dans la salle dite « des Abeilles » qui tient son nom de la frise et du plafond peints par l’artiste genevois Jean-Jacques Dériaz. Une centaine de personnes, dont beaucoup de dames emmitouflées dans des fourrures, sont présentes en ce début d’après-midi, alors qu’il fait, à l’extérieur, une température glaciale. On attend l’orateur.
Sur la scène, celui-ci devise amicalement avec le président Restaud qui, dans un court moment, va le présenter au public. Il semble détendu, amusé d’être là, flatté aussi d’être l’objet d’attentions, de multiples prévenances de la part d’organisateurs empressés. Il a quitté son costume de voyage et sa mise est soignée, une cravate claire, nouée par-dessus un gilet du même drap que le veston, attire le regard et atteste un discret souci d’élégance. Il n’est plus très jeune, comme le révèle quelques filets blancs dans sa barbe, mais il se tient bien droit, un peu cambré, la main gauche sur la hanche, la tête relevée. Une présence d’acteur.
Quand il prend la parole, c’est d’une voix retentissante, ferme, légèrement teintée d’inflexions chantantes, vibrante et même musicale. Une voix de poète, même pour prononcer des phrases convenues : « Je suis très touché de l’honneur qui m’est fait. Il m’est très doux d’être invité dans une ville amie où l’on s’est toujours montré avec moi d’une extrême bienveillance. Genève est à mes yeux une parcelle de France hors de France et une véritable oasis de bon sens et d’honnêteté avec, en plus, ce clair et franc génie helvétique. Merci, chers amis ! »
Le poète pense-il aux rudes combats qu’il lui faut mener à Paris pour s’imposer dans le monde des lettres ? Pense-t-il aux atermoiements du trop prudent Patinot du Journal des débats? Aux confrères jaloux ou mal intentionnés ? Aux éditeurs trop clairement soucieux de rentabilité ? Il poursuit :
– Je suis ici pour vous parler de poésie, le plus pur des langages, le plus noble, le plus désintéressé, le plus fraternel, et aussi d’un roman idéaliste inédit dont je voudrais vous lire un extrait à valeur de confidence qui peut faire office de présentation personnelle : « Je suis pour les sincères. Loyauté, sincérité, franchise, cela contient tout : tout, c’est-à-dire réalité et idéal, aveu du mal et désir du bien ! Et cela c’est l’idéalisme sensé contre lequel rien ne peut prévaloir, l’idéalisme de l’homme qui est bien forcé de marcher sur terre avec des pieds lourds, mais qui a tourné en haut son visage et qui regarde l’homme à la hauteur du regard ! J’appelle cela l’idéalisme à pied. Et moquez-vous de moi si vous voulez. » Vous trouverez ces phrases dans L’Ibis bleu, roman qui paraîtra en feuilleton dans quelques jours, mais je les prends à mon compte, je me les applique, et je suis convaincu de m’adresser à des femmes et des hommes qui les approuvent et les partagent.
Le thème est posé. La suite ne sera, pendant plus d’une heure, qu’un ensemble de variations, illustrées de lectures, autour du sujet : celui de l’amour de l’autre, de la droiture morale, du respect des humbles et de l’aide aux plus faibles, de la pitié, de la réhabilitation des grandes valeurs humanistes : la générosité, l’indulgence, le désintéressement, le courage, la solidarité. Ce n’est plus un poète qui parle, c’est un sage. Tout poète d’ailleurs n’est-il pas un peu moraliste ? Certains, dans l’auditoire, pensent à Victor Hugo, génie de la poésie et défenseur des causes justes. Aicard, précisément, cite le maître, s’enorgueillit de lui avoir exprimé son admiration, d’avoir reçu ses conseils, ses encouragements. L’auteur des Misérables a quitté la vie il y a moins de dix ans, mais il est toujours présent dans les mémoires. Faire confiance aux grands auteurs quand ils sont de grands hommes. Les longs applaudissements, à la fin du propos, récompensent le tribun autant qu’ils félicitent l’homme de cœur. Jean Aicard sourit en s’épongeant le front.
Alors qu’il continuait à serrer des mains d’inconnus et à répondre à des admiratrices fardées, le conférencier vit venir à lui un personnage joyeux et de belle taille qui lui ouvrit les bras, l’étreignit avec force, le fixa longuement d’un regard aigu avant d’exprimer de chaleureux remerciements limités à quelques mots :
– Cher poète, bravo ! Cher ami, merci.
Jean reconnut immédiatement le professeur Raoul Pictet, grand physicien, savant mondialement connu pour ses travaux sur le froid et la liquéfaction de l’oxygène, industriel entreprenant en France, en Allemagne et en Suisse, d’où il était originaire et où il habitait le plus souvent, dans une grande propriété que possédait la famille aux portes de Genève.
Leur première rencontre avait eu lieu dans cette ville, chez des amis, en 1879, lors du premier voyage du poète en Suisse. L’entente avait été immédiate. Le grand savant qu’était déjà Pictet ajoutait à ses qualités de chercheur des talents d’organisateur et d’enseignant, comme il l’avait prouvé en Égypte où il avait séjourné plusieurs années, se faisant apprécier du khédive, créant le département de Physique de l’Université du Caire et imaginant la production de glace dans un pays qui en sentait l’impérieuse nécessité. En société, l’homme se révélait d’un commerce délicieux, cachant son érudition sous une bonhomie familière, sous des dehors espiègles et un penchant pour les sous-entendus ironiques. On lui reconnaissait aussi une vraie sensibilité littéraire et un goût prononcé pour la poésie dont il maîtrisait l’histoire et les pratiques. Jean l’avait revu plusieurs fois lors de ses divers voyages en Suisse, et même à Paris où Pictet avait enseigné à la Sorbonne pour un cours très suivi et au Collège de France où il avait en outre créé une unité de recherche.
Depuis, le savant avait encore gagné en notoriété (malgré quelques revers en ce qui concernait l’exploitation industrielle de ses découvertes), mais n’avait rien perdu de sa jovialité, de son anticonformisme et de son amour de la vie qu’on pouvait qualifier de juvénile, bien qu’il avançât en âge, de deux ans l’aîné de Jean. Les deux hommes en arrivaient à se ressembler : un large front, une barbe bien taillée, un regard vif, un vêtement recherché. Pictet, toutefois, dépassait Aicard d’une bonne tête et ne tenait pas en place : l’impatience du chercheur, contrastant avec la nonchalance du poète.
– Cher ami, j’ai été littéralement conquis, s’exclama-il en prenant les mains de Jean. Vous êtes un homme de cœur et un grand esprit. Je me sens fier de faire partie de vos amis. Merci pour ce moment de grâce, et merci aussi pour les lignes que vous avez confiées à la presse concernant mes médiocres causeries. Je n’en méritais pas le dixième et je reconnais là votre grande générosité.
Pictet faisait allusion à un long article donné par Aicard au Journal de Genève et paru quelques jours plus tôt. L’écrivain y rendait compte de l’intervention du professeur Pictet chez Juliette Adam qui inaugurait, dans son hôtel particulier du boulevard Malesherbes, un cycle de Causeries scientifiques. L’éminent physicien avait prononcé, dans le petit théâtre aménagé à cet effet, trois conférences philosophiques réunies sous le titre Le Libre arbitre et la physique expérimentale. L’article de Jean Aicard louait la hauteur de vue du conférencier et ses conclusions de nature spiritualiste, terme et concept considérés par lui comme essentiels. De longs passages de la conférence étaient reproduits et la thèse se trouvait déclinée sous diverses formes. À partir d’idées fortes : le beau et le bien l’emportent sur le vrai et le juste ; la vertu morale dépasse en considération le savoir et le rayonnement social ; la renaissance spiritualiste et idéaliste triomphera dans l’art et la littérature à la fin de ce XIXe siècle. Ce qui revenait à condamner le pessimisme répandu par Hartmann ou Schopenhauer et l’ironie ou la noirceur cultivées par la littérature naturaliste inaugurée par Flaubert et poursuivie par Zola, des maîtres à respecter, mais à ne pas imiter. La quasi totalité de ce qu’avait écrit Aicard depuis vingt-cinq ans était imprégnée de ces idées. Le savant suisse retrouvait, à partir de ses réflexions scientifiques, ce que le poète provençal avait découvert grâce à ses intuitions. Une phrase du chroniqueur devait résumer la thèse : « Contre cette tyrannie obscure et absolue des milieux et des faits, la Vie même se dresse indignée ».
Raoul Pictet venait précisément, sans effort de mémoire, de rappeler cette phrase remarquable à celui qui en était l’auteur. Puis, l’œil rieur et le verbe haut, après avoir une nouvelle fois exprimé ses félicitations et manifesté sa reconnaissance, il se tourna vers une jeune fille restée discrètement debout au bas de la scène, au milieu d’un groupe d’étudiants, à qui il adressa, tout en parlant, un signe d’invitation à les rejoindre.
– Je voudrais vous présenter une petite personne qui vous admire, qui a lu tous vos livres, connaît par cœur vos vers et aime à vous citer. C’est ma deuxième fille, Violette, ma préférée – mais c’est quelque chose à ne pas dire, comme le répète Hélène, mon épouse, qui, souffrante, n’a pas pu venir vous écouter et vous prie de l’excuser.
– Je suis navré pour la santé de Madame Pictet à qui je vous demande de transmettre mes hommages. Mais la présence de votre fille Violette – quel joli nom ! – me paraît de nature à compenser cette absence que toutefois je regrette. Approchez, mademoiselle.
Une frêle silhouette s’est détachée du groupe, a gravi les marches et s’est présentée au poète qui, croyant voir apparaître une nymphe ou une sylphide, se répète la question que se posait Chateaubriand en franchissant, un soir d’orage, le Saint-Gothard et se souvenant de son adolescence à Combourg : « Me viens-tu retrouver, charmant fantôme de ma jeunesse ? […] Fille aînée de mes illusions, doux fruit de mes mystérieuses amours ? » Ces amours que l’écrivain breton qualifiait de « mystérieuses » Jean, pour son compte, aurait pu les nommer « décevantes ». Car si la littérature lui procurait d’heureuses satisfactions, le territoire affectif qui était le sien ressemblait à une lande désolée. Lui qui avait tant chanté l’amour sous toutes ses formes, n’avait jamais réussi à le vivre pleinement. Des aventures, des liaisons, des passades et jamais une passion sérieuse, de celles qui engagent et s’inscrivent dans la durée.
Violette est là, qui se tient silencieusement face à lui.
Il prend le temps de regarder la jeune adolescente, visage d’enfant et corps de femme, tenue sage et regard provocateur, sourire d’ange et allure sensuelle. Pourquoi cette émotion au moment de lui adresser un compliment ? Pourquoi le maître du verbe balbutie-t-il maladroitement ? Pourquoi l’homme vieillissant se prend-il soudain pour un soupirant ? Violette est une fée, Violette est un mystère, Violette est un miracle. Fallait-il que cette rencontre survienne maintenant, en un lieu étranger, dans des circonstances conventionnelles, alors qu’à quarante-cinq ans il pensait éteinte la flamme du sentiment ? Si c’était elle la « fille aînée de ses illusions », si c’était elle qui devait le réconcilier avec les élans du cœur, qui devait l’aider à entrer dans le grand âge avec l’âme d’un jeune homme ?
Le malicieux professeur Pictet semble avoir perçu le trouble du poète et vole à son secours :
– Violette après sa maturité, va entamer des études de lettres : la science physique a des charmes qui ne la touchent guère, hélas pour moi. Elle veut écrire des livres, des vers, des romans. Vous êtes pour elle un modèle, une référence. Elle n’ose pas vous exprimer l’étendue de l’admiration qu’elle vous porte, bien supérieure à celle que je lui inspire moi-même. N’est-ce pas, ma chérie ?
La sylphide va enfin se mettre à parler :
– C’est un grand honneur pour moi de rencontrer aujourd’hui un homme de lettres illustre et un admirable poète. Merci d’être venu jusqu’à nous, Monsieur. Mon père a dit la vérité : je vous admire depuis toujours.
– Et moi je vous aime, chère enfant.
Cette courte phrase, cette réplique de théâtre cette déclaration directe, Jean ne l’a pas prononcée. Il la gardera pour lui. Ou pour un autre jour. Il n’a rien à répondre. Rien à ajouter. Rien à commenter. Son trouble le laisse interdit. Il est temps de quitter l’Athénée de prendre congé de la Société des Arts. Il est temps de revenir à ses écritures, à ses rêveries. Il est urgent d’oublier Violette. Mais comment oublier Violette ? Une sylphide, une possible « fille aînée de ses illusions » ?
En se retrouvant, un peu plus tard, dans la rue, puis sur la Place Neuve, le poète constata, avec une sorte de jubilation inexplicable, que la neige tombait en abondance. Il se sentit heureux, et jeune.
2
Le salon de Juliette Adam avait sensiblement perdu du brio qui avait été le sien du temps de l’Empire, tout en restant un foyer actif et recherché de la mondanité, une mondanité dont la futilité apparente ne parvenait pas à étouffer les estimables manifestations de l’esprit. On y venait pour causer, activité dominante des milieux privilégiés en cette « fin de siècle » (selon une expression qui commençait à se répandre avec insistance), pour se montrer, pour rencontrer des personnages influents susceptibles de favoriser un avancement ou une réalisation ; on y venait aussi pour échanger des idées, critiquer le gouvernement, défendre des œuvres innovantes, soutenir la création, y trouver, pour un jeune auteur, une chambre d’écho et une sorte d’adoubement officieux.
Jean Aicard, dès son installation à Paris, aux premières années de la République, avait en vain chercher à pénétrer un de ces lieux où se bâtissaient les renommées. Après quelques tentatives infructueuses il avait pu être introduit dans le cénacle de l’ex-Madame de La Messine (nom d’auteur des premiers livres de Juliette Adam) en 1879, en même temps que Pierre Loti qu’il ne connaissait pas alors mais qui allait devenir un ami cher. L’élégant salon littéraire où se réunissaient les plus grands écrivains et penseurs se trouvait alors au 23 faubourg Poissonnière et s’était transporté, depuis, au 190 du Boulevard Malesherbes, à proximité de la place et de l’église de Saint-Augustin. Là, tous les mercredis, avait rendez-vous l’élite de la capitale. Loti et Aicard étaient vite devenus des fidèles, Juliette Adam, les appelant affectueusement « mes fils ». Elle avait accueilli certains de leurs textes dans LaNouvelle Revue, publication à la mode qu’elle dirigeait avec autorité et compétence.
Juliette Adam aurait bien aimé que son cercle égalât en prestige celui qu’avait animé, au début du siècle, une autre Juliette, Madame Récamier, l’égérie de Chateaubriand dont tout le monde louait la grâce et l’intelligence et qui recevait à l’Abbaye-aux-Bois, sur la rive gauche. Mais, à près de soixante ans, la fondatrice de La Nouvelle Revue, n’était pas en mesure de rivaliser avec la « divine » sur le chapitre de la beauté, compensant cette infériorité par une intense activité d’écrivain et une réelle implication politique, passion qui lui avait été transmise par son mari, ancien député puis sénateur, et surtout par Léon Gambetta, un habitué de la rue Poissonnière. L’ancien président du Conseil était mort depuis plus de dix ans, mais Juliette continuait à défendre avec conviction les idées républicaines qui étaient les siennes et s’était engagée dans une nouvelle croisade, celle du droit des femmes. Ses amitiés de jeunesse avec George Sand et Daniel Stern (pseudonyme de la comtesse Marie d’Agoult) l’avaient sensibilisée à une cause qui était devenue pour elle fondamentale.
Assez peu de femmes, pourtant, étaient présentes en ce mercredi de janvier 1894, pour la réouverture du salon du boulevard Malesherbes. Jean Aicard faisait partie des invités et devait lire quelques extraits de son futur roman Fleur d’abîme,à paraître en feuilleton dans le Journal des débats politiques et littéraires de Patinot. En attendant son tour, il devisait sur des questions diverses, mêlant la poésie, la philosophie et la science, avec son confrère Sully-Prudhomme, avec l’éditeur Jules Hetzel, l’astronome Camille Flammarion et son ami Édouard Schuré, le philosophe et musicologue, spécialiste de Wagner. Ils furent rejoints par un personnage de haute stature que le poète ne s’attendait à voir en ces lieux, le professeur Raoul Pictet, toujours rieur et élogieux :
– Mon cher poète ! quel plaisir de vous retrouver ! Vous savez que vous avez littéralement enchanté votre auditoire lors de votre dernier passage à Genève. Votre voix, votre diction, vos vers et votre prose ont conquis nos amis de la Société des Arts. Ils vous attendent à nouveau avec impatience, surtout quand vous faites paraître un nouveau livre. Quelle fécondité !