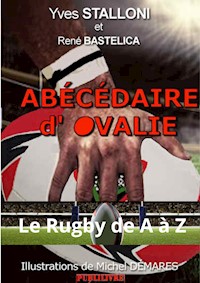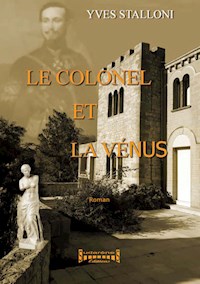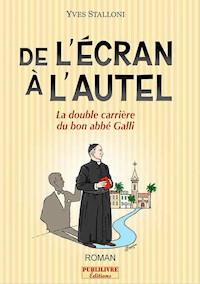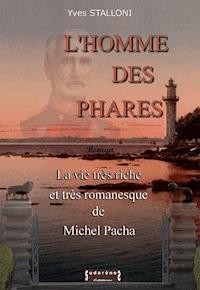Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PLn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les êtres d’exception mettent beaucoup d’application pour donner corps à leurs rêves. Naturellement, et sans calculer les risques. C’est le cas de Jean du Plessis, officier de la Royale qui délaissera les bateaux pour les ballons plus légers que l’air capables de le hisser « jusqu’aux étoiles ». Son parcours personnel, sentimental, professionnel est parfois tourmenté, parfois douloureux, parfois heureux ou même sublime, mais jamais banal. Il le conduit à prendre le commandement du Dixmude, un gigantesque dirigeable de la série des zeppelins arraché aux Allemands en 1918, qui viendra stationner sur la base de Cuers-Pierrefeu, près de Toulon. C’est aux commandes de cette immense nef volante que s’écrira son destin, achevé dans l’incandescence d’une nuit d’orage en Méditerranée, près des côtes de Sicile, à la veille de Noël 1923. Cette histoire vraie et tragique, reconstituée à partir d’une rigoureuse documentation, devient, par la grâce de l’écriture, de l’imagination et du style, un haletant récit.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Yves Stalloni, universitaire de formation, ancien professeur de Khâgne, membre titulaire de l’académie du Var, est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages dans des genres divers.
Depuis une dizaine d’années il se consacre à l’écriture de fiction, comme dans
Eudoxe ou une initiation toulonnaise et surtout dans
L’Homme des phares roman à partir du personnage de Michel Pacha.Il connu un gros succes avec
De L'écran à l'autel, retraçant la vie du célébre Sanaryen Galli
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yves Stalloni
JUSQU’AUX ETOILES
L’épopée tragique du DIXMUDE
« Celui qui s’oriente sur l’étoile ne se retourne pas. »
Chapitre 1
Le jeune Jean du Plessis ne se doutait pas, quand il reçut en cadeau, pour ses dix ans, un exemplaire de Cinq semaines en ballon, le roman de Jules Verne, que ce livre allait changer sa vie et orienter son destin. Il s’agissait d’un de ces grands volumes cartonné in-octavo publié par la maison Hetzel avec des illustrations dues, pour cette fois, à Édouard Riou et Henri de Montaut. La couverture, généreusement colorée de rouge, faisait apparaître dans sa partie supérieure et insérée dans un cartouche jaune, le nom de l’auteur, inscrit en belles lettres ouvragées noires, lui-même placé au-dessus d’une sphère représentant de façon schématique le globe terrestre, en partie cachée par une étiquette d’un rouge vif où était inscrit, en caractères plus sobres, le titre de l’ouvrage. Le pied de de la couverture annonçait la collection à laquelle ce roman devait se rattacher : « Voyages extraordinaires ».
En observant le détail de la décoration générale, on était immédiatement alerté par la thématique exotique à tendance africaine révélée par des dessins stylisés d’éléphants, de serpents et d’autres étranges animaux dissimulés dans une végétation tropicale. Cette composition se combinait à la dimension maritime suggérée par un morceau de mer d’un bleu cru, une ancre de marine mêlée à des cordages et un bâtiment de navigation bizarrement pourvu de huit mats et placé quelque part dans le ciel, loin de l’étendue d’eau. Enfin, en rapport avec le titre de l’ouvrage, apparaissait, dans le coin supérieur droit, une montgolfière dont la nacelle semblait se balancer au gré du vent. Ces représentations étaient fondues dans un ensemble de motifs décoratifs de couleur or, volutes, arabesques, figures géométriques, et achevées par une frise florale encadrant, sur fond noir, l’inscription : « Collection Hetzel ».
Une telle couverture était déjà, pour le petit Jean, une invitation au rêve et au voyage.
Les premières pages du livre venaient confirmer la promesse d’évasion : d’abord par le sous-titre, bien en vue sur la première page, et ouvrant à de nouveaux horizons « Voyages et découvertes en Afrique par trois Anglais ». Ensuite par le frontispice en regard du premier chapitre, revenant à l’essentiel et montrant, dans une fine gravure en noir et blanc, un ballon flottant dans les airs au-dessus d’un paysage mal défini mais plutôt hostile d’où se détachaient les pics abrupts d’une montagne escarpée. Le titre du roman était reproduit en lettres blanches sur les flancs rebondis du ballon.
En route pour l’aventure : « Il y avait une grande affluence d’auditeurs, le 14 janvier 1862, à la séance de la Société royale géographique de Londres, Waterloo place, 3. »
Curieusement, nous étions, en écho à la première phrase du livre, un 14 janvier, veille de la date anniversaire de la naissance de Jean, né un 15 janvier, et au début de l’année 1902, soit exactement quarante ans après les événements racontés par le romancier. Ce livre arrivait au bon moment et portait en lui de bienveillants augures. Peut-être les parents du Plessis l’avaient-ils choisi en raison de ces coïncidences.
Jean était un enfant curieux, intrépide, très en avance pour son âge et passionné de lecture. À moins de dix ans, il venait d’entrer en Cinquième au collège privé Saint-Maurille des Ponts-de-Cé, sur la Loire, l’école publique ayant refusé de lui accorder la dérogation lui permettant de sauter la Sixième. Son père, Joachim, qui avait contribué à la création de la faculté catholique d’Angers, n’eut aucun mal à obtenir l’admission de son cadet, dont il avait assuré lui-même jusqu’alors la formation scolaire, dans un établissement confessionnel de la ville dans laquelle il était venu habiter. Avocat au barreau de Rennes, spécialiste d’histoire du droit, d’économie politique et de droit commercial, licencié ès lettres, le comte Joachim du Plessis de Grenédan, qui venait de dépasser la trentaine, jouissait d’une grande considération en Bretagne et dans les Pays de Loire. L’illustre famille, dont il était le descendant avait compté parmi ses ancêtres un chevalier ayant combattu en faveur du roi de France à la bataille de Bouvines ; elle prenait son origine au cœur de la Bretagne, dans la commune de Mauron, au lieu-dit Le Plessis près de la forêt de Paimpont, à l’ouest de Rennes, ville où était né Jean. Les hasards de la carrière universitaire du jeune professeur de droit avait conduit la famille à s’établir, deux ans plus tôt, en Anjou.
Dès son plus jeune âge, Jean avait montré une attirance pour les livres, que ses parents et ses proches ne se privaient pas de lui procurer. Il abandonna très vite la littérature de jeunesse ou les contes, jugés puérils, pour s’intéresser à des ouvrages plus ambitieux liés à l’histoire, à la religion (la Bible était un livre de chevet) ou racontant de riches aventures humaines. Il était encore à l’école primaire qu’il avait déjà lu les grands poèmes épiques de l’Antiquité, ceux d’Homère ou de Virgile qui le transportaient sur les rives ou les flots de la Méditerranée. Il manifesta peu après un réel intérêt pour les romans historiques d’Alexandre Dumas qui le ramena sur terre, en France et à une époque moins lointaine. Franchissant les frontières, il découvrit, grâce à son père, Fenimore Cooper, dont il adora Le Dernier des Mohicans et surtout La Prairie, qui mettait en scène le fascinant Squatter Ishmaël Buch et sa famille.
Mais très vite l’enfant marqua une préférence pour des histoires de marins, des aventures de navigateurs, des expéditions sur les océans, dont un extraordinaire exemple était, à ses yeux, l’immense épopée du diabolique capitaine Achab dans le Moby Dick de Melville. Dans la même veine, son père lui avait mis entre les mains, à peine paru, le roman d’un officier anglais signant du nom de Joseph Conrad, Lord Jim. Ce livre fut une révélation, même si l’épilogue était tragique et favorisait l’identification : de Jean à Jim, il n’y avait que quelques lettres de différence.
Jules Verne était également un des auteurs favoris du deuxième fils des du Plessis, par sa capacité à inventer des récits chargés de mystères et de péripéties dont certains se passaient sur ou sous les mers. Le garçon ne connaissait pas, toutefois, le premier des volumes constituant la série des « Voyages Extraordinaires », celui qu’il reçut en ce jour d’anniversaire de janvier et intitulé Cinq semaines en ballon. L’heure, en ce début de siècle, était, après l’exploration des mers, à la conquête des airs. Des expériences, pas toujours convaincantes, cherchaient à exaucer le vieux rêve des hommes, voler. L’Éole de l’ingénieur Clément Ader avait réussi à s’élever sur quelques mètres, et L’Illustration en donnait une relation enthousiaste. D’autres « fous volants » imaginaient des engins étranges appelés « aéroplanes » ou « avions » qui supplanteraient bientôt les aérostats, tels celui de Blanchard qui, cinquante ans plus tôt, avait franchi la Manche en ballon, ou le dirigeable conçu par le Breton Dupuy de Lôme, mu par une hélice et les bras d’une équipe de marins. Le livre de Jules Verne, négligeant les tentatives des « plus lourds que l’air », venait opportunément célébrer de façon romanesque les mérites des aéronefs à hydrogène ou à air chaud. Jean s’envola littérairement sur le Victoria au-dessus de l’Afrique, de Zanzibar aux sources du Nil, mais son voyage dura moins de cinq semaines puisqu’il dévora le livre en à peine trois jours.
Il est difficile de vérifier si cette lecture de jeunesse eut une incidence sur la vocation du jeune du Plessis. Les grands choix de la vie sont souvent le résultat d’une conjonction de causes dont on a du mal à discerner la principale. Un peu comme un fleuve qui, quand il arrive à la mer, est grossi de divers affluents apportant chacun sa part au débit général, les événements majeurs d’une existence – parcours professionnel, engagements affectifs, installation géographique – ne sont pas toujours explicables de manière univoque, faisant intervenir une part de hasards et de tournants conjoncturels. Pour Jean, que son père aurait bien vu, à son image, embrasser une carrière juridique ou universitaire, l’avenir, très tôt se dessina sous l’uniforme. Une longue lignée de du Plessis de Grenédan avaient souhaité justifier leur rang et leur titre en devenant officiers au service de la patrie et du roi. La fin de la monarchie et l’avènement de la République ne signifiaient pas l’abandon des devoirs de l’aristocratie. Le doute n’habita jamais le jeune garçon : il entrerait dans un corps d’armée.
La surprise vint non de l’orientation militaire mais de la préférence précoce pour la marine. Jean avait beau être Breton, il n’était pas né au bord de la mer et n’avait de l’océan qu’une connaissance superficielle, acquise à l’occasion de séjours de vacances dans la famille de sa mère, à La Bernerie, sur la baie de Bourgneuf, en pays nantais. On ne trouvait d’ailleurs pas, dans ses aïeux, sauf dans des branches collatérales, de marins, de capitaines ou de navigateurs. Son lieu de résidence et d’études le plaçait à égale distance de Saumur, où l’on formait des cavaliers, et de La Flèche d’où sortaient les généraux. Si l’atavisme n’avait pas joué dans son attirance pour la Royale, il n’était pas interdit, alors, de l’imputer à l’influence des lectures de jeunesse, dont celle de Jules Verne, d’Hermann Melville, de Joseph Conrad. Sauf à parler d’une destinée particulière décidée d’En-haut.
Personne, dans la famille, ne s’opposa sérieusement au choix de Jean pour la marine, choix inattendu mais non dépourvu d’ambition. Son frère aîné, de deux ans plus âgé, répondant au prénom de Joachim, comme leur père, semblait vouloir se destiner aux métiers de la magistrature. La petite Marie, née en 1895, pourrait, grâce à son mariage, faire entrer un jour dans la famille un universitaire ou un ingénieur. Rien ne s’opposait donc à ce que l’un des descendants mâles des du Plessis devienne officier et serve son pays dans une voie qui rappellerait l’action de plusieurs glorieux ancêtres.
Il fut donc convenu, pour satisfaire au désir du garçon, que Jean, dès la fin du cycle secondaire, et le baccalauréat en poche, serait inscrit dans une classe préparatoire au concours de l’École navale. Ainsi, le 5 octobre 1907, âgé de moins de seize ans, l’adolescent entrait en classe de « Flotte » au Collège Vaugirard, situé à Paris, dans la rue du même nom. Cet établissement, fondé par les Jésuites, était installé sur un vaste domaine où s’élevaient deux élégants bâtiments de style XVIIe siècle, seuls vestiges des constructions de jadis où étaient formés les futurs prêtres. Une ancienne chapelle, dans laquelle se donnaient encore des offices, avait toutefois été conservée et rappelait la spiritualité originelle des lieux. D’anciens dortoirs avaient été transformés en salles de cours et une aile continuait à être utilisé pour l’hébergement des pensionnaires.
C’est là que Jean allait vivre puisque, en tant que provincial, il serait tout naturellement interne, situation nouvelle pour lui qui n’avait jamais quitté sa famille. L’établissement ayant du mal à recruter, l’effectif de la « flotte » de Vaugirard se limitait à sept élèves.
Quand, par une journée quasi estivale, le jeune homme rejoignit le box qui lui était affectée, son compagnon de chambre était déjà dans la place, allongé sur un des deux lits et plongé dans la lecture d’un petit livre au titre mal lisible.
– Salut à vous, monsieur du Plessis de Grenédan, et bienvenu à bord. Écoute ces phrases : « Ici gît le corps délicat de Lydé, petite colombe, la plus joyeuse de toutes les courtisanes, qui plus que toute autre aima les orgies, les danses molles et les tuniques d’hyacinthes. Plus que toute autre elle aima les glottismes et l’amour qui brise les membres… » Je suis sûr que tu n’as jamais entendu parler de Lydé, la belle courtisane, que tu n’as jamais lu Les Chansons de Bilitis, le chef d’œuvre de Pierre Louÿs, le plus génial de nos auteurs actuels. Je te le passerai, mais ne te fais pas prendre : je ne suis pas certain que nos surveillants apprécient les orgies de Lydé, ni ses « glottismes », c’est-à-dire les spasmes de l’extase. Je m’appelle Adrien Moretti et je viens de La Seyne, près de Toulon. Et toi, d’où es-tu ? J’ai lu ton nom sur l’armoire, un joli nom d’ailleurs, mais on ne dit pas d’où tu viens.
Jean eut du mal à cacher la surprise que lui procurait un tel accueil, bien loin de tout ce qu’il avait imaginé. Il découvrait en même temps, avec autant de stupéfaction que de honte, un auteur dont il ignorait l’existence, des villes françaises qu’il avait du mal à situer et un jeune homme apparemment bien plus âgé que lui, joyeux, familier, à la voix chantante et aux manières directes. Il n’eut pas le temps de répondre, se contentant de sourire de façon un peu niaise.
Moretti reprit son discours d’accueil.
– Je suis arrivé hier et j’ai eu le temps de reconnaître les lieux. Un peu étroit, notre château, et manquant de décoration, mais suffisant pour ce qu’on est appelé à y faire. J’ai pris le lit du côté de la fenêtre, mais on peut changer si tu veux. Je ne suis pas compliqué. Et je sais que, dans la vie d’interne, si on veut bien s’entendre avec tout le monde, il faut faire des concessions. J’ai déjà trois ans d’expérience de pensionnaire.
Adrien avait quitté son lit et, bien qu’à contrejour, affichait un physique d’adulte, d’une taille au-dessus de la moyenne, très mince, avec une abondante chevelure en désordre, un visage anguleux laissant découvrir une barbe naissante et une moustache bien dessinée. Il paraissait déjà tout connaître de la vie et montrait une assurance qui n’en finissait pas d’étonner le petit Breton qui n’osa pas parler des Ponts-de-Cé, du collège de Saint-Maurille, de Jules Verne et de Fenimore Cooper. Jean avait conscience d’être en train de changer d’univers.
– Je sais, on n’est pas là pour s’amuser ni pour lire de la poésie, poursuivi le nouveau camarade. Mais qu’on ne compte pas sur moi pour renoncer à Pierre Louÿs au nom des sacro-saintes mathématiques. Les futurs officiers de notre belle Marine nationale ont le droit d’être ouverts aux choses de l’art. Allez, déballe tes affaires, ton armoire est celle de droite. Après, je te ferai faire le tour du propriétaire.
Adrien se révéla très vite pour Jean un idéal compagnon d’études. Opposé à lui dans presque tous les domaines, il lui apportait tout ce qui lui faisait défaut : l’impertinence, la jovialité, la faconde méridionale, l’esprit de contradiction, une grande liberté dans les manières. Ces marques d’indépendance et de légèreté, en principe peu compatibles avec le statut d’un élève se destinant à devenir militaire, lui étaient unanimement pardonnées car elles étaient compensées par une intelligence supérieure et une vivacité intellectuelle qui lui faisaient comprendre toutes les questions avant même qu’elles aient été posées. Jean était un préparationnaire solide, appliqué, travail-leur, bien que très gai, indépendant et inventif. Adrien, lui, avec la désinvolture d’un dilettante, était le prototype du surdoué.
Le contraste entre les personnalités, s’accompagnait de grandes différences physiques. Jean du Plessis, beaucoup moins grand que son camarade, offrait des traits plus fins, plus juvéniles, un visage plein, le front haut, le cheveu bien rangé et tirant sur le blond, le menton fendu d’une discrète fossette. Mais l’opposition était surtout sociologique. La famille de Jean était enracinée dans le terroir national, appartenait à une noblesse provinciale respectée, comptait dans ses rangs d’illustres personnages, alors qu’Adrien était fils d’ouvrier, de parents immigrés, venus d’Italie pour échapper à la misère. Le premier pouvait revendiquer un héritage celte, le second était imprégné de latinité. Enfin le jeune Varois affichait une grande liberté d’esprit, une indifférence bruyante à l’égard de la religion, quand le petit Breton, animé d’une foi sincère, manifestait dans ses paroles et ses actes une piété fervente et une grande rectitude morale.
Les sujets de désaccords ne manquaient pas entre les deux camarades, chacun essayant de convertir l’autre à sa position, mais ils étaient insuffisants à entamer une amitié née du premier jour, et à éclipser les points de rapprochement : l’attachement à la culture, à l’art et à la musique (Adrien fanatique d’opéra, Jean passionné de piano), la curiosité pour les innovations apportées par le siècle naissant, et, par-dessus tout, le désir de servir et l’amour de la mer et du commandement. Ils seraient marins l’un et l’autre, officiers supérieurs, et racontaient avec lyrisme le type de campagnes lointaines qui leur permettraient d’échapper à la grisaille des garnisons et de conquérir leurs futures étoiles. Le hasard des affectations leur offrirait peut-être le bonheur de se retrouver un jour, ou de se croiser, sur un même navire ou dans une colonie d’outre-mer et de comparer, sans une ombre de jalousie, leurs itinéraires respectifs et le rythme de leurs avancements.
Au bout d’une année de travail acharné, l’élève du Plessis de Grenédan, fut admis à passer en deuxième année de classe préparatoire, de même que l’élève Adrien Moretti, classé tout naturellement premier de la maigre promotion. Ils se retrouveraient à la rentrée prochaine, mais non à Vaugirard, puisque la classe de « flotte », en raison du faible nombre d’inscrits, était supprimée, mais dans un autre lycée privé de la ville, placé sous la direction des prêtres oratoriens, l’École Massillon, quai des Célestins, en bordure de la Seine. À Massillon les élèves trouveraient l’hébergement et l’instruction religieuse, mais l’établissement étant dépourvu de structures pédagogiques, ils seraient conduits à suivre les cours au lycée Saint-Louis, au cœur du Quartier-Latin.
Cette deuxième année, celle de la préparation au concours, fut vécue de façon plus pénible par Jean. La présence d’un Adrien toujours blagueur et confiant à ses côtés, – car les deux garçons avaient décidé de ne pas se séparer – lui procurait une forme d’assurance, le sentiment que rien ne pourrait s’opposer à la réussite, mais elle était insuffisante à éviter le fléchissement de motivation et les moments de découragement.
C’est au cours de cette période que Jean commença à tenir des carnets personnels, sorte de journal intime dans lequel il notait le détail de sa vie, de ses rencontres, de ses lectures, de ses difficultés et de ses satisfactions, de ses joies et de ses déceptions. Sur la couverture cartonnée du premier de ces carnets, il avait collé une étiquette rectangulaire aux coins coupées et aux bordures soulignées d’un double trait bleu. Il écrirait là le titre choisi pour ce recueil de réflexions intimes, un titre légèrement prétentieux et emprunté au cours de latin : « Ad astra per aspera ». Littéralement « Jusqu’aux étoiles par des chemins ardus ». Le professeur avait expliqué que l’adage peut se formuler dans l’ordre inverse : Per aspera ad astra, et qu’il exprime dans les deux cas l’idée que la gloire ne s’acquiert qu’au prix de grands efforts. Jean du Plessis qui, bien que dépourvu de dons particuliers, se sentait promis à un avenir élevé, devinait que sa route vers les sommets serait semée d’embûches. Cette perspective, loin de le décourager avait valeur de stimulant.
Dans une des premières pages de son journal, au mois d’octobre, apparaissent ces confidences : « L’horaire est tellement chargé et la semaine est si dure, qu’il faut se reposer à fond le dimanche, si on veut aller au bout… […] Hier au soir, même pendant la veillée, j’étais tellement fatigué que j’ai cessé de faire des mathématiques. Je piétinais sur place … Je travaille à faire frémir. » Cet accablement lui était rendu encore plus douloureux par l’apparente facilité de son ami. Adrien ne donnait jamais l’impression d’être submergé par le travail ou obligé de fournir des efforts. Les bonnes notes lui arrivaient comme par évidence, laissant son ami à ses doutes et à ses interrogations, ou le conduisant à redoubler d’énergie pour tenter de rivaliser avec ce condisciple plus doué que lui. Mais plutôt que de la rivalité, cette différence d’approche face aux études était porteuse d’émulation et ferment d’amitié : le petit Breton n’hésitait pas à demander conseil et aide au jeune Provençal qui ne marchandait jamais son soutien, corrigeant en partie, par le biais de sa supériorité scolaire, quelque chose du déficit lié au statut social.
Pour échapper aux contraintes scolaires, les deux « flottards » n’hésitaient pas à s’accorder des sorties le dimanche, Jean allant assister à l’office dans diverses églises parisiennes, Adrien flânant à la recherche d’une conquête féminine, tous deux se retrouvant pour un concert ou un récital, ou arpentant la ville à la découverte de curiosités artistiques ou littéraires. Il y avait surtout, pour Jean, le réconfort de la musique qu’il préférait aux séances de gymnastique : « Le piano n’a pas seulement un charme par lui-même, écrit-il le 6 janvier, il est un souvenir pour moi. Souvenirs de la famille et bien d’autres du même genre. Quel monde merveilleux surgit à votre pensée en entendant Beethoven, Chopin, Mozart, Schumann !… »
Malgré des moments de défaillance, Jean ne perdait jamais de vue la noblesse de sa mission et, pour y réussir, se plaçait sous la protection divine, comme il le note dans son carnet à la date du 12 février 1909 : « Mon travail ne va pas mal, Dieu merci, mais depuis deux ou trois jours, j’ai un petit train de paresse. Sursum corda ! de l’entrain et du courage, n’est-ce pas là une qualité propre au marin. » Et, après cet aveu de faiblesse, le retour à la confiance : « Si j’écris ce soir c’est parce que j’ai pris la résolution et que c’est une chose solennelle de prendre un engagement. Ô mon Dieu, donnez-moi […] de ne jamais reculer devant ma besogne. Vous m’avez mis sur terre pour gagner le ciel. Faites que je ne perde pas une occasion de m’approcher de ce but suprême. » « Gagner le ciel » et « s’élever jusqu’aux étoiles » n’était qu’une seule et même chose : l’expression d’un fort désir de réussite.
Cette invocation et cette promesse furent suivis d’effet : Jean du Plessis fut admis à la quarante-et-unième place sur cinquante-neuf à l’École navale. Son ami Adrien Moretti, était également reçu, mais à la cinquième place, résultat flatteur mais qui fut senti par lui, habitué à finir premier, comme une humiliation. L’examen médical les déclara aptes l’un et l’autre, même Jean, qui redoutait d’être écarté à cause d’un léger astigmatisme. La dernière étape franchie, celui-ci pouvait confier à son journal : « Je suis reçu. Ô mon Dieu, merci ! […] Officier de marine, quelle joie !… Me voilà devenu esclave, mais esclave de mon pays… ».
Avant de rejoindre l’École pour une rentrée fixée au 30 septembre, les deux garçons convinrent de se retrouver dans la famille d’Adrien, à La Seyne-sur-mer, pour s’accorder quelques jours de vacances au bord de la Méditerranée. Jean, par la suite, irait accomplir, à pied depuis La Bernerie, un pèlerinage jusqu’à Lourdes, puis réaliserait un séjour en Angleterre pour améliorer son anglais et ferait enfin une courte retraite à la Trappe de Bellefontaine pas très loin de chez lui. Il savait que pour ses succès futurs l’aide du Ciel lui serait indispensable.
Chapitre 2
Face à la mer, dans l’anse protégée de Tamaris, ancienne zone marécageuse dépendant de la commune de La Seyne et qu’un ancien capitaine de marine marchande ayant fait fortune en Orient était en train d’aménager pour en faire une station de villégiature, Adrien, pour la première fois accepta, avec plus de gravité que de coutume, et à la demande de son ami Jean, de revenir sur l’histoire de ses parents.
– Tout commence avec mon grand-père, que je n’ai pas connu, Carmelo Moretti, originaire d’un petit village du Piémont, Marazzano, pas très loin de Coni, ville qu’on appelle Cuneo en France. Ce n’est pas la haute montagne, mais ce n’est pas non plus la plaine ; la vie y est rude, même aujourd’hui, les hivers rigoureux, la terre ingrate et les ressources rares. Carmelo, marié à Giuseppina, ma grand-mère, qu’on a toujours nommée Nina, cultive là un maigre morceau de terre et se fait bûcheron l’été. Ils ont six enfants dont quatre garçons, et ni la terre ni les arbres ne réussissent à nourrir la grande famille. L’aîné, Roberto, un gaillard sérieux et travailleur, approche de ses dix-neuf ans quand il comprend qu’il n’y a guère d’avenir pour lui à Marazzano. Dans le village, beaucoup de jeunes partaient, certains pour la ville, Turin essentiellement, d’autres pour des pays lointains comme l’Amérique, qui faisait rêver, la plupart se contentaient de franchir la frontière, située dans les montagnes, à quelques dizaines de kilomètres à peine, pour tenter leur chance en France.
L’objectif était d’atteindre la ville côtière de La Seyne (la désignation « sur Mer » sera ajoutée plus tard) où le climat était agréable, les gens accueillants et les emplois nombreux. C’est ainsi que le fils aîné de Carmelo Moretti, Roberto, celui qui deviendra mon père, après un voyage éprouvant, arrive à La Seyne en septembre de l’année 1881, (mais je ne suis pas tout à fait sûr de la date), et est immédiatement embauché aux chantiers navals où la main d’œuvre italienne était très appréciée. L’entreprise proposait des salaires attractifs, grâce auxquels Roberto pouvait envoyer régulièrement de l’argent à la famille restée au village, et elle logeait son personnel célibataire dans des immeubles sans âme que l’on voit toujours à proximité du port. Après deux ans de labeur, il lui fallut retourner en Italie pour effectuer son service militaire.
Adrien fit une pause dans son récit pour expliquer à son ami le projet un peu fou de celui qu’on appelait Michel Pacha qui venait de faire construire le long de la corniche récemment ouverte une succession de maisons à l’architecture remarquable, un peu orientales, un peu chalets suisses, un peu villas italiennes, et qui s’était installé dans un « château » baroque et exubérant qui devait porter témoignage de sa réussite. Jean retrouvait avec amusement dans cet étalage désordonné une marque de la tendance aux excès et à l’ostentation prêtée aux méridionaux. Il se garda bien d’en rien dire à son ami. L’arrêt suivant se fit devant un vaste bâtiment de plusieurs étages et de style néo-classique où se lisait l’inscription « Grand Hôtel de Tamaris », lieu qu’Adrien considéra avec admiration : « Dans cet hôtel vient souvent séjourner Pierre Louÿs, l’auteur des Chansons de Bilitis, ce livre remarquable que je t’ai fait lire où apparaît la belle Lydé. Peut-être y est-il en ce moment ; je n’ai jamais osé franchir la porte. » Puis il reprit le fil de son histoire.
– Sans l’avoir demandé, Roberto fut incorporé dans la marine italienne et fut affecté, pour la plus grande partie de son temps militaire, sur divers bateaux stationnés dans le port de Savone. Depuis là, la distance n’était pas très importante pour se rendre à son village natal où vivaient toujours ses parents, ses deux sœurs et l’un de ses frères. Ainsi, pour chacune de ses permissions, le matelot Moretti retournait à Marazzano où il retrouvait sa famille et ses amis d’enfance dans un environnement où il avait grandi et dont il gardait la nostalgie. Il ne reconnut pas immédiatement la petite Francesca Beltramo, qu’il avait laissé fillette et qui était devenue une jeune femme au regard clair et à la silhouette élégante, précédée d’une réputation de sagesse et d’impertinence à la fois. Le permissionnaire ne résista pas longtemps aux charmes de la belle Francesca qui ne se montra pas insensible à la séduction de ce fringant marin qui aimait à parader en uniforme et que chacun appelait « il Francese ».
À la fin de son service militaire, Roberto regagna La Seyne où il retrouva son emploi aux Chantiers avant, quelques mois plus tard, de revenir au village pour faire sa demande. Moins d’un an plus tard, le mariage était célébrée en l’église Santa-Teresa de Marazzano, après quoi les jeunes mariés reprirent la route du Var pour s’installer dans un appartement du centre-ville, rue de Messine, un nom qui rappelait l’Italie. Mon autre grand-mère, la signora Beltramo, versa quelques larmes, mais elle aurait pleuré bien davantage si elle avait su que sa jeune épousée, ne parlant pas un mot de français, avait commencé par vivre douloureusement le début de cet exil. Petit à petit, tout rentra dans l’ordre. C’est à la rue de Messine que sont venus au monde ma grande sœur, Anna, et mon frère, Alberto, puis celui qui te parle, Adriano, tous nos prénoms commencent par un A, une fantaisie de mes parents qui, par cette lettre pensaient que nous aurions envie d’être les premiers. Je suis né le 9 octobre 1890, le jour même où Clément Ader s’est envolé pour la première fois dans son engin volant appelé « avion » et baptisé Éole.