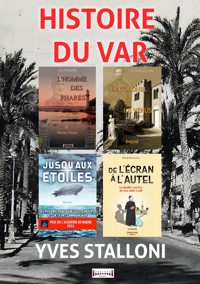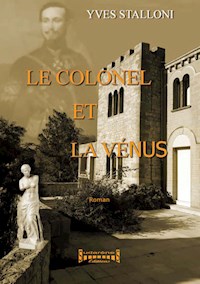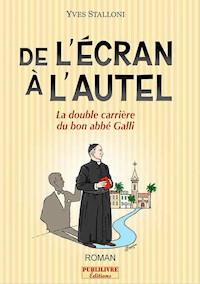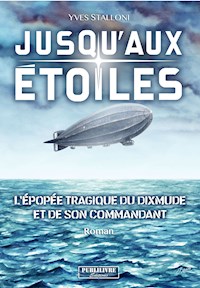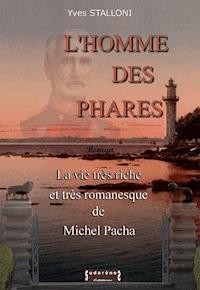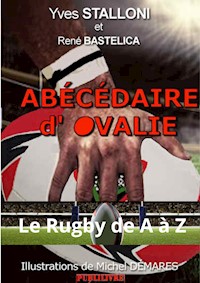
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PLn
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Les amoureux de ce jeu presque bicentenaire que l’on nomme « rugby », qu’ils soient pratiquants, dirigeants ou spectateurs, précédés par des journalistes compétents, ont inventé un pays imaginaire, l’Ovalie. Ce territoire qui tire son nom de la forme singulière d’un ballon, s’étend de l’Europe de l’ouest aux continents américain, africain, austral et même asiatique. Il a ses lois et ses règles, ses rites et ses coutumes, ses héros et ses voyous. Pour le visiter, apprécier ses beautés, connaître son langage, comprendre ses subtilités et pénétrer ses mystères, nous proposons ce petit dictionnaire portatif qui, de A à Z (ou presque), avec humour et néanmoins rigueur, vous permettra de tout savoir sur le rugby.
René Bastelica, Michel Démares , Yves Stalloni, cet « attelage » réunit trois passionnés du ballon ovale, chacun dans son registre : René le cerveau, par son infaillible érudition, Michel, la fantaisie, par la finesse de ses dessins, Yves, la plume, par son habitude de l’écriture après plus de quarante livres publiés. Autre point commun : leur attachement à un club particulier, le R.C.Toulon.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Yves Stalloni est agrégé de lettres modernes, docteur d’État ès lettres, professeur honoraire de Chaire supérieure, membre titulaire de l’Académie du Var. Il a fait l’essentiel de sa carrière à Toulon, au Lycée Dumont d’Urville où il eut en charge les Classes préparatoires et notamment les prépas HEC et la classe de Première supérieure (Khâgne). Avec, occasionnellement, une fonction de chargé de cours à l’Université de Toulon et du Var. Yves Stalloni est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, de nombreuses éditions critiques et d’environ quatre cents articles parus dans des revues diverses, le tout dans le domaine de la critique littéraire, de la littérature générale, de la culture et de la méthodologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yves Stalloni
et
René Bastelica
ABÉCÉDAIRE D’OVALIE
Illustrations de Michel Démares
"Le rugby ouvre la porte aux rêves, s'appuie sur des traditions, ennoblit les souvenirs. C'est un sport qui a su se doubler d'un climat".
Michel Serres
Interview pour la série « Regards sur le sport »
de Benjamin Pichery (2009). Production Insep
Avant-propos
Le rugby est un sport aux règles complexes. Pour son principal concurrent, le football, les lois du jeu sont simples : pousser du pied un ballon (rond, ce qui est le propre d’un ballon) pour le faire entrer dans un cadre limité pendant que l’équipe adversaire s’active à contrarier la manœuvre en même temps qu’elle agit pour obtenir à son crédit le même résultat. Au rugby, c’est bien autre chose. Le ballon, cas unique, commence par ne pas être rond, mais ovale ; les passes entre partenaires se font exclusivement en arrière, les con-tacts sont autorisés mais dans certains cas objets de sanction, le décompte des points se fait de manière bizarre et pour tout dire arbitraire. On se sert surtout de ses mains, mais le pied est très utilisé ; à espaces réguliers, seize gaillards répartis en deux groupes, s’agrègent bizarrement pour construire un abri humain vacillant au milieu duquel est jeté le ballon ovale avec obligation de l’extraire dans de bonnes conditions. Sans parler des « arrêts de volée », « renvois aux 22 », « mêlées à cinq mètres », « passes croisées » et autres « groupés pénétrants », appellations curieuses correspondant à des figures convenues.
Ce fonctionnement complexe et codifié est relativement maîtrisé par le spectateur initié, qui, souvent, a lui-même pratiqué ce jeu sophistiqué. Même si les règles changent et que tout n’est pas toujours très clair dans les décisions de l’homme en noir, les subtilités techniques, les conventions verbales, la gestuelle arbitrale procurent au connaisseur une espèce de jouissance secrète qu’il aime à partager avec d’autres spécialistes. Sur le terrain, le rugby est essentiellement un sport d’équipe ; dans les tribunes ou devant sa télévision il reste un spectacle à partager. Suivre un match de rugby en solitaire est un plaisir qui relève presque de l’onanisme. À plusieurs, on observe, compare, analyse, critique, rougit de honte ou vocifère de joie. Rien de tel pour le profane qui, seul ou en compagnie, a du mal à comprendre les rites de cette messe laïque. Il lui manque les clés et les codes. Le ballet des acteurs sur le pré ne manque ni de grâce ni d’âpreté, mais le sens échappe et la finalité reste obscure. Il attend qu’on lui explique, qu’on le mette au secret, qu’on l’aide à rejoindre la famille, à pénétrer au royaume d’Ovalie. Ce petit livre espère remplir cette fonction en offrant au plus grand nombre, sans trop de pesanteur et à partir de 150 entrées soigneusement choisies, les repères et les éclaircissements qui permettront d’apprécier les finesses d’un jeu où se côtoient voyous et gentlemen, de rugueux combattants et de véloces et élégants finisseurs.
Notre sélection – inévitablement subjective – accorde une place prioritaire aux phases de jeux, aux règles techniques et aux formulations, souvent anglaises, parfois imagées, qui les désignent. Une autre catégorie d’entrées concerne quelques personnalités remarqua-bles, joueurs le plus souvent, dont le nom mérite d’être connu pour qui veut pénétrer dans le monde du quinze. D’autres notices sont plus anecdotiques, plus inattendues, plus marginales bien que toujours en relation avec notre sport. Pour l’ensemble des cent cinquante entrées de cet abécédaire nous avons voulu allier le sourire et la précision, l’humour et la pertinen-ce, la légèreté et la rigueur, n’oubliant jamais que le rugby est un jeu et qu’il doit rester une fête. Dernière remarque : pourquoi 150 ? Parce que ce nombre paraît suffisant pour dire l’essentiel sans risquer de devenir trop long ou trop technique. Et puis surtout parce qu’il contient, multiplié par dix, le chiffre symbolique de 15, le nombre de joueurs qui composent une équipe. Manière pour notre lecteur, ayant enfin accédé, grâce à notre dictionnaire, au rang de connaisseur, de rejouer dix fois le match.
À dame
C’est une autre manière de désigner la plongée dans l’en-but où se marque l’essai. « Aller à dame », c’est obtenir les cinq points qui récompensent la performance. L’expression pourrait être empruntée au jeu de Dames qui exige que l’on « mange » les pions de son adversaire afin d’aboutir à la dernière rangée du damier, signe de victoire. Analogie moins prestigieuse que celle qui évoque les échecs, mais finalement assez parlante.
Il n’est pas interdit d’interpréter la formule de façon sentimentale et médiévale : « aller à dame » serait une façon de gagner les faveurs d’une « belle dame sans merci », comme le faisaient, en tournoi, les chevaliers du Moyen âge. On parle aussi de « terre promise », métaphore tout aussi éloquente mais biblique cette fois.
Ailiers
Ils jouissent, auprès du public, d’une incontestable faveur, car ils sont (au moins théoriquement), légers, aériens, véloces, adeptes de l’évitement, de la feinte de corps, du coup de reins, du crochet intérieur. Ils sont aussi les finisseurs, ceux à qui revient le plaisir, en bout de ligne, après une série de passes et de courses, d’aller déposer le ballon pour concrétiser une action collective. La part noble du jeu, laissant aux soutiers de la mêlée les tâches obscures. L’évolution du rugby a sensible-ment modifié cette image : les ailiers ont pris de l’épais-seur physique (style Jonah Lomu), et ils ne se conten-tent plus d’attendre, en bord de touche, qu’on leur transmette un ballon d’essai. Ils participent au jeu, se déplacent, échangent leurs postes avec les centres, se rapprochent du 10 pour saisir un espace, et … sont appliqués à défendre, car rien ne sert de marquer, si l’adversaire marque plus que vous. Quand, par un temps pluvieux, tout se passe devant, l’ailier peut con-naître les affres de la solitude et de l’ennui.
Voir : Lomu, Jonah
All Blacks
Inutile d’être un fin connaisseur de l’anglais ni un fanatique de rugby pour savoir que l’expression s’applique à l’équipe, de noir vêtue, de la Nouvelle Zélande. La petite histoire prétend que c’est d’une communication téléphonique de mauvaise qualité que naquit la légende des All Blacks. Le rédacteur d’un journal aurait entendu « All Blacks » là où son correspondant aurait dit « all back » (« tous derrière »), enthousiasmé par un style de jeu tourné vers l’attaque, aussi bien de la part des avants que des arrières. Où l’on voit que la notion de désordre dans l’ordre ne date pas d’hier et reste à l’origine d’un rugby flamboyant. Le surnom de l’équipe n’est pas indifférent, évoquant, a-t-on dit, le deuil de ses adversaires. Car il est vrai que, depuis plus d’un siècle que l’équipe existe, elle a gagné plus de 75% de ses matches. Au point que toutes les autres nations considèrent que battre les Blacks relève de l’exploit. L’équipe de France l’a fait quelquefois, mais plus depuis longtemps. L’insolente réussite des All Blacks suscite l’universelle admiration en même temps qu’elle invite à se poser des questions : comment un si petit pays d’à peine quatre millions d’habitants peut-il engendrer autant de licenciés de rugby et produire ces flamboyantes stars que le monde entier rêve d’avoir dans son équipe (à l’image de Tana Umaga venu renforcer le club du RCT, alors en Pro D2, et devenu le plus Toulonnais des Néo-Zed) ? Question de culture et d’éducation, à l’évidence, ces îles lointaines et déser-tiques occupées à l’origine par les Maoris ayant trouvé dans ce jeu exporté par les colons à la fin du XIXe siècle, un ferment d’unité nationale, une raison d’exister et un modèle identitaire. On n’en finirait pas de citer des champions blacks à la carrière éblouissante, de Don Clarke à Dan Carter, de John Kirwan à Graham Mourie, de David Kirk à Jonah Lomu, de Brian Lochore à Richie Mac Caw. Sans compter tous ceux dont le nom n’est pas resté dans les mémoires mais qui ont honoré leurs couleurs et su entonner cet incomparable chant de guerre qu’est le fameux Haka. Pour les All Blacks, le rugby n’est pas simplement un sport, mais une institution, un art et une religion. Comment lutter ?
Voir : Haka ; Mac Caw, Richard ; Lomu, Jonah ; Umaga, Tana
Dan Carter
Arrêt buffet
Formule sympathique pour un moment douloureux. On l’emploie à propos d’un plaquage brutal, voire violent qui arrête net dans sa course un joueur lancé. Celui-ci n’a pas même le temps de commander un sandwich ou une bière.
Voir : Bouchon, Tampon.
Arrêt de volée
Pas de mystère à propos de cette expression : l’arrêt de volée consiste, alors qu’on se trouve dans ses 22 mètres, à recevoir entre ses bras un ballon envoyé par l’adversaire tout en signalant à l’arbitre, soit par une interjection (« Marque ! »), soit par un geste du bras en l’air, soit par les deux, l’obligation d’interrompre le jeu pour un renvoi par un autre coup de pied. Chose simple, sauf qu’il s’agit d’un geste technique délicat, que sa valeur défensive est souvent déterminante et qu’un ratage peut avoir des conséquences fâcheuses. L’action se déroulant dans une zone de marque, le réceptionneur (le plus souvent l’arrière ou l’ailier) doit assurer le coup au risque de rendre le ballon à l’adversaire ou de commettre un en-avant pénalisé par une mêlée. La réussite de l’arrêt de volée exige de bien se positionner sous le ballon, de ne pas le perdre des yeux et de placer correctement ses mains en berceau. Travail d’artiste qui s’apprend dans les écoles de rugby.
Voir : Chandelle
Arrière
Le quinzième homme, ce qui a valeur de symbole. Le rempart ultime. Le sauveteur prêt à se sacrifier pour éviter un naufrage. Il est celui sur lesquels arrivent les ballons hauts (les fameuses « chandelles » et « up and under ») qu’il n’a pas le droit de rater, ou celui sur qui déferlent des trois-quarts déchaînés qui, par un « deux contre un » d’école, peuvent le mystifier. Longtemps abandonné à son sort, ce poor lonesome boy, était invité parfois à taper les pénalités, histoire de lui faire partager un peu de la victoire (ou de l’échec). Ces temps ont changé, et le Français Pierre Villepreux, référence à ce poste, y est pour beaucoup : l’arrière, désormais, vient se glisser dans la ligne de trois-quarts pour créer un décalage, propose des relances audacieuses depuis son camp, prend des initiatives et vient semer le désordre dans la défense adverse. Ses anciennes prérogatives ne lui ayant pas pour autant été retirées. Quelques arrières remarquables : le Néo-zélandais Don Clarke, le Gallois JPR Williams, les Français Claude Lacaze et surtout l’imprévisible et talentueux Serge Blanco. Son essai de cent mètres contre les Australiens en 1990 lui a apporté une universelle célébrité.
Voir : Blanco, Serge ; Chandelle ; Williams, JPR
Ascenseur
Quand une infraction se généralise, légalisez-la. C’est le cas pour l’« ascenseur », acte qui consiste, à l’occasion d’une touche, à hisser son partenaire afin que celui-ci puisse capter le ballon lancé par son talonneur. Longtemps ce geste a été interdit et sanctionné d’une pénalité. Faute de pouvoir clairement apprécier l’éventuel jeu déloyal, les instances internationales ont décidé d’autoriser l’ascenseur, à condition que le « lifteur » (celui qui soulève le sauteur, à ne pas con-fondre avec le « liftier » de votre hôtel) respecte certaines règles. Cette modification, apparemment minime, du règlement s’avère d’une extrême importan-ce puisque l’équipe qui sort le ballon est presque tou-jours amenée à le perdre sur la touche qui suit. Car les prises en touche sur lancers adverses dépassent rare-ment une ou deux sur dix.
La touche, grâce à l’ascenseur, devient un essentiel « lancement de jeu ».
Attelage
Nom imagé donné aux deux deuxième-lignes, les numéros 4 et 5, qui, soudés par un joug imaginaire, soutiennent, grâce à leur poussée, les piliers, et impulsent l’avancée (gagnante) de la mêlée. Les Britanniques les appellent locks (verrous) car ils bloquent la première ligne composée de trois joueurs. On leur demande d’être athlétiques, dévoués, rompus à ce travail ingrat mais essentiel. Ils ont aussi à batailler sur les zones de combat, lors d’un regroupement ou d’un ruck. Ils sont les premiers au plaquage, souvent le nez dans la boue. Mais en même temps, il est aussi attendu d’eux qu’ils se déploient, se détendent et, du haut de leur double mètre, qu’ils saisissent la balle en touche. Leur rôle devient alors plus visible, plus gratifiant, bien qu’ils ne cherchent pas à jouer les vedettes. Ils sont deux jumeaux, puissants et généreux, au service du groupe.
Voir : Ruck
Avantage
Les règles sont subtiles au rugby et les arrêts de jeu fréquents. Pour favoriser la continuité du spectacle et donner une prime à l’équipe victime d’une infraction, l’arbitre signale la faute adverse par un geste horizontal du bras, mais a pour devoir de laisser l’action se dérouler pour lui permettre de déboucher, éventuel-lement, sur un essai ou sur une autre issue favorable. On dit alors qu’il « laisse l’avantage ». Bien entendu, si cet avantage se révèle improductif, il revient à la faute initiale, en imposant, suivant le cas, une mêlée ou une pénalité. Cette règle pleine de bon sens et d’équité souffre de quelques faiblesses : où commence la situation d’avantage ? quelle doit en être la durée ? Ces questions sont laissées à l’appréciation du directeur de jeu, ce qui est sans doute une bonne chose, mais elles entraînent quelques flottements, incertitudes voire injustices. Faut-il aussi légiférer dans ce domaine ?
Avantage (ligne d’)
Rien de commun avec ce qui précède. L’affrontement (pacifique) de deux équipes ressemble à celui (plus meurtrier) de deux phalanges armées en lutte pour la conquête d’un terrain. Une ligne imaginaire délimite le point d’équilibre, ligne que chacun souhaite franchir pour marquer sa domination et se diriger vers la victoire. D’un côté les défenseurs qui veillent à protéger leur territoire, de l’autre les attaquants qui aspirent à ouvrir une brèche. Après quoi les choses peuvent s’inverser. Deux manières de franchir la ligne d’avantage : la percussion, qui fait appel à la puissance, l’évitement, qui privilégie la vitesse et le mouvement. Le rugby moderne, au moins dans l’hémisphère nord, semble préférer la première solution ; les All Blacks, aussi physiques que véloces, savent user intelligem-ment de l’un et de l’autre. Résultat : la ligne d’avantage est souvent gagnée. Et le match aussi.
Bala
Appelons-le ainsi, c’est une preuve d’amour et de respect. Il s’agit de l’immense Pierre Albaladejo, Dacquois fidèle à son club de cœur, avec lequel il joua six finales de championnat, toutes perdues. N’allons pas croire pour autant que Pierrot fut un looser, car il compte quatre victoires dans le Tournoi des Cinq Nations et pouvait faire basculer un match par un drop venu de nulle part. Il fut le premier à en « claquer » trois dans une rencontre internationale (contre l’Irlande, à Colombes, le 9 avril 1960). On lui attribue, depuis cette date, le surnom de « monsieur drop », étiquette justifiée par des « coups de pied tombés » décisifs contre les Black ou les Springboks. À son poste de prédilection (demi d’ouverture, sélectionné à trente reprises en équipe de France) il était également très à l’aise pour lancer une attaque ou franchir la ligne d’avantage. En 1971, après avoir fait ses essais à la radio, il entame une nouvelle carrière, celle d’assistant du journaliste Roger Couderc pour commenter les rencontres internationales à la télévision. La fonction de « consultant » et le mot lui-même venaient de naître. Le duo officia à 640 reprises et Bala quitta le micro à l’occasion de la finale du championnat de France de 1990. Le 8 septembre 2017, la ville de Dax lui a rendu un légitime hommage en inaugurant une statue à son effigie, en sa présence. Façon de rappeler que ce joueur fin, racé, intelligent et modeste fut un monument.
Voir : Couderc, Roger ; Drop
Ballon
Tout le monde aura remarqué que le ballon de rugby est ovale, ce qui pose pas mal de problèmes à cause de re-bonds capricieux, mais ce qui fait en même temps le charme de ce jeu plein d’imprévus. Et pourtant, en de lointains débuts, les collégiens de la ville de Rugby, avant la révolution qu’allait apporter le jeune William Webb Ellis, utilisaient un ballon tout à fait rond et s’amusaient à le faire passer au-dessus de la barre transversale par des coups de pieds placés ou des drops. On se rendit vite compte que la forme ovoïde se prêtait mieux à l’exercice et surtout qu’elle épousait parfaite-ment les contours de la vessie de porc qui servait à la fabrication des ballons. Cette observation a sans doute inspiré le cordonnier attaché au prestigieux collège, un certain William Gilbert, qui, en 1823, eut l’idée de glisser dans une enveloppe de cuir cousu ces vessies ovales de dimension variable qu’on gonflait à la bouche à partir d’un petit tuyau.