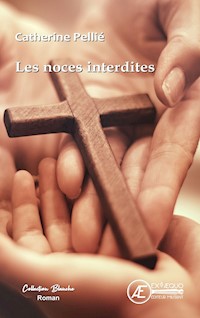Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Marie arrive au terme de sa vie et se confie sur son parcours : enfant adoptée, adulte à la fois heureuse et meurtrie, neurologue, retraitée amoureuse...
Au terme de sa vie, Marie se confie à Camille dans le service de médecine palliative où elle vit ses derniers jours. Elle évoque tout d’abord son enfance marquée par la jalousie envers sa sœur quand elle apprend qu’elle a été adoptée contrairement à cette dernière. Par la suite, sa vie de femme adulte est jalonnée de moments de bonheur, mais aussi de doute, de douleur et d’incrédulité quand elle rencontre la trahison. Par ailleurs, sa vie professionnelle de médecin neurologue la conduit aux plus hautes responsabilités. Elle aime profondément ce métier mais y retrouve pourtant la jalousie et la bêtise qu’elle supporte très mal.
À la retraite enfin, elle découvre une autre vie pour laquelle elle se passionne. Tandis qu’elle se reproche son refus de la vieillesse, un étrange phénomène la fait rajeunir. Quelle est cette affection qui provoque une tardive passion amoureuse ? L’aurait-elle provoquée par son désir de rester jeune ? Elle qui a toujours eu l’Évangile pour modèle et le souci de servir ses semblables, n’est-elle pas en train de perdre son âme et de payer le prix fort ?
Ce roman aborde avec humanité les thèmes de l’adoption, de la maladie, de l’euthanasie, de la fidélité, de la mort, mais aussi de l’amour et de la séduction !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Catherine Pellié
Finitude
Ou Marie, le temps s’en va
Roman
ISBN : 979-10-388-0049-6
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : novembre 2020
© couverture Ex Æquo
© 2020 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite
À ma sœur Christiane,
Préface
La narratrice livre sa vie tourmentée à une amie qui découvre au fil des pages une jeune fille solitaire, une amoureuse transie au désir d’enfant ambigu, brillante neurologue puis retraitée active… Segments haletants qui traversent les fugues d’un mari indolent et l’ingérence d’une maladie étrange.
Ce roman aux nombreux rebondissements aborde avec humanité les thèmes de l’adoption, de la maladie, de l’euthanasie, de la fidélité, de la mort, mais aussi des fulgurances de l’amour et de la séduction. Aux confins d’un féminisme salutaire, le lecteur appréciera ce vent de liberté qui invite l’héroïne à recouvrer les plaisirs plus ou moins interdits d’une jeunesse fantasmée.
1
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Voilà pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car c’est à l’heure que vous ignorez que le Fils de l’homme va venir.
Mt 24, 42. 44
Marie sait qu’elle va mourir ; elle ne sait ni le jour ni l’heure, mais elle sent que le moment est proche. Cette nuit, demain, plus tard ? Pourtant elle se sent bien dans ce lit d’hôpital où elle se trouve actuellement. Son regard balaye les murs qui l’entourent : ils sont peints en blanc teinté légèrement de vert, ce qui en atténue la dureté. Elle regarde maintenant la fenêtre d’où l’on voit quelques branches d’arbre bouger sous l’effet du vent. Il va encore pleuvoir, aurons-nous une tempête ? pense-t-elle. Marie aime bien la tempête, lorsque les éléments se déchaînent ainsi sur les hommes, lorsque la pluie lui fouette le visage. Ce sera ma dernière tempête. Elle n’est même pas triste, elle en en a pris son parti : Il faut bien une dernière fois. Deux femmes, dont l’une doit être nouvelle, car elle ne l’a jamais vue, entrent dans sa chambre. Elles discutent entre elles, mais Marie n’entend pas distinctement ce qu’elles disent. L’une d’elles s’approche du lit :
— Comment allez-vous, Madame Courbet ?
Marie lui répond d’un sourire et d’un clignement de paupières sans parler. La nouvelle lui demande alors :
— Il y a une erreur sur votre pancarte numérique, vous n’avez sûrement pas soixante-neuf ans, n’est-ce pas ?
Marie ne répond pas, elle a l’habitude de ce genre de remarque. Cette femme, ne doit pas être au courant de son diagnostic : comment comprendre en effet qu’à soixante-neuf ans, elle en paraisse facilement trente de moins, et qu’elle soit enceinte de surcroît ? Elle tourne la tête sur le côté et attend patiemment que l’infirmière ait fini de prendre sa tension puis elle lui signifie d’un sourire las qu’elle aimerait se reposer.
— Je reviendrai tout à l’heure, Madame Courbet, nous vous laissons tranquille maintenant.
Les deux femmes quittent la chambre tandis que l’infirmière chuchote quelque chose à l’oreille de l’aide-soignante.
Une douce torpeur envahit Marie. Elle pense à sa fille qui est venue la voir hier, mais qui a dû repartir pour Paris.
— Ulysse a perdu une dent, il est tout fier. Il t’a fait un dessin, Maman.
Marie a regardé l’œuvre d’art d’un air un peu absent :
— Il est très beau, tu le féliciteras de ma part.
Elle se demande si son fils reviendra avant qu’elle ne meure.
Et puis, elle pense à lui. Elle voudrait bien ne pas y penser, mais elle ne peut s’en empêcher. Son cœur se serre et deux grosses larmes coulent le long de ses joues, sans qu’elle se donne la peine de les essuyer. Elle respire profondément et la sensation de chaleur l’envahit de nouveau. Elle se met à fredonner tout doucement :
Je ne sais ni le jour ni l’heure
Mais je sais que c’est Toi, Seigneur
— Marie, tu chantes ? dit Camille qu’elle n’a pas entendue entrer dans la chambre, c’est bon de t’entendre chanter et tu sembles bien ce matin, cela me réjouit.
— Bonjour, Camille, c’est toujours un grand plaisir de te voir, mais je ne chante plus comme avant, malheureusement.
— Je venais parler un peu avec toi, tu veux bien ?
— Oui, volontiers, dit Marie en souriant.
— Alors, j’aimerais que nous reprenions ton histoire, celle que tu m’as évoquée dans les grandes lignes et qui t’a amenée dans ce lit d’hôpital, mais aussi de toi, de ce qui est important pour toi, de ce que « tu mets dans ton moteur » comme le disait je ne sais plus quel slogan publicitaire. Tu t’arrêteras dès que tu te sens trop fatiguée, dit-elle en voyant le geste de Marie qui semble vouloir l’interrompre. Moi, j’ai tout mon temps et c’est à toi que je voudrais le consacrer. Es-tu d’accord ?
— Depuis deux jours, je ne cesse de la parcourir cette histoire. Hier une bénévole de JALMALV{1} est venue me voir. Elle était très gentille et j’ai passé un bon moment avec elle, mais je n’ai pas pu me livrer comme je l’aurais voulu. Mais à toi, oui, je crois que j’en suis capable et que j’en ressens même le besoin. À toi qui sais si bien écouter.
Marie a connu Camille Lacroix comme externe dans son service il y a une vingtaine d’années : elle s’était dit à l’époque qu’elle ferait sans doute un bon médecin et l’avenir ne l’a pas démentie. Après avoir exercé la médecine générale dans un village de Haute-Saône pendant quinze ans, Camille s’est tournée vers la médecine palliative, une discipline qui convient parfaitement à son tempérament — à la fois empathique et énergique — et dans laquelle elle a pris rapidement la plus haute responsabilité. À plusieurs reprises, lorsque Camille a sollicité les conseils de Marie, celle-ci les lui a prodigués d’autant plus volontiers qu’elle a toujours ressenti de l’affection et de l’admiration pour ce jeune médecin.
2
Tu sais, Camille, j’ai toujours paru plus jeune que mon âge. C’est drôle de commencer ainsi, mais tu vas voir que cette particularité m’a suivie toute ma vie d’une certaine façon. Je ne me souviens pas de ma naissance, évidemment, mais ma mère m’a raconté — ou plus exactement, on lui a rapporté — que j’étais prématurée de dix semaines, que j’avais mis plusieurs jours à récupérer mon poids de naissance, mais que l’attention de tout le personnel de la maternité m’avait permis de surmonter ce handicap. Celle qui m’a mise au monde avait accouché sous X et demandé que l’on me prénommât Marie pour me mettre sous la protection de la Sainte Vierge. J’ai pu être adoptée peu après ma naissance par un couple qui, désespéré après dix ans de traitements infructueux, avait renoncé à donner naissance à un enfant. Mes parents adoptifs m’ont donné comme deuxième prénom Madeleine, qui était celui de ma grand-mère maternelle, mais aussi en souvenir des larmes qu’ils avaient versées.
Il semble que j’aie grandi lentement et, que, jusqu’à l’âge de deux ans, j’aie continué d’inquiéter le corps médical qui se demandait si je n’étais pas destinée à mourir prématurément.
Mais, comme tu vois, j’ai survécu.
Très peu de temps après mon adoption, ma mère s’est trouvée enceinte. Ce phénomène, n’est pas rare, tu le sais, l’arrivée d’un enfant dans la famille provoquant une sorte de déblocagechez des femmes apparemment stériles. Il paraît que je n’ai pas très bien accueilli cette petite sœur. Il fallait s’y attendre, Isabelle était d’un an ma cadette, et elle avait l’audace de me voler la vedette : j’en ressentis une jalousie féroce.
À l’école, j’étais si chétive que les enfants de ma classe pensaient que j’avais au moins un an d’avance. Et puis, vers l’âge de sept ans, je me suis finalement décidée à pousser et à me hausser jusqu’à la taille des autres élèves. C’est à cette époque que mes parents commencèrent à se demander s’ils devaient me dire la vérité sur ma naissance. Je suçais encore mon pouce et ils se disaient qu’il fallait peut-être attendre encore un peu : à chaque jour suffit sa peine ! Après bien des tentatives, ils réussirent enfin à me persuader d’abandonner cette assuétude. Alors, non sans avoir pris l’avis d’un psychologue, le jour de mes huit ans, mes parents se décidèrent à m’annoncer qu’ils m’avaient adoptée lorsque j’étais toute petite. Sur le moment, je n’ai pas réagi, tout simplement parce que je n’ai pas compris, jusqu’au jour où je demandai à ma mère si ma petite sœur avait été adoptée elle aussi. Elle prit alors le temps de m’expliquer les circonstances de mon adoption et comment elle s’était trouvée enceinte peu de temps après, alors qu’elle n’y croyait plus. Là, j’ai vraiment compris et j’ai alors demandé qui était ma vraie mère et pourquoi elle ne s’était pas occupée de moi. Maman m’a répondu que ce n’était pas possible de le savoir, car elle m’avait officiellement abandonnée et que c’était grâce à cela qu’elle avait pu m’adopter. Elle a ajouté :
— Sans doute, ne pouvait-elle pas s’occuper de toi, peut-être parce qu’elle était trop jeune ou trop pauvre.
Je n’ai plus jamais posé la question et, contrairement à d’autres enfants adoptés, je n’ai jamais voulu connaître mes parents biologiques. Par la suite, j’ai interrogé quelques personnes qui étaient dans mon cas et aucune d’entre elles ne s’en était préoccupée. Il me semble que l’on monte un peu trop en épingle ceux qui réclament la levée de l’anonymat et je suis persuadée que c’est un biais : on ne parle pas de ceux qui savent bien, comme moi, qui sont leurs vrais parents, c’est-à-dire ceux qui les ont désirés et aimés, ceux qui se sont occupés d’eux.
À l’époque, le sens de cette révélation me sembla limpide : c’était injuste, mais Isabelle était davantage leur fille que moi et je me suis mise à la détester. Cependant, je gardai tout cela dans mon cœur et n’en laissai rien paraître.
Comme je ne posais plus de questions, mes parents pensèrent que j’avais digéré la nouvelle. Je dois dire qu’ils multipliaient les marques de tendresse envers moi et que je le leur rendais bien : j’adorais mes parents, tu sais, mais j’aurais voulu les avoir pour moi seule. Ils étaient pourtant attentifs à ne jamais faire de différence entre ma sœur et moi, mais moi, bien souvent, je refusais de jouer avec Isabelle alors qu’elle était d’un caractère particulièrement conciliant. Je sais maintenant que maman se désolait de mon attitude et s’inquiétait de mon caractère renfermé. Il est vrai que je n’amenais jamais de petites copines à la maison, mais que je me lançais, lorsque je me croyais seule, dans de grandes conversations avec ma peluche préférée, un horrible chat bleu, borgne et tout râpé, habillé d’une salopette ridicule et dont l’œil unique pendait lamentablement. Ce doudou disgracieux était l’objet de toute mon affection et je le trouvais le plus beau de la terre : je n’ai jamais pu le jeter, tu sais !
Ce fut l’époque où je me suis prise de passion pour la lecture. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main et la maison regorgeait de trésors dans ce domaine. J’avais repéré tous les placards muraux où mes parents avaient remisé des livres dont certains étaient très anciens. Je me suis d’abord plongée dans la Comtesse de Ségur dont je connus bientôt l’œuvre par cœur puis dans tous les livres d’aventure que je pus trouver. Amusés par cette passion dévorante, mes parents m’offraient des livres de la nouvelle « Bibliothèque verte » qui semblaient me plaire davantage que la « Bibliothèque rose » que je trouvais un peu trop mièvre. Je les ai toujours, sais-tu ? Je les avais gardés pour mes petits-enfants qui d’ailleurs ne les lisent même pas ! J’avais bien aimé les aventures du « club des cinq », mais j’étais surtout passionnée par tout ce qui concernait le Grand Nord avec Jack London et James-Oliver Curwood. Cela dit, je ne dédaignais pas les bandes dessinées et je connaissais toutes les aventures de Tintin et Milou sur le bout des doigts. Ma sœur s’amusait à m’interroger, mais j’étais incollable aussi bien sur L’oreille cassée que sur Les cigares du pharaon.
L’amour de la lecture n’était guère propice à me sortir de ma réserve naturelle et, le dimanche, je pouvais rester des heures dans ma chambre sans qu’on entendît le son de ma voix. Mes parents commençaient à s’inquiéter de plus en plus et envoyaient régulièrement Isabelle me proposer une balade :
— Allez, Marie, il fait si beau, viens donc faire une partie de Canoë sur le lac : nous ramerons à tour de rôle.
Il m’arrivait de céder, mais, à peine rentrée, je me replongeais dans mes livres. Le même scénario se reproduisait chaque dimanche, y compris lorsque mes parents recevaient des amis ayant des enfants du même âge que nous : je restais un moment, pour leur faire plaisir, mais je filais dès que je le pouvais dans ma chambre.
En fait, c’était surtout la compagnie des garçons que je fuyais : je les trouvais stupides et puérils. Mes parents ne comprenaient pas très bien les raisons de cette aversion que j’aurais été bien incapable d’expliquer, mais je sais maintenant — ce que je n’osais dire à l’époque — qu’ils me faisaient peur. Mon père était le seul « mâle » qui avait grâce à mes yeux. La vérité était que je les enviais : ils étaient plus forts, ils n’avaient peur de rien alors que j’avais peur de tout. Toute petite, je me disais que peut-être, je ne resterais pas fille toute ma vie et que ma timidité me passerait quand je deviendrais garçon, mais à la puberté, je dus me résoudre à cette vérité première que je voulais ignorer : j’étais une fille et je le resterais. C’est ainsi que, la mort dans l’âme, je me résignai. Je me souviens qu’un jour, deux adolescents qui me suivaient dans la rue en se moquant de moi — sans doute les avais-je pris de haut — avaient été jusqu’à dire que je ressemblais à Michel Simon. Tu te rappelles la tête de ce comédien remarquable : j’avais bien compris que ce n’était pas un compliment.
Je passe rapidement sur l’épisode, que nous avons toutes vécu au moins une fois, celui du type qui m’a abordée pour me dire que j’étais mignonne et que nous pourrions faire ensemble des choses agréables — je n’ai pas besoin de préciser lesquelles. Tout de même, j’étais pétrifiée et je suis rentrée chez moi en pleurant pour me précipiter dans les bras de ma mère.
— Tu as bien fait de ne pas répondre, m’a-t-elle dit, et elle m’a bercée comme un bébé pour me calmer.
Les jours suivants, comme je me regardais dans un miroir, je me demandais pourquoi l’homme avait dit que j’étais mignonne, car, personnellement, je me trouvais sans intérêt et, en tout cas, bien moins jolie que mes camarades de classe dont j’admirais les beaux cheveux et le rire franc des filles qui se savent belles. J’avais des cheveux châtains assez communs et surtout, ils étaient très fins et difficiles à coiffer, si bien que ma mère me les avait fait couper très court. Je trouvais que mes yeux étaient vilains. Quant à ma bouche, elle était trop petite et me faisait paraître toujours plus jeune que je n’étais. Les deux abrutis avaient raison : j’étais vraiment moche et il n’y avait que ma mère pour me dire que j’étais belle,
— Surtout quand tu souris, ajoutait-elle.
— Mais Isabelle est beaucoup plus belle que moi, rétorquais-je amère.
Peu de temps après mon entrée en quatrième, je tombai malade. Après m’avoir gardée à la maison, pensant à une grippe sans gravité, ma mère s’est décidée à appeler le médecin de famille qui ne put poser un diagnostic immédiatement et fit effectuer des examens complémentaires : j’avais la fièvre typhoïde, et personne ne comprit comment j’avais pu la contracter. Je ne sais pourquoi j’en ressentis une certaine fierté : enfin, il m’arrivait quelque chose de peu banal, même si c’était très pénible. Je dus être hospitalisée et la fièvre ne tomba qu’au bout d’une semaine qui me parut une éternité tant mon mal de tête me donnait l’impression d’une explosion imminente. Le séjour dura trois semaines malgré tout, car des complications cardiaques étaient survenues entre-temps. J’avais déjà, depuis toute petite, une peur panique de perdre mes parents, mais c’est à cette occasion que je réalisai vraiment dans ma chair que la mort pouvait aussi m’atteindre. Je me rappelle m’en être confiée à ma mère qui se montra rassurante :
— Ne t’inquiète pas, Marie, car, si notre corps est mortel, nous ressusciterons tous un jour, c’est Jésus qui nous l’a promis. J’avais une confiance inaltérable en ma mère et cette explication me parut convenable, au moins momentanément, mais je ne pouvais m’empêcher de penser que la mort était certaine alors que cette résurrection future semblait plus problématique. Ce n’est que plus tard, vers l’âge de dix-sept ans, que la conscience de ma finitude et du temps qui passe inexorablement commença à s’infiltrer en moi. J’eus alors la sensation douloureuse de vieillir et réalisai que la joie que je ressentais à chaque anniversaire pourrait bien se ternir avec le temps.
Mon séjour à l’hôpital me procura ma première déception sentimentale : je baillais d’extase devant le jeune interne qui s’occupait de moi. Tout en faisant mes prises de sang, que j’acceptais sans broncher, il me racontait des histoires que j’écoutais avec admiration. Je retrouvais mon père dans son sourire bienveillant et malicieux et, bien qu’il appartînt au genre masculin et ne fût pas mon père, il trouva grâce à mes yeux. Évidemment, il ne se doutait de rien et continuait à plaisanter gentiment avec moi sans penser à mal et sans soupçonner l’effet ravageur que produisaient sur moi ses beaux yeux bleus et son sourire de star. Le jour où je dus pourtant quitter l’hôpital, je fus désespérée, car j’avais dû partir sans pouvoir dire au revoir à l’amour de ma vie dont je ne connaissais même pas le nom. De retour à la maison, j’ai tout de même pensé à lui pendant des semaines jusqu’à admettre que je ne le reverrais sans doute jamais et que je ne pouvais continuer ainsi à me consumer d’amour.
Le retard que j’avais pris en raison de mon hospitalisation et de ma convalescence qui dura encore deux semaines me valut des difficultés scolaires que je ne parvins pas à surmonter. À la fin de l’année, la directrice annonça à mes parents que je devais redoubler ma quatrième et ma mère la pria alors de s’arranger pour qu’Isabelle et moi ne fussions pas dans la même classe, situation qui serait difficile à vivre pour son aînée. Ce fut une résurrection pour moi : alors que j’étais jusque-là une élève médiocre, je devins franchement brillante : tout me sembla facile à partir de ce moment. À la fin de l’année, on me décerna le prix d’excellence et tant de premiers prix que mes parents se demandèrent comment une telle transformation avait pu s’opérer ; ma sœur me félicita chaleureusement et — je le crois — avec sincérité.
Enfin, je commençais à trouver la vie intéressante.
Par la suite, je continuai de multiplier les succès scolaires et fus même présentée par le lycée au concours général de latin, mais je n’obtins pas de prix.
— C’est déjà magnifique d’avoir été présentée, dirent mes parents avec fierté.
Je passai mon baccalauréat avec une mention bien, et je ne pus m’empêcher de m’en glorifier auprès d’Isabelle qui s’en tira honorablement sans plus.
Malgré tout, je restais d’une timidité maladive.
Après nos examens, Isabelle fut conviée à une soirée par des camarades de classe et proposa de m’y amener pour me sortir un peu. Un garçon m’invita à danser avec un sourire et, par sa façon de me tenir, me fit comprendre que je lui plaisais bien, mais, lorsqu’il risqua un baiser dans le cou, je me dégageai brutalement et me réfugiai aux toilettes, suivie par Isabelle affolée :
— Il avait pourtant l’air gentil, ce garçon, qu’est-ce qui t’a pris ?
Comme une imbécile, je ne trouvai rien à répondre et réclamai de rentrer à la maison en reniflant. Isabelle ne me reprocha jamais de lui avoir gâché sa soirée, mais je me sentais complètement déplorable. C’est peu de temps après – je ne saurais dire s’il y avait un lien avec cet événement — que j’eus un épisode dépressif sans cause apparente. Alors que j’avais finalement appris à vivre avec ma peur de la vieillesse et de la mort, je pourrais te dire exactement le jour précis où j’ai ressenti un vertige qui m’a anéantie sur le moment. L’absurdité de la vie m’éclata à la figure : à quoi bon étudier, passer des examens, se bâtir une vie future, mais surtout surmonter ses handicaps, avec la souffrance que cela représente, traverser le cycle des saisons qui se répète inlassablement pour finir inexorablement par mourir ? À quoi bon tout cela et pourquoi ne pas en finir dès maintenant ? Curieusement, malgré la violence de cette expérience, cet épisode n’eut guère de suite et la vie continua comme auparavant.
3
Le baccalauréat en poche, l’heure du choix définitif avait sonné pour nos études supérieures. Isabelle s’inscrivit en faculté de droit, tandis que je me tournais vers la médecine que j’avais choisie depuis longtemps. En fait, ce qui avait initialement guidé ma décision n’était pas tant l’envie de devenir médecin que de faire les études les plus longues possible, en partie pour retarder l’entrée dans la vie active, mais surtout parce que les études me semblaient donner un sens à mon existence.
La première année, comme tu le sais, on n’aborde que les matières fondamentales. Je peux te dire que je ne séchais aucun cours, contrairement à d’autres qui étaient nettement moins assidus. C’était le cas en particulier de mon amie Christiane avec qui j’avais sympathisé dès le début. Il faut dire aussi que Christiane était plus « délurée » que moi, comme disait ma mère qui craignait une mauvaise influence sur sa fille bien sage. La deuxième année, je repérai un étudiant qui me plaisait bien : les cheveux noirs et le teint très pâle, genre « beau ténébreux », il était parfois accompagné d’une fille, pas toujours la même. Tu comprendras plus tard pourquoi je te parle de ce béguin. Je l’avais surnommé Étienne — je ne sais plus pourquoi — et je le cherchais du regard dès que j’entrais dans l’amphithéâtre. Si je ne le voyais pas, je me sentais triste une partie de la journée, mais je n’ai jamais rien tenté pour faire sa connaissance : j’étais bien trop timide pour ça. Un jour, Christiane surprit mon regard alors que je le cherchais des yeux et me demanda si j’attendais quelqu’un. Comme je rougissais, elle m’a gentiment taquinée :
— Ne serais-tu pas amoureuse, ma belle ? Allez, présente-le-moi ! mais j’ai esquivé avec humeur.
Un jour, je ne revis plus Étienne et ce garçon disparut ainsi de ma vie sans y être vraiment entré.
Les choses se sont gâtées lorsque je commençai les premiers stages à l’hôpital. Je tombais dans les pommes en toute occasion, ce qui faisait de moi la cible régulière des railleries de mes camarades étudiants. Ce n’est pas tant le sang que je craignais que la vue des trocarts s’enfonçant dans un corps humain. Il faut dire aussi que, encore à cette époque, je paraissais plus jeune que mon âge, à tel point que, lors d’un voyage avec mes parents, la propriétaire de l’hôtel leur avait demandé si elle devait m’inscrire sur leur fiche. Tu te rends compte, cela voulait dire que je paraissais à peine quinze ans, alors que j’en avais déjà vingt. C’était très gênant à l’hôpital : certains patients ne me prenaient pas au sérieux et refusaient même de se faire examiner par moi. Il m’arrivait d’être obligée de faire appel à un assistant lorsque je me trouvais en trop grande difficulté.
J’ai bien failli tout abandonner, tu sais, en pensant que je n’étais vraiment pas faite pour ce métier, mais je changeai d’avis lorsque je devins externe et dus effectuer moi-même ces examens invasifs qui m’avaient tant impressionnée au début.
— Finalement, on s’y fait, ai-je dit à mes parents avec qui j’avais partagé les affres que j’avais traversées.
Après mon premier poste aux urgences chirurgicales où j’étais passée maître dans l’art des sutures en tout genre, je revins un jour dans ce service pour dire bonjour aux infirmières. La surveillante me happa au passage.
— Ah ! Marie, rends-moi service s’il te plaît : regarde-moi cet animal qui s’est battu avec son copain à coups de tesson de bouteille. Il a une grosse blessure au cuir chevelu qui saigne comme un bœuf. L’externe de garde n’a encore jamais fait de suture et il est complètement paniqué ; ne pourrais-tu la faire et lui montrer par la même occasion ?
Je sentis mon cœur battre de plaisir devant cette marque de confiance. Je me suis mise en tenue et j’ai entrepris consciencieusement la suture, laissé les fils longs pour attacher ensuite la compresse bien serrée qui empêcherait la blessure de continuer à saigner : ma suture était impeccable. En même temps, tout en sermonnant l’homme sur les dangers de ce genre de bagarre, j’avais expliqué chacun de mes gestes à l’étudiant qui me regardait d’un air admiratif.
Je prenais de l’assurance et cela me réjouissait.
Quelques semaines plus tard, je fus affectée dans un service de réanimation où je devais faire six heures de présence par jour. Le rythme de travail était épuisant : de huit heures à quatorze heures, je courais d’un patient à l’autre sans avoir le temps d’une pause, puis me précipitais pour assister à mes cours sans même pouvoir déjeuner. Au bout de deux mois, les externes devaient changer de service, car ils avaient du mal à tenir cette cadence infernale. Entre-temps, les événements qui secouaient Paris avaient progressivement contaminé notre petite ville et je n’étais plus obligée de courir après la fin de mon service, car les cours avaient été interrompus. Lors du changement de stage, je fus chargée d’expliquer le travail à mon successeur. Il me demanda si je pouvais rester toute la matinée, mais je refusai, car je devais me présenter à mon nouveau poste. Je lui promis simplement de ne partir qu’à neuf heures après lui avoir expliqué ce qu’il aurait à faire. Lorsque nous nous présentâmes mutuellement, je ne pus m’empêcher de sourire en entendant son prénom, et Joseph me rendit mon sourire en ajoutant :
— Alors, nous sommes faits l’un pour l’autre.
Je venais de rencontrer l’homme qui allait partager ma vie. À neuf heures, quand je suis allée rejoindre mon nouveau poste, nous avions déjà pris rendez-vous pour le soir même. Nous nous sommes retrouvés dans un café où des amis de Joseph nous attendaient. Ce dernier me présenta et je les trouvai tous merveilleux. J’avais l’impression extraordinaire qu’un miracle s’était produit en moi, comme si je sentais toutes mes défenses céder une à une. À un moment, ma tête a tourné et je me réveillai dans les bras de Joseph qui attribua mon malaise à l’alcool dont je n’avais pourtant pris que deux petites gorgées.
Lorsque le lendemain, je racontai ma soirée à Christiane, elle n’a rien trouvé de mieux que d’exiger que Joseph changeât de prénom, et m’a demandé si nous avions déjà couché ensemble.
— Non, mais, on dirait que tu ne sais pas à qui tu parles, ai-je rétorqué.
L’après-midi, comme nous passions devant la Faculté des Lettres, occupée depuis le début des événements, nous pûmes constater qu’un désordre incroyable y régnait alors que la situation était nettement plus calme en médecine.
— De toute façon, nous sommes bien obligés d’assurer les soins à l’hôpital, fit remarquer Joseph.
Un camion de don du sang était garé près de la sortie et attendait le client.
— Allons-y et rendons-nous utiles, ai-je alors proposé.
Ce n’était peut-être pas une bonne idée. Moi, j’avais déjà donné mon sang plusieurs fois et je vis s’enfoncer le trocart sans frayeur, mais au bout de cinq minutes, j’entendis des voix derrière moi, venant de l’endroit où était allongé Joseph.
— On le met en position déclive, dit une voix ;
— Allez, on enlève le trocart, ça va monsieur ? dit une autre voix.
Je compris que Joseph avait fait un malaise.
— Chacun son tour, ai-je dit en riant, alors que nous sortions ensemble du camion au bout d’un quart d’heure, mais je regrettai ces paroles, car je voyais bien qu’il était vexé de s’être trouvé mal devant moi.
Il allégua le fait qu’il n’avait pas eu le temps de manger le matin et resta un bon moment taciturne.
— Il sera dit que je doive toujours suivre tes directives, a-t-il dit au bout d’un moment.
Comme je ne comprenais pas sa remarque, il m’avoua d’un ton faussement fâché que c’était lui à qui j’avais appris à faire une suture et que je ne l’avais même pas regardé, ce qui l’avait profondément blessé. C’était vrai, je l’avais à peine regardé, car j’étais bien trop concentrée sur mon ouvrage et attentive à bien expliquer ce que je faisais.
— Je dois avouer aussi que ça me plaisait bien d’être celle qui sait ! ai-je dit en éclatant de rire, pour dissiper le malaise qui s’était installé.
Nous sommes alors passés devant le cinéma et Joseph proposa d’aller voir le dernier Rohmer qui s’y jouait. Assis à notre place, nous discutions en attendant la projection du film lorsque Joseph esquissa un geste tendre que je repoussai avec douceur.
— Il va falloir que tu attendes un peu, lui ai-je dit.
Il me prit alors la main et me demanda des yeux si je voulais bien. J’acquiesçai d’un signe de tête et d’un sourire.
Ce fut une époque bénie pour nous deux. Joseph et moi nous voyions tous les jours et, s’il nous arrivait de réviser nos cours ensemble, nous passions le plus clair du temps à nous dire notre amour. J’avais accepté ses baisers, mais, lorsqu’il avait tenté une timide incursion dans mon décolleté, je l’avais encore doucement repoussé. Si tu savais comme je me sentais anachronique et presque coupable d’être aussi farouche, mais Joseph ne semblait pas m’en vouloir.
Quelquefois, il nous arrivait aussi de discuter des événements qui ne dérangeaient guère notre ville, et notre propre vie en particulier, alors que la capitale semblait à feu et à sang si l’on en croyait les informations.
— En médecine, j’ai l’impression que nous sommes un peu sous-développés politiquement, lui ai-je dit un jour.
Comme il ne comprenait pas ma remarque, j’ajoutai :
— Eh bien, il me semble que nous organisons notre carrière de futurs privilégiés sans beaucoup nous préoccuper des autres, non ?
Le temps passa : tandis que Joseph avançait progressivement dans l’exploration de mon corps, j’attendais avec une certaine impatience les plaisirs que ses caresses me faisaient pressentir. Cependant, nous réalisions que nous ne pourrions pas nous marier avant d’être financièrement autonomes, donc après le concours de l’internat qui n’aurait lieu que dans deux ans. Joseph, qui s’était montré jusqu’ici d’une patience d’ange et n’avait jamais voulu me bousculer, me fit remarquer qu’il serait difficile d’attendre aussi longtemps. Je dus en convenir et nous décidâmes ensemble que notre « mariage secret » aurait lieu quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. L’élection était certes un événement important pour nous et nous avions l’intention d’apporter nos suffrages à Michel Rocard qui nous avait subjugués, comme presque tous nos amis avec qui nous discutions le soir jusqu’à point d’heure. En vérité, ce qui guida essentiellement notre choix sur la date, c’était la perspective d’un départ de mes parents qui avaient décidé de faire un petit séjour d’une semaine chez des cousins et de rentrer le dimanche en fin d’après-midi pour voter. Nous aurions ainsi l’appartement pour nous seuls et pourrions inviter quelques amis au courant de notre grave décision.
Le grand jour arriva et les amis firent la fête jusqu’à une heure avancée de la nuit. Alors que j’étais surtout attentive à ce que personne n’abîmât quelque chose dans l’appartement, c’était surtout Joseph qui semblait appréhender notre premier rapport, s’inquiétant d’abord de savoir si j’avais bien pris la pilule et me disant ensuite qu’il ne voulait surtout pas me faire souffrir. Il fut si délicat avec mon hymen que je me rappelle seulement l’extase que je ressentis lors de la fusion de nos corps.
À partir de ce jour, j’eus la sensation que je n’aurais plus jamais peur. Tu me demandes de quelle peur je parle ? Lorsque j’étais petite, c’était celle d’être encore abandonnée par mes parents, et par la suite, ce fut celle — comment dire ? — d’être de trop. Les deux gamins qui m’avaient comparée à Michel Simon me persuadaient que j’étais laide, mais mon miroir me disait que j’étais plutôt insignifiante. Je fus très étonnée lorsque le pervers qui m’avait abordée me trouva jolie, mais paradoxalement, malgré le traumatisme que je subis, cette rencontre commença d’insuffler en moi le sentiment d’exister. Plus tard, j’acquis, grâce à mes études, la preuve que j’étais capable d’apprendre et même d’être utile, mais c’est l’amour de Joseph qui me confirma que j’existais vraiment. Je n’étais plus cette fille transparente et coincée qui se recroquevillait dans l’attente d’un regard des autres, osant à peine demander d’être reconnue, appréciée et — récompense suprême — désirée. Le temps de la chrysalide était achevé et, tel l’enfant qui crie lorsque l’air s’engouffre dans ses poumons, je hurlais de joie en accueillant cette délivrance.
4
Je voudrais te parler maintenant de la mort de mes parents, un événement tragique et un tournant important de mon existence. Ce fut quelques mois après notre mariage officiel qui fut célébré comme prévu juste après le concours de l’internat. Un an auparavant, nous nous étions décidés à annoncer à nos parents que nous avions pris un peu d’avance et ceux-ci l’avaient bien accepté, d’un côté comme de l’autre. Les miens avaient même mis à notre disposition un petit studio qu’ils louaient jusqu’ici à des étudiants et qui s’était récemment libéré.
Je me réveillais chaque matin dans les bras de Joseph et nous formions tous deux un couple complètement fusionnel. Nous habitions toujours dans notre petit studio en attendant des jours financièrement plus favorables et les nombreux enfants que Dieu voudrait bien nous accorder.
— Enfin, pas trop nombreux quand même, ai-je dit en riant quand Joseph émit par plaisanterie le désir d’en avoir au moins dix !
Je continuai de prendre la pilule malgré tout, en arguant que nous ne pouvions nous permettre d’en avoir un tout de suite.
Le résultat du concours me fut favorable et je pus choisir le poste en neurologie que je souhaitais, un peu moins pour Joseph qui s’en moquait, car il se destinait à la médecine générale. Quant à Christiane, elle décrocha le poste en gynécologie qu’elle voulait absolument et nous attendions avec impatience et un peu d’appréhension notre prise de fonction comme internes.
Un dimanche, nous étions en train de déjeuner lorsque le téléphone sonna. Joseph décrocha et je compris dès ses premières paroles qu’il s’était passé quelque chose de grave.
— C’est ta sœur : tes parents ont eu un accident de voiture.
Il me passa le combiné et Isabelle m’apprit entre deux sanglots la triste nouvelle. Les parents étaient venus passer quelques jours chez elle pour visiter un peu Paris et, comme ils rentraient ce jour même à Martignan, un cinglé en voiture de sport les avait percutés de face à grande vitesse alors qu’il doublait toute une file de voitures. Ils n’avaient rien pu faire pour l’éviter et la collision avait été brutale. Malgré les efforts des secouristes pour les ranimer, ils étaient morts tous les deux à leur arrivée à l’hôpital de Sens où ils avaient été conduits.