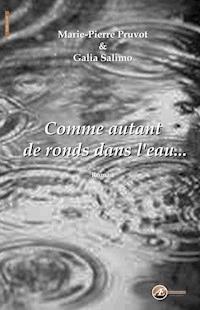Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Les Savoirs
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Une langue tue est une langue morte.
S'il est un sujet qui est passé sous silence dans la campagne présidentielle, c'est bien celui de la langue française. Même les discussions sur la culture, si fréquentes, s'en détournent et l'ignorent. Pourtant le français, dans les instances internationales, dans la communication planétaire, en France même, se délabre chaque jour sous les coups de boutoirs des ayants voix. Plus la France s'efface dans l'Europe, dans l'OTAN et dans le monde, et moins sa langue est parlée. Que peuvent les sans voix si les partis de gouvernement convergent sur et aboutissent à la pensée unique : l'acceptation de la fin de la culture française ? Les Français parlent français.
Marie-Pierre Pruvot, citoyenne "d'en-bas", s'est donné pour tâche de feuilleter le journal
Le Monde, d'en relever des titres et des commentaires parus sur une période de près de soixante-dix années pour constater qu'en dehors du général de Gaulle, si ferme dans son combat pour la langue française, tous les autres, par esprit de compromis, par négligence, ou par volonté de détruire, se résignent à notre déclin ou nous y précipitent. Un cri du cœur : parle français. Si tu le tais, tu le tues. Une langue tue est une langue morte.
Découvrez un essai passionnant qui milite contre la résignation face au déclin de la langue française. Un cri du cœur : parle français.
EXTRAIT
On peut affirmer qu’à terme, si une immigration massive se poursuit et que progressent vers le fiasco la société et son école, l’intégration des étrangers ne pourra se faire et l’état sera détruit par les différents replis qui menacent déjà. Si l’état se tient et gouverne et si l’école des quartiers d’accueil et d’ailleurs remplit son rôle, les migrations venues du sud et de l’est sont moins redoutables à la survie de la France que ceux-là même qui, malgré l’opposition des peuples, veulent imposer la supranationalité, le morcellement du pays, la dissolution de l’état.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Marie-Pierre Pruvot est née en 1935 en Algérie. Elle s’installe à Paris à l’âge de 18 ans et devient une figure emblématique des nuits parisiennes sous le nom de scène de « Bambi ». Dans les années 60, Marie-Pierre reprend ses études, passe le bac en 1969 et devient professeur de Lettres modernes en 1974. Aujourd’hui à la retraite, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages aux éditions Ex-Aequo :
J’inventais ma vie en trois tomes,
France, ce serait aussi un beau nom et
Marie parce que c’est joli (aux éditions Bonobo).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
France,
ce serait aussi un beau nom…
Essai
Marie-Pierre Pruvot
Dépôt légal mars 2011
ISBN 978-2-35962-253-9
©Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Éditions Ex Aequo
Table des matières
Un incident 8
Fin de la seconde guerre mondiale 12
La IVème République 19
Naissance de la Vème République 42
I Décolonisation 42
L’éloignement 80
1. Président Pompidou 80
2. Président Giscard d’Estaing 93
La Vème République à l’épreuve 107
1er Septennat 107
La France Gaulliste ? 124
Président Chirac 124
Le septennat 124
Le quinquennat 136
Le Symbole de la Mort 161
Président Sarkozy 163
Le protocole de Londres 171
Lettre à expédier aux Sénateurs : 174
Références diverses 178
Préface
de Nicolas Dupont-Aignan
Président de DEBOUT la REPUBLIQUE
Une déclaration d’amour pour la France, sa langue et sa liberté. C’est à cela que nous convie Marie-Pierre Pruvot au fil des pages de son dernier ouvrage.
Patiemment, Marie-Pierre Pruvot a compilé, lu et analysé les titres et articles du Monde depuis sa création jusqu’à nos jours, nous invitant ainsi à prendre du recul et à nous replonger dans le passé contemporain de notre pays.
Par son travail, elle nous offre à voir les transformations des analyses de l’état du monde tel qu’il fut compris et analysé par les intervenants du journal de référence. Marie-Pierre Pruvot nous convie ainsi à une évolution de la vision de notre pays depuis près de soixante-dix ans.
S’offre ainsi à nous, par petites touches, le grand basculement des élites françaises dans un nouveau paradigme. La France, qui était au sortir de la deuxième guerre mondiale un pays libre évoluant dans un univers compliqué et que le Monde tâchait de nous rendre intelligible, est devenu un pays qu’il faut à tout prix dissoudre dans une idéologie dévoyée de l’internationalisme : le mondialisme ultra-libéral.
Le sort réservé à notre langue, qui revient comme un fil rouge de toute cette évolution, est un exemple criant de cette volonté de nos dirigeants d’abandonner ce qui a fait la grandeur de notre pays pour le soumettre aux postulats dominant dans le monde, et en particulier dans le monde anglo-saxon.
L’on comprend alors, à travers son récit, que si les langues sont interchangeables lorsqu’il s’agit de désigner les choses, elles ne le sont plus du tout lorsqu’elles manient les concepts. Loin de se réduire à un simple moyen de communication, les langues sont aussi un moyen de penser, de voir le monde. Elles sont le fruit de l’histoire, de cultures, et du cheminement politique des peuples. Plus encore en France où la langue est l’un des fondements, si ce n’est le fondement principal, de l’identité nationale.
En voulant supplanter plus ou moins insidieusement la langue de Molière par celle de Shakespeare – en fait un globish internationalisé – la volonté était d’adapter coûte que coûte le modèle politique, économique et social de notre pays aux idées dominantes. Le but était de sacrifier la solidarité nationale, ou la conception exigeante de la République aux dieux de la mondialisation américaine et du libéralisme triomphant !
Or, aujourd’hui, le français recule partout, que ce soit dans les entreprises, où l’anglais est de plus en plus langue de travail, chez nos ministres qui s’expriment à l’étranger en anglais, ou également dans notre vie quotidienne où tout ce qui est nouveau se voit affublé d’un nom anglais. Et loin de protéger notre langue, l’union européenne s’est révélée être l’une de ses plus féroces ennemies.
Mais, loin de s’inquiéter de cette dérive, notre élite politique semble au contraire s’en accommoder parfaitement. Ainsi, peu de temps avant la présidence française de l’UE, Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur, déclarait qu’elle ne militerait pas « pour imposer l’usage déclinant du français dans les institutions européennes à l’occasion de la prochaine présidence française de l’Union. » L’uniformisation est en marche avec l’aval de nos gouvernants et au grand dam des francophones du monde entier.
Il ne faut pourtant jamais désespérer de la France. En son sein se trouvent toujours des volontés et des forces pour rester fermes dans ses convictions et ses combats. Marie-Pierre Pruvot est l’une d’entre elles. La reconquête de notre liberté passera par le recouvrement complet de notre langue, elle passera par des livres tels que celui-ci.
Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortelles…
Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie… Ce seraient aussi de beaux noms… Et nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde.
Paul Valéry,
Un incident
Le journal Le Monde, daté du 26 novembre 2005 publie une triste nouvelle : « Le traité d’amitié franco-algérien ne devrait pas être signé cette année. » Le sous-titre précise : « La loi française du 23 février, dont un article vante les mérites du colonialisme, a retardé le processus. L’autre point d’achoppement concerne la question des harkis. »
Le destin des Harkis, longtemps dissimulé à l’opinion, effraie par sa cruauté. Le nombre des victimes, on l’ignore. On parle, ce 26 novembre, de 15000 à 25000 supplétifs musulmans sacrifiés en Algérie après le départ de l’armée française. Mais, (suivons Mohand Hamoumou et Abderahmen Moumen citant Jean Lacouture en 1991) « Cent mille personnes sont mortes par notre faute. Un massacre honteux pour la France et pour l’Algérie. Le déshonneur est trop lourd à porter. » Est-il donc nécessaire, pour faire un traité d’amitié avec l’Algérie, de lui rappeler des crimes commis alors que la population était en effervescence, presque en état de guerre civile, en tout cas de lutte entre les clans, et assoiffée de vengeance ? Battons seulement notre coulpe puisque le gouvernement français était au courant des malheurs qui se préparaient et les a permis en ne transférant pas en France les victimes désignées. Inutile de rien imputer aux Algériens qui s’arrangeront, comme nous, avec leur conscience. Ce n’est pas à nous de leur faire la leçon.
Quant au premier des deux points qui font obstacle au traité d’amitié, à savoir la loi du 23 février 2005 qui vante le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et qui a tant fait réagir le président Bouteflika, elle est absurde puisqu’elle ne peut changer la réalité des faits. Les lois qui fixent l’Histoire sont insupportables. Si les manuels scolaires se soumettent à celle sur les bienfaits de la colonisation, ce sera l’occasion pour les enseignants de fustiger l’histoire officielle comme ils se doivent de le faire lorsque les manuels scolaires présentent l’intégration européenne comme une excellente chose, la mondialisation comme inévitable ou encore la langue anglaise comme la langue universelle ; bien pire encore, lorsque dans les manuels scolaires « l’entité France, celle de la République française, a purement et simplement disparu au profit des deux autres niveaux : le niveau européen et celui des territoires qui composent la France. » (Rémy Knafou, Le Monde daté 5 octobre 2011) Cette loi du 23 février 2005 est donc vaine, elle est surtout pernicieuse puisqu’elle nous éloigne du traité d’amitié avec l’Algérie. Amitié si chère à notre cœur.
Nos députés avaient-ils seulement l’Algérie en tête en votant cette loi ? Les petits Français ont appris pendant des siècles que leurs ancêtres les Gaulois étaient des sauvages, et que leur capitulation, leur soumission à Jules César et leur renoncement à leur langue et à leurs lois leur avait été profitables. C’est cet état d’esprit que les imprudents députés voulaient remettre au goût du jour. Moins pour faire avaler la pilule aux Algériens que pour y disposer les Français. Nous étions à cinq semaines du référendum sur la constitution européenne qui proposait aux Français – sous un déluge de mots spécieux – de transformer la France en province et d’adopter une autre langue et d’autres lois. Ceux-là même qui préparaient « l’inféodation de la France » (J. Chirac) et consentaient à son « abaissement » ne s’étaient peut-être même pas douté que l’Algérie pouvait avoir une fierté nationale ni que le président Bouteflika se raidirait contre le trucage de l’Histoire. Nos députés ne cherchaient pas à humilier l’Afrique du Nord, ils voulaient pour la plupart chanter les bienfaits du colonialisme auquel ils s’apprêtaient à soumettre la France et se donner des arguments pour justifier leur politique de reniement.
Un mot de plus concernant ce traité aléatoire. Monsieur Benjamin Stora, dont personne ne conteste les compétences, juge que les temps ne sont pas propices à sa signature. « Les Français sont-ils prêts à entendre, par exemple, que 30000 Maghrébins sont morts pour eux pendant la première guerre mondiale ? Et 80000 autres pendant la seconde guerre ? Qui sait que 50000 soldats d’origine maghrébine ont péri en Indochine ? » On ne voit pas pourquoi les Français ne seraient pas prêts à entendre cela. La presse nous montre chaque jour qu’elle est capable de focaliser sur tel événement, tel anniversaire, et le ressasse à satiété. Pourquoi pas le souvenir des hommes des colonies qui sont morts pour la France ? Ils le méritent bien. Et Benjamin Stora de poursuivre : « Entre la tentation sécuritaire, le repli nationaliste et l’exaltation de la nation française, comment plaider pour l’écoute de l’autre ? » On veut bien admettre la tentation sécuritaire. Mais où le prestigieux historien voit-il le repli nationaliste et l’exaltation de la nation française, qui ne sont d’ailleurs pas incompatibles avec l’évocation de centaines de milliers d’hommes, « la chair à canons » aujourd’hui étrangers, et qui se sont dévoués, sacrifiés pour la France ? Ce pourrait être au contraire un motif de fierté nationale.
La nation française, qui l’exalte ? Qui ne l’outrage pas ? Comparons : Monsieur Blair a dit avec panache, dans la veine de « Rule Brittain », à propos de l’Europe, « We must lead it or leave it. », on la guide ou on la quitte. A-t-on entendu un premier ministre français en dire autant ? Le monde entier aurait crié à l’arrogance française. Monsieur Blair n’a pas de souci à se faire.
Repli nationaliste ? Parlons plutôt de repli identitaire de populations immigrées – mais pas seulement – qui risque fort de conduire plus tôt qu’on ne pense à la balkanisation de la France. Ce serait plutôt l’absence de fierté nationale, le constant autodénigrement, une certaine publicité donnée à l’idée que la nation française doit disparaître et se fondre dans un ensemble plus grand, qui ferait obstacle à l’intégration des immigrés, et non la mise à jour de l’Histoire, au demeurant indispensable et urgente. A qui peut-on demander de s’assimiler à un peuple qui se renie lui-même ? Une phrase d’Alain Finkielkraut écrite après les grandes émeutes des banlieues : « Ce qui m’inquiète, c’est la désaffiliation nationale. Je dis donc effectivement que lorsque certains jeunes émeutiers évoquent entre eux les Français nous sommes perdus. » On ne peut mieux dire. Mais cela n’est vrai qu’à condition de se placer au sein de la nation française. Pour les partisans d’une France morte et d’une Europe considérée comme un conglomérat d’ethnies entremêlées ayant chacune ses droits et coutumes propres, sa langue vernaculaire, ses intérêts particuliers, la situation décrite comme un drame par Alain Finkielkraut devient une aubaine, pour les eurolâtres, un motif d’espérance.
On peut affirmer qu’à terme, si une immigration massive se poursuit et que progressent vers le fiasco la société et son école, l’intégration des étrangers ne pourra se faire et l’état sera détruit par les différents replis qui menacent déjà. Si l’état se tient et gouverne et si l’école des quartiers d’accueil et d’ailleurs remplit son rôle, les migrations venues du sud et de l’est sont moins redoutables à la survie de la France que ceux-là même qui, malgré l’opposition des peuples, veulent imposer la supranationalité, le morcellement du pays, la dissolution de l’état.
La querelle n’est pas récente. Il suffit de feuilleter Le Monde depuis sa création pour en découvrir les premières manifestations. Déjà tout s’y annonce : les batailles sur les lois électorales, la constitution française, la construction de l’Europe, la création d’une armée européenne, l’immigration… tant de sujets qui se discutent encore et nous tiennent en haleine. S’y ajoutent quelques images jaunies, certaines violentes : la menace que fait peser l’URSS, les guerres de décolonisation… Certaines plus souriantes : la princesse Elisabeth a donné naissance à un fils…
Fin de la seconde guerre mondiale
Le premier numéro du Monde paraît en décembre 1944, cinq mois avant la chute du IIIème Reich. C’est l’époque où le général de Gaulle, chef de la France libre, est à la tête du gouvernement provisoire au milieu des troubles de la libération. Le pays est à bout de souffle et en ébullition. Que les Français reprennent confiance en la France, voilà la tâche la plus urgente, et peut-être la plus difficile : « Nous sommes blessés, mais nous sommes debout » dit le Général. Il se plaît à célébrer la France libérée par elle-même en omettant une fois sur deux d’évoquer le rôle des alliés. Le président Franklin Roosevelt (le « faux témoin » aux yeux de de Gaulle) ne l’aime pas. Jean Monnet a bien fait son travail. L’Amérique a reconnu le régime du maréchal Pétain jusqu’au moment du débarquement américain en Afrique du Nord, et, une fois à Alger, elle a suscité un général conciliant pour éliminer de Gaulle. Le peuple au contraire confirme l’un et évince l’autre. Les Américains veulent placer la France vaincue par l’Allemagne et libérée par eux sous leur administration. Jean Monnet, loin de s’y opposer, cherche à utiliser leur puissance pour « détruire » – c’est son mot – le Général. Il l’a vu d’un mauvais œil arriver à Londres, a tout fait pour l’empêcher d’utiliser la radio anglaise, et ne souffre pas l’idée que la France recouvre son indépendance et son éclat. Son projet, c’est que les gouvernements européens soient les exécutants des décisions qu’il aura lui-même prises à la tête de « pools » supranationaux. Le Général, à l’inverse, veut replacer la France humiliée parmi les grandes nations. Rude tâche pour le chef du gouvernement qui se voit tenu à l’écart de la conférence tripartite, dite de Yalta ou du partage du monde. Ni le pacte franco-soviétique ni le soutien de Churchill n’ont rien pu contre l’opposition de Roosevelt.
1945.
La conférence de Yalta dure une semaine : du 4 au 11 février 1945. Il est alors évident que le Reich ne tiendra plus longtemps. L’Allemagne sera divisée en quatre zones qui seront administrées par l’URSS, les USA et la Grande Bretagne. La 4ème zone étant attribuée à la France, à la demande pressante de Churchill. De nouvelles frontières y sont décidées, qui favorisent l’URSS. Celle-ci s’engage à entrer en guerre contre le Japon. Enfin, une conférence sera convoquée à San Francisco pour créer une Organisation des Nations Unies. Une seconde tentative de gouvernance du monde. L’espoir !
La guerre touche à sa fin. Le lecteur d’aujourd’hui, pour peu que, comme nous, il ne soit pas féru d’Histoire, s’étonne de constater que pendant l’agonie du Reich de très violents combats ont encore lieu sur le territoire français. Or la bataille des Ardennes, celle pour la libération de Colmar, font rage. Plus surprenant encore pour les lecteurs oublieux ou peu informés que nous sommes, alors que la bataille générale pour la prise de Berlin est commencée, que les troupes russes et américaines, toutes deux sur le sol allemand, ne sont plus qu’à 72km l’une de l’autre, le 20 avril à deux semaines de la mort d’Hitler, on relève cette nouvelle incroyable, « La poche de Royan est liquidée. » Les Allemands s’étaient incrustés dans cette région et ils tenaient encore quand le Reich s’écroulait. Royan n’aurait pas tardé à tomber à son tour. Nos alliés n’ont pas eu la patience d’attendre. Ils ont préféré la raser. Frénésie de la cruauté, de la destruction inutile.
Pendant que le grand Berlin est dévasté et qu’on y a des « visions d’horreur », Hitler, dans son bunker, semble encore espérer. Croit-il au miracle de sa bombe atomique qui viendrait le sauver in extremis, ou bien imagine-t-il que les derniers actes de vaillance de son armée vont lui permettre une honorable capitulation ? A-t-il peur à son tour de la mort qu’il a tant donnée ? Peut-il encore attendre un dernier réconfort ? Invraisemblable ! Pourtant, la vie lui en offre un : le 12 avril, on apprend la mort de Roosevelt dont le cœur a lâché. Il faut encore patienter jusqu’au 3 mai pour savoir que le chef des nazis s’est suicidé le 30 avril.
8 mai : L’Allemagne a capitulé.
Le tour de force, c’est que le drapeau français est ajouté à la dernière minute parmi ceux des vainqueurs. Voilà la magie du chef de la France libre. La France siège parmi les vainqueurs ! Après la débâcle de 1940, après la honteuse collaboration avec l’occupant, la France est « Debout ».
Il n’empêche. L’Empire a vu la France vaincue. Il ne supporte plus sa tutelle. L’exigence de liberté s’empare des peuples soumis. L’esprit de décolonisation semble dès cette époque s’imposer aux yeux de certains, mais, on ne sait pourquoi, le désengagement colonial semblerait aux Français un renouvellement de la défaite de 1940, et on ne l’envisage pas sans réticences. Pour cette France épuisée, la guerre va durer encore dix-sept ans. Comment un pays, quasiment ruiné, peut-il soutenir encore un tel effort ? Les protectorats, les colonies, tout commence à bouger. Les combats « font rage à Damas. » C’est vrai. La Syrie est encore protectorat français ! Théoriquement. Car l’indépendance de la Syrie et du Liban est au programme depuis des années. La guerre franco-française qui s’y est déroulée en 1941 a laissé des traces profondes. La ligue arabe menace la France. L’Angleterre a la volonté de garder ses positions au Moyen-Orient. Elle en a, semble-t-il, les moyens. Du moins le pense-t-elle. La France lui cède.
Là-bas, en Indochine, (encore une colonie française) le Japon, toujours en guerre contre les Etats-Unis, fait un coup de force pour nous chasser. Nous devons, semble-t-il, lutter à tout prix. On lit, à la date du 20 juin : « Héroïque résistance des troupes françaises en Indochine. » On y est donc si mal en point ? Le général de Gaulle, qui voudrait prévenir les troubles dans notre impatient empire reçoit le sultan du Maroc et le bey de Tunis…
Bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août.
Samedi 11 août : capitulation du Japon.
17 août. Congrès sioniste de Londres.
Dans le flot des nouvelles fracassantes, cette dernière information est tenue pour négligeable par le grand public. Il en est encore ainsi aujourd’hui. On ne remarque que les actions d’éclat, souvent sans lendemain. Les étapes discrètes qui mènent aux grands résultats, on les néglige. C’est ainsi qu’en France s’établissent des situations de fait dont le peuple n’a guère entendu parler et qui sont des malheurs pour le pays. Ainsi en va-t-il aujourd’hui de l’élimination progressive de la langue française dans les instances internationales, à Bruxelles, et dans la France même, qu’on s’ingénie à faire disparaître.
Peut-être qu’après l’effondrement du Japon, la France croyait avoir repris ses positions en Indochine. Elle espère au moins y conserver son influence. Mais « le Viet Minh y favorise pillages et exactions. » Le Viet Minh, c’est l’organisation communiste combattante. Mieux, Hô Chi Minh, son chef, se plaint de la politique française à… Truman, qui a pris la suite de Roosevelt. Truman, qu’on avait dit falot à la vice-présidence, se sent de l’assurance, sitôt qu’il hérite du pouvoir. Les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ce sont ses succès personnels. Il a aussi des projets pour l’Europe. Les Etats-Unis d’Europe, c’est ce qu’il souhaite. En seraient exclues : l’URSS et la Grande Bretagne, trop occupée à gérer son vaste empire… Cette Europe unie ne serait pas dangereuse car elle serait maintenue en état d’infériorité, avec une armée réduite. Truman ! Un ami qui nous veut du bien.
1946.
Le Général n’est plus à la barre pour lui répondre. Le 22 janvier 1946, il s’est démis de ses fonctions. La mésentente entre les principaux partis de gouvernement l’a obligé à se retirer. On dit qu’il s’attendait à être aussitôt rappelé. Il lui faudra douze ans pour qu’en pleine tourmente algérienne, et donc par le plus grand des malentendus, le Président de la République lui demande de revenir et que l’Assemblée Nationale l’investisse des pleins pouvoirs. Janvier 46 donc, c’est un de ces grands moments qu’on aimerait récrire, car c’est alors qu’il est urgent d’engager une politique de désasservissement des peuples. De Gaulle l’aurait fait. Hélas, il s’en va. Les trois grands partis de gouvernement qui l’ont vu partir se sont bien gardés de le rappeler, mais ils ne peuvent se mettre d’accord sur rien. Ni la constitution française, ni l’Empire.
Le Vietnam est érigé en « République libre » au sein de l’Union française, et déjà on sait que ce statut doit être évolutif. Pourtant, la crainte que les communistes de Hô Chi Minh s’imposent par la force fige les positions. Contenir les communistes est un mot d’ordre chez les Occidentaux.
L’Angleterre, mieux armée que nous, nous a persuadés d’évacuer nos troupes du Levant. Bien que tout son empire bouge, elle espère y maintenir son autorité. Même si elle reconnaît d’assez bonne grâce le droit à l’Inde de choisir sa constitution, elle est partout contestée. En Palestine, elle lutte contre l’immigration clandestine des Juifs et cherche à liquider la résistance de ceux qui y sont déjà installés. Des titres du journal Le Monde : « La tragédie palestinienne… » ; « Les Juifs, forts de leurs malheurs passés… » Soixante années d’un même conflit, transfiguré, mais qui reste un peu le même.
Plus divertissantes sont les relations des expériences atomiques américaines de Bikini, en juillet 1946. Première expérience, on lit, non sans s’étonner : « plusieurs navires sont coulés, incendiés, ou gravement endommagés. C’est un succès, affirme l’amiral responsable des opérations, mais les spectateurs sont déçus. » Trois semaines plus tard, lors de la seconde expérience, « sont coulés : un cuirassé, un porte-avions et deux petites unités. Une colonne d’eau s’est élevée à 1500 mètres. » On ne dit pas si les témoins sont satisfaits.
Un problème commence à sourdre, menaçant. Rapprochons deux articles concernant la langue française. L’un, tiré d’une chronique d’Albert Dauzat : « Défense de la langue française ». Son titre, « Les euphémismes ou la politesse du langage. » Amoureux de leur langue, les Français aiment ses difficultés, les disputes qu’elles suscitent, et souvent les puristes s’en donnent à cœur joie, sûrs, en défendant la rigidité de leurs principes, de défendre la langue elle-même. Ce n’est pas le cas de l’article du jour, au titre explicite, mais c’est souvent le cas dans les chroniques du Monde. La plupart du temps, question de spécialistes. Un autre article, bien plus notable, illustre le délabrement de la France : « Le Français ne ferait-il plus foi ? » Où il est dit que dans les textes diplomatiques, seuls le russe et l’anglais pourraient faire référence en cas de litige. C’est à cela qu’on juge du dépérissement politique d’un peuple. Comment nos hommes politiques pourraient-ils maintenir le rang de la France ? Ils se laissent conduire par leurs jalousies et leurs chamailles et se sont ôté le pouvoir de gouverner. Le Monde titre : « L’état désintégré. »
La grande affaire de la France en 1946 c’est la rédaction et l’adoption d’une nouvelle constitution. La question est de savoir si la France aura un gouvernement suffisamment stable, avec une majorité assurée, qui ne se délite pas au moindre débat, c’est-à-dire un gouvernement apte à régler les problèmes monumentaux qui se posent à une France abattue par la seconde guerre mondiale ou si va s’instaurer une république clanique où une multitude de partis tirent à hue et à dia empêchant, même les hommes politiques les plus capables, de se maintenir au-delà du temps prévu pour la tâche restreinte pour laquelle ils ont été faits ministres. Début mai, une première constitution gabegique est présentée au peuple qui la repousse par 10 000 000 de Non pour 9 000 000 de Oui. C’est un succès pour les partisans d’un pouvoir fort, en faveur de quoi plaide le général de Gaulle. Hélas, le plat est présenté à nouveau, et le peuple, par lassitude, finit par adopter une constitution sans nerfs par 9 000 000 de Oui contre 8 000 000 de Non. On mesure l’étendue de l’abstention. La mauvaise constitution est adoptée par 36% du corps électoral. Ainsi donc, alors que le pays est au bord du gouffre, que des troubles violents éclatent aux quatre coins de l’Empire, que des peuples entiers sont à la merci de notre gouvernement de qui ils attendent une ligne politique définie, voilà que nos hommes politiques, sous couvert de démocratie et de tous ces jolis mots dont on se pare pour cacher ses vices, s’arrangent pour qu’aucun d’entre eux ne soit assuré de garder le pouvoir de façon durable et se condamnent à l’impuissance.
Les Vietnamiens ouvrent les hostilités contre la France à Hanoi. Le conflit s’étend. Etat de siège dans toute l’Indochine du Nord. On parle de « l’équivoque Ho Chi Minh »
Les articles concernant l’Algérie se multiplient. On y apprend que le mouvement nationaliste est activement soutenu par les mosquées. Le mot d’ordre des oulémas algériens est : L’Islam est ma religion, l’arabe ma langue, l’Algérie ma patrie. Pendant que la puissance française cherche à naviguer entre des opinions opposées en tentant des solutions qui ne satisfont personne, les antagonismes se durcissent. Dès les années 20, un certain monsieur Violette, gouverneur général de l’Algérie, avait prévenu : « Si vous ne donnez pas la France pour patrie aux Algériens, ils s’en feront une eux-mêmes, à leur manière. » Les Français sont restés sourds à cette mise en garde. Le jour du 8 mai 1945 ont eu lieu les terribles événements de Sétif et d’ailleurs, réprimés de la manière qu’on sait. Comment a-t-on pu penser que des gens élevés dans nos écoles, gorgés de droits de l’homme et de révolution française pourraient être assez veules et stupides pour accepter sans perspective de souveraineté l’humiliation d’être tenus pour des citoyens de seconde zone ? L’Algérie va devenir le plus insoluble des problèmes.
La IVème République
1947.
Avec l’élection, le 17 janvier 1947 de Vincent Auriol, premier président de la IVème République, s’inaugure la pratique de la constitution. Le président consulte afin de nommer un président du Conseil apte à gouverner. Il choisit Paul Ramadier qui constitue son gouvernement. Georges Bidault, ministre des affaires étrangères. Secrétaire d’état aux anciens combattants et victimes de la guerre : François Mitterrand. Bon dernier dans l’ordre protocolaire est le secrétaire d’état à la France d’outre-mer, G. Moutet. La France d’Outre-mer ne méritait-elle pas une place plus prestigieuse ? Quelques esprits éveillés se posent cette question : « L’Union française ne serait-elle pas une antichambre de sortie ? » C’est une question provocante, mais elle est sans doute perçue comme une boutade. Aucun homme politique français de l’époque n’imagine que l’Union française puisse être purement et simplement dissoute. Il serait plus facile de trouver aujourd’hui un partisan de la dislocation de l’Union européenne.
Qu’on ne s’étonne pas si cette lecture du Monde passe sous silence des événements de la plus grande importance comme « Le verdict du procès de Nuremberg ». Aussi important qu’ait été le procès décidé à la conférence de Yalta, le verdict est un point final, et ne semble pas avoir de conséquences sur le déroulement de la politique française. D’autres informations moins retentissantes retiennent davantage l’attention puisqu’on connaît leur progression : ce titre du 4 octobre 46 : « L’imbroglio palestinien » relayé par celui du 11 décembre 46 : « Le Judaïsme américain prendra-t-il la tête du sionisme mondial ? » Février : « Loi martiale en Palestine ? » Septembre : « Un groupe de terroristes Juifs qui se proposaient de lancer sur Londres tracts et bombes tombe dans un piège de la police. » La menace n’aurait-elle fait que changer de mains ? Pendant ce temps, les émigrants de l’Exodus ont débarqué à Hambourg. 1er octobre : « Qui maintiendra l’ordre en Palestine après le retrait des troupes britanniques ? » Le 2 décembre : « L’ONU décide le partage de la Palestine » Les Arabes qui tiennent cette terre depuis plus de mille ans y voient une spoliation qu’ils nomment « Naqba » catastrophe. Titre : « Proche Orient en ébullition ». Dans cette affaire, « La France se range dans le camp occidental » estime-t-on à Washington.
1948.
Mars : « Plan de partage de la Palestine repoussé par le Conseil de sécurité. » Mai : « A l’expiration du mandat britannique, l’état d’Israël proclamé cette nuit est aussitôt reconnu par Washington ». « Les forces juives occupent Jérusalem. » C’est une aventure d’apparence rocambolesque que la création de l’état d’Israël. Aventure qui, quelque compassion qu’on éprouve pour les peuples lésés et dont on comprend qu’ils n’admettent pas le fait accompli, a nécessité de la part des Juifs, juste après la Shoah, un tel ressort fait de nationalisme, de volonté, d’organisation : de génie politique, qu’on ne peut qu’admirer et envier.
Remontons le temps de quelques mois pour revenir aux affaires de la France. Le général de Gaulle lance un grand mouvement, le RPF, avec la ferme intention d’obtenir le pouvoir pour changer la constitution qui ne permet pas une action suivie. Il n’atteindra pas son but. Alors la constitution de la IVème République stagne plus de dix années dans l’impuissance. Les partis représentés à l’Assemblée nationale ne parviennent pas à s’accorder sur des solutions acceptables pour une majorité. Un exemple, dans l’Empire : « Agitation générale à Madagascar. » et en France : « Le débat sur les salaires relègue la question de Madagascar au second plan. » 6 avril : en Algérie, les élections donnent un triomphe pour le RPF (de Gaulle) et un échec pour les nationalistes (Messali Hadj). Mais… les élections en Algérie… passons.
Les problèmes sociaux de la France sont tels qu’on parle de situation insurrectionnelle, d’incidents qui éclatent ici ou là, de sabotage même, comme sous l’occupation. Le gouvernement d’André Marie, récemment installé par l’Assemblée, tombe le 31 août sous les coups de la même Assemblée. Le pays reste sans gouvernement. Monsieur Robert Schuman, pressenti par le président de la République, est investi, mais renonce aussitôt. Le président de la République reprend ses consultations et finit par rappeler le même qui parvient à s’imposer, et forme son gouvernement. Il démissionne en septembre. Un commentaire de Rémy Roure dans le Monde : « Vacance d’autorité » Vincent Auriol reprend ses consultations. Monsieur Queuille est élu président du Conseil.
Après une série d’élections remportées par le RPF, le Général hausse le ton : « Que la parole soit rendue au peuple ! » Mais la dissolution de l’Assemblée nationale poserait la question du mode de scrutin, puits sans fond de difficultés et de disputes. Alors les hommes politiques resserrent les rangs pour s’accrocher à un pouvoir dont ils savent qu’il ne peut plus prévenir les événements. Il les subit. On perçoit que ces hommes, qu’on retrouve presque tous, toujours les mêmes, dans les différents gouvernements, éprouvent l’angoisse de leur impuissance. Les grands problèmes stagnent et s’aggravent. Déjà l’Allemagne émerge de ses ruines, et déjà les beaux parleurs évoquent une Europe où « les frontières n’auraient aucune signification. » On se demande : pas même de frontière linguistique ? Ceux qui, dès le milieu du XXème siècle, prônent la disparition de la France dans un vaste ensemble, savent qu’ils condamnent aussi sa langue. On dit que monsieur Monnet ne parlait qu’anglais, même en famille, et qu’il n’avait pas seulement fait apprendre le français à sa fille qui fut obligée de s’y mettre sur le tard. Les dangers d’aujourd’hui étaient perceptibles il y a un demi-siècle, et plus.
Quelques titres :
Touchant. Londres, 15 novembre : La princesse Elisabeth a donné naissance à un fils.
Inquiétant. La coupure de Berlin est un fait accompli. Pour stopper le flux d’Allemands qui rejoignaient l’ouest, les communistes ferment leurs frontières. Le « blocus » de Berlin commence.
Stupéfiant. « Un péril national : l’immigration incontrôlée des travailleurs nord-africains ». Toujours les mêmes phrases, pas sous les mêmes plumes.
1949.
« Premiers obus communistes sur Pékin ». Pour le lecteur d’aujourd’hui, la nouvelle a quelque chose d’incongru car on s’étonne que la Chine ne soit pas encore totalement communiste. C’est bientôt chose faite. Par une sorte d’arrangement incompréhensible, elle laisse les nationalistes se replier sur Formose : Taiwan.
Aux élections cantonales, le RPF s’affirme davantage.
Mai : « Le pétrole a jailli en Algérie »
13 mai « Le blocus de Berlin est levé. »
En septembre, on pavoise. Monsieur Henri Queuille, président du Conseil, fête son année de gouvernement. Voilà qui prouve qu’on peut gouverner dans ce système politique et contredit ce méchant de Gaulle qui aspire à la dictature !
En octobre, chute du gouvernement Queuille. Il a dû affronter des problèmes sociaux très graves. C’est ce monsieur Queuille qui a signé le pacte Atlantique. On le retrouvera. On appelle parfois la IVème République La République de monsieur Queuille. Il sera vice-président du Conseil dans les cabinets Pinay, R. Mayer, Laniel.
Le président Vincent Auriol consulte.
Monsieur Jules Moch est pressenti. Echec.
Monsieur René Mayer est investi. Echec.
Georges Bidault sollicite et obtient l’investiture.
Pendant ce temps, on intronise Rainier III, 26 ans, prince de Monaco, premier de la troisième maison Grimaldi. Ainsi, la couronne tombe sur la tête d’un Polignac, vieux nom français qui a connu la faveur, les heures de gloire, mais aussi la disgrâce, la détestation publique. Pour la principauté commence un long règne de prospérité.
L’année 1949 se termine sur une note joyeuse : « Le premier milligramme de plutonium français est isolé. » Qui dit que la IVème République n’a rien fait ?
1950.
Monsieur Bidault est Président du Conseil après la démission de monsieur Queille, l’échec de monsieur Moch, puis l’échec de monsieur Mayer.
Le 5 mars, sous le ministère Bidault remanié après le départ des ministres socialistes, « L’assemblée a abordé le projet de loi sur les sabotages et les atteintes au moral de l’armée. » Voilà pour l’atmosphère. Voici un commentaire du Monde : « La France minée. »
Avril. Mort de Léon Blum, 78 ans, homme politique français de la plus grande importance. Interné en 1940, traîné au procès de Riom, livré aux Allemands et déporté à Buchenwald (1943 à 1945). Il meurt entouré de respect et de prestige. En attachant son nom aux premiers congés payés français, en 1936, il se fit une réputation sans satisfaire entièrement son camp, la gauche, qui souhaitait, contre Franco, l’engagement de la France aux côtés de la jeune République espagnole. On s’est parfois demandé si les congés payés de 1936, la liesse qu’ils ont déclenchée, étaient en phase avec la conjoncture mondiale : Mussolini et son fascisme depuis 1922 en Italie, Hitler et son nazisme en Allemagne depuis 1933. Léon Blum s’abritait derrière l’avis des militaires, qui s’abritaient derrière la ligne Maginot, qui ne protégeait personne. Léon Blum a écouté les suggestions de de Gaulle sur la construction d’une armée de blindés, et les a repoussées comme contraires à son idéal pacifique. Un idéal pacifique, avec, à ses frontières, Franco, Mussolini et Hitler. Passons ! Il aurait aimé mener à bien le projet dit « Blum Violette » sur l’Algérie qui aurait au moins ouvert des perspectives aux populations. Il lui a été impossible de faire adopter son projet : les gouvernements de la IIIème étaient trop faibles. Il aurait pu et dû aspirer à un pouvoir fort. Cependant, il a mis en place les institutions de la IVème République, tout aussi inefficaces, dans un moment où le pays avait le plus besoin de stabilité pour gérer un calamiteux après-guerre.