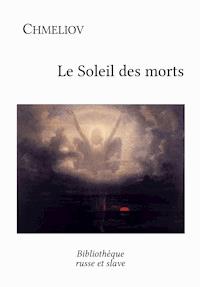Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Écrit en 1911,
Garçon ! conte le destin des pauvres gens dans une Russie entre-deux-guerres, celles de 1905 et de 1914, et entre deux révolutions, à travers la vie d'un homme, serveur de restaurant, qui voit sa famille en proie aux soubresauts de l'époque.
« C'est Dieu entrevu derrière des piles d'assiettes. » (Henri Troyat)
Traduction d'Henri Mongault, 1925.
EXTRAIT
En dépit de mon tempérament je suis patient et retenu — n’ai-je pas pour ainsi dire cuit dans mon jus pendant trente-huit ans ? Eh bien, des mots pareils me firent sortir de mes gonds. Entre quatre yeux je n’y aurais pas pris garde, mais devant Koliouchka !
— Qu’est-ce que vous fichez chez moi ? Qui vous a donné le droit d’y pénétrer ? J’ai confiance en vous, je ne ferme pas la porte à clef, et je vous trouve à fureter dans ma chambre avec des inconnus !... Si, dans vos restaurants, vous avez l’habitude de fouiller les poches, ce n’est pas une raison pour que je vous laisse bouleverser mon domicile !...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ivan Sergueïevitch Chmeliov, né à Moscou le 21 septembre 1873 et mort le 24 juin 1950 près de Paris, est un écrivain russe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Ivan Chmeliov
Шмелёв Иван Сергеевич
1873 – 1950
GARÇON !
Человек из ресторана
1911
Traduction et préface d’Henri Mongault, 1925.
© La Bibliothèque russe et slave, 2015
© Ivan Chmeliov, 1911, 1925
Couverture : Édouard VUILLARD, Scène dans un café (1910)
PRÉFACE
Encore peu connu en France, Ivan Serguévitch Chmélov n’en est pas moins un des plus grands écrivains russes contemporains.
Il est né à Moscou en 1873 dans une de ces anciennes familles marchandes qui ont pieusement conservé jusqu’à nos jours les antiques coutumes. Son grand-père et son père entreprenaient des travaux : construction de ponts, flottage de bois. C’était dans leur cour un défilé ininterrompu d’artisans, d’ouvriers de tout poil : charpentiers, menuisiers, couvreurs, peintres, pécheurs, bûcherons, saltimbanques et autres gagne-deniers. Le jeune garçon, à qui les contes d’une vieille nourrice ont déjà ouvert les trésors de l’imagination populaire, prête l’oreille aux propos savoureux tenus par ces gens de métier : dès l’enfance il acquiert auprès d’eux le sens de la langue et la connaissance des mœurs russes. Toute sa vie il se souviendra de ces humbles et leur fera dans son œuvre la part très large. En attendant, il ouvre sur la vie des yeux émerveillés. Aucune lecture ne fausse ce premier contact avec l’existence : en fait de livres, la maison paternelle ne lui offre guère que le Psautier.
Cependant, le collège, puis l’université le guettent. Il se fait même recevoir avocat, mais au bout de deux ans il dit adieu au barreau pour se consacrer aux affaires. Il passe huit longues années en province, dans ce gouvernement de Vladimir où les forêts séculaires, les vieilles églises, les confréries d’enlumineurs d’icônes voisinent avec de grands centres industriels. Il renouvelle connaissance avec ses amis d’autrefois, paysans, ouvriers, petits trafiquants, gens de peu dont bientôt il va dépeindre les mœurs.
Il arrive tard à la littérature et n’y entre que par la petite porte en publiant des contes pour la jeunesse (1906). Pourtant, ses premières nouvelles : Déchéance (de caractère autobiographique) et Le Citoyen Oukléïkine (histoire d’un savetier ivrogne et révolutionnaire), sont remarquées par la critique et valent à cet inconnu un chaleureux accueil dans les milieux littéraires. Maxime Gorki l’invite à collaborer à ses fameux recueils de La Connaissance (Znanié), où ont été publiées la plupart des grandes œuvres russes contemporaines. Il y donne d’abord Au pied des Monts, paysage criméen, puis en 1910 : Garçon !... (Tchéloviek iz restorana), court roman qui consacre définitivement sa réputation.
Le style pittoresque de ce roman, sa langue spéciale, les détails précis qu’il renferme sur les grands restaurants de Moscou firent naître la légende que l’auteur avait exercé le métier de garçon. En réalité, M. Chmélov avait à peine mis les pieds dans ces établissements : toutefois, ces courtes apparitions lui avaient suffi pour en saisir l’atmosphère et en tirer une œuvre très russe de facture mais de signification largement humaine. Elle lui valut une grande popularité parmi la corporation dont il avait décrit avec sympathie les durs labeurs : il en eut plus d’une fois des preuves touchantes et évoque avec émotion tel jour de famine où un ex-garçon, devenu sous le nouveau régime fonctionnaire notoire et pourvoyeur aux vivres, lui exprima — plus en actes qu’en paroles — sa reconnaissance.
Certains critiques russes ont comparé les mémoires du garçon moscovite au Journal d’une femme de chambre. Rapprochement purement extérieur. Mirbeau est avant tout fielleux, bilieux, coléreux. Chez Chmélov, la satire est plus dans le fond que dans la forme ; elle se tempère d’ailleurs d’une noble patience chrétienne. Le garçon ne signale pas l’injustice sociale pour le plaisir de déblatérer contre elle : il en prend prétexte — trait bien russe — pour chercher le sens de la vie, et quand il croit l’avoir trouvé, il se résigne.
M. Chmélov aussi se résigne : à la nervosité première succède un apaisement inattendu. L’artiste se replie sur lui-même, son œuvre s’illumine d’une clarté intérieure, son style châtié, travaillé, atteint une rare perfection. Les nouvelles de cette période sont de véritables poèmes, de purs joyaux, défiant malheureusement toute traduction, car chaque mot, chaque virgule y occupe la place nécessaire, chaque phrase concourt à l’harmonie générale. Citons : Le Rapide du Loup (1913), sanglot de violoncelle dans la nuit ; La Vigne (1913), lourde grappe automnale chargée de suc et de parfum ; surtout les admirables Adieux à la Vie (1913), hymne crépusculaire à la nature et à la mort, d’une pureté vraiment cristalline ; L’Inépuisable Coupe enfin (1918-19), délicieuse icône qui semble peinte avec amour par un patient enlumineur qui serait en même temps un grand poète.
Si l’on considère que ce dernier ouvrage a été écrit par M. Chmélov à la lueur d’un mauvais lumignon, aux jours les plus sombres de la révolution russe, on reste confondu devant la sérénité dont il fait preuve. Cependant, depuis la guerre, une sourde colère recommençait à gronder en lui. Pour dépeindre les effets de la tourmente dans les âmes des combattants, des petites gens, voire des nouveaux riches (La Face Secrète, 1915 ; Plaisante Aventure, 1916), sa manière redevenait nerveuse, parfois même trépidante, rappelant celle du grand Leskov à de certaines heures (Cela fut, 1923).
Fixé en France depuis l’an dernier, M. Chmélov y travaille à une œuvre immense, synthèse des événements contemporains. À en juger par le portique récemment paru en revue et intitulé Le Soleil des Morts, cette vaste tragédie est appelée à un grand retentissement. Sur l’œuvre comme sur le visage de M. Chmélov la douleur a marqué sa profonde empreinte. Continuant à évoluer dans le sens que laissaient prévoir ses pages d’avant-guerre, son réalisme s’estompe de plus en plus de mysticisme. Mais tout pantelant de blessures qui, sans doute, ne se fermeront point, c’est avec son sang qu’il nous retrace l’agonie de sa patrie. Toujours plus profond, toujours plus humain, — plus hautain aussi, — il quitte les rangs des écrivains purement russes pour se réunir à la phalange des grands artistes européens.
H. M.
I
En dépit de mon tempérament je suis patient et retenu — n’ai-je pas pour ainsi dire cuit dans mon jus pendant trente-huit ans ? Eh bien, des mots pareils me firent sortir de mes gonds. Entre quatre yeux je n’y aurais pas pris garde, mais devant Koliouchka !
— Qu’est-ce que vous fichez chez moi ? Qui vous a donné le droit d’y pénétrer ? J’ai confiance en vous, je ne ferme pas la porte à clef, et je vous trouve à fureter dans ma chambre avec des inconnus !... Si, dans vos restaurants, vous avez l’habitude de fouiller les poches, ce n’est pas une raison pour que je vous laisse bouleverser mon domicile !...
Et il nous en dégoisa !... Le plus fort — sans être même éméché ! Comme s’il craignait pour son magot !... Tout cela parce que nous lui avions donné congé. Nous ne pouvions plus y tenir. Il avait beau être chien de commissaire, il se montrait trop fier, trop méfiant. Je lui fis honnêtement comprendre qu’avec son caractère difficile et ses habitudes d’intempérance je ne pouvais plus le garder sous mon toit. Alors, furieux de me voir montrer sa chambre à d’autres, il se mit à m’invectiver.
— Pour qui me prenez-vous ? Vous me traitez comme un chien !
Etc., etc. Au contraire, toujours pleins d’égards pour lui, nous nous tenions même sur nos gardes, mon fils Koliouchka nous ayant prévenus que son emploi le rendait dangereux. J’avais justement alors avec Koliouchka de fréquentes prises de bec à propos de mon métier. Dès que le gamin eut grandi et acquis de l’instruction, il me vit d’un mauvais œil servir dans un restaurant.
Le Borgne, notre locataire — nous l’appelions ainsi entre nous, son vrai nom était Iéjov —, le Borgne avait touché l’endroit sensible. Je fouille les poches ! En m’entendant injurier de la sorte, je faillis cogner, mais le madré compère s’empressa de donner un tour de clef. Puis, par l’entremise de Loucha, mon épouse, il m’envoya un mot d’excuses : il rejetait son emportement sur le chagrin, la malchance, et nous offrait cinquante kopecks d’augmentation sur son loyer. La bonne blague : il ne nous avait jamais réglés que par cinquante kopecks à la fois ! Non, je préférais le voir déguerpir, parce qu’il commençait à nous effrayer. Il ne se montrait jamais, trouvait toujours moyen de filer en douceur. Quant à Koliouchka, nous nous disputâmes si fort ce jour-là que je finis par lui flanquer une gifle. Depuis lors il me faisait souvent des remarques déplacées.
— Vous voyez, papa, la première canaille venue peut vous montrer au doigt !
Je me taisais, songeant à part moi : « Il est encore jeune et ne connaît rien à la vie ; quand il aura vu le monde, il changera de ton ! »
C’était dur tout de même de se voir ainsi traiter par son fils ! Domestique, garçon de café... Est-ce ma faute si le sort a voulu faire de moi un laquais ? D’ailleurs je ne suis pas le premier larbin venu, j’appartiens à un restaurant de premier ordre, fréquenté par le public chic. Les petites gens n’y sont point admis : les portiers ont l’ordre de ne pas les laisser monter. Nous ne recevons que des personnes bien posées, instruites : généraux, capitalistes, négociants, aristocrates... En un mot, la crème, le gratin. C’est un art que de servir pareille clientèle : il faut savoir se tenir, éviter tout sujet de mécontentement. Et puis on ne vous accepte pas de but en blanc : nous devons subir l’épreuve du feu, passer un examen comme pour entrer à l’Université. On exige de nous une belle prestance, le visage net, sans taches, le regard sévère. On ne nous admet qu’à bon escient. Et puis il faut aussi savoir se montrer discret, veiller à tout sans en avoir l’air. En fait, nous ressemblons à des maîtres d’hôtel d’un restaurant de second ordre.
— Vous vous adonnez, disait le gamin, à un métier bas, inutile. Vous faites des courbettes aux goujats, aux mufles... Vous leur léchez les pieds pour cinquante kopecks !
Il me reprochait mes pourboires ! Mais ce sont ces pourboires, ces malheureuses pièces de cinquante kopecks obtenues à force de courbettes et de complaisances, qui m’ont permis de l’élever, de lui acheter pantalons, vestes, bottines, livres ! Que ne connaissait-il la vie ! Il aurait su que parfois on fait des courbettes, on lèche les pieds pour bien moins que cinquante kopecks ! J’en ai été plus d’une fois témoin.
Un jour, dans le salon rond, il y avait grand gala en l’honneur d’un ministre ; je faisais partie des serveurs, et je vis de mes propres yeux un important personnage, la poitrine constellée de décorations, se précipiter pour ramasser le mouchoir que monsieur le ministre avait laissé tomber. Il me devança, écarta même ma main sous la table. Comme si c’était son affaire de courir après les mouchoirs ! Si Koliouchka l’avait vu, il eût compris qui de nous deux était le laquais ! Moi, au moins, quand j’offre une allumette, le service l’exige : je remplis les devoirs de ma charge, rien de plus...
Depuis que j’ai commencé mon métier, encore tout garçonnet, je n’en ai pas changé, contrairement à certaines personnalités, et non des moindres. Aujourd’hui, on les voit plastronner à la place d’honneur, licher du johannisberg ou du champagne en levant leur petit doigt orné d’une grosse pierre qui leur sert à prendre la parole ou à taper sur leur verre ; une autre fois, dans une compagnie, on les trouve en bout de table, la voix fluette et mielleuse, sur le qui-vive comme un héron, tout tendus vers une seule direction. Je connais ça...
Mon physique vaut celui de bien d’autres. Je ressemble à l’avocat Glotanov, Antone Stépanytch, même que ça fait rire les camarades. Nous portons tous deux l’habit, mais le sien est d’étoffe plus fine et de façon plus soignée... À vrai dire, sa bedaine, barrée d’une grosse chaîne d’or, en impose plus que la mienne. Nous sommes tous deux chauves et de même poil, mais il porte toute sa barbe et moi seulement des favoris. S’il daignait se raser et arborer un numéro au revers de son frac, on nous prendrait l’un pour l’autre. Nos portefeuilles ne diffèrent que par le contenu. Le sien est bourré de traites et de billets de banque, tandis que le mien, tout aplati, ne renferme, en fait d’argent et de traites, que deux cartes de visite, celles de M. Pérékylov, avocat stagiaire, et de M. Zatsiepski, artiste lyrique — cette dernière ornée d’une couronne. Il y a trois semaines, l’oubli de leur porte-monnaie les a contraints à me signer ces reconnaissances pour les sommes respectives de neuf et de douze roubles ; depuis lors ils ne se montrent plus et croient sans doute pouvoir en esquiver le paiement, mais pas de ça, Lisette ! Les clients de ce genre ne manquent pas, et s’il fallait payer pour tous ceux qui ont oublié leur argent, je suppose que la Banque d’État n’y suffirait guère !
Il y a des purotins qui aiment à jeter de la poudre aux yeux, à se pavaner dans les grands restaurants, surtout en compagnie de gens de la haute. Ils trouvent très chic de monter nos escaliers feutrés de tapis, de souper dans nos blanches salles à miroirs. Ils oublient alors de compter, principalement s’ils traitent quelque capricieuse personne du beau sexe... Quand vient la douloureuse, leur confusion fait peine à voir : ils examinent l’addition, se troublent, et, sous prétexte de la vérifier, vous entraînent dans le corridor où, la voix tremblante, ils vous prient d’accepter leur carte. On y consent à ses risques et périls, et c’est parfois avantageux, quand pour prouver leur reconnaissance ils ajoutent à la dette un ou deux roubles. Loin de nuire à personne, cette petite opération fait marcher le commerce. Il n’y a rien là de répréhensible. Quand Antone Stépanytch déjeune avec des hommes d’affaires, il dit de fort belles choses sur les roulements de fonds, et en plus des deux immeubles qu’il possède déjà dans un beau quartier, il vient d’en acquérir un troisième, ce dont je l’ai entendu tout récemment complimenter.
Et son ami Vassili Vassilitch Kachérotov, la Providence, comme on l’appelle ! Celui-là porte toujours sur lui des billets en blanc : au moment opportun, cela lui permet de venir en aide aux fils de famille et d’en tirer bénéfice. Je l’ai vu faire son chemin, lier connaissance avec des gens si huppés que... On lui a même confié la curatelle d’un couvent de religieuses — il adore les novices. En un mot, c’est un homme influent ; on prétend même que sa spécialité lui vaut la connaissance de femmes du monde. Que ne ferait pas l’argent ! Pourtant c’est un bonhomme tout ratatiné, dont les dents gâtées exhalent à une assez grande distance leur mauvaise odeur.
Bien sûr que la vie m’a éprouvé, j’ai perdu mes cheveux, mais je ne suis point malingre, j’ai belle mine et garde mes favoris en dépit du règlement : dans notre restaurant à la française tous les garçons sont rasés. Mais notre gérant, Stross — un monsieur très bien qui possède une écurie de courses et deux maîtresses —, m’ayant remarqué un jour que je le servais, fit venir le maître d’hôtel et donna l’ordre de ne pas toucher à mes favoris.
Ignati Iélisséitch, rentrant par déférence sa bedaine, s’inclina.
— Parfait. Certains clients aiment cela... à cause de la prestance...
— Justement.
Sur cet ordre spécial du gérant, Ignati Iélisséitch m’enjoignit sévèrement :
— Soigne tes favoris. Tu peux te vanter d’avoir de la chance !
De la chance, hum ! faudrait voir ! Évidemment, j’ai meilleur air, les clients auraient honte de m’allonger seulement cinquante kopecks ; je dois avouer tout de même que dans notre métier, des favoris, c’est gênant.
Bref, j’ai de l’allure : un vrai diplomate, comme m’appelait par manière de plaisanterie Kirill Savérianytch.
Kirill Savérianytch !... De quelle monnaie a-t-il payé la bonne opinion que j’avais de lui ! Quel homme cependant ! Mieux né et un brin protégé, son intelligence l’aurait mené loin : quel champ d’action se fût alors ouvert devant lui, au lieu de ce salon de coiffure où il débite des parfums ! Il aime fort à réfléchir et note même dans un cahier ses pensées sur la vie.
Que de fois, dans des moments pénibles, il m’a remonté le moral ! Que de fois il a essayé, par de fins raisonnements, d’inculquer à Koliouchka des idées saines !
— Iakov Sofronytch, me disait-il, tu facilites aux gens l’absorption de la nourriture, tandis que je remets de l’ordre à leur physionomie. C’est la vie — et non pas nous — qui en a ainsi décidé...
Il valait vraiment son pesant d’or !
Pour en revenir à ce qui me concerne, quand je me mets sur mon trente et un et que je me regarde dans la glace, j’ai peine à croire que je sois le même homme que des clients éméchés se permettent parfois d’attraper en cabinet particulier... Je ne suis pourtant pas un rien du tout, un sans-foyer, un vagabond ; j’ai une situation, je gagne dans les soixante-dix à quatre-vingts roubles par mois, je connais les convenances, je sais me tenir avec les gens de la haute. Et puis mes enfants ont reçu une bonne instruction : mon fils à l’école Réale, ma fille au collège. Et malgré cela les gens les plus chics, ceux qui devraient comprendre, des personnes bien éduquées, qui parlent plusieurs langues, mangent délicatement, s’excusent quand elles renversent une chaise... Eh bien, des fois...
Un jour, par exemple, un monsieur fort poli, dont l’uniforme s’ornait d’une plaque ronde, accompagné d’une dame en grand chapeau à plumes, dont je n’ignorais certes pas les origines, me traita de butor, parce qu’en leur servant un plat de poisson je n’avais pu éviter de les frôler, tant ils se pressaient l’un contre l’autre. Je m’excusai, bien entendu : que pouvais-je faire d’autre ? Mais je n’en sentis pas moins l’offense. Il me donna un rouble de pourboire, non pas pour réparer, mais histoire de jeter de la poudre aux yeux, de parader devant la donzelle. Avec son esprit fertile, ingénieux, Kirill Savérianytch mit l’incident sur le compte d’une absence dont seraient souvent victimes les gens les plus célèbres. C’est possible, et quand même ce n’est pas bien ! Il m’a parlé d’un livre où un savant proclame que le travail ennoblit, qu’aucune injure ne saurait l’atteindre : comme si je ne le savais pas ! Quand on est à l’abri des avanies, il est facile de prendre les choses par le bon côté. Kirill Savérianytch en parle à son aise : si quelqu’un le traitait de butor, il porterait aussitôt plainte au juge de paix. Tandis que nous, un esclandre nous ferait mettre à la porte : impossible alors de trouver une place dans un autre restaurant de premier ordre, tout le monde serait vite au courant. Un savant peut écrire tout ce qu’il veut dans ses livres, personne ne songera à l’appeler butor. Mais s’il était dans notre peau, si pour un rouble le premier venu avait le droit de le traiter de haut, il entonnerait une autre chanson.
Je les connais, les savants. Un soir que quelques-uns fêtaient un de leurs collègues, un petit chauve qui venait de publier un livre, ils brisèrent pour plus de dix roubles de vaisselle. Les clients n’ont pas l’air de se douter que, sur l’ordre de la direction, le maître d’hôtel nous fait payer la casse... Impossible de les importuner pour de pareilles vétilles, ils s’offenseraient ! Ils discutent, s’échauffent, choquent leurs verres sans y prendre garde... et vous soutirent bel et bien un rouble de la poche ! Quand on voit un Antone Stépanytch absorber, avec accompagnement de vins fins, les plats les plus recherchés, on se demande ce qu’il a bien pu faire pour être si riche... Pas moyen de comprendre. Il est vrai que ses amis eux-mêmes le traitent ouvertement de fripon.
Je n’invente rien. Messieurs les administrateurs de la société industrielle dont Antone Stépanytch défend les intérêts devant les tribunaux donnaient leur dîner annuel. Il y avait là toutes sortes de capitalistes et même le fameux millionnaire Goustchine, connu du monde entier. Eh bien, j’ai vu ce monsieur Goustchine taper sur la cuisse d’Antone Stépanytch, je l’ai entendu lui décocher :
— Décidément, tu es un fieffé fripon, vieux frère !...
Parmi les éclats de rire, Antone Stépanytch avoua d’un air goguenard qu’il avait, en effet, plus d’un tour dans son sac. Au dessert arrivèrent ces demoiselles les Françaises, et l’une d’elles, par complaisance pour monsieur Goustchine, voulut aussi traiter Antone Stépanytch de fripon. Monsieur Glotanov, qui bien sûr n’avait plus sa tête à lui, s’emporta :
— La première... venue se permet !
Même qu’il employa une expression très raide et eut un geste fort violent. Il s’ensuivit un tel scandale que, sans le bon renom de notre restaurant, l’affaire tournait mal. La robe de la demoiselle était toute souillée de caviar : ils en avaient renversé un tonnelet entier. Ah ! J’en ai vu de toutes les couleurs !
Combien de ces malheureuses créatures ont défilé devant moi ! Pures et innocentes, elles se sont un jour laissé séduire et jeter en pâture au trottoir. Personne ne s’en est soucié... Parfois, le soir, ma prière faite, je me couche et perçois, de l’autre côté de la cloison, le souffle léger de ma petite Natacha... Je me prends à songer... Que lui réserve la vie ? Elle n’héritera de nous ni coupons, ni valeurs, ni maison de rapport, comme nos anciennes propriétaires, les demoiselles Poupaïev.
II
Nous menions une vie paisible, quand tout à coup le tourbillon nous emporta...
C’était un dimanche. Bien que Koliouchka dénigrât mon zèle religieux, j’avais assisté à la première messe et prenais mon thé sans me presser, profitant de ce que notre restaurant n’ouvrait ce jour-là qu’à midi. Nous savourions des petits pâtés aux choux en compagnie de mon ami Kirill Savérianytch, le coiffeur, que la clarté de sa voix pendant la lecture de l’Épître avait mis de fort belle humeur. Aussi dissertait-il sur la vie et sur la politique. Suivant sa très juste expression, la semaine étant consacrée à un travail acharné, le dimanche devait être réservé pour des entretiens profitables.
Et comme nous en vînmes à parler de la religion et de la foi au Créateur, je me pris — par manque d’instruction, m’affirma ensuite Kirill Savérianytch — à reprocher aux savants de trop se fier à leur cerveau et de ne pas vouloir admettre l’existence de Dieu. Fort chagriné que Koliouchka n’allât jamais à l’église, j’ajoutai qu’il était amer de donner de l’instruction à ses enfants, car elle pouvait les mener à leur perte. Alors mon Koliouchka de répliquer :
— Vous êtes dans l’erreur, papa, et ne comprenez rien à la science.
Il était si offusqué qu’il en cessa de manger.
— Oui, reprit-il, vous ne comprenez rien à la science, ni même à la foi et à la religion !...
Moi, ne rien comprendre à la foi et à la religion !Je voulus lui rabattre le caquet...
— Tu n’as pas le droit de parler ainsi à ton père ! Bien sûr que je ne connais pas toutes tes sciences et que je n’ai pas étudié, disons, la géographie ; cependant je t’éduque de manière que tu vives en homme distingué et non en larbin, ainsi que tu m’appelles.
Il eut un soubresaut.
— Sans la religion, j’aurais depuis longtemps désespéré et mis fin à mes jours. Et toi, tu as beau t’instruire, tes sentiments n’en deviennent pas plus nobles... Voilà ce qui me chagrine...
Kirill Savérianytch hocha la tête en signe d’assentiment, mais Koliouchka se rebiffa.
— Je n’ai que faire de vos remontrances ! Si je vous disais tout ce que j’ai sur le cœur, vous comprendriez ce qu’est la vraie noblesse. Et quant à vos prières, Dieu s’en soucie peu, si tant est qu’il existe !
C’était par trop fort ! Tandis que je lui parlais foi et religion, il s’entêtait dans ses errements... Je me maudissais d’avoir voulu en faire un savant. Il amenait des brassées de livres et passait les nuits dessus : que de pétrole il me brûlait ! Et ce poitrinaire de Vassikov, l’employé de chemin de fer, ne le lâchait pas d’une semelle... Aussi était-il devenu tout maigrichon et méchant comme la gale...
Pour cette mauvaise parole sur le Créateur, je le menaçai du doigt, et Kirill Savérianytch, la bouche tordue dans un geste familier, lui décocha une de ces œillades ! Mais l’autre, dressé sur ses ergots, invectiva contre chacun en termes si violents que Kirill Savérianytch se prit à toussoter et à jeter des regards inquiets par la fenêtre.
— Vous avez perdu votre peine, criait-il. Je sais de quelle noblesse vous entendez parler. La poche pleine, n’est-ce pas ?
Il tapotait la poche de son veston.
— Eh bien, je préfère casser des pierres que de vous procurer ce plaisir !
Un vrai forcené ! Et moi qui m’étais tant démené pour lui ! Si monsieur le directeur avait consenti à lui accorder une bourse, c’est que, chaque fois qu’il venait au restaurant, je me mettais en quatre pour le bien servir et priais le chef, Alexiéi Fomitch, de soigner particulièrement ses commandes. Même que je lui exposai trois fois ma situation par écrit, et que bien souvent je lui obtins, grâce à mes accointances avec le contrôle, des réductions sur l’addition. Et voilà quelle était ma récompense !
Kirill Savérianytch voulut à son tour raisonner Koliouchka ; il lui dit des choses admirables :
— Vous êtes jeune, impétueux, vous n’avez pas encore pénétré le fin fond des sciences. Les sciences conduisent graduellement l’homme à la véritable noblesse, lui donnent la clef éternelle du bonheur. Ainsi, par exemple, s’il n’y avait pas de machines, moi qui suis coiffeur, je mettrais dix bonnes minutes à opérer une coupe de cheveux — et encore parce que je connais très bien mon métier — tandis qu’avec une tondeuse je n’ai besoin que d’une minute. Il en va de même partout. À l’heure actuelle, à l’aide des machines, on extrait de l’air toutes sortes de choses, jusqu’à du sucre. Un temps viendra où les savants inventeront des machines qui feront tout elles-mêmes. Quand nous en serons là, tout le monde se reposera au sein de la nature. Voilà pourquoi il faut étudier les sciences, et c’est ce que font les gens instruits et bien élevés. En attendant, résignons-nous, croyons à la divine Providence. Voilà, jeune homme, ce qu’il ne faut pas oublier !
J’approuvai pleinement ces sages propos, mais Koliouchka ne se rendit pas et déversa sur Kirill Savérianytch un flot de paroles :
— Laissez là vos sornettes !... D’après vous, le cheval doit crever tandis que l’herbe pousse ? Vous en parlez à votre aise, vous dont toute l’occupation consiste à débiter des parfums, à raser les gens, à les poudrer, à les teindre, à dissimuler leur calvitie !...
Atteint dans son amour-propre, Kirill Savérianytch s’emporta jusqu’à l’enrouement.
— Étudiez d’abord l’Évangile et après je discuterai avec vous ! Je connais la philosophie ! J’en remontrerais à votre professeur...
Il se frappa la poitrine. Mais mon garnement ne se tint pas pour battu... Il lui rendit vingt mots pour cinq... Il avait, lui aussi, de la lecture.
— Ah ! ah ! L’Évangile !... Je le connais aussi bien que vous ! Voulez-vous que je vous expose tous les points de votre croyance, que je vous explique mathématiquement toutes vos machines, que je vous prouve que le monde n’est que misère ?... Est-ce cet Évangile-là qu’il vous faut ? L’Évangile !... Vous vous en servez pour y tenir votre comptabilité !...
Il hurlait comme un possédé, arpentait la pièce, gesticulait, menaçait du poing. Que voulez-vous, le bon Dieu l’a fait bouillant, irascible !... Ce qu’il en dégoisa sur la vie, la politique et bien d’autres choses ! Il appelait les gens par leurs noms, ne ménageait même pas les plus respectables. Il citait l’histoire, remontait aux origines. Oui, on voyait qu’il avait de la lecture ! Voilà la vérité, affirmait-il, et c’est ainsi qu’il faut vivre, et c’est cela qui s’appelle bien penser !
Kirill Savérianytch, la bouche tordue, semblait tout penaud. En réalité, il préparait sa réplique. Il commença d’un ton fort poli, en esquissant un beau geste :
— Vous détournez la question et vous vous payez de mots. Toutes vos assertions ne sont que phrases creuses. Il en va autrement dans la vie. Donnez-vous la peine de réfléchir et vous saisirez le fond des choses. Je m’y entends parfaitement en politique, et j’estime que...
Mais Koliouchka donna un si violent coup de poing sur la table que la vaisselle en tressauta. Ah ! c’est un gaillard, trop emporté malheureusement !
— Eh bien, laissez-nous réfléchir, et pendant ce temps-là rafraîchissez les binettes !
Sans prendre garde à cette insolence, Kirill Savérianytch continua d’une voix calme :