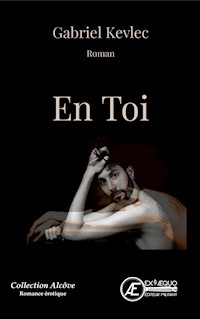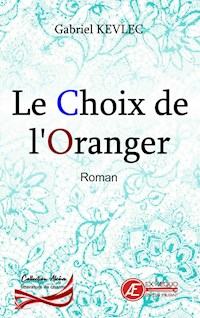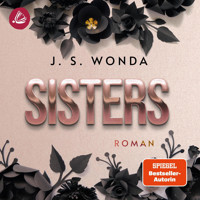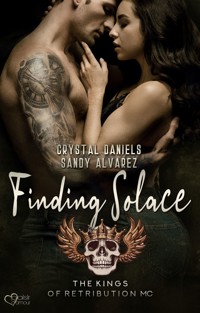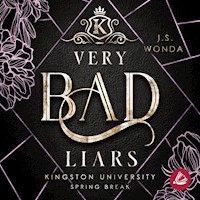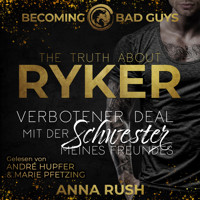Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
« Certaines histoires restent gravées dans le bois ou dessinées dans la neige à tout jamais. »
Tel est l’incipit du journal de Florian Audriat, décédé en 2015, père de Camille et de Cédric.
Leurs deux parents disparus, ils décident de vendre la maison familiale et s’y rendent pour la dernière fois. En triant les affaires de leur père, ils dénichent des carnets d’écolier qui vont les bouleverser à jamais.
En 2013, mû par une nécessité viscérale, Florian y a couché par écrit certains chapitres de sa vie. Ceux qui racontent son grand amour se résumant à une seule lettre : C.
Le premier débute en 1961, à son arrivée à l’internat de Mercury, en Savoie. Les suivants révéleront des secrets inavouables à son époque, toute une vie clandestine.
Sous le ciel de
La Nuit Étoilée sur le Rhône de Van Gogh, Florian et C. rêvent. Au son d’un vieil album vinyle des Drifters, C. et Florian dansent. En témoignent ce noisetier qui fleurit en plein hiver, et cette figurine sculptée qui ne tient pas debout.
Et parmi les encres du passé, une interrogation lancinante s’impose à Camille et Cédric : qui est C. ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gabriel Kevlec est un poète à la petite semaine, né au moins deux siècles trop tard, un pornographe romantique, un fou amoureux, entre folie douce ou folie furieuse. Il compose ses vers et ses phrases à la main, entre les portées des musées et les allées des morceaux de violons, ou alors est-ce l’inverse ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Kevlec
Garde-moi la dernière danse
Romance
ISBN : 979-10-388-0402-9
Collection : Vibrato
ISSN : 2825-3213
Dépôt légal : septembre 2022
© couverture Ex Æquo
© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Éditions Ex Æquo 6 rue des Sybilles
88370 Plombières Les Bains
www.editions-exaequo.com
À lui que j’ai aimé,
que j’aime,
que j’aimerai,
sous le même ciel,
même de loin,
le cœur sur la main…
Nous limitons volontairement le nombre de pages blanches dans un souci d’économie des matières premières, des ressources naturelles et des énergies.
Préface
« Garde-moi la dernière danse » annonce la couleur. Celle du définitif, de l’irrémédiable, de l’inéluctable. Celle d’un amour qui se délecte sous un ciel d’étoiles, s’emporte dans une chambre d’internat, survit au départ, et se nourrit de moments volés.
Jusqu’à la dernière danse.
Celle qui permet à deux êtres de se perdre dans leur propre tempo, de s’alanguir dans des soupirs de bonheur, de composer les mêmes respirations de cœur, d’accorder leurs pas et de tenir jusqu’à la note finale. L’ultime mouvement.
Le geste éternel de l’amour, l’universel, l’intemporel amour. Celui qui vous fait tenir, quelle que soit l’absurdité de l’interdit édicté par des soi-disant penseurs du bien et du mal.
Gabriel Kevlec signe avec ce quatrième roman une histoire à vous couper le souffle, à vous attraper le cœur, à vous arracher votre temps. Pour celles et ceux qui connaissent ses autres œuvres, vous pourriez rétorquer que ce n’est pas un scoop.
Certes.
Mais.
Je tiens à vous alerter pour celui-ci : enfermez-vous à double tour pour le lire, prévenez vos proches que vous ne serez là pour personne et ce jusqu’à la dernière page, et munissez-vous de mouchoirs.
Beaucoup.
Ne venez pas me dire ensuite que je ne vous aurais pas prévenus !
Jeanne Malysa
1
14 janvier 2015
— Allô ?
— Camille, c’est Cédric…
— Je sais, frérot, j’te rappelle que ton nom s’affiche quand t’appelles. Enfin, peut-être pas sur ton portable du siècle dernier, tu me dir…
— Camille…
Blanc.
D’instinct, je reconnais ce silence qui précède les mauvaises nouvelles. Lourd. Palpable. Le souffle retenu du monde entier. La dernière fois que le téléphone a résonné de cette façon, c’était le jour de l’accident de maman. On n’oublie jamais ce genre de silence. Mon ventre se creuse d’un trou noir qui arrache le quotidien à son lit tranquille, le fige peu à peu dans une lise poisseuse, le sable mouvant des sorties de route. Comme un réflexe, mes doigts agrippent une mèche noir corbeau et tirent dessus, l’entortillent jusqu’à ce que cela fasse mal. Au diapason des pulsations qui battent sous mon cuir chevelu torturé, la douleur égrène le temps qui crachote, ralentit.
Vingt-quatre images seconde. Dix. Cinq. Deux. Une.
Stop.
Telle une gamine devant son premier film d’horreur, je ferme les yeux. Tropisme ridicule. Dans la vraie vie, les cauchemars passent sans problème le mur des paupières.
— Camille… C’est papa. Il est mort.
— Encore ?
Ça m’a échappé.
L’étude de ce notaire est un plateau de jeu grandeur nature. Depuis ces larges fauteuils à l’assise rembourrée disposés de façon parfaitement symétrique jusqu’aux étagères de bois sombres où pas un livre ne dépasse, tout semble factice. Étrangement figé. J’ai l’impression d’être entrée par effraction dans les coulisses du dungeonverse{1}, dans un de ces bureaux confidentiels qui régissent en secret le grand ordonnancement du dehors. Ici, on établit les règles de la campagne, on signe des accords de collaboration, on se partage des biens, on dépouille des moribonds… Le Maître du Jeu garde sur ses étagères les milliers de fiches-personnages, arbitre les conflits, et veille au respect des lois naturelles. Sous ses fenêtres, des PNJ{2} vont et viennent, leur libre arbitre-mirage en bandoulière. Leur fin de partie est déjà prévue, écrite, signée et cosignée, et, tout en poussette qu’ils soient, doudou et tétine dans l’inventaire, les joueurs suivants sont déjà prêts à looter{3} leurs cadavres au premier signe de faiblesse. Exaltant. Sordide.
Celui qui entre sans un mot et s’installe sur le grand fauteuil rouge face à nous honore la tradition et commence par un bref rappel des arcs de la campagne précédente.
— Alors… monsieur Cédric Audriat, madame Camille Audriat, vous êtes ici pour liquider le testament de feu Monsieur Florian Audriat, votre père, étant les seuls héritiers testamentaires vivants depuis le décès de votre mère, Madame Lucie Audriat, née Jory, le dix-sept août 2003.
— Euh… Oui.
Cédric répond à la non-question en tordant ses doigts comme un gamin à qui on demande de réciter une poésie qu’il n’a pas apprise.
Je regarde mon petit frère avec tendresse. Les deux années qui nous séparent ne l’ont jamais empêché de se poser en protecteur, en gestionnaire de tout lorsque plus rien n’allait, moi la première. L’habit de responsabilités lui va bien, alors qu’il jurerait par-dessus les résilles noires planquant sur mes bras les stries blanchâtres, scories de tristesse en barreaux d’échelle lancées vers un ciel où maman est partie sans prévenir. Le notaire doit le sentir, l’ayant cité en premier. Ou alors c’est un petit éclat de sexisme ordinaire, qui sait… Aucune importance.
— Selon ses souhaits exprimés par écrit dans le contrat qu’il a signé ici même en 2013, et confirmés par l’acte de notoriété établi par mon collaborateur et moi-même, vous héritez donc de la totalité des valeurs mobilières et immobilières listées dans le bilan de patrimoine, à savoir la propriété sise au lieudit Mercury, communauté d’agglomération Arlysière, Savoie, ainsi que des biens qui y sont conservés. Vous devenez également les seuls bénéficiaires en indivision des liquidités rapportées par les futures ventes et exploitations des œuvres actuellement en circulation. Je vais procéder au plus vite à la déclaration de succession auprès des services fiscaux. Monsieur Audriat, vous m’avez précisé par téléphone que vous ne souhaitiez pas rompre l’indivision. Madame Audriat, vous confirmez cette requête ?
Un petit silence s’installe, griffé par le tripotage nerveux d’un trombone complètement déformé. Je ne suis même pas sûre de comprendre la question. Je jette un coup d’œil vers Cédric qui opine de la tête. Je dois visiblement répondre « oui, on garde l’indivision » alors qu’en moi tout s’est déjà divisé. Âme scindée. Cœur pulvérisé. C’est un miracle si tout demeure encore d’un seul tenant. Le pantin chenu qui soliloque sans me regarder dans les yeux a-t-il jamais eu un père pour poser ce genre de question ?
— Euh… Oui. Oui, on va tout garder ensemble.
Visiblement satisfait que je n’interrompe pas trop longtemps sa prestation, le notaire reprend son monologue.
— Fort bien. Alors la suite sera plutôt rapide. Vous allez recevoir d’ici la fin du mois de la part du cabinet un récapitulatif des honoraires et débours ainsi qu…
Lasse, je coupe le son. Sur son visage à l’immobilité et à la neutralité de cire, ses lèvres s’agitent comme si elles étaient indépendantes du reste de la face, deux grosses sangsues un peu desséchées se tortillant douloureusement pour s’échapper de cette statue d’argile. J’ai presque envie de les aider, de tendre la main vers elles, d’enfoncer mes ongles dans cette glaise blême pour les en arracher dans un sublime jet de sang rubicond qui viendrait foutre en l’air le document bien propre facturé plus de deux cents euros la feuille. Je me demande si, à ce prix, ils le réimprimeraient ou si dans notre dossier figurerait pour toujours une liasse de feuillets à l’odeur rance et métallique d’un pétage de plombs en règle.
— Camille ? Tu viens ?
Debout à côté du fauteuil où je me suis affaissée sous le poids du discours, Cédric me jette un regard où brille cette lueur d’inquiétude que je ne connais que trop. Elle hante ses pupilles depuis des années, arrose le noir que le deuil a collé à mes cheveux, mes vêtements et mes ongles, éclabousse les fantômes de sourires que je dispense désormais avec une parcimonie proche de l’ascèse.
Je me redresse un peu trop vite, et ma hanche cogne contre le coin du grand bureau de bois avec un bruit sourd, laissant présager un bel hématome.
Il faut croire que chaque expérience douloureuse laisse ses marques.
Le notaire nous raccompagne jusqu’à la porte du cabinet, ponctuant ses pas de banalités d’une absolue platitude, et se fend même d’un « Bonne journée ! » avant de faire demi-tour et de nous laisser sur le trottoir, tout chargés de papiers nous donnant l’autorisation de piller et disperser les restes d’une vie.
De solder ce qui fut mon père.
Une bonne journée, vraiment ?
***
2 février 2015
La petite citadine de Cédric traverse à grand-peine le jardin qui a dû être un jour d’une inégalable beauté, mais qui aujourd’hui ressemble à un terrain vague laissé aux affres du temps et aux squatteurs potentiels. Au-dessus de nos têtes, le fort de Tamié perce le jour qui se lève à peine et nous juge de sa haute et imperturbable stature ; le ciel bas et lourd me rend presque claustrophobe.
Je n’ai jamais aimé la Savoie, ses montagnes en dents de piège à loup, ses habitants aussi renfermés que les vallées où le soleil ne pénètre jamais. Mille fois mes colères adolescentes avaient exigé que l’on quitte cet endroit. Je voulais l’ivresse du monde, je rêvais l’étourdissement de la ville, le métro, les gens pressés, le temps qui manque toujours, cette exaltation furieuse que je voyais comme la plus glamour et la plus épanouissante des façons de vivre. Des années plus tard, Paris avait fini par m’offrir tout cela, au prix exorbitant d’une solitude à fendre les pierres, mais ça, je ne l’avais jamais avoué à papa. Fierté mal placée sans doute.
Quand maman s’éteignit, les liens qui nous nouaient tous devinrent soudainement très lâches. Enlevez la pierre de voûte d’une arche et c’est le château entier qui s’écroule. Quinze jours après son enterrement, prétextant des études de Game Design{4} que seule la capitale pouvait m’offrir, j’avais fui cette terre de ruines et ma famille amputée sans un regard en arrière. Quelques années plus tard, ce fut au tour de Cédric de boucler ses valises ; il posa ses cartons dans un deux-pièces à Grenoble, suffisamment près pour faire l’aller-retour chaque weekend, puis un passage rapide aux vacances, puis un simple coup de fil aviné au Nouvel An.
Papa n’avait jamais eu l’air de nous en vouloir. On lui avait bien proposé de nous rejoindre et de s’établir dans une de ces deux villes, lui vantant l’accessibilité de Grenoble et l’amour de l’art des Parisiens. Il aurait pu y installer l’atelier où les talents qui l’avaient rendu célèbre se seraient épanouis encore davantage, mais il s’y était toujours fermement opposé avec un gentil sourire. Ce morceau de pays, c’était sa terre, et ce tas de vieilles pierres, sa maison. Que pouvait-on répondre à de tels arguments…
Au bout du jardin ensauvagé, la bâtisse hors d’âge nous a vus arriver et nous réserve un accueil des plus sinistres. La lourde porte grenat cent fois repeinte semble n’attendre qu’un coup d’épaule pour dégueuler ses remontrances acides. Une bouche rouge de monstre ou de marâtre de conte.
Dans l’alignement du bâtiment principal, la vieille grange abritant l’atelier de mon père se laisse manger par les ronces et le lierre. Les racines d’un noisetier tout tordu en défoncent le seuil.
Tout ici paraît caustique. L’air lui-même est chargé d’amertume et d’une brume lourde qui refuse de s’arracher à ce flanc de montagne, tentant de nous y enfermer nous aussi.
— Bon… Ce que je te propose : on fait un petit tour rapide, voir ce qu’on veut garder et ce qu’on peut vendre ou bazarder. Le mec de l’agence m’a dit qu’il passerait dans la semaine pour une estimation, mais que pour un bâtiment comme ça, ça pouvait aller très vite. Et de toute façon, je n’ai pu arracher que trois jours à mon chef. Bref, on doit le vider pour hier. J’ai déjà appelé une entreprise qui peut nous débarrasser de presque tout ce qu’on ne garde pas pour trois fois rien. Et j’ai loué un garde-meuble à Grenoble pour les trucs à stocker en attendant de savoir quoi en faire… Camille ? Tu m’écoutes ?
— Oui, oui…
Non.
Devant cette façade blanche et grise, je me sens minuscule. Minable, aussi. Depuis combien de temps n’ai-je pas mis les pieds ici ? Combien d’anniversaires, de Noëls, combien d’années papa a-t-il passés seul ici à donner à son bois chéri des formes humaines pour habiter le silence ? Je pensais avoir encore le temps, et puis c’était loin, et puis j’avais du travail, et puis… Des excuses, tout ça. Rien que des excuses.
Les rares fois où je daignais m’arrêter ici quelques heures, papa m’accueillait avec un grand sourire. Pas un reproche, même voilé, n’était prononcé. Que me dirait-il aujourd’hui ? Je ne sais pas.
Si, je sais.
« Quand le moment sera venu, tu verras derrière le ciel, ma chérie… ». Il me répétait ça tout le temps, tel un mantra.
Dans ma tête, sa voix douce et claire résonne encore avec tant de netteté que si je ferme les yeux, je peux presque le toucher. Instinctivement, je lève la tête, mais rien ne perce l’épaisse couverture de nuages gris. Un ciel de cendres. Il faut croire que le moment n’est pas encore venu.
Je m’attendais à un grincement sinistre, mais la lourde porte d’entrée s’ouvre sans un chuintement sur un hall presque vide. Un peu de poussière habille les quelques meubles ; en dehors de ce détail, rien n’a changé depuis la dernière fois que j’ai franchi ce seuil.
Sur la droite, dans le grand salon, trône encore l’immense table de chêne qui a accueilli des générations entières d’enfants perdus à l’époque où la bâtisse était encore un rejeton de l’Assistance publique. À gauche, les murs de la bibliothèque gardent jalousement des centaines d’ouvrages aux couvertures écornées religieusement triés par collection, par auteur, par couleur, trahissant l’obsession de mon père pour l’esthétique de l’ordre. Au fond du hall, un escalier en colimaçon mène aux chambres et, un étage plus haut, au grenier. Sa rampe de fer forgé à la courbure de serpent a acquis sous la caresse de milliers de mains une douceur et un lissé tels que, même adulte, on ne peut s’empêcher de s’imaginer s’y asseoir pour se laisser glisser. Une telle hardiesse m’a valu à six ans une dent cassée et une semaine de privation de jeux extérieurs, mais je souris au souvenir tendre de ce qui représentait alors une folle transgression des règles établies.
Pragmatique, efficace et sans perdre de temps, Cédric a grimpé l’escalier, le carnet de notes à la main, pour débuter l’inventaire des chambres. Lasse avant même d’avoir commencé, je me résigne à le suivre avec toute la lenteur de la mauvaise volonté, m’offrant le luxe de laisser traîner mes yeux sur un passé révolu qui paraît ici plus proche que nulle part ailleurs.
Chaque meuble est à sa place, solidement ancré au vieux parquet ou aux tomettes ébréchées du carrelage. Pas de bibelot, peu de photos, seulement de l’utile. Du nécessaire. L’ensemble donne l’impression d’une maison de passage, un de ces gîtes appartenant à tous, donc à personne, et au sein desquels ne subsiste bien souvent pas même le souvenir des gens qui y ont laissé quelques jours. Des murs de pierres à nu renforcent encore cette sensation de froideur, de dureté, le même mélange algide que l’on retrouve sur les traits des gens d’ici. Que l’on retrouvait sur ceux de papa.
S’il avait toujours été un père aimant et attentionné, distribuant sans compter les câlins et les mots d’amour, ce pays l’avait semble-t-il peu à peu contaminé, figeant son visage et ses yeux gris dans un masque de gravité qu’il arborait dès qu’il était seul ou lorsque la fatigue gommait son sourire. Il avait alors cette lueur de mélancolie singulière dans les pupilles, comme s’il se voyait déjà inhumé dans ce sol qu’il avait été incapable de quitter. La petite fille que j’étais avait la certitude que c’étaient ces murs et ces montagnes qui rendaient triste son papa, et j’avais haï cette région avec deux fois plus d’ardeur, sans comprendre pourquoi il s’obstinait à rester. L’adulte que je suis devenue a fini par admettre que, à l’instar de tous ceux qui ont grandi ici, papa chérissait ces forêts de malheur dont il ne parvenait à s’arracher. Un syndrome de Stockholm régional qui avait peu à peu creusé une volée de rides profondes sur ses tempes et un trou de plus au cimetière, gueule ouverte de cette terre vorace réclamant son tribut.
— Camille ! Viens voir !
La voix un peu étouffée se répercute en écho dans la cage d’escalier, renforçant encore les accents d’une émotion que Cédric n’a pas pris la peine de cacher. Je presse le pas, curieuse de voir ce qui avait réussi à sortir mon frère de sa rigueur militaire.
— T’es où ?
— Grenier ! Fais gaffe, les trois dernières marches sont raides.
Les ampoules nues lancent sur les poutres de la charpente une lumière chaude, créant des ombres innombrables sur le capharnaüm qui a envahi tout l’espace disponible. Le grenier a beau être immense, occupant une surface équivalente à celle du rez-de-chaussée de la bâtisse, les dizaines de meubles et d’objets entassés là installent l’impression d’une oppressante exiguïté. Paradis de chineur, enfer de fossoyeur…
Maladroite, je cogne mon genou contre une armoire, perds l’équilibre et me rattrape de justesse à une poutre, manquant de peu de passer la main à travers une peinture encadrée qui y est suspendue. Se déplacer relève du niveau final du jeu Fantasia{5}, et je m’attends à tout moment à ce qu’une plateforme cède sous mon poids, me renvoyant au jardin-point de départ en un sadique respawn{6}.
Agenouillé sur le parquet sale devant un grand coffre de bois, une toile d’araignée accrochée à ses cheveux, Cédric examine ce qui m’apparaît d’abord comme un ancien livret d’école. Ses yeux brillent de surprise, les miens sourient de voir intact l’enthousiasme de mon frère pour tout ce qui concerne le professorat d’antan. Animé d’une telle passion, il doit être un formidable instituteur. Devant lui, le vernis de la huche renvoie la lumière en un doux miroitement qui perce la poussière. Même de là où je me trouve, je peux reconnaître dans la facture du bois et les finitions du couvercle ouvragé le travail soigné de mon père. Dévorée de curiosité, je le rejoins et jette un coup d’œil avide à ce qui semble tant l’émerveiller.
Rangés en piles régulières, de fins carnets d’écolier sont entreposés par dizaines, soigneusement reliés par des bandes de tissu effilochées et jaunies par le temps. Cédric a libéré du premier lot le tout premier de ces ouvrages. Leurs couvertures noires un peu ternes, leurs coins parfois cornés, trahissent un âge certain. Peut-être datent-ils de l’époque où l’on enseignait ici et partout ailleurs un roman national largement biaisé.
Alors que je déplace les piles pour estimer le nombre de carnets rangés là, un bruit sec se fait entendre depuis l’intérieur du coffre. Dérangé dans son sommeil, un petit objet a chuté entre les livrets jusqu’au fond baigné d’obscurité. À l’aveugle, je plonge ma main pour dénicher le trésor.
Sous mes doigts, je reconnais sans mal, pour l’avoir déjà éprouvée mille fois, la douceur toute particulière que recèle un bois longuement poncé et verni. Je mets au jour un personnage grand comme la paume et sculpté dans une essence souple et claire, presque rosâtre. Les heures passées à espionner mon père dans son atelier m’ayant laissé en mémoire le nom des principaux arbres de nos forêts, j’identifie sans mal un bois de noisetier assez jeune. Les coups de ciseau sont plutôt malhabiles, le travail un peu hésitant, et peu de détails ont été modelés : une tête avec un nez étrangement long et pointu, un corps rond et sans bras, deux grosses jambes soudées et un socle à l’arrondi grossier. S’il s’agit là d’une création paternelle, elle doit être l’une des premières, gardée là telle une relique, et cela la rend plus précieuse encore.
Curieuse, je me lève pour regarder l’objet à la lumière du jour filtrant péniblement à travers le velux poussiéreux. L’éclairage naturel révèle les imperfections du vernis, et une petite rainure en forme de virgule sur la tête, sans doute le fruit d’un dérapage de biseau. Sous le socle, une étrange saillie intrigue ma paume. Retournant le sujet, je ne peux retenir un sourire attendri devant le motif ressortant grâce à une délicate ciselure : un cœur en relief flanque la base de la petite sculpture. Le soin apporté à cet ornement, son absolue symétrie résultat d’un long et minutieux travail au bédane et à la râpe, tout dans ce motif contraste avec son emplacement, comme si on avait voulu dérober sa perfection aux regards. Je m’agenouille et pose la figurine sur le plancher sale, mais elle refuse de tenir debout, l’enjolivement amoureux la privant de toute stabilité. Une figurine qu’on ne peut même pas exposer : joli raté, papa !
— Cédric, regarde par ici ! Ça doit être un des premiers travaux de papa…
Pas de réponse.
Je jette un coup d’œil dans sa direction, prête à me répéter pour le sortir de la lecture intégrale des carnets qu’il a visiblement entreprise, mais une brillance singulière dans ses pupilles me vole la parole. Mon frère semble profondément ému. Plus que ça, il paraît bouleversé.
— Cédric ? Ça va ?
Il relève la tête, et mon cœur manque un battement lorsque je crois apercevoir dans ses yeux des larmes agglomérées qui menacent de déborder à tout instant. La dernière fois que j’ai vu mon frère pleurer, c’était pour la mort de maman, il y a douze ans. Sans un mot, il me tend le carnet.
Glissant la figurine dans la poche de mon imperméable, je le rejoins et prends délicatement le cahier, reconnaissant immédiatement l’écriture de mon père. C’est celle des cartes d’anniversaire et de Noël, l’écriture d’un adulte que la myopie et la sénescence ont un peu agrandie, un peu tordue. Si les feuilles datent bien de plus d’un demi-siècle, leur contenu est beaucoup plus récent. Sous le regard un peu perdu de mon frère, je tourne rapidement les pages jusqu’à la première. Pour seul titre, elle est chapeautée d’une date : 24 novembre 2013.
2013… C’est l’année terrible au cours de laquelle un premier AVC a laissé papa sur des béquilles, incapable de travailler. L’année où la peur l’a visiblement poussé à prendre ses dispositions chez le notaire. L’année de la grande dispute aussi, lorsque Cédric et moi avons exigé qu’il s’installe dans une résidence médicalisée où il pourrait être veillé nuit et jour. Son refus de quitter ces murs avait jeté sur nous le voile de la culpabilité, nous forçant à engager une assistante de vie et à l’appeler un peu plus souvent pour vérifier qu’il ne gisait pas inconscient au pied des escaliers. Il décrochait à chaque fois, mais ne disait souvent pas un mot, l’élocution lui ayant été presque entièrement volée par cet embole vicieux venu se loger dans sa tête. Las de combler le silence, nos appels s’étaient espacés. Peut-être étions-nous partis du principe que les mauvaises nouvelles finissent toujours par arriver, de toute façon.
L’année suivante, le 2 octobre 2014, le deuxième AVC était venu confirmer cette règle, et nous pûmes suivre en direct au téléphone le transport de son corps inerte qu’un palpitant têtu s’escrimait à maintenir en vie. Une chambre d’hôpital toute blanche avait accueilli son coma tout gris, et les coups de téléphone avaient cessé, remplacés par les bips sans fin des machines monitorant sa déchéance. Que restait-il à dire, de toute façon…
2013… C’est l’année où le père qui savait raconter des contes de tous les pays et avait de l’or au bout des doigts, le père que je connaissais et admirais follement, est mort.
J’étais loin de me douter que les histoires qui ne franchissaient plus ses lèvres avaient trouvé, du fait de notre absence, un autre moyen d’être au monde.
L’anxiété et la honte en poids au creux du ventre, je prends une grande respiration de la même manière que lorsque l’on plonge en apnée, et je me mets à lire.
24 novembre 2013
Certaines histoires restent gravées dans le bois ou dessinées dans la neige à tout jamais, et j’ai longtemps hésité à coucher celle-ci sur papier. Berné par l’immuabilité de ces terres, je pensais avoir encore tout le temps du monde, je me croyais immortel. Le coup de coude de la Faucheuse il y a quelques mois a eu raison de mes doutes. Mais la peur de disparaître est-elle une raison suffisante pour tout dire ? Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais même pas à qui j’adresse ces mots.
Je ne sais pas qui vous serez, vous qui lirez un jour ces lignes. Un lointain descendant portant mon nom et aucun souvenir de mon existence ? Un inconnu ravi d’avoir fait un bon coup immobilier ? Un squatteur à la curiosité bien placée ? Que penserez-vous de moi après votre lecture ? Me comprendrez-vous ? Peut-être que ce que je vais vous raconter dans ces pages vous fera me mépriser. Mais dans ce monde où l’amour est devenu une affaire de convenances, un produit de consommation qui vaut autant qu’un autre, j’ai la sensation que cette histoire, mon histoire, vaut la peine de prendre enfin la lumière.
Et de lumière, j’en suis plein.
Je suis amoureux.
Éperdument.
Cela fait cinquante-deux ans que je le suis, et le feu brûle avec la même ardeur que le tout premier jour.
Il s’appelle C.
C. Une seule lettre. Dans ma tête, je lui donne une forme de lune, et comme elle, il me visite chaque soir en songe et veille sur mes nuits depuis plus d’un demi-siècle.
Comprenez-moi bien, j’avais pour Lucie, la mère de mes enfants, une affection tendre et sincère, elle m’a fait avec leur venue au monde le plus merveilleux cadeau qu’un homme puisse recevoir. Mais C… C. m’a donné une vie entière, et chaque fois que nos peaux se sont rencontrées, j’ai eu l’impression de renaître, je me suis senti immensément… vivant. J’ai eu maintes fois l’occasion de tout quitter pour lui mais, avec le recul, je sais que j’ai bien fait de ne pas franchir le pas. Pour mes petits d’abord, Camille et Cédric, et j’espère de tout cœur qu’ils ne culpabiliseront jamais pour ça ; ils ont instillé en moi assez de bonheur pour plusieurs vies. L’époque était bien différente alors, et une fois que l’on arpente une route, cela demande un courage monstre de changer de trajectoire. Un courage que je n’ai pas eu. Est-ce que je regrette ? Oui. Et non. C. a enchanté mon existence et, d’une certaine manière, il est resté avec moi chaque jour. Il est dans cet atelier, accompagnant du regard et de ses mains mes premières créations. Il est entre ces murs de pierre, se faufilant à la nuit tombée jusque dans ma chambre. Il est au cœur de ce noisetier miraculeux dont les fleurs ne cèdent pas face aux premiers froids. Il est partout autour de moi, partout en moi.
Et puis… si j’avais eu le cran de tout quitter pour lui, de quitter ma famille pour lui, cela m’aurait sans doute changé, abîmé, et peut-être que ce changement aurait eu raison de nous. En restant loin de lui, je l’ai gardé. Je les ai tous gardés.
J’attends notre prochaine rencontre avec l’impatience d’un enfant le soir du réveillon. Il aura encore vieilli bien sûr, et moi aussi. Chaque fois je le découvre comme si c’était la première fois, et chaque fois je retombe amoureux.
J’espère réussir à travers ces lignes à vous le faire rencontrer, lui qui brille à jamais juste derrière mon ciel.
J’ai tout écrit. Tout ce dont je me souviens. Tous ces morceaux de nous, les couleurs, les odeurs, les sensations, les frôlements, les frissons de chaque instant passé à ses côtés, la douleur de chaque minute écoulée loin de lui. Le temps se fait vrillette sur mes souvenirs, et je crois que c’est ça, finalement, qui m’a décidé : plus que de partir, j’ai peur de partir en ayant oublié. La faillite de ma mémoire serait une douleur inénarrable, sans doute incompréhensible pour ces jeunes d’aujourd’hui que des machines suivent à la trace du premier au tout dernier jour. Moi… Je n’ai pas de photos de nos premiers regards, pas de traces de nos premiers émois, tout ceci n’existe plus que dans ma tête, alors je vous livre entier son contenu, sans filtre, sans censure. Je sais que ça ne se fait pas de parler de ça pour un vieil homme comme moi mais, bien avant d’être un vieillard abîmé par les années, j’étais — et j’ose croire que je le suis encore — un homme avec ses élans du cœur et du corps. Les « ça ne se fait pas » m’ont déjà tant pris… Alors, je vous en prie, ne fermez pas les yeux. Ne sautez pas de passage.
À travers vous qui allez me lire, tout ceci continuera d’exister bien après notre départ.
J’avais quinze ans lorsque mon cœur a commencé à battre.
Il s’appelait C. On m’appelait Flo-Rien. Et on sentait dans l’air le parfum des dernières neiges…
Les points de suspension terminant la dernière ligne font écho aux larmes roulant sur les joues de Cédric. Dans ma poitrine, mon cœur s’est serré douloureusement et les mots me manquent. Alors que je tourne la page d’un doigt tremblant, Cédric arrête mon geste.
— T’es sûre ?
— Sûre de quoi ?
— Papa trompait maman…
— Et alors ?
— Papa trompait maman… avec un homme !
— Il était amoureux.
— D’un homme !
— Et ça fait quoi ? Homme, femme, on s’en fout ! Moi, je veux savoir. Et il voulait que quelqu’un sache. C’est pour ça qu’il a écrit tout ça ! T’as qu’à partir si ça te choque.
— Non, c’est que… Je sais pas…
— Si, tu sais. Tu crois que j’suis pas au courant pour Jérémy quand t’étais au lycée ? J’étais dans sa classe, j’te rappelle…
Ce prénom fait monter aux joues de Cédric une rougeur telle que, même dans la semi-obscurité du grenier, sa peau irradie.
— Voilà. Alors, me casse pas les pieds avec ta morale à la con. Je veux lire.
Cédric inspire longuement en fermant les yeux. Dans sa tête luttent visiblement une curiosité bien naturelle et quelque chose qui ressemble à de la peur. Peur de savoir ? Peur de se reconnaître ? Il a beau être mon frère, ses amours me sont étrangères. Un coup de fil de temps en temps ne suffit pas à s’apprendre, tout juste à vérifier qu’on est encore vivant. Je ne demande rien, et il ne se confie pas à moi.
Lorsqu’enfin ses paupières se relèvent, son regard a pris le reflet terne de la sédition. Il n’a jamais rien pu me refuser.
— D’accord… mais on descend au salon. J’ai besoin d’un verre. Papa gardait un excellent whisky pur malt dans le comptoir, j’espère qu’il en reste…
La figurine dans la poche, les carnets dans les bras, je descends l’escalier avec l’impression élusive de m’enfoncer dans les profondeurs d’une mémoire jalousement gardée par ces murs jusqu’à aujourd’hui.
La grande table accueille mon chargement, une bouteille presque pleine et deux verres. Cédric remplit le premier et avale une longue gorgée d’ambre tel un courage liquide.
— Lis à voix haute, d’accord ?
— Pour que tu me fasses chier sur les liaisons comme si j’étais un de tes élèves ?
— Camille…
— Okay, okay !
Je me racle la gorge, et tourne enfin la page nous propulsant plus de cinquante ans en arrière.
2
Février 1961
Comme chaque matin depuis que l’on m’avait balancé ici tel un vieux sac de linge, j’avais avalé mon petit déjeuner en quelques minutes et fui les murs aux premières heures de l’aube. Plantée au milieu d’un grand parc qui avait dû un jour être clôturé, la maison m’avait regardé partir dans l’air glacé de tous ses yeux aux volets encore clos. La double porte grenat flanquant le rez-de-chaussée lui faisait une bouche purpurine perpétuellement hurlante. Un long cri inaudible que même les pépiements des fauvettes ne parvenaient pas à couvrir.
Le silence était roi en cette enclave savoyarde, bien loin des trépidations de la ville pourtant si proche à vol d’oiseau. Mais on ne volait pas ici. On était terriens de père en fils depuis des temps immémoriaux, soldats d’une guerre sans fin, combattant sans relâche pour faire reculer l’ombre des grands épicéas dévorant les rares lopins où l’on pouvait encore espérer faire pousser quelque chose. Dans le village, c’était à peine si l’on pouvait compter une vingtaine d’habitants taiseux, des hommes tellement pétris d’hiver qu’ils étaient devenus glace, si imbibés du blanc des bouleaux et du ciel qu’ils blanchissaient eux-mêmes des années avant l’âge. Dos et dents cassés, ils avaient la peau parcheminée par l’air coupant qui, le soir venu, s’engouffrait dans la vallée sans plus trouver la sortie et hurlait sa colère en faisant claquer les volets et se plaindre les charpentes. Avant leur vingtième année, ils avaient aux mains le brun des rivières, les failles des chaos granitiques et leurs rêves en deuil sous les ongles.
Éreintés par les exigences sans fin de la terre, les garçons et filles qui grandissaient là apprenaient rapidement l’économie de paroles et de gestes ; les mots coûtaient, les sentiments aussi. Alors on gardait le silence. On ne se racontait pas : les nouvelles finissaient toujours par arriver et cette fichue météo bien trop froide n’accompagnait jamais, « y’a plus de saisons », c’était ainsi depuis toujours. On ne disait pas « je t’aime », on s’encombrait des tendres brutalités d’un mariage de raison, de ceux qui garantissaient que le terrain reste « chez nous », et on faisait deux ou trois gamins pour assurer la relève. La fatigue héréditaire n’incitait guère à l’épanchement entre ces montagnes aux profils acérés tranchant les cieux.
Qu’aurait-on pu dire que chacun ne sût déjà de toute façon ?
J’étais arrivé deux ans plus tôt, et j’avais l’impression que cela faisait quelques siècles. Le temps s’écoulait différemment ici. Lorsque la vieille Fiat avait suivi les méandres enchâssés, plongeant dans des forêts sans lumière et sans joie, j’avais su d’instinct que l’on ne me coupait pas seulement de mon passé, on essayait de contraindre mon avenir. Dans le coffre, le sac de tous les orphelins trimballés de familles d’accueil en internats au gré des subsides accordés chichement par le gouvernement. La guerre avait décimé des familles entières, et les rejetons de ces milliers d’hommes et de femmes partis en fumée, poussières retombant telle la neige d’un cauchemar noirci de nuit et de brouillard, essaimaient dans toutes les campagnes. Les bonnes gens collaient des tuteurs à ces jeunes branches d’un arbre généalogique abattu, et quand les fruits s’obstinaient malgré tout à ne pas prendre de belles couleurs, ils passaient la main. De petits larcins en fugues, de familles en instituts, j’avais suivi la route des mal-aimés jusqu’à ce terminus : l’internat pour jeunes garçons Sainte-Rita de la Bonne Espérance. Le nom m’avait fait rire, comme on rit encore à treize ans des ironies délicieuses qui prennent le voile de la bienséance. Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Le responsable des services sociaux m’avait arrosé de sa fausse bienveillance.
— Tu y seras très bien encadré, Florian. Dimanche, je prierai pour toi. J’allumerai un cierge pour ton salut, mon enfant.
— Pour mon salut, ce s’rait plus efficace de foutre le feu à toute l’église…
Sa double claque m’avait incendié les joues.
Quant à la bonne espérance… Ma foi, qu’il espère, qu’ils espèrent tous, ça ne coûtait pas très cher.
De mon côté, je fomentais en secret des rêves de grandeur. Les rêves d’enfant sont toujours grands, pas vrai ? Puisqu’on avait coupé mes racines, je m’étais mis en tête de devenir le maître incontesté du bois, un génie mondialement reconnu dans le domaine de l’ébénisterie, un art que j’avais découvert au hasard de mes déambulations dans les ateliers d’un Paris qui n’en finissait pas de se rebâtir.
L’artisan qui m’avait surpris un matin la main dans sa caisse croyait davantage au travail qu’à la justice, et j’avais payé ma faute de quelques heures de balayage d’atelier.
À le regarder travailler le chêne et l’érable, faisant sortir d’une masse lourde et sale les arabesques les plus fines, la curiosité et la passion m’avaient saisi pour la première fois de ma vie. Je m’étais approché, il m’avait collé un rabot dans la paume, et j’avais appris, de la façon dont on apprend depuis toujours les plus grandes choses : en écoutant, regardant, imitant. Sans enfant, le menuisier avait vu en moi un réceptacle pour son savoir en héritage, et moi, j’avais trouvé un maître que le soir, dans le secret de mon cœur fatigué du jour, j’appelais papa. Rapidement, l’élève avait dépassé le maître et commencé à s’imaginer un avenir. J’avais l’arrogance de la jeunesse, les mains fines et agiles, aussi promptes à faire les poches que des miracles, et la force de soulever des montagnes. Une bêtise de trop au foyer avait mis un grand coup de hache dans le chemin enfin droit qui avait l’air presque tracé jusqu’à la fin.
Par la vitre de la voiture, les montagnes en question s’étaient mises à rire.
Cette étroite plaine en coupe-gorge avait largement raboté mes fantasmes de grandeur, et à peine avais-je sorti du coffre mes maigres possessions que j’avais été saisi par le sentiment d’une durée qui n’en finirait pas, et accablé par une anxiété poisseuse, telle la prémonition que je ne parviendrais plus jamais à m’extraire de ce piège qui se refermait sur moi.
On m’avait indiqué une chambre que par bonheur je ne partagerais jamais, mais dont la porte ne fermait pas à clé. Les règles n’auraient pu être plus clairement énoncées : ne rien posséder dont tu ne puisses souffrir la perte sans verser quelques larmes. Qu’à cela ne tienne, j’avais séché les miennes depuis longtemps déjà, et mes biens les plus précieux étaient enfouis tout au fond de ma tête. J’avais des espoirs qui valaient des milliards, et suffisamment de rêves pour tenir les quelques centaines de nuits me séparant de cette majorité rimant si bien avec liberté. Huit ans ferme{7}. Il me suffisait d’être patient, et de laisser le temps passer.
Et il passa, le temps, et il tira sur mes bras et mes jambes comme on modèle la glaise, faisant peu à peu de moi un antonyme des autochtones et des autres garçons du foyer. À quinze ans, j’étais devenu aussi fin qu’ils étaient tous massifs, aussi blond qu’ils étaient tous bruns, et si le travail du bois vers lequel on me poussait pour embrasser une carrière honorable avait ajouté quelques cals à mes mains, celles-ci restaient aussi délicates que celles de la gouvernante.
Tels les animaux d’un troupeau qui se débarrassent volontiers du mouton noir, les autres pensionnaires m’avaient rapidement montré leur dos, puis leurs poings, m’attribuant la place de souffre-douleur de tous et d’ami de personne. Le premier coup de pied dans l’estomac m’avait tiré quelques cris, les suivants n’obtinrent en réponse que mon silence. Il était tout simplement hors de question que je laisse échapper quoi que ce soit. Tout retenir, larmes, paroles, tout garder pour plus tard, quand je partirais enfin sans un regard en arrière. Les professeurs qui se succédaient devant nous, le directeur de l’internat, même la petite bonne à tout faire aussi sotte que gentille, tout le monde détourna pudiquement les yeux, trouvant à l’incurie une vertu tant de fois validée par l’histoire : rien ne rapproche davantage qu’un ennemi commun. Les bagarres entre garçons s’étaient faites moins fréquentes, et cela valait bien, a priori, le prix de quelques gifles assénées au grand échalas qui ne disait plus un mot à personne et ne se plaignait jamais. J’appris à chérir la solitude, et à voir battre dans les veines du bois que je travaillais sans relâche bien plus d’humanité que dans celles de mes semblables.
Dans la lumière blafarde de ce petit matin de février, la forêt m’accueillit comme on ouvre ses bras à l’enfant prodige enfin de retour. J’avais tant de fois parcouru ces sous-bois que je pouvais reconnaître chaque essence, et éviter chaque racine mauvaise semblant avoir été placée là contre les intrusions. J’avais dans l’idée d’aller chercher une belle branche de noisetier que l’orage de la veille avait fait ployer, et de la ramener jusqu’à la grange abandonnée devenue peu à peu mon atelier clandestin. J’y avais péniblement rassemblé les outils nécessaires, aidé plus ou moins officiellement par les quelques enseignants qui voyaient là un travail au moins aussi noble que le leur. L’un d’entre eux m’avait même passé commande d’un petit cadre ouvragé afin d’afficher fièrement l’unique photo d’un mariage d’amour qui ne tarderait pas à se changer en union d’habitudes.