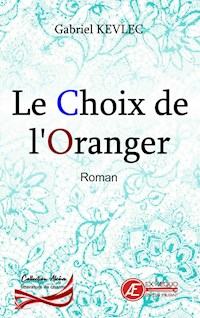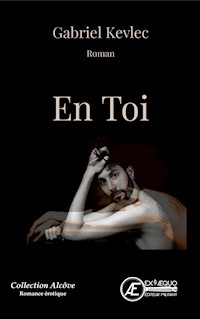
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Je m’appelle Thomas Alderson, et le 14 novembre 1965, dans une verte plaine du Vietnam, je suis mort. J’avais tout juste vingt-quatre ans.
Puisque vous êtes là, puisque nous sommes seuls, installez-vous confortablement et offrez-moi quelques heures arrachées à la folie de votre quotidien. Permettez-moi de vous raconter comment l’Univers s’est joué de moi. Laissez-moi vous chuchoter mon histoire avant que les limbes de l’oubli ne l’emportent. C’est si fragile au fond, la mémoire…
Vous tenez entre vos mains les précieux souvenirs que le temps qui passe n’a pas encore pillés, le récit de l’Amour de ma vie. Un grand amour… Quoi de plus ordinaire en somme ? À ceci près que l’homme extraordinaire qui a bouleversé ma destinée s’appelle Adrian, et qu’il est né en 1989. Il a été tour à tour mon Paradis, mon Enfer, mon Purgatoire. Ma folle espérance d’être aimé. Ma deuxième chance d’y croire.
Alors laissez-moi vous confier la sensation de sa peau, l’émoi de son regard, l’ivresse de son corps, ces frémissements à portée d’âme, et cette certitude absolue : la mort n’était pas ma fin.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gabriel Kevlec est un poète à la petite semaine, né au moins deux siècles trop tard, un pornographe romantique, un fou amoureux, entre folie douce ou folie furieuse. Il compose ses vers et ses phrases à la main, entre les portées des musées et les allées des morceaux de violons, ou alors est-ce l’inverse ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Kevlec
En Toi
Romance érotique
ISBN : 979-10-388-0249-0
Collection : Alcôve
ISSN : 2678-2553
Dépôt légal : décembre 2021
© couverture photo de Philippe Debieve pour Ex Æquo
© 2021 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Préface
Est-ce que L’Aventure de Mme Muir (Joseph L. Mankiewicz) et les Ailes du désir (Wim Wenders) vous parlent ? Si vous avez vu ces films, vous aurez une petite idée de certaines images qui me sont venues en tête lorsque j’ai lu ce troisième opus de Gabriel Kevlec. S’ils vous sont inconnus, je vous les conseille, mais seulement après avoir refermé la dernière page de ce livre. Parce qu’il est unique.
En Toi est l’histoire de Thomas, tué au Vietnam, qui revient en âme et en pensées dans le monde de ceux en chair et en os. Devenu invisible pour le commun des mortels, il glisse à travers le fil du temps, pénètre la trame des êtres et apprend notre troisième millénaire. Lors de son voyage éthérique, la rencontre d’un papillon, joli guide doré, l’amènera vers celui qui donnera un sens à sa nouvelle « vie ».
Je n’en dis pas plus, le reste, vous le découvrirez en tournant les pages.
Envolez-vous au pays imaginaire de Gabriel Kevlec, non pas celui des Enfants perdus, mais celui où les mots ciselés sont rois, habillés de nuances écarlates, habités de poésie, nourris de douceur, entretenus par la passion et animés par la plume exceptionnelle de l’auteur.
Envolez-vous avec Thomas et Adrian, écarquillez votre esprit, enroulez votre corps telle une liane autour de leurs instants, retenez votre souffle, souriez, pleurez, vibrez.
Venez vous fondre dans l’écriture de Gabriel et vous aurez tout cela. Je peux vous l’assurer !
Jeanne Malysa
Prologue
J’ai la tête pleine de ces mots, maintenant que je n’entends plus les siens…
« Le plus beau jour de ma vie ».
« L’amour de ma vie ».
« Pour la vie ».
Ces expressions existent dans toutes les langues du monde. Elles célèbrent l’amour, la réussite, l’engagement, avec pour toile de fond cette unité maîtresse de référence : la vie.
Une vie humaine. À peu près quatre-vingts ans pour un homme. Vingt-neuf mille deux cents jours. Et sur ces quelques dizaines de milliers de fois où le Soleil s’est levé au-dessus de nous, certaines journées s’ancrent dans la mémoire. Façonnent notre histoire. Font de nous ce que nous sommes. Nous bâtissent. Nous détruisent.
On ne sait jamais en se réveillant qu’aujourd’hui sera le jour le plus important de notre vie.
On n’en prend conscience que lorsque la nuit tombe, lorsque des dizaines, des centaines de nuits sont tombées, lorsque vient le temps du bilan, le moment de se raconter à quelqu’un ou au silence.
Pour moi, l’heure est venue.
Puisque vous êtes là, puisque nous sommes seuls, et même si je n’ai pas révolutionné le monde ni fait d’immenses découvertes, même si je n’ai pas marqué la grande Histoire des hommes, j’aimerais vous confier mes souvenirs. Me raconter à vous. Vous conter, moi aussi, le plus beau jour de ma vie, l’amour de ma vie. Implacable, le temps pille mes souvenirs, mais je ferai de mon mieux pour ne rien oublier. C’est si fragile au fond, la mémoire…
Toute histoire a un début. Une naissance. Un incipit. Je vais donc, si vous le permettez, commencer par le commencement.
Je m’appelle Thomas Alderson, et le 14 novembre 1965, aux alentours de treize heures, je suis mort.
Je suis mort en soldat. Membre du Premier bataillon du Septième de cavalerie, deuxième peloton, sous les ordres du lieutenant Henry Herrick. Mon unité a été larguée en fin de matinée dans la vallée d’Ia Drang, sur les hauts plateaux du Sud-Vietnam, afin de repousser les régiments des Viêt-Cong vers le massif de Chu Pong. C’était ma toute première intervention, et quand mon arme avait fauché un premier soldat d’en face, je m’étais figé au-dessus de son corps. C’était un jeune homme, à peine plus de vingt ans. Un jeune homme pareil à moi. Les doigts sur son cou à la recherche d’une pulsation, je n’avais pu que constater que je venais de devenir un assassin légal, que j’avais privé l’ennemi d’un pion qui serait vite remplacé. L’ennemi… Son sang sur ma peau était pourtant pareil au mien.
Lorsque la rafale de mitraillette creva ma gourde et ma poitrine, j’avais vingt-quatre ans depuis quelques minutes à peine. Sous la lumière éblouissante des explosions de napalm, inondé des hurlements de rage et de souffrance de mes camarades, mon corps s’est affaissé le long de ce ruisseau tranquille. Je me rappelle y avoir vu deux libellules accrochées l’une à l’autre, dessinant sur fond d’azur un petit cœur organique. Une déclaration d’amour délicieusement ironique de cette région sauvage, magnifique, dont la végétation exubérante se couvrait peu à peu du sang poisseux de tous ces enfants jouant à la guerre. La main dans l’onde claire, je suis mort comme ces millions de Vietnamiens et ces quelques soixante mille soldats américains de ce que Reagan appellera des années plus tard « la guerre la plus noble de l’histoire des États-Unis ». C’est toutefois avec assez peu de noblesse qu’en un dernier réflexe inutile j’ai tenté de contenir mes tripes, dégueulées par mon ventre ouvert sur le vert tendre de la prairie.
Je suis mort en gamin. L’uniforme ne compte plus, à la fin. Lorsque votre sang décore de volutes écarlates l’eau si pure de la rivière, vous ne pensez pas aux valeurs que vous avez portées jusqu’à ce champ de bataille. Vous ne pensez pas à ce rôle que vous êtes censé tenir, cette pichenette décisive enrayant l’effet domino, parce que soudainement vous étreint la conscience claire, douloureuse, que le domino, c’est vous, et le camarade tombé juste après vous lors de la deuxième salve, et celui d’après, et celui d’après… Vous ne pensez plus à l’esprit de ce pays qu’on vous a envoyé défendre dans cette vallée aux mille nuances de vert qui se brouillent, devient toile impressionniste derrière le vernis d’hémoglobine. Non… Vous songez confusément à ceux que vous allez laisser derrière vous.
Mes parents.
Je ne sais pas pourquoi, une image précise s’imposa à moi alors que ma vie se répandait dans l’herbe, l’image de cet écran de télévision dans lequel le jeune sénateur John Fitzgerald Kennedy, bronzé et confiant, attirait à lui les regards et les suffrages, arrachant à un Nixon pâle et amaigri une victoire qui dès lors semblait déjà écrite.
Lorsque le temps étira les derniers battements de mon cœur, je nous revis entassés devant le petit poste en noir et blanc, harassés de la chaleur baignant la baie de San Francisco en ce mois de septembre 1960. J’allais avoir dix-neuf ans quelques jours plus tard, mais, tel un bambin, j’étais assis en tailleur sur la moquette. Maman était aux fourneaux, les liens de son tablier plissant sur sa taille fine les carreaux jaunes de sa jolie robe. Chaque fois qu’elle passait une tête curieuse dans l’entrebâillement de la porte, l’odeur appétissante d’un pain de viande s’échappait par vagues de la cuisine. Assis dans son fauteuil, Papa enrageait devant l’image de ce jeune catholique faisant passer son président pour un homme dépassé.
Papa enrageait souvent.
Contre les Rouges, ces nuisibles rongeant les idéaux de sa Nation, celle qui lui avait permis de cumuler avant quarante ans une florissante carrière, un pavillon avec jardin sur les hauteurs de Potrero Hill et une rutilante Chrysler noire. Contre le gérant du magasin Woolworth de Greensboro qui, deux mois plus tôt, avait servi à son comptoir les Noirs comme s’ils étaient des Blancs. Contre la vente de la pilule contraceptive, cette hérésie qui allait priver le pays d’une jeunesse forte, capable de le défendre contre ceux qu’il appelait « les bridés » et qui, loin dans l’Est, crachaient sur ses valeurs.
Il éructait, vitupérait, me dépeignait un monde plein de dangers, me mettait en garde contre tous ceux qui foulaient aux pieds les mots des Pères Fondateurs. Mais tous les grands de son monde étaient les petits du mien, alors je hochais vaguement la tête, de ce mouvement auquel on peut tout faire dire, tandis que mes pensées s’égaraient à la plage.
Ce jour-là, l’ennemi s’appelait Kennedy, avait l’assurance des vainqueurs, la coiffure parfaite et le sourire étincelant. Je me souviens avoir songé qu’il était très bel homme, de l’inconfort immédiat que cette simple pensée avait instillé dans mon esprit et au creux de mon pantalon. De la chaleur qui avait creusé mon ventre et coloré mes joues. De la honte, aussi, diffuse. Du regard en coin que j’avais jeté à mon père, juste pour m’assurer qu’il n’avait rien perçu de mon trouble. D’avoir refoulé tout au fond de ma tête des envies floues, poisseuses, auxquelles je refusais de donner une image et un nom. Auxquelles je refusais de donner ce nom, ce mot terrible qu’on crachait comme un glaviot sur tous ceux qui avaient l’audace de montrer leurs fragilités ou quelques manières, dénonçant avec une violence inouïe ce que j’imaginais d’une douceur sans pareille.
Je n’étais pas ça.
Je ne pouvais pas être ça.
J’étais un Alderson, un bon fils, un protestant, et tout avait déjà été écrit pour moi ; j’étais promis à un bel avenir dans l’entreprise familiale et à une jeune fille délicieuse aux lèvres aussi rouges et brillantes que la pulpe d’un fruit d’été.
Elle s’appelait Mary.
Mary et sa robe d’écolière à carreaux rouges, nattes blondes sautillant au rythme de sa corde à sauter dans la cour de récréation.
Mary et sa jupe en corolle, un foulard rockabilly retenant des boucles dorées se balançant gentiment dans le vent léger sur le chemin du lycée.
Mary et son short court, si court sur ses jambes interminables où j’avais posé une main hésitante lors du barbecue du dimanche. Devant l’initiative maladroite, mon père avait donné une grande claque dans le dos du sien, comme pour se congratuler de cet accord signé du bout de mes lèvres. Je l’avais embrassée, elle avait rougi, je n’avais rien ressenti. Mes parents étaient ravis, tout se déroulait de la manière dont ils l’avaient prévu. Ma route était tracée, une ligne droite sans détour que je n’avais plus qu’à suivre vers ce nom et cette réussite qu’on me léguait en responsabilité, aussi lourde que des chaînes à mes chevilles. Ma mère s’était réjouie de la portée de petits-enfants blonds et robustes que je ne manquerais pas de lui amener pour le déjeuner dominical.
Tachant le sol d’hémoglobine, avachi sur des siècles de terre, cerné de ces montagnes telles des vagues figées, je me laissai lentement immerger par les ombres vieillissantes de ma mémoire. La lumière du Soleil se mit à décroître doucement. Se pouvait-il que la nuit tombe si tôt ?
Sur la peau du ciel à vif, des bulles de mémoire filaient, déployant leurs ailes rassurantes, chassant la douleur. Déjà, je n’avais presque plus mal. Déjà, le froid engourdissait mes sensations.
Couchées sur le dos dans un lit d’immensité, les étoiles planquées derrière le bleu observaient leur ciel d’humanités. Vu de là-haut, tout ceci ne devait pas avoir beaucoup d’importance. Tout devint peu à peu si calme. Si paisible. C’était doux de mourir, finalement…
Un souvenir particulier vint alors se poser sur mon bras, lissant ses plumes tièdes, emplissant mes iris d’images un peu ternes.
Mary et sa respiration qui s’était accélérée, sous le soleil de cette fin d’après-midi arrosant d’ombres rougeoyantes son dos et les grains de beauté de ses fesses. Dans le parc où nous nous étions promenés, loin des bruits de la ville, je l’avais allongée dans l’herbe tendre.
Quelques semaines auparavant, sa première fois avait aussi été la mienne; elle avait laissé sur le drap de ma couche quelques gouttes de sang et une poignée de soupirs. Pas de quoi faire un souvenir grandiose. Mais les premières fois ne sont jamais fantastiques, n’est-ce pas? Mes copains parlaient de feu d’artifice, d’apothéose, aucun n’avait évoqué ce vide que j’avais éprouvé, ce bruit blanc teinté d’une forme de désespoir; ils devaient s’être vantés, comme d’habitude. La troisième fois ne s’avéra pas plus extraordinaire que la deuxième, et je commençais à me résoudre à cette fatalité : je devais être de ceux qui n’atteignent jamais les astres.
Entre les arbres sages, l’air doux de ce soir de juin nous avait étreints dans un cocon de silence que nos corps déchiraient maladroitement. À l’instar des fois précédentes, ma verge en piston profondément accrochée à ses souffles, j’avais essayé de me laisser porter par sa voix, ses gémissements remontant du creux de sa poitrine, espérant percevoir moi aussi ces décharges de lumière, ces courants pétillants sous ma peau en boucles chargées d’étincelles, tout ce que mon ami Gary m’avait décrit, les yeux chatoyants. Mais malgré mes efforts, impossible pour moi de convoquer les cieux. Mécanique, automatique, je réfléchissais peut-être trop.
Mary s’était soudain cambrée, tendant vers moi ses seins blancs et menus, la tête en arrière, la bouche ouverte. La troublante impudeur de cette vue m’avait fait fermer les yeux. Enclos dans mon monde intérieur, j’avais senti peu à peu fondre mes chaînes mentales, ces résistances inquiètes, et le feu de mes entrailles avait consumé l’image de cette femme gémissant sous mes doigts, laissant place à des visions aussi floues que des rêves.
Les épaules de Gary, en sueur sous la canicule implacable d’Ocean Beach… Les gouttes d’eau de mer dévalant sa peau, s’accrochant aux poils épars de son torse…
Des flashs, des flamboyances s’étaient imposés, impossibles à retenir, mais avais-je seulement envie d’essayer ?Personne ne pouvait me reprocher de penser, si ? Dans le creux de mon ventre, un brasier s’était mis à enflammer mes fibres, réduisant ma retenue en cendres.
Rapidement, Mary s’était échappée de l’étreinte de mes bras, avait plaqué mon dos sur les trèfles, s’était retournée, puis m’avait enjambé. La chaleur de ses cuisses sous leur vernis de sueur moite avait embrasé mes joues. J’avais senti ses doigts fins lissant mon sexe, ses lèvres se poser sur mon gland. Au-dessus de moi, deux monts de porcelaine piquetés de points de cannelle.
Les fesses charnues de Gary, courant nu et hilare sur le sable, m’entraînant vers les cris de James et Charles qui s’étaient déjà jetés dans les vagues, s’arrosant d’eau froide et de rires comme des gosses. Les muscles de son dos roulant sous l’effort, toute cette force contrôlée… Étrange superposition d’images, impression de voir crépiter les couleurs…
Nichée dans ses courtes boucles blondes, une fente étoilée de cyprine s’était mise à ondoyer au-dessus de ma bouche. J’y avais osé une langue timide, maladroite entre les plis des lèvres roses, flattant presque par mégarde la perle qu’elles cachaient. En écho, Mary avait fait glisser contre sa joue ma hampe raide jusqu’à la racine. Refermant les paupières, je m’étais abandonné aux caresses, me délectant de la sensation de l’emplir, absorbant le moindre frémissement de sa gorge velours. À nouveau, j’avais alors franchi en pensée les limites imaginaires, dépassé le cadre étroit du réel, du présent. Elle m’aspirait, me suçait, et moi je fouissais de ma langue le cul ouvert de Gary, incapable de repousser ces visions oniriques d’étreintes masculines. J’avais cédé aux suggestions implacables de mon esprit, sans rejet ni colère, sans peur ni honte. C’était tellement… plus évident. Plus naturel.
Lapant entre ses nymphes le sirop de son plaisir, j’avais imaginé m’emplir la bouche d’une tout autre laitance, luisante comme la queue des comètes, épaisse tels des astres liquides. J’étais devenu terre chaude s’ouvrant à la pluie, à la sève jaillissant d’une poutre que je rêvais d’accueillir au fond de moi.
À partir de cet instant, Mary n’avait plus étouffé ses cris; j’avais pu voir s’envoler dans les airs les souffles de sa gorge, le crescendo de ses gémissements, la symphonie de son corps entier. Lorsqu’elle s’était retournée pour me chevaucher à nouveau, je n’avais même pas ouvert les yeux. J’avais voulu jouir de ce plaisir primordial, de cette clarté sauvage dévalant ma colonne vertébrale en coulée de lave jusqu’à mes bourses. La chaleur de son étui de soie autour de ma queue engloutie m’avait enivré aussi sûrement qu’un alcool fort; au creux de ce vertige, les premiers flux de sève avaient bouillonné en cascade dans mes testicules. Ancrant mes mains à sa taille pour ne pas faillir, je m’étais vu me glisser dans un fourreau que j’imaginais bien plus étroit, sous des râles bien plus graves, l’emplir jusqu’au débordement. Des images mentales saccadées, enchaînées, de moins en moins floues, de plus en plus rapides…
La lumière de la plage rasant le dos cambré de Gary, ce moment suspendu où le dernier rayon s’éteint, laissant dans l’ombre nos corps emmêlés, imbriqués, arpenter les étendues de sa peau, cette vastitude à mon échelle, ces monts à mordre et ces creux à emplir, les vagues de mon sexe déferlant dans son cul, repartant, revenant plus loin, encore, cette invasion, cette ascension vers le zénith, la nuit qui s’installe et sa chair qui me brûle tel un millier de soleils, son regard brasillant comme si l’univers se consumait à l’intérieur de lui, encore, encore, tellement d’astres au-dessus de nous, son anus ouvert en astérie, la crête, le souffle perdu, ses râles, ses mots, « Baise-moi, putain, vas-y ! Baise-moi ! Tommy… Plus fort, plus fort… », la cadence de ses doigts branlant son propre gland, le torrent qui gronde, coups de reins gorgés d’écume, encore, encore, tout mon corps qui se concentre en un point, gravité que couronne mon bassin qui danse, et soudain l’expansion, la déflagration, blanche, atomique, incendies de foutre épais déversé tout au fond de lui…
Au diapason de mes divagations intérieures, Mary s’était tendue, les mains pressant mon torse comme pour me maintenir loin de son ascension. D’un seul coup, je m’étais alors senti noyé, dépossédé entre ses chairs devenues soudainement liquides, ruisselant le long de mon sexe, mon ouvrage mental balayé implacablement, laissant derrière lui un vide sensoriel étourdissant et les scories d’une frustration impossible à contenir.
Le pinacle de son plaisir avait fait se tordre son visage béat, regard aveugle vers le ciel en feu. Entre les ondes de ses parois brûlantes, la vigueur de mon rêve éveillé s’était dégonflée tel un ballon de baudruche. La respiration erratique, elle s’était affalée sur ma poitrine. Frêle. Trop frêle. Un murmure, presque inaudible, chuchoté contre ma peau abritant un cœur fêlé. « Je t’aime, Tommy ». J’avais fait mine de ne rien avoir entendu. Le soleil avait alors disparu derrière la baie, laissant la nuit dissimuler le dépit et la honte qui m’empourpraient doucement les joues.
Je l’avais ramenée chez elle à pas lents, et nous étions passés devant la maison de Gary. Ses fenêtres aux volets ouverts et sa marquise couverte de feuilles mortes dessinaient un visage qui me narguait. Un court instant, j’avais été pris de l’envie fulgurante d’aller sonner à la porte pour le voir, pour… Mais je savais instinctivement qu’il n’y avait pas d’expérience unique en ce domaine, pas d’entre-deux, qu’un fantasme aussi fort ne devait soit jamais être réalisé, soit être maintes fois répété, ce qui était tout simplement inenvisageable. Et que si le désir ne se contrôlait pas, je pouvais toujours choisir l’ignorance. Ou la fuite.
Quelques jours plus tard, j’avais rempli les formulaires faisant de moi un soldat, promettant de faire de moi un homme, un vrai, pour la plus grande joie de mon père. Ça ne faisait pas partie du plan, mais un héros dans la famille, ça ne se refusait pas… « Je suis fier de toi, fiston, la Nation entière sera fière de toi. »
Lorsque mes pupilles se dilatèrent, absorbant jusqu’au dernier grain de lumière, je me rappelle m’être demandé si la fierté de mon père prendrait la couleur de ce drapeau qu’un de mes camarades lui remettrait bientôt. Bleu comme le ciel indifférent à mon départ. Rouge comme mon sang abreuvant la terre. Blanc comme la mort. T’es fier de moi, papa ?
Et puis elle est venue.
Ce fut une étrange sensation. Comment vous la décrire ? C’était pareil à… être caressé par une aile de demoiselle ou se plonger dans un bain de plumes et de miel. Intense et doux. Si difficile à décrire…
Je me suis senti sortir de moi-même comme on tombe une étoffe, un drap de soie glissant de mon visage à mes pieds. Léger et transparent, je me suis séparé, scindé de ma matière, désincrusté de chacune de mes cellules jusqu’à flotter au-dessus de ce corps qui m’avait accompagné vingt-quatre années durant. J’étais… mort. Indubitablement. Pourtant, j’étais toujours là. Les récits bibliques dont on m’avait abreuvé tout au long de l’enfance allumèrent un bref instant une peur ancestrale au creux de mon estomac, une angoisse vite chassée par la découverte curieuse de ces nouveaux ressentis.
On ne se rend jamais vraiment compte de la douleur irrémédiablement associée à l’existence même de la chair, du poids des organes tirant sur les ligaments, du grincement des articulations, de la brutalité du sang pulsant dans les artères, de la mort quotidienne de centaines de nos cellules, leur noyau qui se fragmente, leur membrane qui se déforme, et puis cette implosion, ces supernovas microscopiques qui nous émiettent peu à peu. C’est une violence de chaque instant, un bruit corporel incessant dans lequel je baignais depuis mon tout premier cri, que je ne percevais même plus, et qui projetait son ombre de peur et de souffrance sur tout.
Jusqu’à ce moment.
Libéré de ce larsen intérieur, je me rappelle avoir été habité pour la première fois par la sensation, non pas d’être au monde, mais d’en faire vraiment partie. D’appartenir à cette débauche de vie éternelle et omniprésente, celle qui existe au-delà des myriades de formes assujetties aux cycles de naissances et de morts. J’étais descendu du manège, et j’embrassais intensément le monde pour la toute première fois. Mon… — comment appeler ça… Mon âme ? Mon ectoplasme ? Mon essence ? —, mon être, cette chose invisible et indestructible, était soudain sur la même dimension que la planète entière. En accord parfait.
Et maintenant ? Allais-je être guidé pour me présenter à Lui, à Son jugement ? Ou mes pensées m’avaient-elles déjà condamné aux infinis tourments des Enfers ? Allait-on faire le procès de mes vertus et de mes péchés ? Mon cœur allait-il être pesé face à la plume ? Où étaient ceux qui, comme moi, étaient tombés dans cette plaine mouchetée de cadavres ? Incapable d’accéder à la moindre réponse, de savoir ce que j’étais supposé faire désormais, où j’étais censé me rendre, je me suis allongé près de ma dépouille et abîmé dans la contemplation de la vie qui continuait à passer sans moi.
Je ne sais pas combien de temps exactement je suis resté ainsi, couché près du ruisseau à regarder se succéder jours ardents et nuits glaciales. Un matin, j’ai vu que l’on enlevait mon corps avec ceux des autres vrais perdants de cette guerre, tous ces hommes tombés pour des idées et que l’on allait désormais compter comme on ramasse ses pions à la fin d’une partie d’échecs. Je n’ai pas suivi ma dépouille. À quoi bon ? Ce n’était plus que de la chair morte qui déjà se décomposait, un vaisseau abandonné… J’ai regardé partir sans émotion particulière ce vêtement trop petit, trop abîmé qu’on jetait aux ordures.
Immobile, j’ai observé indéfiniment les graines germer, devenir pousses, plantules, arbrisseaux ; j’ai admiré les fleurs et les fruits, les balades amoureuses des libellules, le ruisseau charriant de mystérieux pétales venus des hauteurs, puis des feuilles aux limbes couleur de flamme, les mille facettes de cette vie foisonnante dont je n’étais plus que simple spectateur.
Lorsque je me suis enfin relevé, personne, ni Dieu ni diable, n’était venu me chercher. Il n’y avait pas eu de grande lumière au fond du tunnel ou de passeur sur sa barque. On — Lui ? Eux ? Ça ? — m’avait oublié.
Alors j’ai fait ce que j’aurais dû faire depuis le début : je suis rentré chez moi.
1
En ce matin de retour à San Francisco, le soleil soufflait sur la baie comme un paléontologue soufflerait sur un fossile enseveli depuis la nuit des temps. Un air lourd, sec, une chape de chaleur immobile envahissait les rues avant même les premières lueurs de l’aube, inventant des flaques de lumière inondant le bitume. Je me rappelle avoir mis quelques minutes à réaliser que j’étais arrivé, à faire la différence entre les moiteurs indochinoise et californienne.
Pour fuir la plaine qui m’avait vu mourir, j’avais instinctivement longé la rivière, ne croisant pas âme qui vive jusqu’à l’océan. Celui-ci prit l’aspect d’une voie potentielle, d’un chemin envisageable. Un courant puissant m’emporta rapidement, accompagnant mon errance pendant des jours, des mois peut-être. Flottant entre ciel et mer, je perdis rapidement la notion du temps, me contentant parfois de m’abîmer dans la contemplation de la fabuleuse vie sous-marine indifférente à mon passage. Lorsqu’émergea sur l’horizon la plage encore lointaine de Baker Beach, celle qui était le décor de tant de mes souvenirs, je ne pus retenir un cri de soulagement : j’étais rentré à la maison.
Hommes et femmes marchaient vite sous les assauts du jour, lunettes de soleil vissées sur le nez, regards rivés à de petits appareils étranges, plats et lumineux, ressemblant à des morceaux de talkie-walkie. Les mains et l’esprit entièrement accaparés par ce qui m’apparaissait comme un bout de plastique clinquant, ils passaient à travers mon corps transparent sans frémir. J’arpentais les trottoirs sans savoir où aller, peu à peu contaminé par cette fièvre qui semblait habiter les passants et les faisait courir vers un but que je n’avais plus. L’air sentait le bruit et l’urgence, la frénésie.
J’avais essayé de tapoter une épaule, de chuchoter à une oreille, de bousculer un corps et puis deux, de crier, de hurler, et même de frapper, plaçant dans mon poing serré mon angoisse tout entière, mais personne ne me voyait ni ne m’entendait. Enfermé dans cette solitude imposée, j’oscillais entre panique et rire nerveux, avec l’impression très nette de devenir fou. Je me souviens avoir pensé que c’était peut-être ça, l’Enfer : être bloqué dans l’invisible, l’inaudible, sans plus aucun contrôle sur ce qui m’entourait ; une demi-réalité en forme de camisole.
Au bout de plusieurs heures, je n’avais pas croisé une seule âme errante pareille à la mienne, ni dans le petit cimetière dont j’avais longé chaque stèle, ni même dans l’église où j’avais attendu naïvement l’illumination sous les vitraux colorés. Dans ma tête surgit l’hypothèse folle d’avoir été victime d’une erreur de celui qui, là-haut, gérait la répartition des vivants et des morts.
Seuls les chats semblaient capter mon essence et plongeaient parfois leurs regards en agate dans le mien avec une intensité telle que je cessais de douter de ma présence.
Oreilles basses, poil hérissé, queue agitée, un minuscule chaton blanc avait lancé vers moi un feulement sourd puis s’était réfugié dans une grande maison cossue dotée d’une chatière. M’élançant pour le suivre, j’avais franchi la lourde porte comme si c’était un simple mur d’eau.
Dans le salon, une étrange télévision, immense et plate, était allumée. Les couleurs qu’elle affichait étaient si éclatantes que je m’étais figé devant les images. Une présentatrice commentait les titres de l’actualité, lançait de petits reportages et des pages de publicité. Ma curiosité face à ce nouveau monde me poussa rapidement à l’exploration hors de cette maison, à m’aventurer des jours entiers derrière les murs des musées et des salles de classe, des centres commerciaux et des austères bâtiments officiels.
Ébahi, j’appris qu’un demi-siècle s’était écoulé sans moi, qu’un homme noir avait été notre président, que le monde entier pouvait désormais discuter sur une toile, que ma guerre faisait maintenant partie des programmes d’histoire. Qu’il y avait presque plus de plastique que de poissons dans les océans. Que l’on était désormais capable de greffer des bras bioniques, mais qu’une maladie terrible, le SIDA, tenait tête aux médecins. Que l’on avait marché sur la Lune. Que l’on avait inventé ces machines de science-fiction répondant à nos ordres, allumant la lumière ou lançant de la musique. Que l’on pouvait du bout du pouce passer un appel vers n’importe quel pays. On communiquait par ondes, par satellites, par mails, par SMS, par visioconférences… Je n’avais pu m’empêcher de relever la délicieuse ironie de tous ces écrans se vantant de vouloir rapprocher les hommes tout en s’interposant entre eux. Chaque personne que j’avais croisée dehors était accrochée à son téléphone portable — ce bout de plastique avait donc un nom… et un prix faramineux ! —, un appareil rendant chacun aveugle et sourd à ses voisins immédiats. Georges Orwell en aurait fait une syncope.
Une poignée d’hommes avait inventé le monde actuel, rejouant le siècle des Lumières en binaire : il y avait l’avant, sans cesse critiqué, et l’après, se résumant à un simple vœu qui n’avait plus rien de pieux. Et puisque désormais tout pouvait s’acheter, Dieu se chiffrait maintenant en dollars.
Rapidement, j’avais emmagasiné de nouveaux mots, comme on apprend une langue étrangère, jusqu’à maîtriser parfaitement le vocable de ce siècle : ordinateur, e-mail, playlist, montre connectée, cigarette électronique, et puis… terroristes, Uber, végan, charge mentale, antispéciste… Un champ lexical entier qui fleurait bon l’angoisse, la peur de l’autre et de soi-même.
Le moral en berne, j’avais fini par replonger dans les rues de cette ville qui avait été un chez-moi et que je ne reconnaissais plus. Cinquante ans marquent autant les visages que les maisons, et j’avais été incapable de retrouver un chemin familier. J’étais perdu, dans tous les sens du terme. Las de chercher, pris d’un vertige après tant de découvertes, j’avais fini par m’asseoir sur les petites marches d’un commerce abandonné, et j’avais commencé à regarder les passants.
Le monde était devenu si différent de celui que j’avais connu… Des gens multicolores dans des tissus ternes. À la terrasse du café, un groupe de jeunes gens en tenue très chic discutait de politique avec le sourire. Deux d’entre eux étaient noirs, un autre latino. Le petit serveur pressé leur avait apporté leur commande comme aux autres. Un sanglot d’émotion était monté dans ma gorge ; si seulement les quatre de Greensboro{1} avaient pu voir ça ! Leur combat avait donc finalement porté ses étranges fruits… {2}
M’arrachant par surprise à ma contemplation ravie, un couple s’arrêta brutalement devant moi. À hauteur de mon regard, leurs doigts entrelacés me firent l’effet d’un uppercut ; je levai les yeux et obtins confirmation de ma folle hypothèse : il s’agissait de deux hommes. Inconscients ! Vous cherchez à vous faire massacrer ? Par réflexe, je tournai rapidement la tête de droite à gauche, cherchant avec anxiété les policiers qui auraient vite fait de mettre un terme violent à un tel étalage public de perversion, mais nul képi ne surgit dans mon champ de vision. Les gens passaient à côté des amoureux, indifférents à cette affection affichée avec naturel. Était-il possible que pour ça aussi, la bataille eût été remportée ? C’est pas croyable… Lorsque le couple reprit sa marche, je le suivis des yeux jusqu’à les voir disparaître à un angle de rue. Pas un regard hostile ne fut lancé dans leur direction. C’est extraordinaire…
Rapidement, un autre changement m’avait sauté aux yeux. Dans le centre-ville, San Francisco avait pris des allures de millefeuilles : en haut, à hauteur des lunettes et des boucles d’oreille hors de prix, la strate des élites, ceux qui avaient l’air d’être toujours en retard, zombies de la rentabilité, attaché-case dans une main et smoothie vert dans l’autre, et qui faisaient du yoga face à la mer ; en bas, ras le trottoir, la couche des laissés-pour-compte. Les toiles de tentes bleues avaient envahi le centre-ville, et des rues entières semblaient colonisées par cette étrange maladie, celle de la misère humaine.
Dans ces corps innombrables couchés dans les ruelles, j’avais entrevu la lueur d’un désespoir universel, d’une solitude en mauvaise herbe poussant dans les poitrines. Les choses avaient beaucoup changé, oui… Mais était-ce pour le mieux ? Tant de droits acquis, et pourtant tant de pauvreté, tant de douleur encore… C’était ça, l’idéal pour lequel j’étais mort ?
Tout à mes pensées, j’avais fini par m’éloigner instinctivement des rues, du monde, rejoignant une partie de la baie délaissée par la foule. Semblant avoir été dessiné à la hâte par un enfant, un petit sentier de terre serpentait entre l’océan qui n’en finissait plus de soulever sa jupe et des blocs de maisons pudiques qui lui tournaient le dos, volets clos telles des paupières outragées. Irrégulier, fébrile comme une suture hasardeuse, le chemin sillonnait entre l’immensité d’un bleu si intense qu’il en devenait noir, et la géométrie immaculée des bâtiments. Au loin, l’homme avait lancé par-dessus les eaux tranquilles ses poutres d’acier, droites et segments, diagonales parfaites et angles droits. Un peu d’ordre rassurant par-dessus le brouillon des vagues.
Un petit parc arboré avait accueilli la fin de mes ruminations, minuscule enclos de verdure bien clôturée, de peur que la nature ne s’en échappe et n’aille ternir de ses courbes folles, de ses couleurs chatoyantes, l’uniformité grise et lourde du béton tout autour. Une impression de déjà-vu m’avait saisi. La forme des arbres, la butte contre laquelle le vent se jetait, tout ceci me semblait familier.
J’étais déjà venu ici. Je le sentais. Mais quand ? La mémoire se dérobait à moi.
Un panneau de bois peint à la main avait été posé contre le tronc d’un peuplier, l’enlaçant d’un fil de fer terni de rouille. L’écriture malhabile enjoignait les promeneurs à vivre leur vie avec abandon, à poursuivre leurs rêves aussi grands soient-ils, à être courageux, à tomber amoureux, à sourire aux étrangers, à saisir leur chance, à trouver leur chemin.
Des injonctions au bonheur et au plaisir, comme si l’homme avait soudainement perdu de vue le simple objectif d’être heureux.
Trouver mon chemin… Ce n’était pas faute d’avoir cherché, mais les années avaient changé le nom des rues et des enseignes, m’égarant tel un gosse en forêt.
Un papillon était venu se poser sur le coin du bois verni. Dans ses yeux remplis de nuit se reflétaient des ailes pleines de soleil, un jaune ardent, vibrant, enfermé par un liseré d’écailles bleues et noires. Il avait décollé, avait plané quelques instants devant moi, tout auréolé d’une sérénité lointaine, puis avait visité quelques fleurs. Il était beau, beau de légèreté, de grâce. Beau de liberté. On devinait presque, à la façon dont il passait hésitant d’une fleur à l’autre, qu’il venait de loin. Comme moi. Un butinage plus tard, il avait franchi la barrière du parc, s’en allant colorier la rue, insouciant de sa destination. Je l’avais suivi.
L’insecte d’or avait voleté autour des platanes qui, sereins, rappelaient aux passants en crevant le bitume que, sous leurs pieds, une terre ancestrale toujours fertile n’avait pas vu le soleil depuis longtemps. À l’instar de ce sol, certains détails de ma vie de mortel étaient là, juste sous la surface, luttant pour revenir combler les blancs. Entre les pavés disjoints marquant le bord de la route s’accumulait la poussière du temps qu’une plante plus coriace que les autres prenait parfois comme substrat. Il faut croire qu’il n’y a pas plus têtu qu’une fleur.
Échappée d’un jardin, une branche aventureuse de cerisier avait attiré l’attention du papillon ; il s’était posé au bout du tendre rameau, sur le bourgeon vert portant déjà en son cœur toute la rougeur des prochaines amours. Mû par l’élan, j’avais poursuivi ma route, m’enfonçant dans les contre-allées couvertes de gravier rose jusqu’à déboucher sur une large rue dévalant une colline goudronnée. J’ai reconnu l’âme du lieu avec autant de certitude que lorsqu’on met un nom sur un visage qu’on n’a pas vu depuis un siècle, devinant sa jeunesse sous les rides.
Potrero Hill.
J’étais chez moi.
Mon quartier s’était métamorphosé. Les jolies maisons gentiment entretenues le dimanche par les pères de famille avaient cédé leur place à de gros blocs de béton et de verres aux arêtes saillantes, dégueulant de leur garage ouvert des voitures gigantesques aux silhouettes de monstres. Tout paraissait être devenu démesuré.
Fébrile, j’ai remonté ce qui était ma rue jusqu’au 144, avant de me figer.
Ma maison avait disparu.