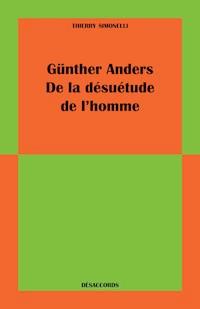
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Jasmin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le témoignage existentiel d'un Européen qui reçut une éducation philosophique de l'entre-deux-guerres.
Les textes de Günther Anders renferment le témoignage existentiel d'un Européen qui reçut une éducation philosophique de l'entre-deux-guerres. En effet, comme étudiant de Husserl et de Heidegger, Anders côtoya Hans Jonas et Hannah Arendt dont il fut l'époux de 1929 à 1937. Durant les années 50 et 60, Anders acquit une certaine renommée pour son combat contre les armes nucléaires, mené aux côtés de Primo Lévi et Bertrand Russell. Humaniste farouche, il aimait à dire, marquant ainsi sa rupture définitive avec le concept scolastique de la philosophie : " N'est-il pas plus important que l'humanité existe plutôt que la " philosophie " ? Bien que je sois classé comme " philosophe ", je ne m'intéresse que très peu à la philosophie. Mon intérêt appartient au monde, de même que l'intérêt des astronomes n'appartient pas à l'astronomie, mais aux étoiles. "
Dans cet essai qui se veut une introduction à la pensée de Günther Anders, l'auteur s'attache tout particulièrement à mettre en perspective les analyses de Günther Anders portant sur l'obsolescence progressive de l'homme.
Plongez dans cet essai qui se veut une introduction à la pensée de Günther Anders, se centrant sur les analyses du philosophe portant sur l'obsolescence progressive de l'homme.
EXTRAIT
La raison de cette inversion tient au développement des forces de production par le recrutement de la science et de la technique comme premiers moteurs économiques. Ainsi, sur le plan économique, la pente prométhéenne se manifeste dans notre « manque de manque » (Mangel an Mangel, AM 2, pp. 19, 215). Nos besoins sont insuffisants pour assurer l’écoulement de la production écrasante des marchandises.
La confusion, voire l’inversion du créateur et de sa créature donnent lieu à une situation historique originale, qui se caractérise par un déplacement du sujet du besoin (ou du manque). Au déplacement du sujet du travail se rajoute donc un déplacement du sujet du besoin.
Le premier pas, celui de la perversité ordinaire de la relation produit-offre, consiste dans l’inversion de l’ordre temporel : ce n’est plus la demande qui suscite l’offre, mais l’offre qui précède et doit solliciter la demande.
Un deuxième pas est franchi quand cette inversion est elle-même subvertie. Car, remarque Anders, la perversité ordinaire maintient l’être humain à la place du sujet du besoin. Même si le besoin du consommateur lui est, pour une large part, hétéronome, il reste le besoin d’une personne, le besoin de l’être humain.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Thierry Simonelli est docteur en philosophie. Son doctorat a porté sur l'éthique et la psychanalyse dans l'œuvre de Jacques Lacan (Université de Paris IV, Sorbonne). Il est psychanalyste et chargé d'enseignement à l'Université de Metz, ainsi qu'au Centre de Recherche Public Santé (Luxembourg). Il mène des activités de recherche au sein du Groupe d'Etudes et de Recherches Epistémologiques (Paris VIe).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Copyright
DÉSACCORD
Collection dirigée par
Angèle Kremer Marietti
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Titre
Exergue
Les vrais écrivains sont les remords de la conscience de l’humanité.
Ludwig Feuerbach,
MOMENTS D’UNE VIE
Selon Hannah Arendt, sa première épouse, Günther Stern, alias Günther Anders, était un personnage saugrenu, difficilement supportable (« schwer erträglicher Kauz1 »). Parmi les diverses raisons alléguées à l’appui de leur divorce, Hannah Arendt mentionnait également l’implacable pessimisme de son mari.
Günther Stern, est né en 1902 en Silésie, à Breslau – aujourd’hui Wroclaw, en Pologne. Il est le deuxième d’une famille de trois enfants. Sa sœur aînée, Hilde, est née en 1900, sa sœur cadette, Eva, en 1904. Son père, William Stern (1871-1938), et sa mère, Clara (1879-1945), étaient l’un et l’autre psychologues. William Stern était d’ailleurs loin d’être un inconnu à l’époque. Il était plus connu que Freud pendant les trois premières décennies du vingtième siècle. Il avait publié une bonne quarantaine de livres, traduits dans plusieurs langues, quelque 200 articles et était membre des comités de rédaction de 7 revues de psychologie. De 1897 à 1919, il a enseigné la philosophie et la psychologie à l’Université de Breslau. Pendant cette période, il fut également, entre autres, co-fondateur de la « Société de psychologie expérimentale » (1904), dont il allait prendre la présidence en 1934, et fondateur de l’Institut berlinois de Psychologie Appliquée. L’activité scientifique de William Stem se caractérise par une diversité impressionnante : père de la psychologie différentielle en Allemagne, il fut également l’inventeur du « quotient intellectuel », défenseur d’une psychologie personnaliste et avait acquis une réputation mondiale grâce à ses études sur la psychologie des enfants.
Il n’y a aucune contradiction à ce que la carrière d’un pessimiste débute par une enfance heureuse. Ce fut le cas de Günther Stern. Grandissant dans le monde privilégié et protecteur de la bourgeoisie, Günther et ses deux sœurs bénéficiaient de toute l’attention de leurs parents et d’une parfaite éducation. Lorsqu’il avait cinq ans, sa mère notait à son sujet : « Ainsi que nous devions le découvrir plus tard, Günther possède un talent musical extraordinaire, il dépasse très nettement ses sœurs. » Voici la description d’une des scènes caractéristiques du ménage : « Aujourd’hui, le père faisait de la musique avec ses enfants. Günther chanta bon nombre de chansons d’enfants et de chansons populaires sans faire aucune faute. On lui permit alors de tenter de composer lui-même (à l’aide d’un doigt) une mélodie. À ce moment, il fut saisi d’une ambition zélée, il essayait et essayait et, de temps à autre, s’essuyait les yeux qui brillaient d’une lueur humide – les larmes n’étaient jamais loin quand l’ambition lui rendait visite. […] Dans son excitation joyeuse, il nous appela affirmant qu’il savait désormais jouer du piano, et, avec un empressement zélé, il réussissait à nous convaincre de son savoir-faire2. » Günther Anders lui-même se rappelle son enfance partagée entre les plaisirs et les jouissances de ses « trop nombreux talents ».
En 1916, la famille Stern déménagea à Hambourg, où le père allait occuper un poste de professeur de philosophie, de psychologie et de pédagogie à l’Institut de Psychologie de l’Université de Hambourg. William Stern était par ailleurs cofondateur de l’Université de Hambourg et directeur de l’Institut de Psychologie. De nature optimiste, le père de Günther Stern croyait profondément à la bonté de la nature humaine et se consacrait à l’étude de l’unité de la personne3. Günther Stern dédia le premier volume de l’Antiquiertheit (1957) à son père en mentionnant l’ouvrage Personne et chose. À ce propos, il écrivait que la chosification de l’être humain ne tient pas tant au traitement scientifique de la « personne », mais au traitement factuel de l’homme par l’homme4.
Bien qu’il fût élevé dans le respect de la diversité des religions, Günther prit en dégoût l’image du Christ crucifié. Dans un article paru en 1978, intitulé « Mein Judentum », Anders mentionnait l’influence exercée sur lui par l’interdit de l’image de la religion juive. Cet interdit, il l’avait retrouvé plus tard, non sans plaisir, dans la philosophie marxienne ; dans sa critique de l’idéologie comme fausse conscience et dans son concept du fétichisme.
Mais la belle enfance heureuse fut troublée par le fait d’appartenir à la religion juive. Pourtant, William et Clara, ses parents, prenaient au sérieux leur assimilation à l’empire prussien5. Comme des milliers de juifs allemands, ils se sentaient allemands avant d’être juifs. Une image, dont Günther Anders devait se souvenir encore adulte, montrait sa mère accommodée en figure de « Gretchen », distribuant des vivres aux soldats de l’Empire. Le commentaire de Anders en retient comme une faute morale : « Oui, cette élève modèle effarouchée c’était toi, mère. Était-ce vraimentnécessaire ? » Ainsi Edith Stein allait-elle devenir l’insigne de cette fervente tentative d’assimilation. Élève de William Stern, assistante de Husserl, convertie au catholicisme à 20 ans (1922), religieuse de l’ordre des Carmélites (1934), elle mourut dans la chambre à gaz d’Auschwitz (1942).
Günther apprit la signification de l’appartenance à la religion juive dans l’Allemagne des années 1910, à l’âge de 8 ans. Récusant l’idée catholique de la culpabilité congénitale de l’être humain, il se voyait menacé, évité et exclu par ses camarades de classe.
À l’âge de 15 ans, selon ses propres dires, il fit l’expérience de ce qui devait avoir lieu à grande échelle quelque seize ans plus tard. Visitant les champs de guerre français avec un groupe d’écoliers paramilitaires, il ne voyait pas seulement les premiers mutilés de la guerre, mais, le seul non-aryen du groupe, il devait subir maltraitances et tortures. Ainsi, adolescent, il était déjà devenu un « avant-gardiste de la souffrance6 ». Depuis lors, l’enthousiasme de l’assimilation avait pris un sens différent pour Günther Stern. Il ne fut jamais tenté par le zèle de l’assimilation, de la participation ou de la collaboration.
En 1919, il entama des études de philosophie, et suivit les cours de Husserl à partir de 1921. C’est sous la direction de Husserl qu’il prépara sa thèse de doctorat sur « Le rôle de la catégorie de situation en logique », soutenue en 1924. À partir de 1925, il participait aux séminaires de Heidegger en compagnie de Hannah Arendt et de Hans Jonas. Bien qu’au début il fût fasciné par Heidegger, Günther Stern sut par la suite se garder d’une participation zélée. Invité à la hutte du Todtnauberg, il salua l’épouse de Heidegger (qui appartenait à la jeunesse national-socialiste) en remarquant qu’il était juif et faisait donc partie de ces gens qui devraient être exclus de la vie publique7.
Plus tard, de retour de son voyage en France, il passait la nuit chez Heidegger et s’impliquait dans une violente discussion philosophique autour de la question de l’espace, de l’enracinement et de l’anthropologie philosophique. Lors de cette discussion, Stern reprocha à Heidegger d’être un « Wurzelphilosoph » (philosophe de racines, mais également philosophe à carottes) réduisant l’être humain à un végétal8.
Et, il rajoutait à un Heidegger incrédule qu’une telle anthropologie était grosse des pires dangers politiques.
En 1929, Günther Stern et Hannah Arendt se marièrent à Berlin et déménagèrent à Francfort avec des projets professionnels bien réfléchis. Pour Günther Stern, ce déménagement était lié à l’espoir d’obtenir un poste de chargé de cours à l’Université de Francfort. Mais il devait s’y heurter à Adorno, à deux reprises. Après un exposé de Günther Stern, tenu à la « Kant-Gesellschaft » sur « L’étrangeté au monde [Weltfremdheit] de l’être humain », Adorno prétendit sentir des « odeurs existentiales en provenance de Fribourg ». Ainsi, Stern se vit proposé de changer de sujet d’habilitation et de rédiger un mémoire sur la philosophie de la musique. Mais Adorno récusa à nouveau ce projet, pour manque d’orientation marxiste.
En 1930, âgé de 28 ans, Günther Stern finit par abandonner les projets universitaires ; c’est alors qu’il entama une carrière de journaliste.
Grâce à la recommandation de Berthold Brecht, Stem eut un poste de feuilletoniste du Courrier de la Bourse. Rapidement, le directeur du journal reprochait à Stem que la moitié des articles du feuilleton étaient signés de son nom. Ce dernier lui répondit aussitôt : appelez-moi autrement [anders]. Et son directeur lui répliqua : « Parfait, à partir d’aujourd’hui, vous vous appellerez également Anders. » À partir de ce jour, Anders signa tous ses textes non-philosophiques du nom de Günther Anders.
En 1933, il dut fuir l’Allemagne parce que la Gestapo avait découvert son nom dans le carnet d’adresses de Brecht9. Avant de partir, Anders avait entamé son roman10Les catacombes molussiennes. Interdit de papiers et de travail en tant qu’étranger, il survivait à Paris en se consacrant à l’écriture de son roman. Il y fit la connaissance d’Arnold Zweig, d’Alfred Döblin (dont le roman Berlin Alexanderplatz lui avait laissé une impression non moins intense que Être et Temps) et fréquentait régulièrement le neveu, Walter Benjamin. C’est alors que les Recherches philosophiques publièrent son exposé sur l’étrangeté de l’homme sous le titre de « La pathologie de la liberté ». Bien que son travail restât marqué par l’influence des analyses existentiales de Heidegger, Günther Anders n’en empruntait pas moins une voie contraire à celle du maître. Anders se montrait préoccupé non pas par l’être-au-monde, mais par l’être perdu dans le monde, par l’être sans monde. L’être-jeté de Heidegger y est définitivement privé du retour à soi de l’authenticité et reste exposé au choc de la contingence de son être-là. Plus tard, Sartre reconnaîtra sa dette envers cet article11.
Quant à William Stern, il dut fuir l’Allemagne en 1934. Chagriné, abattu et dans une profonde incompréhension face au nazisme et à l’antisémitisme, il allait mourir d’une crise cardiaque à Durham (Caroline du Nord), aux États-Unis, en 1938. Avant sa mort, il avait néanmoins obtenu un poste de professeur (visiting professor) à la DukeUniversity de Durham.
En 1936, à son tour, Günther Anders émigra aux États-Unis, pour vivre à New-York d’abord. Il devait y survivre en partie grâce au soutien financier de son père. Pendant quelques mois, il travailla pour le bureau appelé Office of War Information. Il s’agissait d’un poste convoité par les émigrés, non seulement parce qu’il leur permettait de recueillir des informations sur leur pays d’origine, mais surtout pour ses confortables revenus. Anders démissionna quand on lui demanda de traduire en allemand un livre qu’il jugeait fasciste. En 1937, il divorçait de Hannah Arendt et, en 1939, il suivit sa nouvelle compagne, une actrice, à Hollywood.
À Hollywood, il rédigea quelques scénarios de films, mais sans aucun succès. Il se résigna alors à gagner sa vie en tant qu’employé accessoiriste : à ce titre, il lui arrivait de cirer des bottes de SA12. À partir de 1942, il partageait la maison de Herbert Marcuse à Santa Monica.
Il fit, pendant cette période, une autre expérience qui devait marquer profondément et irrémédiablement sa conception de la technique, voire sa conception du monde : le travail à la chaîne d’assemblage d’un grand producteur d’automobiles américain. « N’était mon temps passé à l’usine, en effet jamais je n’aurais été en mesure d’écrire […] ma critique de l’époque technique. Même aujourd’hui, alors que j’écris le deuxième volume de cet ouvrage […], je me nourris de ces expériences. Si j’ai pu me faire une humble renommée, c’est grâce aux connaissances que j’ai pu acquérir à cette époque, dans l’anonymat total13. »
Une autre expérience qui allait laisser une profonde empreinte sur la pensée de Anders fut celle de la télévision aux États-Unis. La télévision était assez peu répandue en Europe, alors qu’aux États-Unis elle était déjà intégrée dans la vie quotidienne de beaucoup de ménages. Comme les autres immigrants européens, Anders pouvait donc observer ce phénomène avec les yeux candides de celui qui avait fait un saut dans le temps.
1950 fut l’année de son retour en Europe. Chassé des États-Unis par la politique de Mc Carthy, mais ne voulant habiter ni l’Allemagne occidentale de Adenauer, ni l’Allemagne orientale de Ulbricht et de Pieck, Anders se décida pour Vienne. Il refusa également la proposition d’Ernst Bloch, qui lui réservait un poste de professeur à l’Université de Halle. On verra dans ce refus le signe d’un être-au-monde toujours problématique pour Anders, mais aussi une rupture définitive avec le concept scolastique14





























