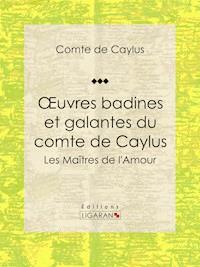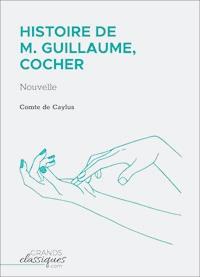
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Immersion dans les amourettes du Paris populaire du XVIIIe siècle
POUR UN PUBLIC AVERTI. Un cocher de Paris, avec un style empreint de fausse naïveté, narre quatre histoires amoureuses que son métier lui a données à voir, avant d'évoluer socialement et de devenir un bourgeois respectable grâce à la protection d'une riche veuve. Sur un ton de gaillarde désinvolture, ces petits récits sont l'illustration des moeurs des diverses classes sociales du XVIIIe siècle. Cette nouvelle a étonnamment échappé à la censure de l'époque.
De petites histoires érotiques narrées sur un ton goguenard !
EXTRAIT
Préface – M. Guillaume au public.
Monsieur le public, vous allez être bien étonné de ce qu’un homme de mon acabit prend la plume en main, pour vous faire participant de bien des drôleries qu’il a vu sur le pavé de Paris, où il peut dire, sans vanité, qu’il a roulé autant qu’un homme du monde qu’il y ait.
Quoique je sois, à cette heure, un bon bourgeois d’auprès de Paris, cela n’empêche pas que je ne me souvienne toujours bien, que j’ai été cocher de place, après de remise, ensuite j’ai mené un petit-maître que j’ai planté là pour les chevaux d’une brave dame, qui m’a fait ce que je suis au jour d’aujourd’hui.
[...]
Premièrement, d’abord et d’un ; je commencerai par l’histoire de mamselle Godiche, qui lui est arrivée dans le temps que j’étais à la rue Mazarine, à la Glacière, à Chaillot, avec le fils d’un marchand de l’apport-Paris.
Par après, je vous lâcherai l’affaire de la femme de ce notaire avec un gros commis de la douane, à la foire Saint-Laurent, quand j’étais remisier.
Pour ce qui est de la troisième, ce sera l’histoire de M. le Chevalier Brillantin, qui ne m’a jamais payé mes gages qu’à coups de plat d’épée, pendant que j’ai mené sa diligence.
Et enfin finale, vous aurez celle de Mme Allain, ma bonne maîtresse, qui m’a laissé de quoi vivre, avec M. l’abbé Évrard, duquel elle vit son bec-jaune, comme vous le verrez vous-même à la fin du présent livre.
Par ainsi, ça fera quatre aventures d’amourettes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Anne-Claude-Philippe de Tubières, dit
Comte de Caylus (1692-1765) est un archéologue, antiquaire, homme de lettres et graveur français. Voyageur et collectionneur d'antiquités, on lui doit de nombreux ouvrages d'archéologie ainsi que les premières bases de la méthode comparative en la matière. Il est l'auteur de nombreuses nouvelles érotiques, parmi lesquels
Histoire de Mr. Guillaume, cocher et
Voluptueux Hors de Combat, incluses dans les
Œuvres badines complètes (1757), mais aussi de contes de fées :
Les Féeries nouvelles (1741),
Les Contes orientaux (1745) ou
Cinq contes de fées (1745).
À PROPOS DE LA COLLECTION
Retrouvez les plus grands noms de la littérature érotique dans notre collection
Grands classiques érotiques.
Autrefois poussés à la clandestinité et relégués dans « l'Enfer des bibliothèques », les auteurs de ces œuvres incontournables du genre sont aujourd'hui reconnus mondialement.
Du Marquis de Sade à Alphonse Momas et ses multiples pseudonymes, en passant par le lyrique Alfred de Musset ou la féministe Renée Dunan, les
Grands classiques érotiques proposent un catalogue complet et varié qui contentera tant les novices que les connaisseurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
M. Guillaume au public.
Monsieur le public, vous allez être bien étonné de ce qu’un homme de mon acabit prend la plume en main, pour vous faire participant de bien des drôleries qu’il a vu sur le pavé de Paris, où il peut dire, sans vanité, qu’il a roulé autant qu’un homme du monde qu’il y ait.
Quoique je sois, à cette heure, un bon bourgeois d’auprès de Paris, cela n’empêche pas que je ne me souvienne toujours bien, que j’ai été cocher de place, après de remise, ensuite j’ai mené un petit-maître que j’ai planté là pour les chevaux d’une brave dame, qui m’a fait ce que je suis au jour d’aujourd’hui.
Dans ces quatre conditions-là, j’ai vu bien des choses, comme je vous disais tout-à-l’heure, ce qui fait que je me suis mis à rêver, en moi-même, comment je m’y prendrais pour coucher ça par écrit.
Je n’ai pas bien la plume en main, à cause du fouet d’autrefois qui me l’a corrompu ; mais quand j’aurai écrit ce que j’ai envie d’écrire, je le ferai ré-écrire par un écrivain des charniers, que je connais, du temps que j’étais à la ferronnerie.
Je sais ce que je vais vous dire, pour en avoir vu plus de la moitié de mes propres yeux, moi qui vous parle, quand je menais l’équipage.
Les gens qui vont dans un fiacre, tout partout où ils veulent aller, ne prennent pas garde à lui ; ça fait qu’on ne se cache pas de certaines choses, qu’on ne ferait pas devant le monde.
Mais, comme il y a très-bien de ces affaires-là que je sais, je n’étais pas mal embarrassé par qui commencer, et puis ça aurait fait tout dès d’abord, un trop gros livre. Je me suis avisé, avec l’écrivain duquel je vous ai parlé, qu’il fallait, pour ne pas faire d’embarras, vous en couler quatre l’une après l’autre.
Premièrement, d’abord et d’un ; je commencerai par l’histoire de mamselle Godiche, qui lui est arrivée dans le temps que j’étais à la rue Mazarine, à la Glacière, à Chaillot, avec le fils d’un marchand de l’apport-Paris.
Par après, je vous lâcherai l’affaire de la femme de ce notaire avec un gros commis de la douane, à la foire Saint-Laurent, quand j’étais remisier.
Pour ce qui est de la troisième, ce sera l’histoire de M. le Chevalier Brillantin, qui ne m’a jamais payé mes gages qu’à coups de plat d’épée, pendant que j’ai mené sa diligence.
Et enfin finale, vous aurez celle de Mme Allain, ma bonne maîtresse, qui m’a laissé de quoi vivre, avec M. l’abbé Évrard, duquel elle vit son bec-jaune, comme vous le verrez vous-même à la fin du présent livre.
Par ainsi, ça fera quatre aventures d’amourettes.
Si ceux-là vous plaisent à lire, je vous en détacherai encore d’autres, qui ne seront pas moins chenues.
1Histoire et aventure de mamselle Godiche la coiffeuse
Comme j’étais un jour de l’après-dîner à attendre le chaland à la Mazarine, voilà que je vois qui vient à moi, une petite jeune demoiselle bien gentille, qui me demande :
— mon ami, qu’est-ce que vous me prendrez pour me mener au pont-tournant ?
— Mamselle, ce lui fis-je, vous êtes raisonnable.
— Oh, point-du-tout, ce fit-elle, je veux faire marché.
— Eh bien, vous me donnerez vingt-quatre sols, la pièce toute ronde…
— Oui-dà, qu’il est gentil avec ses vingt-quatre sols ! Il n’y a qu’un pas. Je vous en donnerai douze : tenez, j’en mettrai quinze ; si vous ne voulez pas, je prendrai une brouette…
— Allons, Mamselle, montez. Vous donnerez de quoi boire… oh, pour cela non, ne vous y attendez pas : c’est bien assez… eh mais ! Dites donc, l’homme, tirez vos vitres, il fait tout plein de vent (il ne soufflait pas), cela me défriserait ; et ma tante croirait que j’ai été je ne sais où. Je tire mes glaces de bois, et nous voilà partis.
Tout vis-à-vis des théatins, v’là-t-il pas qu’une glace tombe dans la coulisse de la portière, et j’entends :
— Cocher, cocher, relevez donc votre machine qui est tombée !
Pendant que je la relève, il passe par-là un petit Monsieur, qui regarde dans ma voiture, et qui dit tout d’abord :
— Ha ! ha ! C’est Mamselle Godiche ! Eh, mon Dieu ! Où allez-vous donc comme cela toute seule ?
— Monsieur, je vais où je vais, ce n’est pas là vos affaires, répondit-elle.
— Ah ! Pour cela, reprit-il, vous avez raison ; mais vous sentez fort, mademoiselle, qu’une demoiselle comme vous, qui va dans un fiacre l’après-midi, toute seule, ne va pas coiffer des dames à cette heure.
— C’est ce qui vous trompe, M Gallonnet, répliquaGodiche ; et cela est si vrai, que voilà un bonnet que je ne fais que de monter, pour le porter à une dame, pour aller au paradis de l’opéra.
À la vérité, la petite futée tire de dedans sa robe un escoffion qui était dessous ; et le Monsieur le voyant, tire une révérence en riant, et s’en va.
— Pour cela, dit Mlle Godiche, après qu’il fut parti, les hommes sont bien curieux ! Aussi pourquoi votre chose ne ferme-t-elle pas bien ? C’est le fils d’un tailleur de notre montée, qui ne va pas manquer de l’aller dire partout. C’est la plus mauvaise langue du quartier, et ses bégueules de sœurs aussi : parce qu’on se met un peu plus proprement qu’eux tous, il semble qu’on soit une je ne sais qui. Il faut que je sois bien malheureuse de l’avoir rencontré là ! Tenez, voilà vos quinze sols ; je ne veux plus aller dans votre vilain carrosse. Ah, mon dieu ! Qu’est-ce qu’on va dire ? Si ma tante sait cela, je suis perdue ! Eh bien, vous voilà comme une bûche de bois, me dit-elle, à moi qui l’écoutais sans mot dire, allez donc où je vous ai dit, il en arrivera ce qui pourra : il faut bien que je porte ma coiffure, une fois ; cette dame m’attend : dépêchez-vous donc.
Nous voilà allés. Nous arrivons au pont-tournant, où il n’y avait non plus de dame à sa toilette, que dans le creux de ma main. Mamselle Godiche regarde à droite, à gauche, et tout partout. À la fin, elle me dit, mon ami, voulez-vous que je reste dans votre carrosse, jusqu’à ce qu’un de mes cousins, qui doit me mener quelque part, quand j’aurai été chez cette dame, soit venu ? Je vous donnerai quelque chose pour cela. Volontiers, lui dis-je, mademoiselle, car j’avais pris de l’affection pour elle ; et puis j’étais bien aise de voir son cousin, que je me doutais bien qui ne l’était pas plus que moi.
Au bout d’un gros quart d’heure, je vois venir un grand jeune homme, qui vient dar, dar, du côté de la porte Saint-Honoré. Je le montre à mamselle Godiche :
— N’est-ce pas là votre cousin ?
— Eh, oui vraiment ! Appelez-le, car il ne sait pas que je suis en carrosse.
Je cours après le cousin, qui s’en allait enfiler le chemin de Chaillot ; et je lui dis :
— Monsieur, il y a là Mamselle votre cousine Godiche qui voudrait vous parler un mot.
Aussitôt après m’avoir dit grand merci, il s’en court à mon carrosse, monte dedans, et voilà mes gens à chuchoter comme des pies-borgnesses, pendant longtemps. À la fin ils me disent, que je les mène dans quelque bon cabaret de ma connaissance ; et que je serai bien content d’eux, si je veux les attendre pour les ramener à Paris, quand ils auront mangé une salade. En même temps le Monsieur, pour me faire voir que c’est de bon franc jeu, me coule dans la main une roue de derrière, à compte.
Je leur proposai de les mener chez la veuve Trophée, à l’entrée du cours ; mais ils trouvèrent que c’était trop près du soleil. Je leur parlai ensuite de la Glacière à Chaillot, ou de Mme Liard au roule ; mais ils aimèrent mieux la Glacière, où je les débarqua, en peu de temps.
Comme je me doutais bien du cousinage que c’était, je fis signe à la maîtresse, qui entend le jars, autant qu’il se puisse ; et elle les fit mettre dans un petit cabinet en bas sur le jardin.
Pour ce qui est de moi, je vous range mon carrosse ; et comme il y avait bien des écots, j’ôte les coussins, que la maîtresse du cabaret va porter dans la chambre où était mon monde, afin que personne ne les prenne.
Au bout d’environ près de deux heures, mamselle Godiche eut envie de prendre l’air dans le jardin ; son cousin y vint avec elle, et ils se mettent à regarder danser. Pendant ce temps-là, j’étais avec deux de mes amis de ma connaissance, dont il y en a un soldat des petits corps, et nous buvions une pinte de vin, en mangeant le reste d’une fricassée de poulets, que le cousin et la cousine m’avait donnée dans le jardin avec de la salade qui restait, de façon que nous ne faisions pas si mauvaise chère.
Comme nous n’étions pas bien loin de la danse, je vis que l’on venait prier mamselle Godiche pour un menuet ; ensuite elle prit son cousin, et ils se mettent à danser ensemble fort gentiment.