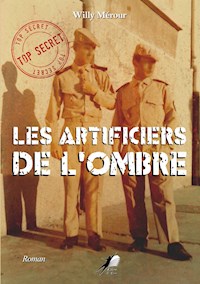Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Histoires d'elles, histoires de filles, histoires de femmes.
Amour très court, amour toujours, amours au féminin...
Nul doute que nous croisons au quotidien, souvent sans le savoir, une Marie-Anne, une Florence, une Julia.
Certaines assument avec élégance ou provocation leur différence, mais d'autres la taisent encore.
À travers les destins croisés de plusieurs femmes et d'un homme, Willy Mérour observe notre société avec la bienveillance nonchalante de celui qui sait, qui comprend et jamais ne juge.
La vie mouvementée d'une femme trop bien née et de ses amours lesbiennes sert de fil rouge à ce roman foisonnant où les corps et les destins s'entremêlent au rythme de la vie.
Willy Mérour joue avec les sentiments sans se jouer de ses héroïnes, anti-héroïnes pourrait-on écrire tant les figures mouvantes et émouvantes qui traversent ce roman paraissent réelles, ancrées dans le quotidien.
Roman ? Voire… Un roman-réalité qui dresse également un très beau portrait d'homme, collègue, complice et surtout ami.
Eric Chesneau.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste, photographe,
Willy Mérour fut également animateur de nuits blanches souvent colorées et webmaster d'un site internet "de filles". Il nous plonge au cœur de milieux qu'il connaît bien. Des histoires d'amour puissantes et sensuelles entre filles.
Rectificatif : des histoires d'amour... tout simplement.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willy MÉROUR
Histoires d’Elles
ou la vie tumultueusede Marie-Anne
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN papier : 978-2-490522-97-2ISBN Numérique : 978-2-490522-98-9Dépôt légal : Juin 2020
© Libre2Lire, 2020
Photo de couverture : © Willy Mérour 2010
À Christelle, ma fille.
Les personnages, situations et lieux de cette histoire sont totalement imaginaires. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou disparues, institutions, situations et lieux ne serait donc que le fruit du hasard.
Quoique… Allez savoir !
*
Quand on possède ne serait-ce qu’un soupçon d’humanité, il n’existe pas de mal ni de bien que l’on fasse à autrui sans en recevoir des éclaboussures en retour.
WM
1
Irrémédiablement l’horloge tournait et l’heure de l’avion approchait. Il faudrait bientôt reprendre le chemin d’Orly pour déposer Gaëlle d’où elle repartirait vers sa lointaine province. Encore le temps d’une petite pause dans un fast-food de Saint-Ouen. Peut-être plus pour tenter vainement de braver ce temps qui passait, que pour reprendre des forces avant d’affronter la circulation parisienne de cette fin de dimanche.
Florence s’accrochait à son amie. Bien loin d’opposer une quelconque résistance, celle-ci se laissait aller à une proximité tant souhaitée. La salle du restaurant était presque vide. Florence et Gaëlle s’assirent côte à côte, Franck prit naturellement place en face. Les frites fumantes et le Coca ne les intéressaient plus. Sans se préoccuper de lui, elles s’enlaçaient puis s’embrassaient à pleine bouche sans retenue. Il détournait pudiquement la tête avec ce sentiment de joie de voir sa fille pleinement heureuse. Les rares clients qui avaient vu la scène n’en revenaient pas, certains souriaient, d’autres semblaient scandalisés de voir deux filles s’embrasser ainsi et qui plus est en public.
Pour elles plus rien n’existait, Florence et Gaëlle étaient en dehors du temps des autres. Une petite planète qui n’appartenait qu’à ces deux cœurs réunis dans un monde d’amour. Qu’importait le jugement de ceux qui ne faisaient que croiser leurs vies en ces quelques instants. Entre deux baisers, Florence souriait à son père qui prenait la mesure de son bonheur. Que celui-ci soit né d’une relation au féminin ne le dérangeait pas.
Quand on est père, la seule chose que l’on souhaite c’est le bonheur de son enfant. Loin de l’égoïsme et des qu’en-dira-t-on c’est le cœur qui parle et tant pis si celui qui plaisait à sa fille était celui d’une femme.
Si Florence l’aimait, lui l’aimait aussi !
*
Il n’est rien qui ne puisse être relaté. Non… En fait pour Franck la seule difficulté était bien de savoir par où commencer !
Par le début ? Bien que d’une logique évidente, rien n’était moins facile. Certaines histoires ont plusieurs débuts. Un peu comme si on mettait pêle-mêle, dans un entonnoir, différentes tranches de vie, commencées individuellement. Des vies qui se croisent, se télescopent et se fondent dans une seule et même aventure.
Une aventure de courte durée à l’image de ces rencontres éphémères lors des vacances, où à l’issue d’un séjour, chacun promet de conserver le contact, d’écrire, de téléphoner. De pieuses paroles que les couches du temps recouvrent pour finir dans l’oubli.
Franck ne connaissait pas tous les débuts, juste quelques bribes. De toute façon il n’était pas certain que l’histoire aurait gagné grand-chose en compréhension s’il avait pu remonter jusqu’à la petite enfance de chacune.
Oui, singulièrement cette histoire avait plusieurs commencements. Avec de telles protagonistes rien de bien étonnant ! Pour arriver à d’inextricables situations dans lesquelles allaient se retrouver ces jeunes femmes.
Complexité de la vie, petits mensonges, grosses affabulations, arrangements avec le vrai et le faux, amours, ruptures, dans cette époque où il semble très « branché » de se dire lesbienne. Par vérité, par provocation, par jeu ?
C’était le menu de la fin de ces adolescences féminines.
Il n’y a déjà pas pire que la vie pour compliquer les choses simples. Alors quand en plus on veut s’en mêler…
Où se situait la vérité exactement ? De quelle bouche sortait-elle ? Ni de l’une ni de l’autre, Franck se plaisait à croire qu’elle se situerait très raisonnablement dans un juste milieu. À défaut d’une extrême précision, il était certain en prenant sa plume que le récit y gagnerait en clarté !
Tout débutait pour Franck au début du mois de novembre de l’an mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Les premières notes qu’il avait prises étaient couchées sur les feuilles d’un carnet tout vierge. Un de ces blocs-sténos qui ne le quittait jamais, éternel confident toujours prêt à recevoir le plus souvent des écrits d’ordre professionnel. S’il n’avait pas été journaliste aurait-il eu la curiosité de remonter ces pistes pour obtenir une telle compilation de renseignements ? Aurait-il recueilli aussi facilement des confidences parfois croustillantes ?
S’il n’avait pas été l’ami proche, voire très proche, de quelques-unes de ces jeunes femmes, aurait-il pu partager tant de choses avec elles ?
Certainement qu’il serait resté le témoin attentif, mais muet d’une situation complexe à laquelle il avait été mêlé bien malgré lui. La curiosité est un vilain défaut, paraît-il. C’est faux, et si la vie est dans ce cas plus tranquille, elle est également beaucoup moins passionnante !
La curiosité permet de mieux appréhender les choses et les gens, de connaître les détails qui aident à la compréhension du monde que l’on partage avec les autres. Quand on est journaliste, comme Franck, comment est-il possible de tenir le bout de la pelote sans avoir envie de tirer dessus pour voir se dérouler l’ensemble de la ficelle ? Et parfois, tout au bout de ce long ruban de vie, une énorme surprise attend. Elle sera de joie ou de peine, à chacun d’en faire ce qu’il voudra.
À l’autre extrémité de cette ficelle, Franck avait découvert un monde inconnu. Une sorte de galaxie lointaine, au milieu de laquelle tout le monde vit, sans bien en prendre la mesure.
Les femmes qui forment cet univers sont parmi celles que chacun d’entre nous croise en permanence. Rien ne les distingue des autres. Elles sont jeunes ou moins jeunes, elles sont belles ou plus banales, elles sont gaies ou tristes. En fait, la seule particularité de leur personnalité ne se voit pas. Elle n’est pas physiquement remarquable, nullement décelable au seul regard. Elle fait partie d’un monde intérieur, de l’intimité de chacune d’entre elles.
Elles aiment les femmes. C’est tout !
2
Si l’expression « être née dans le velours » devait avoir un sens, elle s’appliquerait particulièrement bien à Marie-Anne, même si par ailleurs on n’est jamais responsable de naître au sein d’une famille aisée ou plus modeste. Le hasard de la vie lui avait octroyé cet avantage de l’aisance matérielle, plus exactement celle de ses parents, et un futur où elle n’aurait pas à se confronter aux fins de mois difficiles.
Mère au foyer, Geneviève Mosht de la Tréandière animait la maisonnée. Grande et plutôt mince, elle avait le visage expressif, quoique rarement rieur, comme si sa condition l’obligeait à forcer sur les rides naissantes de son front. C’était sans aucun doute une belle femme, la trentaine un peu dépassée, rayonnante, et qualifiée comme telle par les rares personnes susceptibles de la croiser assez longtemps pour apprécier d’elle autre chose que son physique. Toujours élégante du matin au soir, elle s’attachait à être la gravure de mode fidèle à ce que son mari pouvait espérer. Une épouse agréable, souriante, toujours disponible et capable de composer avec les relations de travail de Charles-Henri, son mari et seul homme de sa vie, lors des déjeuners et dîners d’affaires.
Tradition oblige, elle vivait entourée, pour ne pas dire assistée, par du personnel de maison en nombre confortable. C’était d’ailleurs la plus importante de ses occupations de diriger cette petite armée de femmes de chambre et de ménage, cuisinières, gouvernantes et autre jardinier, le tout supervisé par un majordome hors d’âge, servant la famille depuis si longtemps qu’il avait vu Charles-Henri en culotte courte. Une chose bien évidemment qu’il n’aurait jamais osé rappeler à son seigneur et maître…
Dans les effectifs du personnel de service, il ne fallait pas non plus oublier le couple habitant la petite maison à l’entrée de la propriété ; lui, gardien en titre de cet immense domaine, et sa femme servant de renfort au service de table les jours de réception au château, c’est-à-dire souvent.
Enfin, il y avait le chauffeur qui, lui, bénéficiait au moins de l’avantage de ne prendre ses ordres qu’auprès de Monsieur de la Tréandière sans passer par le majordome dont l’amabilité et l’œil, autant inquisiteurs que redoutables, étaient craints par tous.
Durant toute sa jeunesse, Marie-Anne avait été persuadée que le chauffeur se prénommait « Bonjour Monsieur », les seuls mots, ou presque, qu’elle avait entendu sortir de sa bouche.
Quant à son père, Charles-Henri Mosht de la Tréandière, Marie-Anne le craignait. Non pas qu’il fut d’une anormale sévérité à son égard, mais sa froideur l’effrayait. S’il avait des sentiments pour sa fille, il n’avait jamais su les exprimer, ou si peu, qu’ils avaient échappé à l’enfant qu’elle était.
Marie-Anne, à qui on avait appris dès le plus jeune âge à ne jamais poser de questions, imaginait son père dans les affaires. Un mot qu’elle entendait souvent, au point que dans ses plus jeunes années, elle s’était imaginé que « les affaires » constituaient un métier en soi. En fait, et jusqu’à la fin de son adolescence, Marie-Anne avait tout ignoré des moyens de subsistance de sa famille. « Les affaires » faisaient vivre tout ce petit monde, et de ça, comme du manque de démonstrations affectives de ses parents, elle se contentait.
Tout aussi strict pour lui-même que pour les autres, la quarantaine bien conservée, Charles-Henri Mosht de la Tréandière portait beau et semblait ne jamais présenter de faille, fidèlement droit dans ses costumes sur mesure. Sa haute taille ajoutait à sa prestance naturelle, rehaussée par une courte barbe bien taillée. Fidèle mallette en main, ne le quittant jamais ou si peu, il partait du château toujours très tôt pour n’y revenir que toujours très tard. Sauf les jours de réception où il s’attachait, politesse oblige, à recevoir personnellement ses invités.
Le maître de maison trônait donc sur cette cour, lui après son père et son grand-père et à la suite de quelques autres ancêtres, dont les portraits peints sur les boiseries de la galerie principale du château jaunissaient au fil du temps. Celui qui avait toujours le plus intrigué Marie-Anne portait une collerette caractéristique de l’époque Henri IV. La peinture vieillie par les années d’exposition assurait qu’il était le premier à avoir été ainsi affiché sur ce mur pour l’éternité. Elle n’avait jamais cherché à savoir qui il avait été, il lui suffisait de le savoir dans la galerie des portraits de famille et le reste appartenait à l’Histoire.
La famille disposait depuis la nuit des temps d’un nom à rallonge doublé de ses propres armoiries, vieux souvenir d’un titre de noblesse décapité par la Révolution, mais personne n’aurait eu la désobligeance de croiser au village le sieur Charles-Henri Mosht de la Tréandière sans se découvrir, en marquant le salut d’un hochement de tête tout aussi respectueux. Les mêmes signes extérieurs de respect que l’on donnait également volontiers au curé du village, et dans une moindre mesure, au maire, également directeur de la petite école communale, à la seule différence que l’on s’accordait le privilège de tutoyer ce dernier.
Manifestement « les affaires » du papa devaient être florissantes, surtout si l’on tentait de les évaluer en bonnes proportions avec la résidence familiale, domesticité comprise ; un château à la limite du Périgord, planté au centre de plusieurs hectares copieusement boisés et entourés par un mur d’enceinte qui avait toujours semblé très haut et infranchissable à la petite fille qu’elle était.
De toute façon, la jeune enfant, pour autant que l’idée lui en soit venue un jour, n’aurait jamais eu le temps d’entamer une telle escalade sans déclencher l’intervention immédiate de la nounou, sans laquelle toute sortie extérieure ne pouvait pas s’envisager.
La propriété des Mosht de la Tréandière avait été baptisée « le château » par les gens du village, une expression venant là aussi de la nuit des temps, bien que la bâtisse cossue ne ressemblât en rien à un vrai château qui aurait possédé tours et créneaux, donjon et douves avec pont-levis.
Il s’agissait plus d’une immense maison de maître au large perron, pourvue de deux étages bardés de fenêtres, d’une bonne quarantaine de pièces sans oublier les deux ailes repliées vers l’arrière ; sur le côté gauche, celle réservée depuis toujours au logement du personnel de maison, sur le côté droit, celle qui avait jadis hébergé les communs et les écuries.
Symétrie architecturale de l’époque, les bâtisseurs avaient décidé de planter la maison face au jardin d’agrément, dans la droite ligne de l’immense grille d’entrée en fer forgé. La longue, très longue allée, protégeait la bâtisse du regard extérieur, d’autant que les générations de jardiniers avaient savamment ordonné la nature pour que les frondaisons aux multiples essences finissent par dresser un rideau de verdure entre le château et la vie du dehors.
Les propriétaires successifs, qui n’étaient autres que les premiers de lignée de chaque génération des Mosht de la Tréandière, avaient toujours respecté l’aspect extérieur du bâtiment. Seule l’aile droite avait profondément changé de vocation après l’avènement de Charles-Henri et avait été reconvertie depuis deux décennies, pour une partie en garage pour les trois voitures, en cuisine moderne pour une autre partie et en chaufferie-buanderie d’une taille presque industrielle pour la partie restante.
Dès la mort de son père, la décentralisation de la cuisine avait été une absolue priorité pour Charles-Henri qui ne supportait pas que ses couloirs et ses salons puissent sentir les poireaux fraîchement cuisinés. On a les aversions que l’on peut !
Fille unique de cette famille de la haute société, noblesse certes ancienne, mais de province comme le ricanaient les bourgeois parisiens avec force mesquinerie, Marie-Anne, dès sa naissance, en début des années soixante, n’en avait pas moins été élevée loin des câlins familiaux, dans un environnement où les débordements sentimentaux n’étaient pas de mise. Pas plus que les jeux en commun avec les enfants des domestiques…
Une incursion ensuite vivement réprimandée auprès de la mère concernée par un majordome aux ordres, car Geneviève Mosht de la Tréandière ne se serait jamais commise à la bassesse de dire elle-même tout le mal qu’elle pensait des autres.
Les parents, et surtout le père, auraient-ils préféré voir la naissance d’un garçon plus à même de perpétuer le patronyme ancestral ? Une interrogation à laquelle Marie-Anne n’avait jamais obtenu de réponse, n’ayant jamais osé poser la question. De peur, peut-être, d’en connaître secrètement la douloureuse réponse.
Puisque Geneviève Mosht de la Tréandière ne pouvait plus avoir d’enfant après cette unique naissance, Marie-Anne demeurerait à jamais la seule héritière du nom. Un nom qu’elle devrait abandonner, ou pour le moins adjoindre à un autre, lors d’un futur mariage. Ce serait alors la disparition définitive de cette branche des Mosht de la Tréandière, bien que Marie-Anne n’ait jamais entendu parler d’un quelconque cousinage prouvant avec certitude qu’une autre branche familiale existât.
Ainsi sont passées les premières années de la jeune fille, de gouvernantes titulaires en nounous intérimaires, n’accédant aux repas en famille qu’au début de son adolescence où le seul bruit autorisé, en plus des monologues du père, était celui de la fourchette frôlant l’assiette. Et encore !
Quant aux nombreuses réceptions que ses parents affectionnaient tant, Marie-Anne n’y fut admise que plus tardivement, à l’adolescence déjà confirmée. Et dès sa première présentation publique à cette tablée bruyante et surannée, où l’habit était de rigueur pour les hommes et où les épouses se sentaient obligées de se parer avec force colifichets, elle comprit immédiatement qu’elle n’avait jamais rien perdu en n’ayant pas été présente plus tôt à de précédentes réunions du même genre.
Avec, en plus, l’énorme avantage de pouvoir s’en dispenser elle-même. Une possibilité de choix que Charles-Henri avait concédé à sa fille, non pas par largesse d’esprit, mais toujours par crainte que celle-ci ne sache pas tenir son rang. C’est-à-dire pour une toute jeune fille, répondre correctement aux questions les plus niaises et redondantes des invités. Qui de toute façon se moquaient parfaitement de la réponse et s’en retournaient immédiatement à leurs fadaises collectives.
Marie-Anne s’était ainsi progressivement forgé un caractère solitaire. Ses avancées, notamment scolaires, elle ne les devait qu’à elle-même. En vieillissant, les sermons et les sentences paternels avaient de moins en moins d’emprise sur elle. La jeune fille avait atteint le stade de l’imperméabilisation de son esprit et si, face à une remarque, elle acceptait de faire la moue, c’était désormais uniquement pour donner le change à un père qui ne l’avait jamais vue grandir. Pour autant que ce détail ait pu ne serait-ce que l’atteindre.
L’école étant obligatoire et les parents ne pouvant plus déroger à la règle générale et républicaine, Marie-Anne échangea sa préceptrice contre une institutrice et découvrit la vie à l’école communale.
La vie extérieure, la vraie vie loin des murailles du château, c’est-à-dire l’apprentissage de la coexistence avec des jeunes filles de son âge, leurs ressemblances, leurs différences et les nouvelles affinités. Les débuts ne furent pas forcément faciles, les enfants ne se font guère de cadeau entre eux et pouvoir narguer voire tancer une Mosht de la Tréandière était une occasion à ne pas laisser passer. Alors, face à ces assauts, Marie-Anne possédant déjà un caractère affirmé et n’aimant pas se laisser faire, fit comme tous les enfants de son âge. Elle distribua gifles, coups de pied et autres ruades à qui voulait s’y frotter et l’affaire fut vite entendue.
Bonne élève, sa scolarité primaire se déroula sans écueil. Les places d’honneur qu’elle accumulait ne semblaient jamais faire vibrer ses parents toujours murés dans cette attitude d’une aristocratie hors d’âge pour laquelle il semblait tout naturel d’obtenir le meilleur.
De cette période elle ne conserverait que peu de souvenirs ou, du moins, ne s’épancherait jamais beaucoup en laissant quand même échapper quelques soupirs de regrets.
Marie-Anne avait grandi dans une famille qu’elle n’aura jamais vraiment connue, encadrée plus qu’aimée par un père et une mère qui avaient eu une enfant comme d’autres ont un animal domestique. Mais il fallait bien assurer la descendance !
Néanmoins, c’est à l’école primaire de ce petit village qu’elle connut ses premiers émois avec sa voisine de table, baptisée promptement « meilleure amie », comme seuls les enfants savent le faire. Premiers élans du cœur encore bien éloignés d’une vraie sexualité. Malgré tout, Marie-Anne se souvenait toujours avec tendresse de cette mignonne petite tête blonde de « meilleure amie » avec laquelle elle échangea son premier et bien innocent baiser.
Un baiser donné et reçu avec timidité et précipitation, sous le feuillage touffu d’un arbre généreux ayant accepté d’abriter leur secret. Son cœur avait battu fort et longtemps dans sa poitrine. Bien même après que la cloche ait sonné la fin de la récréation. Le reste de cette mémorable journée s’était déroulé avec le souvenir si présent de ces lèvres humides et sucrées sur les siennes. N’était-ce pas un petit bout de langue qui aurait tenté de forcer ses lèvres ? Marie-Anne se plaisait à le croire.
Elle n’avait jamais vu de tels films à la télé où on s’embrasse comme ça. Un constat, un regret et une découverte…
À la rentrée suivante vint le temps d’intégrer le collège. L’aristocratie reprenait ses droits et Marie-Anne se retrouva dans un collège privé du chef-lieu de canton. Loin du château et loin de Catherine qu’elle ne revit jamais. Loin aussi d’un petit baiser déposé hâtivement sur sa bouche, mais qui avait marqué pour longtemps son esprit de préadolescente.
L’internat fut pour Marie-Anne, comme pour de nombreuses autres filles, une réelle découverte d’un monde sans parents. Un monde où il était possible de parler à table, pas trop fort quand même, d’échanger des idées, de choisir ses amies et surtout de ne plus subir l’autorité parentale aveugle. Même son nom ne la gênait plus, ou moins, puisque d’autres élèves portaient également des patronymes alambiqués, que le professeur pourtant lui-même issu de la bourgeoisie locale, avait une bonne fois pour toutes décidé de couper au plus juste. Ainsi Marie-Anne Mosht de la Tréandière était brutalement devenue Marie-Anne Mosht, puis de ses amies était venu le surnom encore plus court de MMT. Un surnom auquel elle souscrivit avec grand plaisir au point de l’utiliser toujours depuis cette époque.
Brillante en classes primaires, Marie-Anne devint excellente au collège. Peu de matières résistaient à son énorme faculté d’assimiler et de restituer les cours. Les maths et la physique cahotaient plus difficilement dans sa mémoire bien que sa moyenne dans ces matières ne descendit jamais sous la barre des quatorze ou quinze points. Pour le reste, et surtout en expression française, ses copies portaient rarement moins que des jolis dix-huit ou dix-neuf accompagnés des commentaires élogieux des professeurs.
Comme elle pouvait s’y attendre, ses parents n’étaient pas plus prolixes en compliments. Elle décida que désormais, ses victoires scolaires comme les autres victoires à venir dans d’autres domaines d’ailleurs, seraient les siennes et uniquement les siennes. Et elle ne répondit plus à ses parents que lorsque des questions précises l’obligeaient à s’exprimer en réponse avec la même précision. Ses états d’âme étaient devenus secrets. Rien ne transpirait à l’extérieur de cette frustration et souffrance d’enfant. Sans le savoir, ses parents avaient fait de cette jeune fille de quatorze ans une bête de compétition prête à mordre la vie à pleines dents.
Une détermination qui trouva son apogée dans les années lycée où elle ne quitta la tête de classe qu’une seule fois ; le mois où elle ne put concourir aux tests mensuels à cause d’une vilaine grippe la contraignant à s’aliter.
À quinze ans, l’âge de la puberté atteint et dépassé, Marie-Anne s’épanouit pour devenir une jeune fille courtisée. Elle possédait toutes les qualités les plus nobles qu’avaient pu lui conférer ses origines sociales : elle était intelligente, vive d’esprit, jolie brune au corps sportif et solide. Son visage, encadré par des cheveux très courts qui lui donnaient un indéniable côté androgyne, attirait autant les garçons que les filles. Pas toutes, certes, mais plusieurs manifestement troublées par cette ambivalence, souhaitaient devenir sa « meilleure amie » et plus si affinités. Certainement encore ignorantes de leurs propres désirs et sans aucun doute inconscientes que la sexualité peut aussi se conjuguer au féminin. Mais pour Marie-Anne l’appellation de « meilleure amie » avait un sens bien précis. Il portait le souvenir du goût sucré de son premier baiser secret échangé avec une fille.
Malgré les années écoulées, ce premier baiser partagé furtivement avec Catherine n’était pas qu’un lointain et joli souvenir. Elle avait conservé profondément en elle le goût de cette bouche effleurée, de ce petit bout de langue qu’elle n’avait pas laissé s’animer plus avant par peur de ne savoir qu’en faire. Cette douceur ressentie sur laquelle quelques années plus tard elle pouvait mettre des mots, définir des sentiments. Un souvenir d’enfant devenu au fil du temps une envie concrète. Non, le baiser chaste de Catherine n’avait pas quitté Marie-Anne. Elle croyait parfois retrouver le petit goût de sucré-salé qui l’avait tant marquée quand leurs lèvres s’étaient rapprochées.
Vint l’époque quelque peu trouble où elle s’essaya avec garçons et filles. Petits flirts sans conséquence qui ne furent ni poussés ni concluants. Elle trouva les garçons trop empressés et les filles trop timides. Quand arriva l’heure de son seizième anniversaire et le moment d’entrer en classe préparatoire en vue d’intégrer « Sciences Po », avec presque deux ans d’avance, Marie-Anne n’avait toujours pas trouvé son chemin entre filles et garçons.
Un sujet qui la troublait au plus profond d’elle-même, car depuis plusieurs années, elle prenait des décisions rapides et assurées qu’elle n’avait jamais eu à regretter.
Contrairement aux autres filles de son âge, peut-être aussi moins tourmentées, il était impensable qu’elle explique ses interrogations à sa mère et encore moins envisageable de lui déclarer qu’elle ne savait que choisir entre masculin et féminin. Rien que d’y penser, elle imaginait sa mère parcourant les longs couloirs du château en poussant de hauts cris en demandant à Dieu, ou au Diable, qui pouvait avoir mis de telles idées dans la tête de sa fille.
Imaginer Marie-Anne, sa fille, une Mosht de la Tréandière, préférer les filles aux garçons, était tout simplement impensable. Geneviève Mosht de la Tréandière ne parviendrait même pas à afficher le mot « lesbienne » dans sa tête, alors associer cet horrible mot avec le prénom de sa fille lui serait tout bonnement impossible. En cela, et fidèle à la moralité familiale, Geneviève Mosht de la Tréandière penserait plus au qu’en-dira-t-on qu’à l’éventuel bonheur de sa fille. Cette dernière devrait faire un « grand » mariage, avec un homme, ça va de soi, et dans les intérêts de la famille, ça va sans dire !
Donc, Marie-Anne cessa de penser qu’elle pût un jour s’ouvrir à sa mère de ses tourments d’adolescente et décida qu’elle ferait pour ça, comme pour le reste, ses propres expériences et en tirerait ses propres conclusions.
Ses visites au château n’étaient devenues que des passages rapides où, malgré les absences répétées, personne ne semblait avoir quelque chose à dire à l’autre. Marie-Anne avait depuis longtemps fait le deuil de cette famille si bizarre. C’était la sienne, un point c’est tout et elle venait donc régulièrement présenter ses civilités à ses parents.
Singulièrement c’étaient les domestiques qu’elle croisait au hasard des couloirs qui la saluaient plus chaleureusement que les siens. Certains membres du personnel, les plus anciens au service de la famille, avaient vu naître puis grandir Marie-Anne. Ils connaissaient aussi sa vie familiale et savaient que si elle n’avait jamais manqué de soins matériels elle avait été totalement orpheline d’amour.
Elle prenait toujours un réel plaisir à croiser Philippine. Parfois c’est Marie-Anne qui parcourait les couloirs du château pour la chercher. Souvent elle la trouvait dans la cuisine penchée sur les fourneaux. Quel âge pouvait-elle bien avoir, Philippine ? Ses cheveux gris étaient devenus blancs, son embonpoint légendaire n’avait pas varié. Philippine avait toujours été très proche de Marie-Anne. Avec elle, dans ses bras, elle avait trouvé son compte de bisous et de câlins quand elle était petite, puis avait versé ses premières larmes d’adolescente sur son épaule. Philippine avec sa peau hâlée et son accent des îles lui semblait mille fois plus proche d’elle que sa propre mère.
*
Immuable, le château vieillissait emportant ses passagers dans son sillage. Marie-Anne savait depuis très longtemps qu’aucun renfort moral ne viendrait de ce côté. Elle se satisfaisait donc du renfort matériel en encaissant son chèque mensuel. Une somme rondelette qui lui permettait d’assurer très largement ses quelques frais et parfois même d’en faire bénéficier une autre fille sympa moins bien lotie.
Durant sa seizième année, Marie-Anne décida de faire le choix. Non pas que l’âge fut pour elle une quelconque barrière symbolique, mais son caractère lui interdisait de vieillir plus longtemps sans trancher sur un sujet somme toute très simple qui pouvait se résumer en trois mots : garçon ou fille !
Son physique avenant et un sourire enjôleur, dont elle avait appris à jouer avec un art consommé, lui permirent de trouver rapidement dans son entourage les plus beaux spécimens des deux sexes. C’est ainsi, qu’avec la détermination et le plus grand sérieux d’une anthropologue, elle dessina les brouillons de ses futurs amours. Fille, garçon… Garçon, fille ?
Les plaisirs étaient bien différents et à l’issue de trois essais masculins elle posa ses conclusions. Trop pressé, trop court, trop brutal, pas assez attentionné et trop… corporellement envahissant. Bref, avec les garçons la colonne des éléments négatifs était bien longue. Il ne s’agissait plus de plaisir à partager, mais de déplaisir à supporter. Elle décida de vérifier si le souvenir de son premier baiser féminin, confirmé depuis par quelques renouvellements anodins, pouvait s’agrémenter d’un développement plus charnel.
Avec la même détermination que lors du choix des garçons, Marie-Anne se mit en quête d’une fille. Parmi les prétendantes les plus assidues à répondre à ses sourires enflammés, elle jeta son dévolu sur Pascale. Une jolie blonde aux formes avantageuses et à la bouche gourmande. Une coquetterie discrète qui masquait la musculature sportive d’un corps bien fait. Les deux filles s’étaient déjà plusieurs fois croisées à la salle de sport. S’il fallait faire des essais, autant que ce soit avec des partenaires présentant les plus belles qualités physiques. Puis cette Pascale possédait un autre atout. Marie-Anne ne l’avait jamais vue en compagnie d’un garçon bien qu’elle fût plus âgée qu’elle de deux ans. Les sourires et les échanges de regard dans les jours qui suivirent effacèrent toute possibilité de confusion sur leurs envies réciproques. Marie-Anne, plus habituée à mener la barque, fut cette fois prise de court et invitée à dîner par sa nouvelle « meilleure amie ». Qu’il était loin le temps de Catherine et de cette esquisse de baiser !
*
Jamais elle n’avait vu Pascale face à elle aussi longtemps. Presque deux heures en tête-à-tête dans cette pizzéria. Puis de sauter littéralement sur la très bonne « Napolitaine » après avoir dévoré Pascale du regard. Tout ceci ne laissait aucune ambiguïté sur les raisons de l’acceptation de cette invitation.
D’ailleurs, ce qui était valable pour l’une l’était aussi pour l’autre. Pascale n’avait guère posé le regard autour d’elle, mais presque toujours devant elle. Les deux filles pouvaient lire le désir dans les yeux de l’autre, et si elles ne se touchaient que du bout des doigts, c’était plus pour n’offusquer personne alentour que par timidité.
Marie-Anne sentait son cœur battre très vite, Pascale était très belle, et pour une fois, contrairement à ses tenues portées au bahut, elle était sexy avec sa robe échancrée laissant voir le galbe prometteur de sa poitrine.
Marie-Anne rougit légèrement et elle espéra que sous cet éclairage réduit cela ne se verrait pas. Elle avait opté pour une tenue garçonne avec quelques touches de féminité. Un jeans largement rehaussé par des pièces cousues sur des déchirures très à la mode. Des déchirures, notamment sur les cuisses, qui laissaient voir ici et là un petit morceau de peau. Sexy à souhait !
Marie-Anne se doutait, elle espérait que ce soir… peut-être. Elle n’osa pas poser la question. Pascale menait le bal et ça lui allait très bien. Jusqu’au moment où elle posa sa main sur celle de Marie-Anne sans plus s’occuper des dîneurs autour et lui demanda sans ambages si c’était la première fois avec une fille.
Cette fois, Marie-Anne se sentit rougir et dans les yeux de son amie elle sut que ça se voyait. Elle ne répondit que par un léger signe de tête ; Pascale avait déjà analysé la rougeur et elle comprit la réponse non formulée.
Peut-être pour détendre le climat, certainement parce qu’elle était un peu agacée de voir le client d’à côté laisser son oreille traîner jusqu’à leur table, Pascale se tourna vers lui et l’interpella en haussant légèrement le ton.
Si le curieux se retourna vers sa table en maugréant elle est folle celle-là… Ah mon dieu, quelle jeunesse…, les deux filles éclatèrent de rire et de bon cœur pendant que Pascale payait et donnait le signal du départ.
Le chemin du retour fut rapide, à peine le temps pour la conductrice de poser sa main délicatement sur la cuisse de Marie-Anne qui laissa faire et ne demanda même pas où elles allaient. Pour conjurer le mauvais sort ou de peur de briser un rêve en cours de réalisation ?
La jeune fille ne posa pas de questions quand la voiture s’arrêta. Elle n’en posa pas plus quand Pascale poussa la lourde porte cochère d’un immeuble parisien un peu vieillot. Après les bruits de la rue, on n’entendait que les talons des chaussures marteler le carrelage du hall.
Marie-Anne s’entendit répondre « oui », quand deux étages plus haut, Pascale ouvrit la porte de son petit studio et lui demanda si elle était toujours d’accord avant de la laisser passer.
Avant même qu’elle puisse aller plus loin, elle attrapa la main de Marie-Anne, la tira vers elle avec délicatesse. La victime se laissa faire, se retrouva dans des bras solides et son corps frissonna tout entier quand les lèvres de Pascale touchèrent les siennes. Elle eut une pensée fugace pour Catherine en offrant sa bouche. La langue de Pascale cherchait et trouvait la sienne dans un baiser fougueux. Les deux femmes se collaient de plus en plus et leurs corps commençaient à onduler au même rythme. Marie-Anne avait une envie folle de son amie. Elle sentait son corps en émoi et le bas de son ventre devenait de la lave brûlante.
Le studio était petit et il ne fallut pas longtemps pour que les deux soient allongées sans même interrompre leur baiser. Marie-Anne ne pensait plus à ses angoisses, elle avait envie de faire l’amour avec elle et plus rien d’autre ne comptait.
Elle fit comme Pascale lui avait proposé. Se laisser conduire et faire selon ses envies. Son amie ne précipitait en rien les choses, ayant quitté sa bouche, ses lèvres descendaient dans l’échancrure du corsage après avoir mordillé le lobe et farfouillé dans les plis de l’oreille avec sa langue. Pascale s’en doutait depuis le restaurant, mais elle eut la confirmation que Marie-Anne ne portait pas de soutien-gorge. Elle délaissa l’oreille pour ouvrir petit à petit le corsage avec sa bouche puis pour aller mordiller les tétons à travers le tissu. Ils étaient durs et pointaient sous le vêtement.
Marie-Anne laissait faire, appréciant les caresses prodiguées. Pour le moment elle ne pouvait atteindre que les cheveux de sa maîtresse. Aussi, elle ponctuait la montée du désir par de gros soupirs et son corps tout entier réclamait plus. Elle n’osait pas encore se laisser complètement aller. Elle s’imaginait toute mouillée entre les jambes et ça la mettait mal à l’aise. C’était sans nul doute la première fois qu’elle se sentait dans un tel état, mis à part peut-être, mais dans de moindres proportions, lors de jeux solitaires.
Pascale progressait, elle avait détaché tous les boutons du chemisier et sa bouche courait désormais sur la peau nue du torse de Marie-Anne. Elle appréciait la superbe poitrine de sa jeune amie. Maintenant sa langue descendait sur le ventre chaud tout en tentant, mais vainement, de passer sous la ceinture du jeans. La proximité de cette langue s’approchant de son sexe mit Marie-Anne dans un état d’excitation tel, qu’elle tira sans retenue les cheveux de Pascale qui émit quelques gentils grognements de protestation. Marie-Anne lâcha prise et poussa doucement la tête vers le bas.
Tant pis si elle découvre dans quel état je suis pensa-t-elle sans savoir que Pascale était tout autant excitée. Sentir ce corps vibrer sous elle la rendait fiévreusement hardie. Pour autant qu’elle puisse connaître des moments de doute, ce qui n’était pas vraiment le cas ce soir !
Marie-Anne n’analysait plus rien, elle était devenue qu’un corps brûlant de désir et totalement soumis aux caresses de sa maîtresse. Celle-ci avait défait, avec lenteur, avec saveur, un à un les quatre boutons du jeans. Inconsciemment, Marie-Anne les avait comptés en espérant qu’elle ne s’interromprait pas… Pascale n’en avait pas l’intention ! Elle avait trois, quatre ou cinq mains, Pascale avait des mains partout, une qui triturait à merveille les seins, une autre qui passait sous les fesses de Marie-Anne et qui donnait plus de force à sa bouche qui s’attardait sur le ventre tout en poussant son assaut avec délicatesse et fermeté.
Sans s’en rendre compte, la jeune fille continuait de pousser la tête de son amie vers le bas donnant le signal d’acceptation. Mais n’avait-elle pas déjà tout accepté par avance ? Pascale avait désormais atteint la limite du sous-vêtement, en passant sa langue dessous elle sentait les premières douceurs de sa féminité. Marie-Anne s’arcboutait en se tortillant de désir. À chaque mouvement de son amie, Pascale en profitait pour tirer doucement sur le jeans et le descendre un peu plus.
Ce n’était certes pas la première fois qu’on lui prodiguait ce genre de caresse, lors de ses essais masculins Marie-Anne avait fait la découverte d’une langue sur son corps. Rien à voir avec aujourd’hui et ce qu’elle ressentait !
Presque entièrement dénudée, Marie-Anne respirait fort. Elle attendait la caresse suprême, le moment où Pascale poserait ses lèvres sur son sexe en feu. Contre toute attente elle sentit son amie remonter le long de son corps, laissant encore du répit avant l’ultime coup de grâce.
À coups de petits baisers, elle escaladait, remontait… Le nombril, les seins, puis reprit la bouche dans un baiser de folie. Pascale aimait passer ses mains dans les cheveux courts de son amie. Même ce geste relativement banal déclenchait chez elle des torrents de désir. Le corps de Pascale s’étalait de tout son long sur celui de sa jeune maîtresse, leurs sexes se frottaient ne laissant qu’une fine barrière de tissu entre les peaux enfiévrées.
Marie-Anne pouvait maintenant caresser son amie, si celle-ci avait relevé sa robe pour découvrir le bas de son corps, elle laissait le soin à Marie-Anne de la déshabiller du haut. Sans se faire prier, elle souleva doucement épaule après épaule pour que disparaissent les fines bretelles de la robe. Le soutien-gorge ne fut plus qu’un souvenir le temps d’y penser, et enfin, leurs poitrines durcies par le désir se frottèrent.
Le reste des vêtements fut jeté au sol pêle-mêle dans la plus grande excitation. Maintenant c’était corps nus que les deux jeunes femmes se frottaient délicatement, délicieusement. Pascale avait les seins un peu plus forts que ceux de Marie-Anne, mais ils tenaient fièrement tête à la pesanteur. Il n’y avait plus de pudeur, plus de faux-semblants, plus que deux envies à satisfaire… Dont une pour qui la découverte était teintée de désir et de curiosité.
Comme elle l’avait promis, sans rien vraiment formuler, Pascale prit les initiatives laissant à Marie-Anne la possibilité, au gré de son envie, de répéter ses propres gestes. Et en bonne élève, comme d’habitude, celle-ci les reproduisit.
Quand Pascale décida de lui retirer les mains de ses seins, elle la laissa faire. Quand elle décida de redescendre sur son corps en lui demandant des yeux de ne pas bouger, elle ne bougea pas.
Enfin, sauf quand la bouche de Pascale atteignit la zone sensible, la zone située entre le nombril et les prémices de la petite forêt, bien taillée, de Marie-Anne. À ce moment-là son corps incontrôlable reprit ses mouvements et sa respiration remonta très vite et très fort. Pascale était sur les genoux, la tête en bas, et présentait un fort joli spectacle à sa jeune amie. Elle passa une de ses jambes de l’autre côté offrant son intimité imberbe et ruisselante à Marie-Anne. Cette dernière n’avait jamais vu un sexe de femme d’aussi près. Non pas qu’elle n’en connût point l’anatomie, mais là c’était autre chose. Cette vue, à la faible lueur des deux petites bougies colorées, la fit vibrer. Elle mit ses mains sur les fesses fermes puis appuya légèrement dessus. Pascale comprit la demande et s’exécuta.
La plus âgée laissa faire, ne dit rien, n’exigea rien, n’obligea à rien. Même certains gestes un peu maladroits de Marie-Anne lui convenaient. Il lui était agréable de l’aider dans les premiers pas de sa sexualité au féminin. Marie-Anne avait un corps de rêve et répondait avec bonheur aux caresses les plus intimes et les plus variées.
Elle n’eut pas besoin d’agir ni beaucoup ni longtemps, pour que la jeune fille connaisse le plaisir de l’extase charnelle. Son corps encore animé de soubresauts n’en finissait plus de répondre favorablement aux sollicitations de sa langue habile.
Abandonnant, provisoirement, l’adorable coin secret, elle remonta poser sa tête sur la poitrine haletante, avant de recommencer, avec cette fois plus d’initiatives de Marie-Anne. Puis les deux femmes, repues de plaisir, tombèrent enlacées dans un sommeil réparateur et bien mérité.
*
Cette première nuit avec Pascale, manifestement plus expérimentée qu’elle, fut mémorable. Pas besoin d’une seconde tentative, le coup d’essai étant un coup de maître. Marie-Anne se déclara à elle-même et à l’unanimité de son corps et de son esprit que la femme était l’avenir de la femme. Et essentiellement, irrésistiblement et sans contestation possible, parfaitement compatible avec son avenir personnel.
Depuis ce jour, elle ne distribua plus aux garçons que des bises chastes pour le bonjour du matin. Et encore fallait-il qu’elle ne puisse nullement s’y soustraire sans passer pour une impolie. Et que les garçons soient présentables à ses yeux, rasés de frais et de bonne compagnie.
Son choix, arrêté sur les filles parfaitement revendiqué, fit rapidement le tour de ce petit univers scolaire où la sexualité, à l’époque, ne s’affichait pas encore au fronton des écoles. Cela provoqua bien parfois quelques remous, mais Marie-Anne avait maintenant l’expérience et la répartie toute aussi facile que cassante. Au qualificatif de « gouinasse » lâché hasardeusement par un jeune boutonneux, elle rétorquait aussitôt par un cinglant :
Il est certain que Geneviève et Charles-Henri Mosht de la Tréandière n’auraient guère apprécié ce langage pour le moins imagé et les portraits des ancêtres dans la galerie du château en auraient été tout retournés.
Mais comme au temps de l’école primaire et des coups de pied, l’affaire fut vite entendue ! Les garçons préférèrent l’oublier en tant que cible ne voulant plus s’exposer inutilement aux réponses trop souvent très mordantes de cette « super-bonne-nana-canon-mais-malheureusement-goudou-comme-une-grosse-conne ».
Elle termina l’année scolaire avec un carnet de notes exceptionnelles et une liste d’aventures féminines bien remplie sur laquelle Pascale revenait plus souvent qu’à son tour. Avec elle, et à défaut de sentiments profonds, Marie-Anne avait appris l’amour physique pour lequel, suivant l’avis de Pascale, elle présentait de très généreuses compétences.
Puis, avec l’assentiment de ses parents, bien évidemment toujours dans l’ignorance de la sexualité désormais affirmée de leur fille, Marie-Anne décida de terminer son cycle universitaire à Paris.
La version officielle pour les parents était que l’école parisienne serait de loin la plus compétente et présentait un meilleur taux de réussite aux examens. Ce qui n’était pas faux. La version officieuse était la certitude pour la jeune femme que seule la capitale pourrait cacher ses amours au féminin. Ce qui était parfaitement exact.
Vers la fin de sa dix-septième année, Marie-Anne devint parisienne.
*
De Paris la distance augmenta sérieusement avec le château et les visites de Marie-Anne à ses parents se firent plus espacées. L’excuse était toute trouvée : beaucoup de travail et les bonnes appréciations des professeurs à l’issue du premier semestre confirmaient qu’il avait été intensif. Puis venir en train de Paris au village représentait une véritable expédition qu’un seul week-end n’aurait pu satisfaire.
Marie-Anne se construisit tout d’abord son petit nid dans l’appartement familial de Meudon où quasiment plus personne ne venait, sauf une femme de ménage pour un entretien hebdomadaire. Petit nid était un doux euphémisme puisque ledit appartement se constituait d’un loft entre le quatrième et le cinquième étage d’une résidence cossue de cette banlieue parisienne très huppée.
De la fenêtre du salon ou du bureau à l’étage elle pouvait admirer la Seine, Paris et la Tour Eiffel au loin. Un pied-à-terre près de la capitale dont Charles-Henri n’avait désormais plus l’usage, mais chez les Mosht de la Tréandière on ne vendait pas ses biens, on les conservait et on les transmettait par héritage.
Enfant unique, Marie-Anne hériterait un jour de cet appartement, du château familial au village, d’une « bicoque » en Bretagne pas très loin de Saint-Brieuc, d’un petit « trois fois rien » à la montagne près de Megève et d’une foule d’autres biens dont elle ignorait encore tout.
Il y avait même fort à parier que seul le notaire de la famille était l’unique personnage à détenir une liste exhaustive de l’ensemble du patrimoine des Mosht de la Tréandière.
Un patrimoine, qui malgré une évasion de temps à autre en Suisse, contraignait depuis peu Charles-Henri à cotiser généreusement aux bienfaits du nouvel impôt sur la grande fortune. Avec le bonheur que l’on imagine !
Rapidement, moins de trois mois après son emménagement, Marie-Anne finit par trouver le loft meudonnais trop grand et peu pratique pour se rendre à ses cours parisiens. Un peu de marche pour aller prendre le métro à Issy-les-Moulineaux, puis un changement à Opéra. Bref, à bien l’entendre on aurait pu s’imaginer un chemin de croix version étudiante en détresse tout en jouant aussi sur la corde sensible de la sécurité, seule vibration à laquelle son vénéré père pouvait encore réagir.
Marie-Anne pouvait certes se douter que l’argument manquait de solidité, il avait lui aussi résidé à Meudon, mais elle ne pouvait décemment pas dire à son père que sa voisine âgée l’épiait régulièrement et que ceci rendait moins discrets les passages de ses conquêtes féminines jusqu’à sa tanière. Puis, pouvait-il s’imaginer les peurs de sa descendance, lui qui ne s’était jamais inquiété pour elle et pas plus de ses joies que de ses peines ?
Charles-Henri, à des années-lumière des petits problèmes domestiques de sa fille, n’entendait pas se gâcher la vie avec si peu. Il vota tout de suite un crédit illimité « mais dans la limite du raisonnable Marie-Anne, s’il vous plaît, ne soyez pas inutilement dispendieuse », pour que celle-ci se reloge le plus rapidement possible dans un petit studio en plein Paris.
Proche de sa fac, proche de ses amies, proche de ses « meilleures amies » et très loin de la voisine âgée épieuse de jeunes filles.
Quand les moyens financiers sont à la hauteur, rien n’est impossible. La jeune femme trouva rapidement un petit nid encore plus douillet que le précédent, sous forme d’un deux pièces cuisine dans le cinquième arrondissement de Paris. Charles-Henri paya puis cautionna les charges pour le nouveau refuge de sa fille par l’intermédiaire de son notaire qu’il chargea d’en régler les frais chaque mois. Il ne fit même pas le déplacement pour vérifier. Un Mosht de la Tréandière ne se déplace pas de si loin pour visiter un deux pièces cuisine, fût-il parisien !
Ce qui lui évita de constater que la particularité du cinquième arrondissement de Paris est d’abriter la majeure partie de la communauté homosexuelle de la capitale. Avec tous les établissements spécialisés ; restaurants, bars de nuit et autres lieux de débauche que le coquin vient visiter, mais que l’église et la morale réprouvent !
Sans plus de gêne elle attaqua violemment le crédit alloué pour meubler à son goût ce qui deviendrait son royaume parisien de liberté. Marie-Anne mena cette opération avec la même détermination que toutes les choses qu’elle entreprenait. En une grosse quinzaine, l’affaire fut bouclée et elle emménagea dans cet immeuble cossu, équipé, chose pratique, d’un escalier de service.
Geneviève et Charles-Henri durent bien se résoudre à voir moins souvent leur unique enfant, devenue une jeune femme sans se rendre compte qu’ils étaient complètement passés à côté de sa vie.
Marie-Anne, de son côté, constata avec plus d’amertume que de regret, que ses parents n’avaient jamais évoqué avec elle la possibilité de leur venue à Paris ne serait-ce que pour voir comment elle s’était installée.
Toujours fidèles à leurs principes, ils se contentaient d’envoyer, avec une grande régularité, un chèque confortable à leur fille pour qu’elle subvienne à ses besoins et à ses dépenses de jeune étudiante. Néanmoins, le dernier courrier du père accompagnant le chèque, signifiait à Marie-Anne qu’elle se devrait de rentrer au château dès ses études terminées. Charles-Henri Mosht de la Tréandière envisageait de la former aux « affaires » pour qu’elle prenne la suite le moment venu. Une nouvelle fois il ne demandait pas, mais exigeait. Une nouvelle fois il n’avait manifestement pas compris que sa fille suivait des études très différentes de ce qu’il voulait pour elle. Et une nouvelle fois par manque de diplomatie et d’écoute, il braqua la jeune femme qui n’avait que faire de revenir au village perdu, souvenir d’une jeunesse passée sans intérêt.
Différant le conflit par une réponse évasive, Marie-Anne rappela à son père qu’il lui restait encore de quatre à cinq ans d’études et qu’il serait encore temps d’envisager l’avenir au cours d’une conversation en tête-à-tête lors de sa prochaine visite au château.
Cette déclaration constituait un mensonge éhonté puisque aussi bien Marie-Anne que son père connaissaient le cursus suivi qui devait mener à de hautes carrières, qu’elles soient dans l’administration, la politique et même, à n’en pas douter, dans le journalisme.
Marie-Anne ne put, pas plus cette fois que dans sa jeunesse, solliciter le soutien de sa mère. La malheureuse, tellement peu au fait de la scolarité brillante de sa fille, en était restée à dire à son mari :
Jamais elle n’avait pu s’imaginer que la petite détenait déjà les compétences pour envisager de faire ce qu’elle voudrait, et Geneviève Mosht de la Tréandière retourna à la liste de ses invités de la prochaine réception au château.
*
Ainsi, peu après l’âge de sa majorité, l’inévitable se produisit, à savoir la complète rupture entre le château et Paris, entre Marie-Anne et ses parents ou plus exactement avec son père, ce qui revient au même vu que ce dernier avait toujours conservé la triste habitude de parler pour tous. Une nouvelle fois, mais de façon plus pressante, Charles-Henri redoutait que sa fille ne fît pas de hautes études commerciales, ayant toujours en tête une future passation de pouvoir entre lui et elle.
Peut-être pour la première fois de façon très nette, Marie-Anne lui annonça que sa vocation était le journalisme et qu’elle poursuivrait encore « Sciences Po » un an ou deux avant de se diriger vers une école de journalisme et qu’il n’y avait pas à y revenir.
Cette déclaration en forme de décision irrévocable, ressemblant à une déclaration de guerre, eut pour conséquence une mémorable engueulade avec son père qui n’avait jamais entendu sa fille lui parler sur ce ton et encore moins élever la voix en lui coupant la parole.
Immédiatement, de dépit et dans un énorme élan d’amour paternel, Charles-Henri décida de lui couper les vivres. Fini le coquet chèque mensuel. Début de la galère et de la débrouille.
Qu’importe, Marie-Anne se sentait désormais prête à conquérir la vie, conquérir sa vie. Elle savait depuis toujours ce qu’elle souhaitait exercer comme métier ; elle serait journaliste pour voyager et raconter la vie des autres, leurs plaisirs, leurs détresses, leurs joies et, espérait-elle, expliquer dans le menu les grands moments qui font l’Histoire avec un H majuscule. Être au cœur de l’action, rencontrer et discuter avec les gens proches d’événements heureux ou malheureux, voilà son plus cher désir qui nourrissait sa vocation et sa volonté inébranlable de réussir.
Faire en fait ce qui lui avait cruellement manqué dans ses tendres années. Ses parents, une nouvelle fois sans le savoir ni le vouloir, l’avaient armée pour cette aventure solitaire.
La fille unique, donc forcément future héritière de l’immense fortune des Mosht de la Tréandière, venait de quitter officiellement le nid.
Une nouvelle qui ébranla le château et ses habitants.
Le père tempêta et la mère déprima.
Pour Marie-Anne l’envol avait très largement précédé cet épisode !
3
La vie quotidienne de Marie-Anne se modifia rapidement. Le compte bancaire, qui n’était plus alimenté par le chèque paternel et mensuel, se trouva rapidement au niveau le plus bas avant de flirter avec le négatif. La jeune femme était attentive à ses dépenses qu’elle limitait au strict minimum, mais quand on puise dans n’importe quel récipient au contenu non renouvelé, la finalité n’est qu’une affaire de temps ; le résultat, lui, est déjà connu.
Loin du château familial, loin des répétitifs et inutiles conseils paternels, loin des occupations futiles de sa mère et à mille lieues des exigences d’une aristocratie qu’elle avait dans le même temps appris à détester puis à combattre, Marie-Anne cherchait la solution qui lui permettrait de gagner de quoi subsister correctement sans pour autant sacrifier ses études.
La solution se présenta après qu’elle fit la connaissance de sa nouvelle « meilleure amie » : Aurélie, une jeune femme d’un an son aînée, à l’homosexualité décomplexée, elle-même étudiante à Sciences Po, boursière et toujours entre deux découverts bancaires.
Autant Marie-Anne était brune qu’Aurélie était blonde, une vraie blonde, et c’était un bonheur de les voir ensemble. Enfin pour celles et ceux qui acceptent sans préjugés de voir deux femmes ensemble…
Après une période assez courte de quelques semaines, les deux jeunes femmes décidèrent de vivre en couple, pour le meilleur et sans le pire, aimaient-elles plaisanter avec leurs amies. Marie-Anne étant la seule des deux à avoir un « chez soi », le choix de la résidence fut vite fait. Cette vie commune était une première expérience pour les deux. Ni l’une ni l’autre ne savait où elles allaient, mais détenaient la certitude d’y aller ensemble. Pour le reste on verrait bien à la longue.
Un beau matin Aurélie débarqua chez son amie, avec pour tout bagage, un sac à dos de taille moyenne. Toute sa fortune, toute sa vie se compressaient dans ce sac rouge déjà bien fatigué. Les deux amies, partageant les mêmes cours, la même salle de sport, les mêmes goûts féminins, avaient très logiquement décidé de partager le reste. Même (ou surtout) en cas de disette, l’amour constitue toujours le meilleur remède. Autant dire que pour ces deux-là, la vie était au beau fixe.
Plus par nécessité que par principe, le partage des charges était de mise dans l’organisation financière du couple et sans que Marie-Anne cherche vraiment à savoir comment elle se débrouillait, Aurélie parvenait toujours à payer son écot en temps et en heure. De son côté, Marie-Anne comptait sou après sou, puisant modestement, mais régulièrement sur son compte épargne, que son père, dans ses largesses d’antan, avait généreusement doté. Il était loin le temps de la quiétude à l’ombre des largesses paternelles, il fallait gérer la crise et Marie-Anne s’y employait du mieux possible.
Aurélie, après de longues hésitations, décida d’expliquer à Marie-Anne comment elle gagnait quelques centaines de francs en une soirée. Elle n’avait même jamais abordé le sujet de son petit job d’étudiante. La honte de ce qu’elle faisait ? La crainte de décevoir son amie peut-être ? Ou alors parce que son activité pouvait apparaître comme éloignée de la morale du commun des mortels et pas des plus reluisantes ? Une activité secrète qui permettait à la jeune femme de revenir le dimanche soir avec parfois bien plus de mille francs.
On était certes loin de la fortune, et surtout de la valeur du défunt chèque mensuel, mais selon Aurélie cette manne gagnée facilement et honnêtement, précisait-elle à qui voulait l’entendre, lui permettait de vivre plus confortablement. Dans tous les cas de vivre au présent et poursuivre ses études sans quémander à ses parents financièrement exsangues.
Un soir, devant les inquiétudes sérieuses de son amie sur sa situation financière, Aurélie estima de son devoir d’expliquer ce qu’elle faisait et cette possibilité de partager son activité avec sa compagne. Marie-Anne venait de lui avouer, une fois encore, que cette fin de mois ne serait pas facile et que son banquier allait encore exiger de la rencontrer. Une situation financière qui sentait le soufre, avec cette fois le spectre du retrait de ses moyens de paiement. Le compte épargne ressemblait à un puits quasi épuisé, une grande citerne désormais à bout de réserve. Le début de la fin en quelque sorte.
Une peur d’être complètement à sec à très court terme avec en ligne de mire l’obligation d’avoir recours au château… Rien que d’y penser Marie-Anne sentait l’amertume monter en elle et lui donnait l’envie de s’ouvrir à de nouvelles perspectives. La question n’était pas de savoir s’il lui fallait travailler, mais de savoir ce qu’elle pourrait faire.
Elle avait déjà repoussé plusieurs propositions ; toiletteuse pour « toutous à sa mémère », caissière intérimaire dans la supérette du coin ou encore préparatrice de hamburgers derrière le comptoir de l’oncle Mc Do. Non pas que ces petits boulots ne correspondaient pas à son étiquette, Marie-Anne n’avait aucun a priori, mais ces activités étaient trop voraces en temps et elle ne voulait pas prendre le risque de mettre ses études en péril.