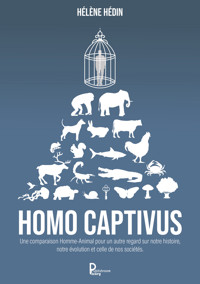
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Il n’est pire prison que celle dont les barreaux sont invisibles
À l’état sauvage, nombre d’espèces sociales (telles que loups, babouins ou chimpanzés) forment des structures hiérarchiques fondées sur l’expérience acquise et le respect de normes éthiques : le lien à l’autre passe avant l’intérêt individuel, les pulsions égoïstes sont régulées, le partage et l’entraide sont récompensés. En revanche, dans un environnement toxique en captivité, ces mêmes espèces forment des sociétés « sans foi ni loi » : des hiérarchies de dominance fondées sur la compétition pour l’accès aux ressources et leur accaparement.
Force est de constater que les sociétés humaines civilisées ont un modèle de développement comparable à celui des animaux des zoos. Mais de quoi sommes-nous donc captifs ?
À travers une démarche pluridisciplinaire, l’auteure met en relation de nombreuses informations issues de la littérature scientifique actuelle et propose une vision novatrice des lois de la vie, de l’évolution de l’Homme et de la société.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HélèneHédin
HOMO CAPTIVUS
Une comparaison Homme-Animal pour un autre regard sur notre histoire, notre évolution et celle de nos sociétés.
Prologue Récit d’une apocalypse
« Laisse le ciel s'écrouler, quand il s'effondrera, nous nous tiendrons bien droits, nous ferons face ensemble ». (Adele, « Skyfall »).
Je suis de la génération décrite par Pierre Bachelet dans sa célèbre chanson : celle qui a vingt ans en l’an 2001. Lorsque sort le célèbre 45 tours, nous sommes en 1985. Le chanteur y est accompagné par un chœur de jeunes enfants qui se plaisent à imaginer comment sera leur vie lorsqu’ils auront vingt ans. Leurs voix inspirent l’innocence mais aussi la force, l’enthousiasme et la liberté. À quoi rêvent-ils ? De quoi auront-ils envie, que feront-ils lorsqu’ils deviendront grands ? Le père qu’interprète Pierre Bachelet les prévient des dangers, mais ne réprime pas leurs élans. Il se dégage de sa voix une certaine bienveillance. Il s’émerveille aussi de la force de vie et de l’envie d’auto-accomplissement qui animent ces enfants. Comme tous ceux de ma génération pour qui cette chanson est un porte-voix, j’ai moi aussi des rêves plein la tête, une imagination débordante et cette envie de vivre. Tout commence donc plutôtbien.
Pourtant, peu à peu, la joie et l’insouciance laisseront la place au désenchantement, à la désillusion et à la frustration. Jeune lycéenne, mon état d’esprit fait plutôt écho à une autre chanson des années 80 beaucoup moins connue. Je tombe sur ce vieux disque oublié dans la collection de ma mère lorsque j’ai 17 ans. Je suis alors en pleine révision du bac français (et accessoirement en pleine crise d’adolescence). J’ai cruellement besoin d’une pause après avoir relu mes fiches jusqu’à la saturation intellectuelle. J’ai envie de prendre l’air, mais il pleut à torrent… Je choisis donc de me caler dans le canapé du salon, casque sur les oreilles, et d’écouter en boucle tous les vieux vinyles qui me tombent sous la main. C’est alors que je redécouvre « Rêver », d’un certain groupe québécois nommé Crescendo. La chanson est assez kitsch, typique du style années 80, mais je suis frappée par les premiers mots tant ils décrivent parfaitement l’état d’esprit dans lequel je me trouve à ce moment-là :
« Rêver, on ne sait plus comment,
Pleurer, on est plus des enfants,
Demain, le monde a 2 000ans,
Aimer, est-ce qu’on saura vraiment ? »
Je suis bouleversée tant c’est précisément ce que je ressens en moi, profondément, intensément. Symboliquement, l’adolescence nous parle d’identité : nous savons à présent ce que nous aimons et ce que nous n’aimons pas, nous avons vécu des expériences qui nous ont fait grandir et ont fait de nous des êtres uniques. Nous avons la sensation de nous connaître. Mais en toile de fond, il y a toujours des interrogations profondes, des non-dits à peine voilés : « voilà ce que nous sommes. Mais à présent, qu’en faisons-nous ? Quelle place y a-t-il pour nous dans cette société ? Quelle place pour l’amour ? Peut-on encore oser avoir des rêves, vouloir changer le monde ? Sommes-nous des idéalistes ou devons-nous nous résigner à suivre le chemin que cette société a tracé pour nous ? » A l’âge où cette intelligence existentielle se développe en moi, je me retrouve plongée dans ces questionnements. Il est vrai que les choses ont bien changé et les prises de conscience concernant le monde ont fini par percer la bulle protectrice de mon enfance. Cette société que je découvre éveille en moi colère, injustice et déceptions en tous genres. Je cherche à comprendre, je me pose des questions auxquelles personne ne semble avoir de réponse. Le monde est fou, et tout le monde s’en fout… Je ne me sens pas du tout à ma place et j’ai l’impression de perdre mon temps à devoir jouer un rôle malgré moi pour faire partie d’une scène de théâtre. Mais je joue mal, je ne suis pas bonne actrice. Je vois la souffrance partout autour de moi, la dysfonction aussi. Cela crève les yeux. Et pourtant, personne ne semble vouloir voir. Il en découle un sentiment de solitude qui ne me quittera jamais plus. J’aime me retirer dans la nature auprès des animaux car j’y trouve l’équilibre et le réconfort que je ne ressens pas auprès de ma propre espèce. Il y a, dans le monde vivant, quelque chose de grandiose, une dimension sacrée à laquelle j’aime me sentir connectée. Je choisis d’étudier la biologie car je veux comprendre le mystère de la vie. Je veux connaître tous ces êtres merveilleux qui peuplent la Terre… Étudier la Vie, la comprendre puis l’enseigner : cela me paraît un beau projet d’avenir.
En 2002, je rencontre Toni au cours de vacances aux Baléares. Il est espagnol, il a 17 ans et moi 21. Le coup de foudre est immédiat et réciproque. Nous entamons une liaison en anglais, car il ne parle pas plus français que je ne parle espagnol. Nous poursuivons cette relation à distance pendant trois ans, sous le regard incrédule ou moqueur de nos proches qui n’auraient pas parié un centime sur la longévité de notre couple. Mais c’était sans compter sur notre amour et notre détermination. Il est vrai que cela peut paraître fou. Mais après tout, nous n’avons rien à perdre. Cette aventure amoureuse me fait sentir à nouveau vivante, vibrante, ce qui ne m’était pas arrivé depuis longtemps. J’avoue avoir un côté romantique, romanesque même. Et puis, après tout, je suis française… Or, comme tout le monde sait, « impossible n’est pas français ! ». Bref, j’ai juste envie de mordre la vie à pleines dents. Cette expérience me donne l’opportunité de rêver à nouveau et qui plus est, d’une manière haute en couleur. La perspective de partir vivre avec Toni en Espagne me transporte de joie. Un vent de liberté souffle sur ma vie et je ne me rappelle pas avoir ressenti un jour une telle intensité. Pendant ces 3 années au cours desquelles nous sommes séparés l’un de l’autre (nous nous voyons quand même dès que nous avons des vacances), je termine mes études, passe le CAPES en Sciences de la Vie et de la Terre, me forme à quelques rudiments d’espagnol et me renseigne sur les dossiers de candidature afin de postuler pour un lycée français en Espagne. Je suis plus que motivée. Et la chance va me sourire !
Ma vie professionnelle commence sur les chapeaux de roues. En 2004, j’effectue mon stage de première année d’enseignement dans un collège du bassin minier de mon Pas-de-Calais natal. L’année suivante, aussi incroyable que cela puisse paraître, j’obtiens un poste de SVT au lycée français Molière de Villanueva de la Cañada dans la banlieue de Madrid. Au cours des quatre années suivantes, je vais vivre une relation à la fois fusionnelle et passionnelle avec mon métier. Les élèves du lycée français sont très bien éduqués, respectueux et cultivés. Je suis catapultée dans un milieu social pour lequel l’école fait sens. Ces jeunes n’ont donc aucun mal à coopérer pour apprendre. Dans ma profession, c’est habituellement en fin de carrière que l’on peut prétendre à un poste de ce genre. J’ai l’immense privilège de commencer ma vie professionnelle par cela. J’ai conscience de la chance qui m’est donnée d’enseigner en ce lieu et j’en éprouve une profonde gratitude. Dans les premiers temps, tout n’est que défis et responsabilités. C’est difficile, mais j’apprends vite et surtout, j’adoreça !
Je suis finalement inspectée en 2010 et cela se passe très bien. Consécration. Cette expérience m’a montré à quel point j’aime enseigner et qu’effectivement, j’ai des dons pour cela. Mais au bout de quatre ans, je commence à ressentir une perte de sens et de l’ennui car les défis sont beaucoup moins nombreux et cette intensité du départ a fini par s’étioler. Nous partons pour Majorque en 2010 et j’entre au lycée français de Palma où un demi-poste de SVT vient de se libérer. Je me dis que peut-être, en changeant d’endroit, j’aurai de nouveaux défis à relever… Ce sera effectivement lecas.
Le public du lycée français de Palma est très différent de celui de Villanueva. Il y a plus d’élèves en difficulté, issus de classes sociales moins favorisées. Je sens immédiatement que l’école fait beaucoup moins sens pour certains d’entre eux. J’ai très vite l’impression, malgré tous mes efforts, de laisser quelques élèves sur la touche. Je ne parviens pas toujours à les accrocher, à leur accorder le temps nécessaire pour les aider à s’en sortir. Leur redonner du sens est un défi de taille. J’essaie des choses, j’échoue, je me remets en question souvent. Je me relève malgré tout. Et si ce n’était pas moi, le problème ? Cela m’amène à de nombreuses prises de conscience plus générales sur l’école. Je commence à entrevoir la problématique du système scolaire qui marche pour certains, mais pas vraiment pour tous. Je ne crois pas judicieux de faire asseoir ces ados sur une chaise pendant huit heures par jour à un âge où, me semble-t-il, ils devraient sortir, voyager et découvrir le monde… Et puis, il y a le problème de l’orientation professionnelle : les jeunes ne se connaissent pas assez pour prendre la bonne décision. Bien souvent, ils choisissent leur orientation par défaut ou par conditionnement social, rarement par vocation. Cela m’interpelle. Beaucoup commencent des études puis se réorientent, s’apercevant trop tard que celles-ci ne leur conviennent pas. Quelle responsabilité avons-nous en tant qu’enseignants ? Nous ne les aidons pas vraiment à se connaître. Je me pose beaucoup de questions…
Deux ans plus tard, je récupère un temps plein, l’essentiel sur le lycée mais aussi quelques heures de collège, ce qui ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Quelque chose me frappe : je vois des enfants de 12 ou 13 ans vivants, vibrants, les yeux pleins de curiosité et très participatifs. Et puis, quelques années plus tard, ces mêmes jeunes sont devenus des adolescents las, apathiques, aux yeux vides, ayant perdu tout leur enthousiasme et leur motivation… Le changement fait froid dans le dos mais fait cruellement écho à ma propre histoire. Entre l’enfance et l’adolescence, quelque chose se casse… Que faisons-nous avec nos jeunes ? Sommes-nous en train de participer, malgré nous, à une fabrique de zombies, en appuyant un système scolaire qui de toute évidence, les vide de leur essence vitale tout en remplissant leur cerveau de connaissances inutiles dont ils auront oublié la quasi-totalité quelques années plus tard ? Est-ce cela, l’école ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Je suis de moins en moins d’accord avec cette structure verticale, où l’enseignant dispense de la connaissance tandis que les élèves la reçoivent plus ou moins passivement. Je pense que nous serions plus utiles à détecter leurs talents. Un jour Arnaud, élève de terminale S, me dit comme ça l’air de rien : « Madame, bientôt vous les profs, vous ne servirez plus à rien puisqu’on a internet ! ». Je crois au fond de moi qu’il a raison. Le métier d’enseignant doit évoluer ou mourir, c’est bien cela que je ressens. Je n’ai pas l’impression que nous apprenions aux jeunes comment ils doivent penser, mais nous participons à un système qui leur dit quoi penser. Je suis de plus en plus dégoûtée, écœurée. Je commence à perdre mon autorité, car encore faudrait-il savoir au nom de qui ou de quoi l’exercer. Quelle est la vision que je souhaite défendre ? Pas celle-là, j’en suis sûre. Mon drame, c’est que j’adore enseigner et au fond je crois que je ne suis pas faite pour autre chose. Mais pas ici, pas comme ça. Peu à peu, mon travail perd de son sens, et les choses ne vont pas s’arranger…
Toni se retrouve au chômage le premier décembre 2011, six mois à peine après notre mariage. Il a alors vingt-six ans, moi trente. Dans sa courte carrière d’électricien, il a connu trois entreprises différentes et a déjà une vision claire de ce que veulent dire les termes exploitation, injustice et humiliation dans le monde du travail. Petit exemple : dans son dernier emploi, on lui payait une partie du salaire au noir. Lors des réévaluations salariales périodiques, par le merveilleux principe des vases communicants, on lui augmentait la part légale, tandis qu’on lui baissait la part au black « pour rééquilibrer ». Tour de magie et retour à la case départ. Mais cette fois, c’est le tsunami : licenciement économique. Pour lui comme pour moi, c’est la stupéfaction ; nous ne nous y attendions pas. S’ensuivront pour lui plusieurs mois de galère et de dépression, un sentiment d’inutilité, de nullité même, ainsi qu’une perte d’identité (et un refuge dans les jeux vidéo). Pour moi, ce sera un sentiment d’impuissance de le voir sombrer sans rien pouvoir faire, à part récolter malgré moi les dommages collatéraux de sa mauvaise humeur. Et puis, bien sûr, viendra aussi la valse des entretiens d’embauche, tous plus déprimants les uns que les autres. Mais il y aura surtout un point de non-retour : en mars 2012, Toni a rendez-vous au siège d’une entreprise située à Calvià. C’est assez loin de chez nous, mais il est prêt à faire l’effort. De toute façon, nous n’avons pas trop le choix. J’essaie de mon côté de le soutenir, de l’encourager comme je peux. Ce soir-là, je rentre du travail avant lui et je l’attends, inquiète. J’appréhende, me demandant si ce sera encore une autre déception. En voyant sa mine déconfite lorsqu’il franchit le pas de la porte, je comprends que mes inquiétudes étaient fondées. Il me raconte alors l’humiliation suprême : on lui a fait subir un entretien double. Oui, vous avez bien entendu. Deux candidats au poste à pourvoir sont reçus en même temps. Par des questions spécifiquement choisies, on les met en compétition, on les incite à se rabaisser, à lutter pour des miettes et un salaire de misère. S’ils refusent, vingt autres candidats attendent derrière la porte. C’est d’une telle violence ! Et leurs interlocuteurs sont bien sûr en position de force.
–« Nous voyons que vous avez tous les deux de l’expérience dans le métier : nous supposons que vous devez disposer de votre propre équipement de sécurité, n’est-ce pas ? »
Tandis que j’entends la voix de Toni, je vois sa mine se décomposer et je suis presque aussi dévastée que lui. « Attends », me dit-il, « ce n’est pas fini ! »
–« Disposez-vous d’outils professionnels que vous pourriez mettre au service de l’entreprise ? »
Je n’ose croire ce que j’entends. Je lui demande s’il est sûr d’avoir bien compris… Il est affirmatif. D’ailleurs, l’autre candidat a donné sans hésiter une liste détaillée des outils qu’il possède, comme un vendeur de bazar cherchant à tout prix à revendre sa camelote : « j’ai même une perceuse si vous voulez ! » Pathétique. Bientôt, il va falloir payer pour travailler. Plus notre discussion avance, plus je vois le regard de Toni changer. Je crois qu’il prend peu à peu conscience de la gravité de la situation et de la violence qu’il a vécue. Il était consterné mais à présent, c’est la colère qui met le feu à son regard. Je le comprends tellement.
–« Tu sais quoi me dit-il, c’est fini. Je ne veux plus passer d’entretien. Ça suffit. Je ne veux plus être électricien. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais plus jamaisça. »
Je compatis, je le soutiens dans son choix. « Ne t’inquiète pas, on va trouver une solution ! »
Quelques semaines plus tard, à la mort de son grand-père, le champ de 8 000 mètres carrés qu’il reçoit en héritage lui donne une idée : se lancer dans l’agriculture écologique. Au moins, il fera quelque chose de nouveau. Au moins, il se sentira utile. Je suis enthousiaste, et mes connaissances en biologie pourront sans doute apporter quelque chose. Nous décidons que je viendrai l’aider pendant mon temps libre et les week-ends. C’est donc plein d’espoir que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure. À cette époque, je suis loin de m’imaginer que ce retour à la nature va précipiter de manière inexorable l’effondrement de mon monde et un basculement irréversible de tout mon système de croyances.
Mais nous n’y sommes pas encore. Quelques mois plus tard, c’est cette fois mon bateau qui se met à tanguer. Je suis convoquée à une assemblée extraordinaire au lycée français, en présence du directeur général de la Mission Laïque Française. Le lycée menace de fermer ses portes. Les comptes sont dans le rouge. On nous annonce un plan de restructuration et plusieurs licenciements… À moins que nous ayons d’autres solutions à proposer. Je précise que je n’ai pas un poste de fonctionnaire à Palma, je suis simple salariée recrutée locale. Je suis donc concernée par cette menace au même titre que les autres. La salle commence à s’agiter, les questions fusent. La tension est palpable et les collègues ont peur. J’essaie de rester centrée, d’assimiler ce qu’on me dit. Avec Catherine, ma collègue et amie, nous échangeons un regard… Rester calme, surtout, rester calme. Quelques jours plus tard, nous proposons une solution collective : travailler une heure par semaine gratuitement afin d’éviter les licenciements. La direction est ravie. Bien entendu, aucun d’entre eux ne s’appliquera cette mesure, seuls les employés sont concernés. Ont-ils délibérément choisi d’annoncer le pire afin de nous faire accepter le « moins pire » ? J’ai franchement le doute. Si c’est le cas, c’est un coup de génie. Nous ne pouvons même pas nous plaindre puisque c’est nous qui avons proposé cette solution. Je sens la colère monter. J’ai 18 heures de cours, 11 groupes classes, les copies à corriger, le laboratoire dont je suis responsable et le projet agricole de Toni qui est très chronophage. Non, vraiment, donner des heures gratuitement, ce n’est pas me respecter. J’ai l’impression d’être prise au piège. Je ressens de l’injustice et de la colère, mais au lieu de réagir à la situation, je choisis de regarder cette colère en face à l’intérieur de moi : je la ressens comme une pression dans l’estomac. Ça vibre fort et c’est désagréable. J’accepte ce que je ressens. La sensation diminue peu à peu et laisse place à de la chaleur. Tout à coup, la colère se transforme en une force intérieure d’affirmation, et je ressens le besoin de me positionner face à cette situation : non, Je ne veux pas de ce monde-là, ce n’est pas ce que je choisis de vivre. Je sais bien que je ne suis pas la seule dans ce cas. Partout dans le monde, des tas de gens vivent des situations similaires ou bien pires que la nôtre. Partout, on entend parler d’usines qui ferment, de salariés exploités, de pouvoir d’achat en baisse, de politiciens corrompus, de riches qui continuent à s’enrichir toujours plus tandis que les autres sont toujours plus pauvres. Est-ce le monde dont j’ai envie ? Sommes-nous tous condamnés à lutter pour survivre ? Soudain, je sens une énergie monter en moi, c’est très fort et ça vient vraiment des tripes.
« Non, je ne veux pas survivre. D'ailleurs, je préfère mourir plutôt que survivre. Ce que je veux, c'est vivre. »
Je me surprends à prononcer cette phrase à voix haute, seule dans ma voiture, à peine sortie de cette seconde réunion. Comme si cette énergie d’affirmation s’était soudain transformée en mots. C’est la première fois que je sens aussi puissamment ce feu intérieur, cette force de vie qui demande à s’exprimer. Je crois que c’est vraiment lié à la notion de liberté. Oui, c’est cela : nous sommes tous pris au piège de ce monde qui ne convient à personne. Je suis prise au piège moi aussi, mais je choisis la liberté. Je ne sais pas comment, je n’en ai aucune idée, mais il faut que je trouve une solution pour me sortir de cette prison. Ce simple positionnement est à l’origine de toutes les décisions que je serai amenée à prendre dans les mois et les années suivantes.
Les heures passées avec Toni dans son projet agricole sont une bouffée d’oxygène pour moi. J’ai toujours aimé observer la nature, je peux passer des heures à contempler plantes, insectes et oiseaux, m’allonger dans l’herbe au soleil en écoutant le chant du merle ou en admirant le vol d’un rapace. C’est une forme de méditation. Cependant, plus j’observe la nature, plus je découvre une complexité insoupçonnée. Je suis amenée à la fois à m’émerveiller de cette beauté mystérieuse et à remettre en question les concepts que l’on m’a appris à l’école, puis à l’université. Avec l’agriculture, je vais de surprise en surprise au point de me retrouver en porte-à-faux avec les programmes que j’enseigne. Ma pensée scientifique académique s’étiole chaque jour un peu plus, en même temps que ma propre identité de professeur de biologie.
Trois piliers de ma vie s’effondrent simultanément : je ne trouve plus ma place dans cette société, je ne crois plus dans le système éducatif et je ne suis plus d’accord avec les principes fondateurs de la biologie. Je vis un désespoir profond, celui de ne plus croire en rien. Il ne me reste qu’une seule certitude, un seul pilier : j’aime enseigner. Mais ironie du sort, je ne suis plus en mesure de le faire. Que pourrais-je bien enseigner à présent, dans quelles conditions et dans quel contexte ? Il me semble qu’il n’y a pas d’issue dans ce système. Il faut bien se rendre à l’évidence, et c’est aussi vrai pour moi que pour le collectif : nous ne vivons pas, nous survivons. Je ne sais plus qui a dit que l’Homme vit sa vie comme s’il n’allait jamais mourir et meurt comme s’il n’avait jamais vécu… C’est précisément ce que je ressens. À ce moment-là, je sais ce que je ne veux plus (survivre) mais je ne sais pas encore ce que je veux. Et d’ailleurs, qu’est-ce que « vivre » ? Curieusement, cette question m’a été posée lors de mon tout premier cours de biologie, en classe de CM1. Je m’en souviens comme si c’était hier. La maîtresse nous avait fait travailler par groupe et réfléchir à cette question essentielle. J’avais pris la chose très au sérieux, me proposant comme rapporteur du groupe, écrivant fièrement nos idées : vivre, c’est manger, boire, dormir, respirer… Je crois que c’est à ce moment précis que j’ai commencé à aimer la biologie. Mais dans mon contexte actuel, la question « qu’est-ce que vivre ? » prend tout à coup une dimension philosophique… J’aimerais prendre une feuille blanche et y écrire mes idées avec le même engouement qu’à l’époque. Mais cette fois, je n’ai pas vraiment de réponse claire à apporter. J’ai l’impression d’être dans une prison et de passer mon temps à me cogner contre lesmurs.
Pourtant, une lueur d’espoir va venir éclairer ma lanterne. Pour notre mariage, mes parents nous ont fait une avance sur héritage. Cela représente une somme d’argent assez conséquente. Au départ, je pensais le mettre de côté mais au point où j’en suis, je n’ai plus rien à perdre. C’est alors que je vais prendre une décision radicale, pour laquelle Toni va heureusement m’appuyer : utiliser cet argent pour faire une expérience (car après tout, je suis une scientifique). Que ferions-nous si nous étions libres, si nous pouvions arrêter de survivre ? Que ferions-nous si nous pouvions enfin vivre ? Ce questionnement me remplit de curiosité, comme si je me rencontrais pour la première fois. Toni ne sait trop quoi répondre mais dans ma tête, les idées fusent très vite : j’aimerais vivre à la campagne entourée de nature et d’animaux, avoir du temps pour lire et m’instruire, observer la nature… Plus j’imagine ma vie de liberté, plus la joie revient dans mon cœur. Combien de temps pourrions-nous vivre comme cela ? Cinq ans ? Peut-être plus ? Cela me semble assez pour trouver une solution à ma problématique existentielle. Afin d’ouvrir les barreaux de ma prison, il me faut comprendre comment marche le monde, comment fonctionne Homo sapiens et me comprendre moi-même. Quelque chose cloche dans mon espèce… Mais quoi ? J’ai besoin de temps pour trouver des réponses. Toni est d’accord pour me suivre dans cette aventure complètement folle. J’ai dit que je préférerais mourir plutôt que de survivre. Je vais en effet mourir socialement et symboliquement, mourir à ma propre identité, avec une seule idée en tête : trouver le moyen d’ouvrir les barreaux de ma prison. Si cela ne fonctionne pas, je pourrai au moins dire que pendant quelques années, j’ai arrêté de survivre. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et que se passe-t-il alors ? Je n’en ai strictement aucuneidée…
En 2014, j’arrête de travailler et nous emménageons dans une jolie maison rurale en pleine campagne majorquine. Nous continuons à nous occuper du potager bio que nous limitons à nos propres besoins. Nous nous occupons de nos chats, de nos poules, puis bientôt deux chiens et un lapin viennent agrandir la ménagerie. L’expérience au quotidien nous amène à ralentir, à nous caler sur le rythme du soleil et des saisons. Le corps s’adapte très vite et aligne son niveau d’énergie sur les aléas climatologiques. Il est au ralenti quand le temps est lourd et humide, il s’active après les jours de pluie… C’est drôle ! Nous passons beaucoup de temps dans la nature, à prendre soin des plantes et des animaux. Nous nous retirons dans une bulle, presque coupés du monde extérieur. Méditation, contemplation, observation et lectures rythment mes journées. Plus je me détache du monde, plus mes capacités d’observation et mon discernement augmentent. Mais intérieurement, c’est assez bouleversant… Heureusement, j’ai la chance d’avoir une grande résilience émotionnelle et cela va m’être très utile. Je vais devoir traverser une dépression au sens littéral du terme. Peu à peu, j’enlève la pression qu’il y avait dans ma vie : répondre aux injonctions extérieures, vouloir bien faire, vouloir plaire, vouloir être une personne gentille, travailleuse et responsable, vouloir être reconnue, admirée, aimée…
Nous perdons quelques amis, quelques membres de la famille s’éloignent également. Je ressens bien le jugement vis-à-vis de notre situation que personne ne comprend. On nous colle une étiquette de fainéants, d’irresponsables ou de marginaux. Mais qu’importe, je n’ai plus d’image à défendre. J’accepte toutes les bouffées émotionnelles qui me traversent les unes après les autres. Comme les émotions sont regardées en face et acceptées (j’ai des facilités pour cela), elles ne restent pas plus de quelques minutes. Ça brûle ou ça tremble dans tout le corps, c’est désagréable, mais je tiens bon. Tous les symptômes de la dépression sont là : ralentissement des fonctions physiques et cognitives, perte de repères, perte de sens. Mais tout est vécu pleinement, conscientisé, accepté. En général, les gens craignent la dépression car ils pensent à la souffrance qui l’accompagne. Cependant, et même si cela semble difficile à comprendre, la souffrance ne provient pas de la dépression elle-même, mais de son refus. Pour ma part, je ne la refuse pas mais la prends plutôt comme un processus initiatique. Il faut se libérer de l’ancien pour faire place au nouveau, je comprends cela. Je lâche prise.
Une fois cette phase terminée, c’est avec un regard neuf que je commence à observer le mal-être de ma propre espèce. Volontairement exclue du monde, je peux alors étudier les comportements de mes congénères à la manière d’un éthologue ou d’un anthropologue, comme s’il s’agissait d’une espèce étrangère et que je la découvrais pour la première fois. La démarche peut paraître surprenante… Cette prise de recul m’offre néanmoins une vue imprenable à 360 degrés sur notre société. Je vois désormais mes congénères comme de petites fourmis engagées dans une course quotidienne effrénée, à la recherche de je ne sais quoi… Plus j’observe, plus j’ai l’impression de m’être réveillée d’un cauchemar. En parallèle, plus je me reconnecte à la nature, plus je retrouve l’équilibre et la sérénité qui m’ont tant manqué. Mais cette reconnexion a un prix : dès que j’entre à nouveau dans « le monde civilisé », je suis prise par le stress et l’angoisse. Je me sens agressée par cette agitation mentale collective, par ce rythme effréné qui n’est plus le mien. Je me sens vulnérable, inadaptée, ayant retiré toutes mes armures et protections. Pourquoi un tel décalage entre le fonctionnement humain et celui de la nature ? Il me semble que nous avons « raté » collectivement quelque chose… Quel « virus » a contaminé Homo sapiens ? Et à quel moment de son évolution ?
Je n’ai plus qu’une idée en tête : trouver la réponse à mes interrogations. Je vais alors observer, investiguer, expérimenter, lire de nombreux ouvrages et articles scientifiques, je vais même reprendre des études d’éthologie. Je vais tâcher de comparer les comportements humains avec ceux d’autres espèces sociales animales afin de comprendre l’origine de notre problématique collective. Je vais envisager la vie sous un angle nouveau et approfondir, fouiller, mettre en relation des informations variées… Jusqu’à changer radicalement ma représentation du monde. Ce livre est le fruit de cette expérience singulière : il présente mon cheminement intellectuel personnel et ne prétend en aucun cas détenir LA vérité. Au contraire, il est plutôt une invitation à se réapproprier individuellement les grandes questions existentielles qui ont toujours habité notre espèce et mener sa propre réflexion afin de participer au changement : créer un modèle sociétal plus juste et plus équilibré dans lequel nous pourrons tous, je l’espère sincèrement, trouver notre place.
PARTIE 1 À LA RACINE DES CAUSES
Chapitre 1 Retour aux sources
« Le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, mais plutôt l’illusion de la connaissance ». (Stephen Hawkins)
Un constat déroutant…
Le 15 mars 2020, soit deux jours avant la France, l’Espagne fut confinée. L’expérience insolite qui dura pratiquement deux mois ne changea pas grand-chose à ma vie d’ermite. Cependant, lors des promenades quotidiennes avec mes deux fidèles compagnons canins, un phénomène étonnant vint attirer mon attention : jamais la campagne majorquine n’avait été aussi bruyante… De multiples espèces d’oiseaux nous offraient chaque jour leurs délicieux chants printaniers. Leurs mélodies sonores et enjouées s’accordaient pour créer un concert hétérogène, une harmonieuse cacophonie. Sans nul doute, les oiseaux étaient beaucoup plus nombreux que les années précédentes. D’une part, les pigeons et autres moineaux des villes, habitués à l’Homme et privés de miettes de pain et autres restes de sandwich pour cause de confinement, émigrèrent massivement vers les campagnes. D’autre part, les oiseaux migrateurs, très nombreux sur l’île à cette époque de l’année, furent beaucoup moins perturbés par les activités humaines ; ils purent alors se reproduire beaucoup mieux et étendre leurs aires de nichage. Ces deux effets combinés expliquaient sans doute la mélodie bruyante de ce chœur des cimes, cuvée (et couvée) 2020, assurément un très grandcru !
Une amie m’envoya une vidéo filmée dans le port de Sóller. On y voyait deux dauphins nageant insouciants entre les bateaux à quai. Sur les réseaux sociaux, une vidéo filmée par un amateur montrait des canetons accompagnés de leur maman, se promenant dans les rues de Palma et nageant tranquillement dans une fontaine publique. Ce phénomène de « recolonisation naturelle » eut lieu un peu partout sur la planète, tandis que la pollution diminuait drastiquement. Cela me fit penser à la catastrophe de Tchernobyl : après l’explosion, les populations furent évacuées de la zone radioactive pendant que la nature était abandonnée à son triste sort. Les scientifiques qui retournèrent explorer cet endroit trente ans plus tard pensaient y trouver un désert. Quelle ne fut pas leur surprise de constater que, malgré un niveau de radioactivité effrayant, la vie s’était adaptée et avait prospéré comme si de rien n’était ! Contre toute attente, les êtres vivants avaient totalement recolonisé la région, au point que celle-ci fut déclarée « réserve radiologique de la biosphère ». Adaptabilité, résilience, tendance naturelle à l’équilibre et capacités d’auto-régénération : telles sont les propriétés universelles du vivant. Ce que l’on observa pendant le confinement n’avait donc rien d’étonnant. Lorsque les humains abandonnaient un territoire, la faune et la flore s’y installaient rapidement et s’y déployaient avec panache, même dans les environnements les plus hostiles.
Au-delà de l’aspect écologique, la crise du Covid-19 provoqua de nombreuses prises de conscience collectives au niveau politique, social et économique. Celles-ci aboutirent globalement à un constat d’échec cuisant : l’état de déséquilibre de notre modèle occidental, compétitif et individualiste, exploitant les plus fragiles, destructeur autant pour l’humain que pour la planète nous sauta aux yeux. Nombreux furent ceux qui ne souhaitaient pas un retour au monde d’avant. Comme beaucoup, je me demandais comment changer les choses… Mais avant de pouvoir répondre à cette question, il me semblait indispensable de revenir aux origines du problème : comment en était-on arrivé là ? Comment se faisait-il que l’Homme « civilisé » ne soit jamais parvenu à engendrer des modèles de développement sociaux ou économiques durables, résilients et auto-régulés, à la manière des écosystèmes naturels ?
« Pourtant, pensai-je, notre modèle socio-économique s’inspire directement des lois de la nature : la libre concurrence des entreprises n’est-elle pas la version économique de la compétition des êtres vivants pour l’accès aux ressources ? Notre pyramide sociale n’est-elle pas à l’image des hiérarchies de dominance que l’on trouve chez de nombreuses espèces animales ? La somme des intérêts égoïstes des individus n’est-elle pas censée générer, chez l’Homme comme chez tous les êtres vivants, l’abondance pour tous et le bien commun ? Si notre système socio-économique repose sur les mêmes lois que la nature, pourquoi échouons-nous à créer un monde harmonieux, prospère et capable d’auto-régulation ? Serait-ce que notre compréhension des lois de la vie est erronée ? »
La notion de lois naturelles me ramenait bien sûr à Charles Darwin dont je connaissais très bien la théorie pour l’avoir enseignée pendant de nombreuses années. Cependant, je décidai de m’y plonger à nouveau et de l’étudier sous un angle différent, afin de voir ce qu’elle pouvait m’apprendre sur le fonctionnement de notre société.
Théorie de l’évolution des espèces
Le naturaliste anglais Charles Darwin proposa la célèbre théorie de l’évolution dans son livre « De l’origine des espèces » publié en 1859 après des années d’observations de la nature et de recherches scientifiques diverses. L’une des expériences fondatrices de sa théorie eut lieu au cours de son voyage dans les îles Galapagos vingt-cinq ans avant la publication de son ouvrage. Darwin y observa plus d’une dizaine d’espèces de pinsons : ces oiseaux se ressemblaient beaucoup mais la forme de leur bec était très différente et curieusement, chaque espèce occupait une île différente. Il supposa que ces pinsons auraient pu apparaître à partir d’une seule et même espèce ancestrale. Celle-ci se serait séparée en plusieurs groupes pour peupler toutes les îles. Chaque population aurait alors évolué progressivement de manière indépendante, constituant chacune une espèce nouvelle. Si cela était vrai pour les pinsons, alors peut-être était-ce la même chose pour tous les êtres vivants : toutes les espèces de la planète auraient pu évoluer au cours du temps à partir d’un même ancêtre commun. La théorie de l’évolution étaitnée !
Plus tard, Darwin chercha à expliquer les différences observées dans la forme du bec des pinsons, et tenta d’identifier les mécanismes à l’origine de leur évolution. Il émit l’hypothèse que le régime alimentaire de ces oiseaux était différent sur chaque île en raison de leurs spécificités écologiques respectives : sur certaines îles, l’abondance d’insectes expliquait le bec long et fin des pinsons, adapté à un régime de type insectivore. Sur d’autres, couvertes de végétation arborescente, les pinsons avaient un bec large et épais leur permettant de consommer les fruits de ces arbres (de grosses graines qu’il fallait casser avec un bec résistant). Ainsi, il semblait y avoir un lien entre les conditions de l’environnement et l’évolution de la forme du bec des pinsons : le milieu paraissait « façonner » les êtres vivants… Mais de quelle manière ?
De la sélection artificielle à la sélection naturelle
Afin de comprendre par quels mécanismes l’environnement pouvait bien influencer l’évolution des espèces, Darwin s’inspira de la sélection artificielle pratiquée par les agriculteurs et les éleveurs. Dans la plupart des cas, l’homme qui pratique la sélection a une idée préalable claire de ce qu’il cherche à obtenir avant de réaliser un croisement. Par exemple, si on croise une variété de pommier à gros fruits acides avec une variété produisant de petites pommes sucrées et savoureuses, le résultat recherché est l’obtention de fruits à la fois savoureux et de grande taille, combinant les avantages des deux variétés parentales. On parle ici de sélection méthodique.
Cependant, Darwin avait remarqué que parfois, l’éleveur ou le cultivateur choisissait de conserver certains descendants d’un croisement après coup, sans intervenir sur les modalités de la reproduction elle-même et sans avoir d’idée préconçue de ce qu’il cherchait à obtenir. On parle alors de sélection inconsciente. Par exemple, parmi plusieurs coquelets issus d’une même couvée, le fermier (qui en théorie n’a besoin que d’un seul coq) peut décider de conserver le plus corpulent, le plus coloré, le plus intrépide, celui qui chante le mieux, etc. La sélection s'effectue en comparant les coquelets et en choisissant « le meilleur » en fonction de critères subjectifs. Cette méthode s’appuie sur la variabilité qui préexiste dans la nature : tous les descendants issus d’un croisement présentent en effet des différences et il se trouve que, « par hasard », certaines caractéristiques peuvent être utiles à l’Homme ou attirer son attention pour une raison ou une autre. Pour Darwin, la sélection inconsciente, un processus lent et graduel, aurait abouti avec le temps à de grandes modifications des races domestiques, à l’insu des éleveurs et des cultivateurs1. Il postula alors que dans le monde sauvage, les contraintes de l’environnement avaient façonné les êtres vivants de la même manière que l’Homme avait modifié, sans intention préalable, les espèces domestiques. Il s’inspira donc de la sélection artificielle inconsciente pour proposer une explication à l’évolution : la théorie de la sélection naturelle. Celle-ci peut être résumée comme suit :
•Tous les individus d’une espèce ne sont pas identiques : il préexiste dans toute population et de manière totalement aléatoire, une grande diversité de variations individuelles appelées « caractères » (taille, couleur, forme du bec, etc.). Ceux-ci sont héritables.
•Dans une population vont naître plus d’individus que le milieu n’est capable d’en nourrir. Il n’y a donc pas de place pour tout le monde. En conséquence, le comportement de tout individu est égoïste, agressif ou territorial. Les êtres vivants sont en compétition les uns avec les autres pour l’accès aux ressources.
•Dans ce contexte, seuls les plus aptes, c’est-à-dire les mieux adaptés aux conditions du milieu peuvent survivre, se reproduire et ainsi transmettre leurs caractères. Les plus faibles et les moins adaptés disparaissent sans se reproduire.
•C’est l’environnement qui sélectionne de manière mécanique et automatique les individus les plus aptes qui transmettront leurs caractères à leur descendance. Ainsi, les caractères avantageux se répandent naturellement dans la population.
•À long terme, cette sélection par l'environnement va mécaniquement « façonner » de nouvelles espèces, au cours d’une évolution lente et progressive.
Prenons par exemple le cou des girafes. Selon la théorie de l’évolution, les girafes descendent d’une espèce d’herbivore tout à fait classique (une sorte de grosse gazelle), dont le cou se serait allongé au cours du temps. Mais pourquoi donc ? On peut supposer que chez les ancêtres de la girafe (que nous appellerons proto-girafes), certaines devaient avoir un cou légèrement plus long que d’autres, un peu comme dans la population humaine où certains individus mesurent 1 mètre 50 et d’autres 1 mètre 90. Selon la théorie de la sélection naturelle, ces proto-girafes au cou un peu plus long eurent par hasard un avantage sur les autres lors d’un changement de leur environnement : il faut supposer que ces animaux vivaient au départ dans des forêts denses. Puis, le climat de la région devint plus sec. La forêt se transforma en une savane aux arbres clairsemés, où le manque de nourriture poussa les individus à entrer en compétition les uns avec les autres pour l’accès aux ressources. Dans ce contexte, les proto-girafes avec un cou légèrement plus long avaient un avantage sur leurs congénères : elles pouvaient accéder à des feuilles d’arbre situées en hauteur, tandis que les autres ne pouvaient pas les atteindre. Ainsi, celles dont le cou était un peu plus long se nourrissaient mieux. Elles disposaient d’une plus grande vigueur physique pour échapper à leurs prédateurs, ce qui leur permettait de survivre et de se reproduire. Ainsi, elles avaient plus de chances de transmettre ce caractère particulier (le cou un peu plus long) à leur descendance. Pendant ce temps, les proto-girafes dont le cou était plus petit, ne pouvant accéder à autant de nourriture, s’affaiblissaient. Elles avaient donc moins de chances d’échapper aux maladies ou aux prédateurs, et une probabilité plus grande de mourir sans descendance, ne pouvant alors transmettre leur caractère « cou plus petit ». À chaque génération, la proportion de girafes au cou plus long augmentait donc, tandis que celle des girafes au cou plus petit diminuait. Imaginez ce mécanisme mis en œuvre sur des milliers de générations successives, et vous obtiendrez l’espèce girafe au cou démesuré que nous connaissons aujourd’hui !
Il faut cependant noter qu’à l’époque de Darwin, la biologie cellulaire et moléculaire ainsi que l’ADN et les principes de la génétique n’étaient pas connus. Ces découvertes furent intégrées plus tard à la théorie initiale sous le terme de « théorie synthétique de l’évolution » ou « synthèse néodarwinienne ». Pour faire simple, j’emploierai ici le terme de darwinisme pour me référer à cette théorie scientifique au sens large.
Précisions sur la notion de théorie scientifique
Lorsque j’enseignais les SVT en classe de terminale S, j’expliquais aux élèves que la sélection naturelle est une théorie et non une loi. Une théorie scientifique propose un modèle permettant d’expliquer un phénomène. Elle se fonde à la fois sur des expériences, des observations et sur les connaissances scientifiques disponibles à une époque donnée. Mais celles-ci sont par définition insuffisantes pour la vérifier ou la réfuter au moment où elle est formulée. En attendant de disposer de preuves scientifiques irréfutables, une théorie peut être considérée comme valable, mais ne peut être prise pour une vérité absolue et définitive. Surtout, il faut bien comprendre qu’une théorie est une interprétation du réel. Elle dépend à la fois de l’expérience personnelle de l’auteur et des connaissances scientifiques dont il dispose. Par ailleurs, même si nous en sommes peu conscients, elle dépend aussi du contexte historique et des idées en vogue à une époque donnée (dans le cas de Darwin, le milieu du XIXe siècle) : celles-ci vont influencer la pensée de l’auteur, parfois même à soninsu.
Face à ces considérations, il me semblait donc utile de réfléchir à cette question : quelles idées inspirèrent Darwin pour construire sa théorie ?
Darwin et la pensée du XIXe siècle
Pour y répondre, il me fallut sortir du domaine scientifique. La thèse de Darwin repose en effet sur un certain nombre de points clés : l’insuffisance des ressources pour tous justifiant la compétition entre individus, l’égoïsme, l’agressivité et la territorialité. La lutte entre tous les prétendants à la survie sélectionne de manière implacable les individus les mieux adaptés à leur environnement, ce qui a été traduit de manière erronée par l'expression populaire « la loi du plus fort ». Nous retrouvons également ces notions dans les principes économiques modernes, qui connurent leur essor à la même époque. L’épistémologue André Pichot explique2 : « la seconde moitié du XIXe siècle a vu le triomphe du libéralisme économique, et Darwin a apporté à celui-ci un argument de poids en lui donnant un fondement naturel ». Selon Julio Muñoz Rubio, biologiste et docteur en philosophie des sciences à l’université de Mexico, nous retrouvons dans le darwinisme les principes du capitalisme : un système compétitif dans lequel les entreprises sont en guerre permanente3.
Je supposai alors que les économistes du XIXe siècle s’inspirèrent de la théorie de Darwin pour proposer une vision novatrice de l’économie. Mais en approfondissant mes recherches, je fus surprise de découvrir que les choses ne se passèrent pas du tout ainsi… À l’inverse, le philosophe des sciences Jean Gayon4 explique que la théorie de la sélection naturelle est une transposition à la biologie de la thèse économique du philosophe Adam Smith dont Darwin connaissait très bien la pensée. Adam Smith est considéré comme le père fondateur de l’économie moderne. Il est aussi l’auteur de la célèbre expression « main invisible du marché » : Smith considérait en effet qu’il existait un principe d’harmonisation naturel, une sorte de convergence des intérêts individuels concourant au bien commun. Selon la thèse économique de Smith, si chacun poursuivait son propre intérêt égoïste, il participait sans le vouloir au progrès économique de la société tout entière. Smith considérait l’égoïsme comme le moteur de la croissance et de la prospérité des nations. Il estimait donc que la libre concurrence était le moyen le plus efficace d’accroître la prospérité générale, et par ricochet, celle de chacun. Mais le plus curieux dans tout cela est que la pensée d’Adam Smith fut largement influencée par l’essor des sciences physiques5. Comme beaucoup d’intellectuels de son époque, Smith était fasciné par les méthodes de sciences expérimentales ayant permis de découvrir les mécanismes et les lois qui régissent l’univers. Il pensait qu’il était possible de modéliser les lois du comportement humain de la même manière que l’on modélise le comportement des corps physiques. L’essayiste Charles Robin explique que pour Adam Smith, les êtres humains sont mus par la force de l’intérêt individuel de la même manière que les corps physiques sont mis en mouvement par la force de l’attraction6. La « main invisible » est donc une transposition économique des lois et des principes qui régissent le monde physique. Par analogie avec la théorie de Smith, Darwin affirma que l’équilibre et les lois de la nature provenaient de la lutte des êtres vivants entre eux pour leur propre bénéfice individuel. En s’inspirant de la pensée économique d’Adam Smith,Darwin fut donc influencé indirectement par les sciences physiques, ce qui permet de mieux comprendre le côté très matérialiste et mécaniste de sa théorie.
Mais ce n’est pas tout : Nathalie Lazaric7, directrice de recherche au CNRS, explique que la théorie de la sélection naturelle s’inspire aussi des travaux de l’économiste Thomas Malthus, dont Darwin avait lu les écrits. D’après Malthus, la population humaine avait tendance à augmenter de manière exponentielle, tandis que les ressources du milieu croissaient beaucoup moins rapidement : il y avait donc un manque de ressources systémique et chronique. En l’absence de régulation par des pressions ou des contraintes extérieures (guerres, famines, épidémies, etc.), toute augmentation de la population provoquait inévitablement tôt ou tard l’appauvrissement des individus, et pouvait même conduire, à terme, à l’extinction de l’espèce8. Dans cette optique, la survie de l’Homme ne pouvait donc résulter que d’une lutte féroce permettant d’éliminer les plus faibles, régulant ainsi la population. Darwin ne fit qu’étendre la théorie malthusienne de la croissance des populations humaines à toutes les espèces vivantes. En résumé, la loi de la compétition égoïste, prônée par Adam Smith, se vit à la fois renforcée et justifiée par la thèse de l’insuffisance des ressources proposée par Malthus. Ces deux concepts furent repris par Darwin dans sa théorie de la sélection naturelle.En réalité, c’est donc bien Darwin qui s’inspira de la doctrine libérale et capitaliste et la transposa ensuite au monde vivant, justifiant ainsi les principes économiques de son époque !
D’une manière générale, selon les biologistes Julio Muñoz et Diego Mendez9, Darwin fut largement influencé par la vision du monde du XIXe siècle, marquée par les principes fondamentaux de l’économie politique : propriété privée, marché, argent, surpopulation, manque de ressources, territorialité, bénéfices, succès, égoïsme. Pour ces auteurs, Darwin commit une erreur idéologique en érigeant ces concepts au rang de pilier central de sa théorie. En contrepartie, en donnant à ces principes un fondement naturel, Darwin contribua à justifier leur bien-fondé, ce qui eut sans nul doute un impact sur le succès de sa théorie. Mais cela va encore beaucoup plusloin…
De la théorie au mythe fondateur
Au fil de mes recherches, je découvris que les concepts économiques du XIXe siècle s’ancraient sur une certaine vision de la nature humaine : celle-ci s’inscrivait dans un courant de pensée appelé modernité, qui trouvait son origine à la Renaissance. À cette époque, la science fit d’immenses progrès, et l’Homme moderne, fort de ses découvertes, chercha à s’émanciper peu à peu des lois divines. Il ne voulait plus subir la vision du monde imposée par le Dogme religieux mais au contraire en être l’acteur, créer sa vie à partir de ses propres règles. En effet, le principe essentiel de la modernité est la faculté pour l’Homme de s’auto-déterminer, de définir par lui-même les normes de son existence. La raison, la science, l’individu, le progrès, la pensée rationnelle, la liberté, le matérialisme : tels sont les mots-clés de la modernité. Or, pour s’auto-déterminer, instaurer ses propres lois, encore faut-il se connaître soi-même… Un certain nombre de philosophes, tels Machiavel, Thomas Hobbes et d’autres, se penchèrent sur ces questions. Comme l’explique Charles Robin, ces penseurs considéraient que l’Homme n’était pas naturellement bienveillant, altruiste et pacifique mais au contraire égoïste, violent et calculateur, hostile et agressif envers ses semblables, mû par son seul intérêt individuel. A l’état de nature, les pulsions violentes poussaient les Hommes à la guerre de tous contre tous. Une seule règle prévalait alors : la loi du plus fort. Selon ces philosophes, il était inutile d’attendre autre chose de l’Homme, de l’inciter à s’élever vers des buts plus nobles ou plus spirituels car il en était incapable. Le Bien n’était pas sa nature, et on ne pouvait rien contre la nature10.
À la Renaissance, ces idées étaient relativement marginales mais elles s’installèrent peu à peu dans la société pour finalement s’imposer comme une évidence. Au XIXe siècle, époque où Darwin formula sa théorie, elles étaient très en vogue et bénéficiaient d’un consensus, notamment au sein de la classe bourgeoise anglo-saxonne. Pour Julio Muñoz Rubio11, il est clair que ce « pessimisme anthropologique » inspira Darwin car le principe de la sélection naturelle est une extension de cette conception moderne de l’Homme au monde vivant : puisque l’être humain est par nature égoïste et agressif, alors bien évidemment la nature et toutes les espèces vivantes le sont aussi.
Pour résumer
La théorie de la sélection naturelle se base sur un ensemble de points clés :
•La diversité des individus d’une population
•La préexistence et la nature aléatoire de leurs différences
•L’insuffisance des ressources pour tous (et donc l’idée d’une nature hostile)
•La compétition égoïste et la lutte pour la survie
•La sélection « automatique » des individus les plus aptes par les contraintes de l’environnement.
Cette théorie est dite matérialiste : elle soutient que les mécanismes de l’évolution s’expliquent par un ensemble de principes exclusivement physiques et mécaniques, sans intervention d’une autorité « divine » ou de tout autre principe organisateur de nature transcendante.
Cependant, la théorie de Darwin se base sur les principes économiques en vogue au milieu du XIXe siècle (ceux-ci continuent d’ailleurs à s’appliquer aujourd’hui). Plus largement, le darwinisme s’ancre à une vision philosophique du monde dite « moderne », devenue dominante en Occident à partir des révolutions politiques et industrielles qui eurent lieu un peu partout en Europe au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Bien plus qu’une simple façon d’expliquer l’origine de la vie, le darwinisme est une manière de comprendre la vie au sens large, une philosophie individuelle et sociale qui donne à la fois un sens et une justification morale à la modernité. Ce n’est pas qu’une simple pièce du puzzle matérialiste : c’est la base qui sert à soutenir toutes les autres pièces12.
En réalité, la théorie de la sélection naturelle repose sur un certain nombre de partis pris idéologiques, c’est-à-dire de croyances culturelles tenues pour vraies sans aucune remise en question. Ces préjugés sur la nature humaine et la nature au sens large nous semblent familiers : en effet, n’a-t-on pas entendu, toute notre vie durant, que « l’Homme est un loup pour l’Homme » ? Que la nature est hostile et cruelle ? Ne parle-t-on pas de « loi de la jungle » ? En y jetant un coup d’œil superficiel, cette thèse nous paraît rationnelle, logique, évidente. Cependant, est-elle réellement justifiée ? Les découvertes scientifiques récentes la confirment-elles ?
1 Gayon, J. (1992). Darwin et l’après Darwin : une histoire de l’hypothèse de la sélection naturelle. Paris : Kimé.
2 Pichot, A. cité par Testard-Vaillant, P. (2008). Charles Darwin : de l’origine d’une théorie, CNRS le journal, 227, 19-29.
3 Muñoz Rubio, J. (2009). Naturaleza humana y teoría darwinista. Revista Digital Universitaria, 10(6), 1-12.
4 Gayon, J. (1999). Darwinisme et économie. Magazine littéraire, 374.
5 Diemer, A., & Guillemin, H. (2011). Political economy in the mirror of physics: Adam Smith and Isaac Newton. Revue d’histoire des sciences, 64(1), 5-26.
6 Robin, C. (Janvier 2021). Adam Smith - La main invisible. [Vidéo en ligne]. Consulté à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=OIvtWvDkkVk&t=1149s
7 Lazaric, N. (2010). Les théories économiques évolutionnistes, p.7-30. Paris : La Découverte.
8 Wikipédia. (s.d.) Le Malthusianisme. Consulté à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Malthusianisme
9 Muñoz Rubio, J., & Méndez Granados, D. C. (2015). La teoría de la evolución como revolución conceptual del mundo.
10 Robin, C. (Juillet 2020). Machiavel - L’art de gouverner. [Vidéo en ligne]. Consulté à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=9tt12zMrx3M ; Charles Robin. (2020). Hobbes - L’homme est un loup pour l’homme. [Vidéo en ligne]. Consulté à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=isCVgDObx4c
11 Muñoz Rubio, J. (2009). Naturaleza humana y teoría darwinista. Revista Digital Universitaria UNAM, 10(6), 1-12.
12 Alonso,C. (s.d). Evolución: cuando la ciencia no busca la verdad. Non traduit.
Chapitre2La nature est-elle vraiment cruelle ?
« Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. » (Gandhi)
Le rôle de l’agression
Tous les animaux qui partagent ma vie (chats, chiens, poules et même lapins) sont des espèces territoriales. Je suis donc habituée à les voir régulièrement « se mettre les points sur les i ». Mes trois chattes (Céleste, Canela et Mimosa) se répartissent l’espace au jardin, et gare à celle qui ose marcher sur les plates-bandes d’une autre ! Link (le lapin) a un territoire qui chevauche celui de Mimosa et Céleste mais il tolère les chattes sans problème. Il peut se montrer menaçant uniquement lorsque Mimosa s’approche un peu trop près de lui, tandis qu’il ne se comporte jamais ainsi avec Céleste dont il apprécie particulièrement la compagnie. Les deux chattes, quant à elles, n’agressent jamais Link et le laissent partager leur espace, magnanimes. De même, mes poules les plus anciennes peuvent se montrer très autoritaires envers les jeunettes et n’hésitent pas à leur voler dans les plumes lorsque celles-ci empiètent sur leur espace vital. Cependant, elles laissent mes deux chiens partager leur territoire sans problème. J’aime passer des heures au jardin à observer mes animaux : certains créent des liens forts entre eux tandis que d’autres se toisent de loin ; il est vrai qu’ils « ne tendent pas l’autre joue », mais tous se respectent malgrétout.
Dans la nature, on peut classer les comportements entre individus en deux catégories : ceux qui renforcent l’union et le lien ou comportements affiliatifs (par exemple, deux chiens qui se lèchent le museau ou deux babouins qui s’épouillent) et les comportements agonistiques, visant à mettre de la distance entre individus (par exemple les grognements de menace ou l’agression physique). Grâce à mes observations, je remarquai que les comportements hostiles se manifestent rarement entre animaux d’espèces différentes. Pour l’éthologue Konrad Lorenz, deux espèces qui partagent le même habitat ne s’importunent pas davantage qu’un médecin ne porterait préjudice au négoce de son voisin mécanicien13. La compétition inter-espèces n’existe que dans les cas où l’une d’elles, provenant d’un endroit éloigné du globe, a été introduite par erreur par l’Homme dans un écosystème qui lui est étranger. Par exemple la tortue de Floride, achetée en animalerie et relâchée dans la nature par des propriétaires inconscients, menace la survie de la tortue européenne avec qui elle entre en compétition pour le territoire ou la nourriture. Cette compétition n’a rien d’une lutte à mort, mais se présente sous la forme d’un remplacement progressif de l’espèce autochtone par l’espèce importée, dont les stratégies d’adaptation et de colonisation du milieu sont plus efficaces.
De même, une proie et son prédateur ne peuvent être considérés comme deux espèces en compétition. Par exemple, la lutte entre un lion et une gazelle n’est pas un combat au sens strict du terme : comme le dit Lorenz, sur de nombreuses photographies magnifiques, on peut apprécier comment le lion, dans l’intensité de l’instant précédant l’assaut, n’est absolument pas en colère ou fâché14. Lorsqu’une forme d’agressivité se manifeste entre deux espèces différentes, c’est avant tout pour transmettre un message. Il existe même des exemples « d’agressivité végétale » : les acacias peuvent produire des tannins toxiques dans leur feuillage, ce qui le rend impropre à la consommation par les girafes. Cela se produit lorsque l’arbre a déjà été largement brouté et n’est plus en mesure d’alimenter d’autres animaux car son intégrité physique se verrait alors menacée. Il s’agit donc de transmettre un message à l’animal : « je ne veux pas que tu manges mes feuilles maintenant. Il faut leur laisser le temps de pousser à nouveau. En attendant, va voir ailleurs ». Cette réaction hostile de l’acacia envers la girafe (si tant est que l’on puisse parler d’agressivité pour un arbre) est donc un simple moyen de mettre des limites et non une compétition à proprement parler.
L’agressivité est beaucoup plus fréquente entre individus d’une même espèce. Par exemple, chez le chimpanzé, la compétition n’est pas rare entre mâles adultes du même groupe. Cependant, même si les combats sont impressionnants, ceux-ci permettent principalement à ces animaux de développer, éprouver et maîtriser leur force physique, un peu comme s’il s’agissait d’une pratique « d’arts martiaux ». En effet, à l’âge adulte, ce sont les mâles qui protègent le groupe. Il est donc important qu’ils apprennent à déployer et entretenir leur force physique, à prendre conscience de celle-ci et à en connaître les limites. La compétition n’est donc que le moyen pour un individu d’acquérir ces compétences. Comme le disait le célèbre généticien et Grand Homme Albert Jacquard, « je n’ai pas à être plus fort que l’autre, j’ai à être plus fort que moi grâce à l’autre ». Cependant, si le jeu dégénère, des individus plus expérimentés interviennent pour y mettre un terme. Le leader peut s’interposer avec vigueur pour séparer deux jeunes mâles en plein combat. Souvent, son autorité est telle qu’une simple attitude d’intimidation suffit à mettre fin au conflit. Les femelles ont leur propre façon d’intervenir dans les combats entre mâles : elles les désarment avant même qu’ils ne commencent à charger, ouvrant leurs mains pour en retirer les grosses pierres ou les bâtons qu’ils s’apprêtaient à lancer à leur adversaire. Curieusement, les mâles se laissent faire15…
Pour Lorenz, l’agression à l’intérieur d’une même espèce revêt une dimension rituelle et il est très rare que les combats provoquent la mort d’un des participants. On trouve des exemples de cette agressivité « contrôlée » dans les luttes entre mâles au moment du rut chez beaucoup d’espèces, ou encore lors des affrontements territoriaux. Lorenz explique que l’agressivité territoriale joue un rôle d’information. En effet, une espèce territoriale doit communiquer à ses congénères l’étendue de son domaine. L’animal va le délimiter à l’aide de différents messages tels que les jets d’urine, les excréments, les phéromones, les vocalisations, etc. Si ces signaux ne suffisent pas et qu’un intrus « marche sur ses plates-bandes », l’agression sera la manière de lui mettre les pendules à l’heure. Lorenz souligne que si l’on considère le territoire d’un animal comme un cercle, le niveau d’agressivité territoriale de cet animal augmente de manière proportionnelle à la proximité de l’intrus au centre de ce cercle. Ce « crescendo » de l’agression permet à l’intrus de savoir dans quelle mesure il a empiété sur l’espace de l’autre. L’agression est donc régulée et permet une meilleure répartition des territoires. De même que pour l’agressivité inter-espèces, c’est le moyen de se faire respecter, de mettre des limites. Il n’y a rien de « personnel » dans cette attitude, mais il s’agit de transmettre un message à ses congénères. Toutefois, il est des cas où l’affrontement vire au cauchemar…
Quand les animaux s’entre-tuent
Chez certaines espèces de Salamandres ou de grenouilles, les têtards peuvent devenir cannibales16





























