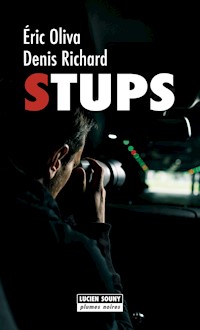Carine venait de terminer son service et, comme chaque soir, elle était pressée de regagner son petit appartement du centre-ville. Ses pieds la faisaient
horriblement souffrir. À cette heure tardive, elle n’avait qu’une hâte : retirer ces satanées chaussures.
C’était une jeune fille plutôt mûre. Pour peu qu’on la connaisse un minimum, on lui donnait facilement plus que ses vingt-trois
printemps. Des jambes minces et musclées et une mémoire d’éléphant l’aidaient sans doute beaucoup dans son travail. De magnifiques yeux verts, qui
semblaient pétiller continuellement, et un sourire naturel faisaient le reste. À ce jour, aucun client n’avait pu quitter son rang sans laisser un sympathique pourboire.
Pourtant, ce soir, elle se sentait vidée. Bien que ce service n’ait pas dérogé à la règle et que certains habitués aient dîné jusque tard dans la soirée, l’un de ses collègues avait déclaré forfait, et c’est à trois qu’elles avaient dû couvrir l’ensemble des deux salles. Comme souvent en fin de semaine, celles-ci s’étaient remplies à deux reprises. À minuit, elle était complètement fourbue. Ses muscles étaient endoloris et son dos la faisait horriblement souffrir. Elle n’avait désormais qu’une envie : se prélasser une demi-heure dans un bain chaud en sirotant une infusion. Rien que d’y songer…
Une fois les chaises retournées sur les tables et le sol flamboyant prêt à accueillir le service du lendemain midi, Carine salua de la main les rares
employés encore présents. Elle enfila son manteau, releva le col bien haut sur son visage, et
quitta le restaurant.
Les petites rues du Vieux-Nice étaient à présent quasiment désertes. Dehors, un vent glacial, qui seyait à merveille à la saison, n’incitait pas les quelques touristes d’hiver à s’y attarder plus que de raison. Cependant, aucun Niçois n’aurait osé s’en plaindre, puisque les fêtes de fin d’année avaient été bercées d’une douce tiédeur. En revanche, le mois de février augurait des jours meilleurs pour les stations de ski des alentours.
Carine pressa un peu le pas. Malgré le col en polaire qui protégeait sa nuque, elle avait remonté son écharpe sur le bout de son nez. Il ne fallait surtout pas qu’elle attrape froid. Elle tenait à cet emploi qu’elle avait eu tant de mal à trouver et ne voulait pas risquer de le perdre à cause d’un rhume imbécile.
Sur le chemin, elle adressa quelques signes de la main à des gens du quartier, qui les lui rendirent aimablement. Elle ne connaissait la
plupart d’entre eux que de vue, mais, à ces heures indues, elle croisait immanquablement les mêmes personnes : celles qui habitaient dans le coin et dont les chiens se retrouvaient pour
faire leurs besoins du soir. Et il y avait les autres : ceux qui se contentaient d’y travailler, n’ayant pas encore terminé ou commençant à peine leur labeur.
Au bout d’une dizaine de minutes de marche rapide, elle bifurqua dans sa ruelle. Celle-ci
n’était pas très éloignée du restaurant qui l’employait, mais Carine préférait faire le grand tour, histoire d’emprunter la rue de la Préfecture. Un ou deux pubs irlandais, généralement gorgés de monde, laissaient filtrer des airs de rock endiablés, orchestrés par des groupes tout aussi déchaînés. C’était le court moment de détente qu’elle s’octroyait avant de rentrer chez elle. Ce soir-là était un peu plus calme que les autres, et elle se surprit à espérer le printemps. Une saison qu’elle affectionnait particulièrement et pendant laquelle les nuits, devenues tièdes, réchauffaient les cœurs et les ardeurs des fêtards. Encore quelques semaines à attendre…
Pour l’heure, elle fouilla dans son sac pour y récupérer son trousseau de clefs, sésame qui lui permettrait de passer du froid de la rue à la chaleur douce de son petit deux-pièces.
Elle s’apprêtait à insérer l’une d’elles dans la serrure de la porte de l’immeuble lorsqu’une curieuse impression la dérangea. Elle arrêta son geste un instant, perplexe, fixant le sol. Elle ne savait pas si elle
devait mettre cette sensation sur le compte de la fatigue ou sur autre chose.
Un ressenti bizarre qui la chagrinait, mais sans qu’elle en comprenne véritablement la cause. Elle tourna la tête et plissa légèrement les yeux en scrutant les pavés qu’elle venait de fouler. Une pensée s’accrocha à son esprit : sa rue manquait cruellement d’éclairage ce soir. Elle secoua le menton et se dit qu’elle aurait sans doute plus tard l’explication à cet étrange sentiment.
Elle déverrouilla finalement la porte cochère et passa une première jambe à l’intérieur, puis la seconde, ses idées toujours ailleurs. Elle s’arrêta de nouveau entre deux gestes, perplexe. Quelque chose à l’extérieur la gênait. L’ambiance qui, ce soir, régnait dans sa rue manquait de particularité. Toujours indéfinissable mais inhabituelle.
— Mais bien sûr !
Une ampoule venait d’éclairer son cerveau. C’était ça ! Elle en était presque certaine, mais voulait s’en assurer. Elle fit un pas en arrière, sortit les épaules et observa quelques secondes le passage étroit formé par l’enchevêtrement de pavés entre les maisons ocre. Ce qui la tracassait depuis le départ lui sauta alors aux yeux. La façade du principal commerce de la rue était éteinte.
Depuis deux ans qu’elle habitait ici, c’était bien la première fois qu’elle ne la voyait pas éclairée en dehors du lundi soir. Le restaurant-pub, tenu par une famille d’origine russe, accueillait presque chaque jour une grande communauté de gens de l’Est. On aurait facilement pu penser que les nuisances auraient gêné les résidents de la ruelle, mais le propriétaire et sa femme avaient mis un point d’honneur à garder l’endroit, ou tout au moins les abords aussi calmes que possible. De plus, ils
avaient toujours été d’une belle amabilité avec l’entourage. Jamais plus de bruit qu’il n’en fallait et, même si le restaurant possédait une autorisation de fermeture tardive, aucun problème de voisinage n’était venu entacher cette proximité. Jamais un mot ni un son plus haut que l’autre. En fait, en y réfléchissant, Carine était en train de se dire que, malgré l’ambiance qu’il pouvait parfois y avoir en fin de service à l’intérieur de l’établissement, ils restaient néanmoins des voisins idéaux.
Et ce soir, la jeune femme prenait enfin conscience que la ruelle était trop calme. Surprenant, et sans doute imprévu, puisqu’il ne s’agissait pas de leur jour de repos. Pour en avoir le cœur net, elle laissa devant elle la porte se refermer et refit le chemin en sens
inverse. Le froid, transporté par ce même petit vent cinglant, lui piqua de nouveau le bout du nez. Carine fut
parcourue d’un long frisson et en regretta presque sa curiosité. Machinalement, elle remonta encore son écharpe de quelques centimètres.
Le bâtiment qui abritait le restaurant voisin ne se trouvait qu’à quelques dizaines de mètres, et elle accéléra le pas. Une douche brûlante l’attendait non loin. Il ne fallut qu’une poignée de secondes à la jeune femme pour se retrouver face aux grandes portes vitrées.
Pour y avoir déjà dîné en compagnie de copines, elle savait que la salle principale était vaste et se finissait dans le fond par une large cuisine ouverte où s’activaient des hommes en toque. À l’étage, une dalle sans doute vétuste avait été remplacée par une imposante mezzanine en chêne sur laquelle, plusieurs soirs par semaine, les clients qui le désiraient pouvaient s’adonner à quelques pas de troïka.
Le volume de la pièce était important. Lorsque, à chaque fin de service, elle passait devant pour regagner son nid douillet, elle
était toujours surprise par l’éclairage intérieur. Maintenant qu’elle y repensait, comment avait-elle pu rater ça ? Régulièrement, pourtant, elle s’en faisait la remarque. Ce presque trop-plein de lumière rayonnait assez pour parvenir à embraser les deux premiers niveaux de l’immeuble d’en face. Heureusement, ceux-ci n’étaient que des bureaux, logiquement désertés de leurs employés à ces heures tardives.
Mais voilà : ce soir, ce n’était pas le cas. Pas la plus petite ampoule. Aucune lueur ne venait filtrer à travers les deux étages de baies vitrées. Dans son dos, le halo de l’unique lampadaire, disposé obliquement de l’autre côté de la rue, peinait à se refléter sur la façade en verre, empêchant de distinguer quoi que ce soit à l’intérieur. Carine, collée contre le battant principal pour n’offrir au vent qu’un minimum de surface, plaça ses deux mains autour de son visage, mais seule la pénombre répondit à sa curiosité.
« Ma foi ! se dit-elle en tournant les talons. Sûrement qu’une urgence les a appelés ailleurs. »
Le froid la tenaillait, maintenant, et elle n’avait plus qu’une idée en tête : rentrer chez elle. Elle fit un pas en avant, mais la lanière de son sac à dos la rappela à son bon souvenir. Soudainement tirée vers l’arrière, elle manqua de tomber à la renverse. La bretelle s’était prise autour de la poignée en bronze de la porte principale, et elle avait bien failli entraîner le battant avec elle.
Carine le regarda, étonnée. Même pressé, qui aurait quitté son établissement en oubliant d’en verrouiller l’entrée ? Toujours mue par la curiosité, elle passa la tête par l’entrebâillement et tenta une nouvelle fois de distinguer quelque chose, sans plus de
succès. Le peu de luminosité timidement dispensé par le lampadaire, qui se trouvait néanmoins à une vingtaine de mètres de là, n’apporterait pas d’eau à son moulin. Elle appela à plusieurs reprises, mais ne reçut aucune réponse. Inspecta autour d’elle, mais la rue était tout aussi vide de passants qu’elle était sombre. Une pensée lui effleura l’esprit :
« S’ils ont vraiment oublié de fermer leur porte, autant que ce soit moi qui m’en aperçoive plutôt que des voleurs. »
Elle prit donc son courage à deux mains et pénétra à tâtons à l’intérieur de la salle. Elle essaya de se remémorer rapidement l’emplacement de chaque meuble et regretta d’avoir laissé son téléphone portable dans son vestiaire. Pour une fois, la torche de son iPhone lui
aurait bien servi. Elle se souvenait toutefois d’un endroit ouvert et large, et s’aventura tout de suite un peu plus loin. Toujours à l’aveuglette, elle fit attention à ne pas trébucher sur les marches qui ceinturaient la salle où devaient être alignées les longues tables. Dans sa mémoire, les imposants piliers soutenant le balcon étaient disposés de chaque côté de la pièce. Elle ne risquait donc pas de les heurter. À ce stade, elle avait en tête de se rapprocher de celui qui devait se trouver sur sa gauche. Elle avait repéré qu’il abritait ce qu’elle pensait être le tableau électrique.
Tout en cheminant avec prudence, Carine continuait d’appeler. Peut-être que sa voix ne portait pas assez loin. Peut-être n’avait-elle pas été entendue immédiatement. Ou alors existait-il une arrière-salle un peu trop bien insonorisée.
— Ils auraient quand même pu nettoyer leur sol avant de partir ! fit-elle tandis que les semelles de ses chaussures, qui persévéraient à torturer ses orteils, avaient de plus en plus de mal à se détacher du carrelage. C’est incroyable que ce soit gras comme ça !
Un bruit mat parvint à ses oreilles. Carine stoppa sa progression, ses sens en alerte. Ce bruit lui
rappela le goutte-à-goutte d’un robinet, mais le son en était beaucoup plus profond, presque étouffé. Elle se pencha légèrement sur sa gauche, devinant à présent le boîtier recherché. Un nouveau « ploc » retint son attention, tout près d’elle.
« Une fuite au beau milieu de la pièce », songea-t-elle, l’esprit un peu confus. « Ils ont sûrement été obligés de fermer à cause de ça. Mais pourquoi ne pas la réparer ? »
Sa main se posa enfin sur l’objet désiré. Elle ouvrit la porte en plastique du tableau et, identifiant du bout des
doigts la série de disjoncteurs, elle en releva plusieurs au hasard. Une lumière blanche et aveuglante inonda immédiatement l’immense salle. Une telle lueur après le noir presque total lui agressa la rétine. Carine eut besoin de plusieurs secondes pour commencer à distinguer ce qui l’entourait. Machinalement, détournant les yeux de la dizaine d’ampoules qu’elle avait mises sous tension, elle baissa la tête et son regard se posa sur ses chaussures. Un premier haut-le-cœur lui vrilla l’estomac. L’éclairage halogène faisait particulièrement ressortir l’aspect sirupeux du sang qui s’étalait sur le sol.
Accentuant la vision, l’odeur métallique qui remonta jusqu’à ses narines la fit chanceler. Sous ses pieds, une mare d’un rouge sombre formait un large ovale au milieu de la salle. Carine pataugeait
dedans depuis quatre bonnes minutes. Seules ses traces s’y trouvaient ; bizarrement, aucune n’en sortait. On aurait dit que plusieurs agneaux avaient été égorgés à cet endroit, mais que les pauvres bêtes s’étaient, comme par magie, volatilisées.
Un nouveau bruit sourd sur sa droite. Carine tourna la tête, surprise. Une minuscule éclaboussure, suivie d’une épaisse auréole, venait de se former sur le sol. La jeune femme ferma les yeux quelques
secondes. Une angoisse viscérale s’immisça au creux de ses tripes. La crainte de comprendre l’envahit. Lentement, elle leva le menton vers le plafond. Elle eut à peine le temps d’apercevoir la goutte de sang grossir devant son visage qu’elle la sentit s’écraser au milieu de son front. Instinctivement, elle tenta de l’essuyer à l’aide de sa manche, ne réussissant qu’à l’étaler sur ses cheveux.
Elle avait l’estomac au bord des lèvres. Son cerveau ne parvenait plus à effacer l’image que son regard venait d’y imprimer. Au-dessus de sa tête, une véritable scène d’horreur était au rendez-vous. Quatre corps étaient suspendus par les pieds à l’imposante poutre en chêne qui servait de support à ce tableau morbide. Même sans avoir pris le temps de les dévisager, Carine n’avait pas le moindre doute. Il s’agissait bien du couple de propriétaires et de leur jeune fils. Leurs trois visages étaient tournés vers la rue. Entièrement ensanglantés, ceux-ci semblaient la regarder de leurs yeux vides. Les longs cheveux blonds
de Mme Kouliakov n’étaient plus qu’un amas poisseux duquel suintait le peu de sang qui restait encore dans ses
veines. À côté de leur enfant, le chien de la famille n’avait pas été épargné. Il était solidement attaché par les pattes arrière et une large entaille avait sectionné sa carotide jusqu’à la colonne vertébrale. Sa langue sortait bizarrement de cette ouverture béante. Avant que la jeune femme se mette à vomir, son attention fut attirée par ce détail qui ne pouvait en aucun cas en être un : les quatre corps avaient subi le même supplice, leurs langues sortant de leurs gorges découpées.
Carine tituba quelques secondes. Les images étaient en train de se mélanger aux effluves de sang et de mort. Le sol se dérobait sous ses pieds. Son cœur s’était emballé et ses poumons commençaient à être saturés en oxygène. Elle avait l’impression qu’ils allaient exploser. Un goût âpre s’était répandu dans sa bouche et coulait dans sa gorge. Mécaniquement, elle descendit les deux marches. Il fallait qu’elle respire de l’air frais. Sans se retourner, retenant son souffle pour éviter les remugles, elle se dirigea vers les baies vitrées. La peur et l’angoisse ne l’aidaient pas. Elle faillit perdre l’équilibre une première fois, se rattrapant miraculeusement à une table, puis une seconde. Ses semelles étaient imbibées d’hémoglobine. De larges traces brunes marquaient sa fuite. Elle poussa le battant
de la porte et sortit dans la ruelle. La tête lui tournait, ses jambes flageolaient et son cœur martelait sa poitrine de plus belle. Une nuée de papillons noirs étaient maintenant de la partie. Tout allait à vau-l’eau. Dans le froid, elle s’agenouilla sur les pavés, haletante. Les images continuaient de défiler à l’intérieur de ses yeux fermés. Le visage entre les mains, elle poussa un hurlement à faire éclater un verre en cristal.
Et puis… plus rien. La jeune serveuse venait de perdre connaissance, et son corps avait
basculé sur le côté.
***
Le chef d’état-major griffonna encore une phrase ou deux sur le bloc-notes qui se trouvait
sur la table basse du salon, puis composa le numéro d’un des collègues de la permanence. Son visage cherchait à ne rien laisser paraître, mais cette tentative relevait d’une mission impossible. Son teint avait viré au vert. En regard de la scène qui avait été découverte par les pompiers, monsieur le procureur avait logiquement décidé de saisir l’antenne de police judiciaire de Nice. Ce n’était pas tous les jours que des flics enquêtaient sur un triple homicide, voire un quadruple, puisqu’ils s’attendaient également à avoir la SPA sur le dos.
Assise à ses côtés, un carré de laine suspendu aux aiguilles qu’elle tenait dans les mains, sa femme avait capté les bribes de l’échange qui venait d’avoir lieu. Elle le regarda, incrédule et curieuse. Elle savait pourtant qu’il ne lui donnerait aucun détail. Cependant, le peu qu’elle avait entendu avait suffi à la mettre mal à l’aise. Elle était presque certaine d’avoir saisi le principal et avait peur de ne pas se tromper. Avant ce nouvel
appel, son mari avait mis fin à une longue conversation avec un magistrat, puis avait posé son portable sur la table, sans un mot.
Les semaines de permanence revenant plutôt régulièrement, ce n’était pas la première fois qu’elle vivait une scène similaire. Depuis sept ans qu’il occupait son poste, elle avait pris l’habitude de ces appels, en pleine nuit ou pendant les week-ends. Mais ils n’étaient généralement pas aussi singuliers et plus procéduriers. Bernard Moscatelli était alors intéressé par les heures de garde à vue, le nombre de personnes interpellées, leur identité, les quantités saisies dans certains cas. Des précisions indispensables aux collègues qui allaient devoir poursuivre l’enquête. Au fil du temps, elle arrivait même à différencier le type d’affaires. Ici, des individus qui avaient été arrêtés par les douanes pour un trafic de stupéfiants. Là, un vol à main armée ou un cambriolage. Dans ce cas, son mari s’inquiétait du lieu des faits, des horaires, des témoins éventuels, du préjudice subi, du nom des victimes… Une multitude d’informations cruciales pour les enquêteurs. Seulement, ce soir, les questions avaient été plus laconiques encore. Cet appel n’avait pas ressemblé aux autres.
À entendre fréquemment les mêmes formules, elles pénétraient insidieusement votre esprit et finissaient par faire partie de votre
vocabulaire. Des phrases, des expressions qui devenaient, en quelque sorte,
votre quotidien. Mais, curieusement, lorsque l’on s’y attendait et qu’elles arrivaient d’une manière différente, la discussion s’avérait tout de suite plus énigmatique. Des termes inhabituels appelaient forcément une affaire singulière. Et ce soir, ça avait été le cas. Il avait demandé les causes du décès, le nombre de victimes, leurs âges. Ce qu’elle avait saisi du monologue avait commencé à l’effrayer, et les notes qu’il prenait n’avaient certes pas aidé à la rassurer. Trois morts… Mais alors, pourquoi quatre corps ? Sans doute avait-elle mal compris.
Elle eut subitement soif. Des difficultés à déglutir. Elle se racla la gorge. Ces fragments de conversation l’avaient dérangée. Elle profita du moment pour disparaître dans la cuisine.
***
Bernard entoura machinalement l’adresse des lieux. À l’autre bout de la ville, un collègue répondit à son appel.
— Allô !
— Salut, Marco. C’est Bernard. Tu dormais ?
— Salut, Bernard. Si je te dis que non, tu vas faire semblant de me croire ? marmonna-t-il d’une voix caverneuse.
Le chef d’état-major ne releva pas.
— Écoute, on vient d’être saisi d’un truc pas drôle du tout. Alors, prends cinq minutes, peut-être un bon café, et quand tu seras tout à fait réveillé, tu me fais sonner. J’attends ton coup de fil. OK ?
Predrag Marcovici, contrairement à Mme Moscatelli, avait l’habitude de ces appels. Parfois, quand la loi des séries se mettait en branle lors d’une semaine d’astreinte, ce genre de chose pouvait arriver plus d’une fois. En revanche, que le chef de permanence lui demande d’émerger avant de lui annoncer le motif de leur saisine l’inquiétait un peu.
— OK, Bernard. Je te rappelle tout de suite, répondit-il avant de raccrocher.
Predrag, que tout le service surnommait Marco en raison de son patronyme, se
leva sans attendre. Il n’était pas non plus nécessaire de réveiller sa femme, qui dormait profondément. Il fila sous la douche. L’eau chaude avait ça de bien : contribuer à remettre les idées en place. Avant de reposer son téléphone, il n’avait pas eu le réflexe de jeter un œil à sa montre. Il ne savait pas l’heure qu’il pouvait être, mais était conscient que ce n’était nullement le moment de flâner. Bernard devait patienter.
Sept minutes plus tard, le portable de Moscatelli vibra sur la table basse. L’homme posa le verre d’eau qu’il tenait à la main et décrocha. Entre-temps, il avait mis à jour les quelques annotations qu’il avait prises à la volée et était fin prêt à détailler à son gars de la Crim’la situation dans son ensemble, aussi terrible soit-elle.
— Je t’écoute, Bernard.
— Tu as de quoi noter ?
— Ouais, vas-y.
En quelques minutes, le commandant annonça les faits tels que le substitut les lui avait relatés. Dans sa cuisine, assis sur un tabouret de bar, Predrag griffonnait à son tour. En professionnel, Bernard essayait d’être le plus précis possible. Il savait que les premiers éléments étaient de la plus haute importance et que les heures à venir risquaient d’être aussi compliquées que harassantes pour les effectifs qui allaient devoir prendre l’affaire en main.
Chez lui, Marco cogitait rapidement. Il soulevait de petits détails qui, peut-être, n’en étaient pas. Il tentait parfois une question, une remarque. S’il le pouvait, Bernard essayait d’y apporter des précisions.
— Tu as prévenu les autres ?
— Oui, c’est fait. Tu as Aurélien des Stups, Patrick de la Financière et Jacques de la BRB.
— OK. Je vais rapidement les dispatcher sur l’enquête de voisinage, mais vu ce que tu m’as annoncé, je demanderai quand même si les gars de mon groupe sont dispo. Il va falloir des mecs pointus, là. Pas question de faire de l’à-peu-près.
— Oui, je pense que c’est plus sûr.
Il savait que le major Marcovici connaissait parfaitement son boulot. En tant qu’excellent enquêteur de la Criminelle, il ferait en sorte que les premières constatations soient effectuées aux petits oignons. Soit dit en passant, celles-ci allaient être d’une importance capitale dans le type d’affaire qui se profilait. Mais il était également conscient que les autres collègues de l’astreinte n’étaient nullement habitués au protocole que la Crim’devait suivre en cas d’homicide, encore moins avec des faits de cette ampleur. L’idée de faire appel à un ou deux gars spécialisés était judicieuse.
— Tu veux que je contacte Nath ? reprit le chef d’état-major.
— T’inquiète, je vais m’en charger, répondit Marco en enfilant son blouson en cuir. Je suis pour ainsi dire sur la
route. Je l’appellerai de la voiture.
— Tu me tiens au jus ?
— Pas de souci, dès que j’ai du neuf. C’est qui, le proc’, au fait ?
— Nellota. Quand je l’ai eue au téléphone, tout à l’heure, elle se préparait à se rendre sur place. Je suppose qu’elle devrait y être. J’ai aussi prévenu l’IJ*. Marianne t’envoie deux bonshommes et en met un troisième en alerte, au cas où. Les premiers se partageront le travail. À toi de voir avec eux quand tu seras arrivé.
— C’est noté, Bernard. On t’appelle plus tard.
***
Nathalie Klein, chef de groupe à la brigade criminelle, venait de se glisser sous les draps lorsque son portable
se mit à vibrer sur sa table de nuit, éclairant une partie du plafond. Le visage de Predrag Marcovici s’afficha en même temps sur l’écran. Instinctivement, elle jeta un œil vers le côté opposé du lit.
Couché sur le ventre, une jambe hors de la couette, Quentin dormait déjà profondément. Le chef des Stups, avec qui elle vivait depuis près de deux ans, maintenant, était rentré quelques heures plus tôt d’une mission à la frontière espagnole. En filature derrière des trafiquants de l’Ariane, cité bien connue des Niçois, il avait passé trois jours entre Le Perthus et Montpellier. Manger sur le pouce et se relayer
avec cinq autres collègues pour tenter de se reposer quelques minutes dans les voitures de service
avait été leur quotidien. D’après le peu qu’il avait bien voulu partager – car tous deux prenaient un soin particulier à éviter de parler boulot à la maison –, l’opération avait néanmoins été productive.
Après le dîner, les yeux rougis de fatigue, il n’avait pas demandé son reste et avait regagné leur chambre avec une démarche de zombie.
Quittant la pièce sur la pointe des pieds, Nathalie décrocha enfin.
— Salut, Marco, dit-elle doucement.
— Salut, Nath. Je te réveille ?
— Non, mais je t’avoue que c’était moins une. Tu as un problème ?
— Ben, tu sais, quand Bernard t’appelle en pleine nuit…
— Ah… merde. Raconte.
Certain qu’elle saisirait le contexte, Predrag se contenta d’aller à l’essentiel, dépeignant seulement les grandes lignes de l’affaire dont il venait d’hériter. Pour faire court, mais aussi pour donner à son récit l’envergure qu’il se devait d’avoir, chaque mot était choisi. Dans son salon, Nathalie Klein s’était assise sur l’accoudoir d’un des deux fauteuils qui faisaient face au large téléviseur. Avant que Marco n’ait terminé, elle lui coupa la parole.
— Je n’ose pas imaginer ce qu’on va découvrir sur place, commença-t-elle sur un ton morne. Laurent est à Lyon, ce soir, et ne rentrera que demain après-midi, donc c’est mort. Mais je pense que Sylvain est chez lui. Je l’appelle et, s’il est dispo, on te rejoint là-bas. Sinon, de toute façon, je viens seule.
— Ça va. Mais tu es sûre que ça ne te dérange pas ? demanda-t-il, même s’il connaissait déjà la réponse.
— Bien sûr que non ! dit-elle en prenant la direction de la salle de bains. Il va y avoir assez de
boulot pour tous.
— OK. Perso, je suis presque arrivé.
— Tu as besoin que je fasse un saut au bureau ?
— Non, c’est bon. J’ai tout ce qu’il faut dans la voiture, et les collègues de l’IJ devraient avoir ce qui pourrait me manquer.
— Ça marche. À tout de suite.
Nathalie raccrocha, puis composa dans la foulée le numéro de Sylvain, qui, comme elle l’avait supposé, dormait depuis un moment. Imaginant que l’appel aurait pu s’apparenter à un biberon supplémentaire, il ne fallut qu’une poignée de secondes au papa pour être totalement réveillé.
— Salut, papa Sly, fit-elle. Désolée de te tirer du lit en pleine nuit, mais, si tu es d’accord, on va avoir besoin de toi.
Le brigadier-chef n’avait ce surnom que depuis quatre mois. Le petit Paul prenait un plaisir
sournois à entrecouper méthodiquement le sommeil des deux parents. Minuit, trois heures et six heures.
Sept jours par semaine. Ou plutôt, sept nuits par semaine. Aucun répit. L’estomac du poupon possédait la régularité d’une horloge suisse. Les cernes qu’exhibait son père chaque matin amusaient beaucoup ses collègues de groupe. Alors, une fois de plus…
Après l’avoir rapidement mis au parfum, elle ajouta :
— Je me prépare et je saute dans la voiture. Je serai chez toi dans… vingt, vingt-cinq minutes. Ça te va ?
— OK, répondit Sylvain en refermant la porte du réfrigérateur. Ça me laisse le temps de faire chauffer un biberon et de le donner à Patricia. Le petit devrait le réclamer dans une demi-heure. Au moins, elle n’aura plus qu’à le lui coller dans le bec. Toujours ça de gagner.
— Tu avais oublié ce que c’était, hein ?
— En quatre ans, on occulte beaucoup de choses, fit Sylvain en faisant référence aux premières nuits de Kylian, son fils aîné.
Nathalie esquissa un sourire bienveillant. Entendre son collègue parler de la sorte après toutes les péripéties qu’ils avaient vécues lui réchauffait le cœur.
Elle était passée par là des années auparavant, et certains souvenirs lui revinrent en mémoire. Tom ne tarderait pas à entrer dans l’adolescence, et il lui arrivait parfois de se dire qu’une deuxième grossesse l’aurait certainement comblée. À trop se poser de questions, on laissait fuir les années. Elle savait maintenant que celles-ci ne se rattrapaient jamais. Au fil des
ans, ses responsabilités à la brigade n’aidant pas, une angoisse s’était insidieusement immiscée en elle : donner la vie une nouvelle fois et ne pas pouvoir consacrer à son enfant tout le temps qui lui était nécessaire. Elle n’aurait pu le supporter. La Crim’était un service prenant. De plus, à l’époque, Quentin n’était pas disponible. Ce second bébé était donc resté une envie et le demeurerait à jamais.
Par amitié, d’abord, mais aussi parce que tous les trois se fréquentaient depuis des années, Patricia et Sylvain avaient tenu à ce que Nathalie devienne la marraine de Paul. Une confiance qu’elle avait assumée le mois passé, les yeux remplis de larmes de joie. C’était donc assez régulièrement qu’elle acceptait un déjeuner, le week-end, chez les Vatier pour s’occuper de son filleul. Parfois, elle leur enlevait l’enfant le temps d’un après-midi, un beau bébé aux joues rondes et au grand regard rieur. Sa façon à elle d’offrir aux parents quelques heures de repos supplémentaires.
Elle se fit couler un expresso, autant par besoin que par envie. Elle se dit que
la caféine contenue dans le breuvage, crémeux à souhait, allait être indispensable pour lui faire oublier que, dehors, la nuit noire était accompagnée d’un froid glacial. L’odeur légèrement amère emplit rapidement le coin-cuisine, excitant ses papilles. Sur le bar, elle
posa la tasse fumante et attrapa son carnet à spirales, qu’elle rangea dans sa sacoche en cuir. À l’intérieur, elle vérifia que s’y trouvait le minimum pour pouvoir travailler, puis enfila une veste chaude, qu’elle agrémenta d’une écharpe en laine. À travers la baie vitrée du salon, les mouvements désordonnés des branches laissaient deviner des bourrasques à décorner un bœuf. Ajoutées aux éclats brillants qui tapissaient le bitume de la rue, nul doute qu’il ne s’agissait pas d’un vent d’autan.
Après avoir déposé un petit mot sur le comptoir de la cuisine à l’attention de ses deux hommes, elle avala son café d’une traite. Fin prête, elle récupéra les clefs de la Mégane de service sur le guéridon et quitta la maison en refermant doucement la porte derrière elle.
***
Huit heures plus tôt.
La famille Kouliakov était revenue des courses pluri-hebdomadaires qui prenaient un temps insensé dans la vie de tous les restaurateurs de la planète. Il arrivait parfois que le boucher, le boulanger et même le primeur livrent les commandes, mais pour le reste – les boissons, les surgelés, les conserves et tout ce dont un commerce de ce genre ne pouvait se passer –, la corvée se faisait obligatoirement chez Metro. Bien entendu, pour leur simplifier la
vie, ce grossiste ne pouvait évidemment se trouver à l’autre bout de la ville. Cet après-midi, pour couronner le tout, les préparatifs d’une rencontre sportive à l’Allianz Riviera avaient considérablement ralenti la circulation sur le tronçon sud du boulevard du Mercantour. L’agencement des parkings n’étant toujours pas achevé, les supporters avaient tout le mal du monde à garer leurs moyens de transport à proximité de ce nouveau stade. Avant chaque match, les CRS faisaient leur possible pour
contenir les hordes de véhicules qui affluaient.
Pendant que le mari s’était affairé à décharger les cageots ainsi que les nombreux sacs du coffre de la petite
fourgonnette achetée pour cette besogne, Agnessa, sa femme depuis vingt ans, s’était occupée de mettre le four et le piano en route. Ils étaient en retard sur l’horaire et ne devaient pas traîner. Ce soir, la cuisinière avait décidé de proposer au menu une spécialité de l’Oural : des pelmeni, sorte de raviolis au mélange savoureux de viande de porc, d’agneau et de bœuf. Des tourtes de poulet viendraient également agrémenter la carte. Elle avait eu du pain sur la planche.
Maksimilian Kouliakov était un homme de quarante-sept ans. Son visage slave aux traits rudes était adouci par des yeux subtilement bridés d’un bleu presque turquoise. Sa peau, très claire en hiver, prenait tout juste une teinte rosée lorsque septembre arrivait. Comme tous les mâles de sa famille, il était grand et de corpulence athlétique. Sans le vouloir expressément, l’homme en imposait. De larges épaules surmontant un torse bombé lui conféraient une allure charpentée. Apparence qu’il avait la curieuse habitude de camoufler avec des t-shirts amples l’été et des pulls XXL durant les périodes froides. Sur son crâne, de rares cheveux contribuaient à lui donner un air martial ; mais cela, il n’y pouvait pas grand-chose. Son éducation, à l’image de l’ancienne URSS – d’où il était parti en 1995 après que Boris Eltsine eut privatisé le secteur public où il travaillait –, était à mille lieues des implants capillaires, et encore plus loin des chirurgiens esthétiques.
Agnessa, quant à elle, était une jolie blonde aux traits fins d’à peine quarante ans. Ses yeux, gris souris sous la pluie, pouvaient prendre un
ton vert d’eau en plein soleil. Tout comme Carine, elle souriait constamment et respirait
la joie de vivre. Les futurs mariés s’étaient rencontrés peu avant leur décision de quitter l’ex-URSS pour venir s’installer en Europe. Le frère de Maksimilian avait déposé ses valises sur la Côte d’Azur en 1991 et, quelques années après, ils s’étaient à leur tour lancés dans l’aventure. Depuis ce jour, aucun n’avait eu à regretter ce choix. Moscou et Saint-Pétersbourg resteraient des villes pourvues d’un cachet typique et historique incomparable, et ils y avaient connu des moments
qui demeureraient gravés dans leurs mémoires. Pourtant, ayant pris goût aux libertés individuelles de la démocratie et à la douceur de vivre du sud de la France, ils étaient enchantés désormais de n’y retourner que pour visiter leurs familles. Heureux quand ils s’y rendaient, ils l’étaient tout autant lorsqu’ils en repartaient. Maintenant, ils laissaient volontiers aux autres les
plaisirs du froid hivernal, un socialisme que l’extrême gauche de notre gauche ne leur envierait certainement pas et les querelles
intestines de pouvoir que se livraient Poutine et Medvedev depuis le début des années 2000. Après deux décennies de cette vie, la nouvelle leur convenait tout à fait.
Une fois installés dans un joli appartement, à deux pas de la promenade des Anglais, ils avaient travaillé d’arrache-pied. Et bien que ce ne soit, ni pour lui ni pour elle, leur métier initial, leur établissement du Vieux-Nice avait prospéré plus qu’ils ne l’avaient imaginé. La communauté russe grandissante et aisée aimait se retrouver autour d’une ambiance chaleureuse qui devait, dans ce petit coin de la Riviera, leur
rappeler leur mère patrie.
Les affaires fonctionnaient plutôt bien et le restaurant faisait la fierté de Maksimilian. Pour lui qui avait débuté dans la vie active comme technicien thermique dans une usine vétuste de la périphérie de Moscou, le changement de voie professionnelle quelque peu radical avait été réussi.
Après que le couple se fut investi sans compter dans le commerce et eut apuré la presque totalité des sommes empruntées, Agnessa avait voulu faire une pause. Elle avait senti que le moment était arrivé et qu’il était temps pour elle de devenir maman. Son mari ne s’était pas fait prier et, moins d’un an plus tard, Vladimir était venu au monde. Neuf ans auparavant, ils lui avaient donné ce prénom parce que son grand-père, fusillé par les Allemands durant la Première Guerre mondiale, l’avait porté.
Au grand désarroi de sa mère, il n’avait hérité d’elle que les yeux, le reste étant la copie conforme de son père. Avec ses lèvres charnues surmontées de ce petit nez court et légèrement retroussé, caractéristiques manifestement familiales, Vlad aurait sans doute un jour eu la stature
de Maksimilian. Si le soir qui se profilait avait été différent, peut-être aurait-il lui aussi enfilé de larges t-shirts et des pulls XXL…
Comme chaque après-midi, le garçon, plutôt grand pour son âge, avait quitté l’école à dix-sept heures et aussitôt rejoint le restaurant. Après avoir avalé un verre de lait et deux tartines de pain frais beurré, il s’était sagement installé à l’une des trois tables accolées au mur des cuisines. Son cartable, posé sur le sol, regorgeait de livres et de cahiers. Dans un silence presque
religieux, il avait entrepris de faire une partie de ses devoirs. Cette année encore, ses notes étaient exemplaires. Il aimait plus que tout arriver chaque trimestre avec, dans
son carnet de correspondance, les appréciations toujours plus élogieuses de son professeur. Il était intelligent, concentré et studieux. Une dictée à réviser, un exercice de mathématiques facile comme tout et Tournez, tournez, bons chevaux de bois à apprendre. Verlaine n’avait qu’à bien se tenir.
Dans une heure, il serait temps de dîner. Sur la table qui lui servait de bureau, une assiette et des couverts
remplaceraient ses cahiers et ses stylos. Puis, vers vingt heures, il
regagnerait la maison, tout seul, comme un grand. C’était la première année qu’il était tout à fait autonome, et cette récente indépendance lui plaisait assez. Il avait l’impression d’avoir hérité d’une tonne de responsabilités et faisait ce qu’il fallait pour les assumer.
Chaque soir revenait le rituel que sa mère et lui avaient mis en place. Rentrer en suivant le même chemin, refermer la porte à clef derrière lui une fois à l’intérieur, prendre sa douche, se brosser les dents, vérifier que son cartable était prêt pour le lendemain et se coucher à vingt et une heures quinze, jamais plus tard. C’était de cette façon qu’il se sentait grand.
À ses pieds, Boris, nommé ainsi en souvenir de l’ex-président, s’était consciencieusement léché les pattes.
La voiture vidée de son contenu, Maksimilian s’était mis au volant et avait quitté les lieux. Les rues et ruelles du Vieux-Nice étant résolument piétonnes, il n’avait pas eu d’autre choix que d’aller la garer au parking.
À quelques mètres, l’homme s’était posté là, à l’affût. Avec sa silhouette pataude à demi dissimulée derrière un conteneur à poubelles, seuls deux yeux sombres étaient à peine visibles. Un bonnet en laine était enfoncé sur son crâne et une écharpe recouvrait le bas de son visage. Une forme dans la pénombre que n’importe quel passant aurait prise pour un SDF à la recherche d’un peu de chaleur. L’obscurité avait gagné ses quartiers d’hiver. Le vent commençait à forcir. Les habitants réintégraient leurs pénates.
Une fois le véhicule hors de vue, l’homme s’était rapidement approché de la devanture. Il avait tiré la porte vitrée et s’était glissé à l’intérieur dans le silence le plus complet. L’entrée était plongée dans le noir. Seul le fond de la salle était timidement éclairé. Sur la pointe des pieds, il avait monté les deux marches qui menaient à la pièce principale. Là, il avait été accueilli par le chien de la famille à l’odorat infaillible. L’animal, content de ce nouveau compagnon, avait secoué la queue de gauche à droite, quémandant une caresse. À la place, une décharge électrique de quelques secondes avait suffi à immobiliser la bête, qui avait basculé sur le flanc.
Dans un angle, à l’autre bout du restaurant, Vladimir avait relevé la tête. Les crépitements rapides l’avaient sorti de ses livres. S’était-il mis à pleuvoir ? Étaient-ce des éclairs qui avaient illuminé l’entrée ? Où était son chien ? Avait-il eu peur de la foudre ? Il l’avait appelé une première fois, mais rien. Le garçon avait essayé de nouveau, sans plus de succès. Étonné de ne pas le voir accourir, il avait quitté sa chaise et traversé la salle, toujours sombre. Près des marches, Vladimir s’était arrêté net. Boris était recroquevillé contre l’un des piliers qui soutenaient la mezzanine. Le bout de sa langue sortait de sa
gueule et l’animal avait le souffle court. L’enfant s’était agenouillé à côté de lui. Délicatement, il avait posé une main sur sa tête, la secouant doucement. Le chien n’avait eu aucune réaction. Ses membres étaient raides comme du bois. Ne sachant trop que faire, Vladimir s’était retourné vers la cuisine. Sa mère, elle, saurait certainement. Il s’était apprêté à l’appeler lorsque l’arc électrique avait pénétré son petit cou et l’avait transpercé de part en part. Ses yeux s’étaient révulsés et son corps s’était contracté avant de s’affaler sur celui de Boris. L’homme avait tiré les deux formes inertes sous le grand escalier, à l’abri des regards.
En une fraction de seconde, il avait traversé la salle et s’était rapproché de la cuisine. La porte battante était maintenue ouverte par une cale en bois. Il avait furtivement passé la tête à travers l’ouverture. Il devait repérer les lieux. Contre le mur, à droite, le four à chaleur tournante ronronnait. À l’opposé, accroupie devant l’armoire frigorifique, Agnessa était occupée à ranger une partie des produits frais. Dos à son destin, sa nuque semblait l’appeler. Son arme électrique à pleine puissance, l’homme s’était approché de sa proie. Au dernier moment, Agnessa avait tourné la tête. Sans doute le sixième sens féminin lui avait-il signalé un danger. Mais bien trop tard pour éviter la longue décharge qui lui avait arraché un cri de douleur avant de la plonger dans le néant. De son sac à dos, l’agresseur avait sorti de quoi ligoter et bâillonner ses victimes. Moins de cinq minutes après son arrivée, la mère, le fils et le chien étaient saucissonnés et enfermés dans la chambre froide. Trois corps atoniques au milieu des quartiers de
viande cellophanés et des fromages frais.
À la seconde où Maksimilian était entré dans son restaurant, une étrange sensation l’avait envahi. Aucune odeur n’émanait encore de la cuisine et Boris n’était pas là pour l’accueillir. Deux faits assez rares pour être soulignés. Il avait appelé le chien à son tour, mais sans plus de réussite que son fils. Au fond de la salle, Vladimir n’était plus à ses devoirs. Il s’était dit que le petit avait certainement amené Boris faire ses besoins. L’un et l’autre ne devraient pas tarder à revenir. L’esprit occupé par ce qu’il lui restait à faire, il avait retiré la sacoche qu’il portait en bandoulière, enlevé son blouson et posé le tout sur une chaise. Il devait s’activer un peu s’il voulait que tout soit prêt pour le service de dix-neuf heures. Les frigos du bar n’allaient pas se remplir seuls et les soixante-sept tables attendaient d’être dressées. À mille lieues de se douter du drame qui se tramait, il n’avait pas entendu la mort surgir dans son dos.
Vu la corpulence de Kouliakov, l’homme avait préféré ne prendre aucun risque. Le pistolet électrique avait ses limites et il n’avait pas eu envie d’en faire les frais ce soir. De sa veste, il avait sorti une matraque télescopique, et ses doigts s’étaient fermement refermés sur son manche. D’un geste rapide, il l’avait dépliée dans un bruit métallique et, dans le même mouvement, l’avait abattue de toutes ses forces sur la nuque du restaurateur. Le tube d’acier avait fendu l’air en sifflant et heurté si violemment le rachis cervical qu’il l’avait brisé comme du verre. Un son mat s’était fait entendre au moment où la moelle épinière fut sectionnée par les vertèbres broyées. Un second, plus sourd, lorsque le corps sans vie s’était écrasé sur le sol carrelé.
La matraque trônant au bout de son bras comme un trophée, l’homme avait pris une profonde inspiration. La paume de sa main droite était venue frapper la bille d’acier, et l’arme avait recouvré sa taille initiale, un peu plus de vingt centimètres. Son cœur s’était mis à battre à peine plus vite que d’ordinaire. Ses gestes se précisaient. Il avait descendu les loquets des portes d’entrée. À partir de maintenant, plus question d’être dérangé. Dans quelques minutes, il allait s’occuper du reste de la famille. De son sac, il avait sorti un long cordage en
chanvre synthétique, un cutter, et avait grimpé les marches de la mezzanine.
***
Sylvain ferma les portes de la Mégane. Le Bortsch n’était qu’à quelques dizaines de mètres de la rue de la Préfecture, mais il pressentait que l’endroit devait grouiller de véhicules de secours. Nath et lui avaient préféré laisser leur voiture un peu à l’écart et finissaient le trajet à pied. Predrag Marcovici sortit de l’établissement au moment où ses collègues de groupe arrivaient. Un bloc-notes dans une main, un stylo dans la
seconde, il respira profondément en regardant le ciel couvert. Il avait le teint cireux, et son chef évita de lui en faire la remarque. Elle fronça le nez avant de demander :
— Alors ?
L’enquêteur la dévisagea plusieurs secondes sans répondre. Il ne savait même pas par quel bout commencer.
— C’est pire que tout ce que j’ai pu voir jusqu’à ce jour, se contenta-t-il de dire avant d’allumer une cigarette.
Il aspira une longue bouffée, l’apprécia un instant lorsqu’elle pénétra dans ses poumons, puis la souffla. Le panache de fumée s’éleva vers le ciel en tourbillonnant. Les flashs revenaient sans cesse. Il secoua
la tête. Vaine tentative pour espérer les chasser. Il aurait tout le temps de se torturer l’esprit plus tard, mais là, il devait rester concentré.
Sylvain prit la parole. Dans ces moments de doute, il savait que moins il
laisserait de vides dans la conversation, moins les pensées de Marco s’égareraient.
— Tout le monde est arrivé ?
— Ouais. Patrick et Jacques ont commencé l’enquête de voisinage avec consigne de laisser des convocations chez tous ceux qui ne
répondraient pas ce soir. Aurélien est avec la jeune femme qui est tombée sur le… carnage.
— Ils sont où ?
— À son domicile, précisa-t-il en désignant la direction d’une des portes cochères, au fond de la ruelle.
— Elle est dans quel état ? s’inquiéta Nathalie.
— Comme tu peux t’en douter… La fille a été découverte inanimée par un passant, juste là, à deux pas de la devanture. Le type a appelé les secours, qui lui ont prodigué les premiers soins. Elle a sans doute perdu connaissance en sortant et s’est ouvert le cuir chevelu en chutant. Cinq points de suture ! Du coup, non seulement elle est en état de choc, mais en plus ils lui ont donné un sédatif pour calmer la douleur.
— Tu préfères qu’on commence par quoi ? fit Nath en se désignant de la main ainsi que Sylvain.
— Je pense que ce serait pas mal que tu ailles voir si tu peux tirer quelque
chose de notre témoin pendant que Sly et moi terminons les constatations. Seul, j’en ai encore pour au moins trois heures. À deux, on va se partager le boulot et avancer plus vite.
— Ça marche pour moi, répondit le brigadier-chef en attrapant dans sa sacoche de quoi prendre des notes.
— Les gars de l’IJ ?
— Ils sont en plein taf. Ils passent la scène de crime au microscope, une pièce après l’autre. Photos, vidéos, traces papillaires et relevés ADN dans chacune d’elles, chaque recoin. Pour l’instant, tout est négatif. Perso, je suis obligé de sortir toutes les cinq minutes tellement l’odeur est écœurante. Et je ne te parle même pas de la vision en arrivant.
— Je te crois sur parole, affirma Nathalie en observant les portes vitrées, qui avaient été recouvertes de draps blancs pour éviter l’attroupement de curieux et les regards indiscrets. Je me contenterai des albums
de l’IJ pour me faire une idée. Tu as l’identité du témoin ?
— Carine Maschini, répondit Marco en relisant ses notes. Elle habite au numéro 34, troisième étage, porte de droite.
Nathalie Klein tourna les talons et laissa les deux hommes seuls. Sylvain jeta
un œil vers son pote. Pas besoin d’en dire plus, un simple regard avait suffi. Marco répliqua :
— Putain ! C’est vraiment chaud ! Ces enculés ont fait un massacre !
— Les corps ont été enlevés ?
— Tu parles ! On devait d’abord se taper toutes les constatations avant qu’ils puissent y toucher. T’imagines même pas. Toute une famille pendue par les pieds et égorgée comme des moutons. Je viens à peine de finir. Les pompiers s’occupent de la suite avec le légiste. Quand je suis sorti prendre un peu l’air, Nellota était partie dégueuler.
— Bon, va falloir y retourner. En espérant qu’elle ne nous ait pas fait un malaise.
Marco acquiesça d’un simple hochement de tête. Il jeta son mégot le plus loin qu’il le put pour ne pas polluer d’éventuelles traces à l’extérieur, puis tous deux disparurent derrière les draps blancs.
Toutes les lampes de la salle avaient été allumées. Deux gros projecteurs supplémentaires, installés pour l’occasion sur de hauts trépieds, donnaient l’impression qu’un soleil d’été avait pénétré les lieux. La chaleur qu’ils produisaient rendait l’odeur un peu plus répugnante. Mais l’identité judiciaire s’activait toujours et les deux fonctionnaires affectés à cette tâche avaient besoin de voir ce qu’ils faisaient. Ils étaient reconnaissables avec leurs combinaisons en papier blanc, leurs masques
verts et les charlottes qui recouvraient leurs crânes. Le plus jeune tenait dans une main un rouleau adhésif à scellés, tandis que le second transportait plusieurs tubes de prélèvements ADN.
Les pompiers avaient mis en place un échafaudage. Pouvoir détacher et récupérer les corps sans patauger dans la mare de sang qui s’étalait sur le sol était indispensable.
Sylvain visualisa la salle d’un mouvement de tête circulaire, puis s’arrêta au pied des marches. L’odeur âcre et tellement caractéristique le prit à la gorge. Celle que l’on sent une fois et que l’on n’oublie jamais. Il sortit de sa poche un mouchoir en papier au parfum d’eucalyptus et se le colla sur le nez. La scène, si on pouvait l’appeler ainsi, était innommable. Une flaque sombre et épaisse dessinait une ellipse sur le carrelage écru. De petits filets plus clairs s’étendaient à la manière d’une toile d’araignée le long des joints en ciment. Sur un côté, des traces de pas semblaient s’être échappées de l’horreur, laissant une succession d’empreintes brunes, plus ou moins nettes, jusqu’au paillasson de l’entrée.
— Notre témoin, précisa Marco en observant le regard de son collègue qui suivait les marques jusqu’à la porte.
— Glauque, grogna Sly.
À gauche, quatre pompiers s’affairaient au bord de la mezzanine tandis que deux autres étaient assurés par des baudriers sur l’échafaudage. Sur le sol, Sylvain compta machinalement les sacs mortuaires dans
lesquels étaient enfermés les corps sans vie. Un homme se trouvait à leur côté, agenouillé près de l’un d’eux. De dos, Sylvain reconnut le médecin légiste. Il lui adressa un « Salut, doc ! » qui n’obtint pas de réponse. Le toubib était concentré sur ce qu’il était en train de faire et certainement un peu secoué. Il le verrait plus tard.
Marco lui fit traverser la salle par la droite. De ce côté, tout avait déjà été répertorié, photographié, scruté et examiné, chaque centimètre carré passé au peigne fin par les gars de l’IJ. Visiblement, rien n’avait été touché ni déplacé par les auteurs du crime. Aucune contamination, aucun relevé probant.
Ensemble, ils franchirent les portes de la cuisine. À l’intérieur, la magistrate était appuyée contre l’évier en inox, les bras croisés comme pour se protéger d’un danger invisible, un masque en papier dissimulant le bas de son visage.
Nellota était à peine moins pâle que lorsqu’elle s’était excusée dix minutes plus tôt pour se rendre aux toilettes. Marco s’approcha d’elle.
— Les renforts sont arrivés, dit-il en désignant son collègue. Sylvain Vatier, qui fait partie de notre groupe.
— Bonsoir, se contenta-t-elle de répondre en lui serrant la main.
— La commandante Klein a rejoint le domicile du témoin, précisa Sly, qui ne voulait pas passer pour les renforts.
— Pour en revenir à elle, vous avez des nouvelles de Mme Maschini ? D’après ce que j’ai pu comprendre, le choc a été violent !