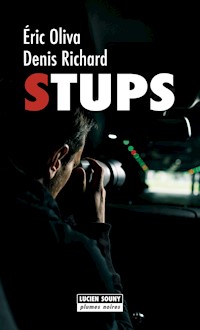Contenu
Page de titre
La vallée était déserte…
De sa main droite…
Valérie était recroquevillée…
Pierre était arrivé…
Une seconde et demie !
Elle sentit le plateau…
Le chauffeur avança…
À mille six cents kilomètres…
Glossaire
Remerciements
Le mot de l'éditeur
Bonus littéraire
Dans la même collection
Copyright
La vallée était déserte. Sur ce sol pierreux, dont les arrêtes saillantes semblaient désigner le ciel de leurs petites phalanges tendues, il n’y avait pas âme qui vive. Les nuages bas, qui se faisaient plus nombreux en fin d’année, transportaient fréquemment leurs lots de bruine passagère dans une atmosphère maussade, froide et profondément inhospitalière. À mille deux cents mètres d’altitude, les températures de décembre avoisinaient déjà le seuil négatif en milieu de journée. Sur l’azur, on pouvait deviner la lueur crépusculaire d’un soleil couchant, qui ne parvenait plus qu’à éclairer avec peine cet endroit retiré du monde. Le froid étendait aussi rapidement sa conquête que la nuit posait son voile sombre sur ce territoire. Un vent glacial renforçait à présent la sensation hivernale, qui avait pris ses quartiers depuis près d’un mois. Non loin, un épais manteau neigeux ornait d’une belle robe blanche les sommets des cordillères Bétiques.
Malgré l’heure tardive et la tranquillité des lieux, il avait mis en place le comité d’accueil habituel. Une quinzaine d’hommes suffisamment armés et à sa botte pouvaient tenir une semaine de siège si leur chef le leur demandait. Éparpillés sur ce morceau de colline, éventrée çà et là par le temps et ses intempéries, ils étaient tout bonnement invisibles. Pourtant, rien ne pouvait échapper à leur vigilance. D’autant que, ce soir, le patron s’était déplacé en personne et il surveillait leurs moindres faits et gestes. Il contrôlait tout et tout le monde, et ici-bas personne n’osait s’opposer à lui. D’ailleurs, qui aurait seulement eu l’audace de discuter l’un des choix de Mohamed El-Fassi ?
Parce que l’homme était considéré, depuis bientôt dix ans, comme le Seigneur du Rif. Incontournable. Celui par qui il fallait
passer pour être approvisionné. Dans cette contrée, il avait la main mise sur la majeure partie des quatre-vingt-dix mille
hectares exploités par des paysans volontairement appauvris et réservés à la culture de cette d’herbe qui rendait riche comme Crésus : le cannabis. Ce pacha du Nord marocain avait un caractère bien trempé, et sa cruauté, trop souvent portée à son paroxysme, était redoutée dans toute la région. La plupart des fermiers – qui survivaient plus qu’ils ne vivaient dans cette partie située au nord-ouest du Maroc – étaient à sa botte, pour ne pas dire à sa merci. Lorsqu’il parlait, tous obtempéraient.
Pendant un temps, par peur des représailles judiciaires et des prisons marocaines, quelques-uns avaient tenté de se soustraire à la loi du maître. Ceux pour qui cultiver un lopin de terre fourni et taxé par le gouvernement suffisait à entretenir une pauvreté qui se transmettait de génération en génération. Les gens simples, qui ne caressaient l’espoir que de s’épuiser aux champs, sachant qu’en contrepartie, ils devraient se contenter d’un bien maigre résultat et d’un revenu tout aussi dérisoire.
Seulement, ces projets n’entrant pas dans le schéma d’optimisation de sa production, El-Fassi avait très vite balayé leur souhait d’autonomie d’un revers de la main. En représailles à ce qu’il considérait comme une trahison, les fils aînés de ces trublions épars avaient été sauvagement assassinés, bien souvent devant les yeux terrorisés de leurs frères et sœurs, qui avaient parfois eu la chance de ne pas assister aux tortures infligées par des bourreaux sanguinaires.
L’écho de ces mesures de répression commandées par le Seigneur du Rif et mises en œuvre par ses sbires se répandait telle une traînée de poudre dans les villages. Le téléphone arabe prenait tout son sens dans ces provinces reculées. Depuis lors, d’Al Hoceima à Melilla, en passant par Driouch ou Nador, chaque villageois avait eu vent du
malheur qui aurait tôt fait de s’abattre sur les siens s’il se levait contre le « patron ».
De cela, et de maintes autres choses, Mohamed s’enorgueillissait. Du haut de son mètre soixante-douze, il avait su mater les prémices d’une rébellion en quelques jours à peine. Des tentatives étouffées dans l’œuf de la seule façon qu’il connaissait : la violence et la terreur. Le teint mat d’avoir trop pris le soleil, il était, à quarante-trois ans, l’aîné d’une famille de six frères et sœurs. Jamais scolarisé, il avait pris en 2005 les rênes des affaires de la fratrie, remplaçant au pied levé son père, qui avait succombé sous les tirs des forces spéciales lors d’une intervention antidrogue ayant tourné au bain de sang.
Ce jour-là, ce fils, embrigadé par un géniteur tout aussi vorace, avait pris conscience de la dangerosité du métier qu’il s’apprêtait à prendre à bras le corps. Mais Mohamed était futé et avait appris des erreurs passées. Une nouvelle stratégie s’était imposée presque naturellement : donner un peu pour recevoir beaucoup. Après avoir glissé quelques enveloppes à certains contacts de son entourage, il avait su, au fil des ans, tisser une
toile sur laquelle il évoluait à merveille. Aujourd’hui, il graissait la main de la plupart des chefs de la police et des hauts gradés de la gendarmerie. Si les colossales gratifications qu’il distribuait ne lui donnaient pas carte blanche pour autant, El-Fassi était néanmoins avisé en temps et en heure de toutes les surveillances existantes ou descentes à venir. L’unique véritable inquiétude qui subsistait venait des services centraux de la police judiciaire et de
ceux qu’il considérait comme les assassins de son père : les forces spéciales. Malgré les ficelles qu’il avait tirées et qui le rendaient pratiquement intouchable, Mohamed n’était pas parvenu à corrompre l’ensemble des camps ennemis.
Alors, pour cette nuit et pour cette raison, chacun était à son poste. Les guetteurs étaient en place et à l’affût. Aucun d’eux n’avait donné l’alerte. La plaine était calme et tout se passait comme prévu.
El-Fassi, vêtu d’un pantalon kaki et d’un blouson de la même couleur, lança un rapide coup d’œil à sa montre. L’imposante Breitling, récupérée au poignet d’un imprudent mauvais payeur, affichait 19 h 15. Au chaud à l’intérieur de son Range Rover, il guettait la moindre variation sur un horizon sans
lune. Scrutant le lointain, il était incapable de différencier le ciel de la mer, qui s’étaient unis pour la nuit. L’appareil ne devrait plus tarder ; son pilote était toujours à l’heure. Il se demanda comment il était possible de foncer au cœur de l’obscurité, tous feux éteints, à vingt mètres du sol, sans rapidement s’écraser sur l’un des nombreux pics montagneux qui découpaient, de leurs doigts acérés, le panorama local.
— Là-bas ! lança Hamid en pointant un index vers l’ouest. Je crois que c’est lui.
Mohamed plissa les yeux un instant, concentrant son regard sur les méandres de ce ciel d’encre. Hamid avait sans doute raison. Lui aussi était parvenu à deviner une légère modulation monochrome dans cette direction : un point sombre semblait se mouvoir dans le noir.
À présent, il fallait faire vite. Le patron lança ses ordres.
De sa main droite, sans le brusquer, Jean-François Debuilt tenait fermement le manche cyclique de son appareil. Chaque commande
sur la poignée l’éloignait ou le rapprochait de la crête des vagues. Même s’il n’en laissait rien paraître, il était concentré sur ses instruments de bord depuis près de deux heures, et des picotements oculaires commençaient à le gêner. Les cadrans, qui donnaient les informations essentielles sur l’état de la mécanique et sa position dans l’espace, étaient volontairement peu éclairés. L’attention qu’il était obligé de fournir se retrouvait, de fait, considérablement accrue par rapport à un vol diurne. Le cap sud-ouest, préalablement entré dans le GPS, était maintenu. Feux éteints, seul l’astre lunaire dessinait, au gré des nuages qui commençaient à s’amonceler tandis qu’il arrivait en vue des côtes orientales, la forme fuselée de son Écureuil sur une mer relativement calme.
Jeff, comme il avait été surnommé lorsqu’il officiait dans l’armée, aimait parfois y croiser une baleine ou un banc de dauphins, qui venaient se
nourrir dans les eaux tempérées de cette partie de la Méditerranée.
Sa vitesse de croisière était stable, sensiblement augmentée par le vent de nord, qui poussait l’appareil vers le sol. Posant un rapide regard sur l’anémomètre et la jauge, il se dit que le retour inverserait forcément la tendance. Mentalement, il calcula sa consommation de carburant. Avec le
poids du chargement qu’il s’apprêtait à embarquer, le complément du réservoir devenait obligatoire s’il voulait être certain de rejoindre la côte espagnole. « Soixante gallons devraient suffire », pensa-t-il. Mais, pour l’heure, ce qui le contrariait nettement plus, étaient ces nuages bas qui s’entassaient au loin en strates épaisses, juste dans l’axe de sa trajectoire.
D’après les informations du GPS, il survolerait la drop zone d’ici trois à quatre minutes. Déjà, les patins de l’hélicoptère effleuraient la cime des hauts sapins, qui se dressaient telle une armée de soldats de bois. Jean-François rectifia la portance de son appareil et diminua d’autant sa vitesse. Il devait éviter les secteurs trop peuplés et continuer de voler sous le seuil de détection radar. Si la pluie se mêlait de la partie, elle compliquerait considérablement sa tâche. Ce soir, il avait hâte de retrouver le plancher des vaches.
— T’en penses quoi ? demanda-t-il à son ami.
— On est bon, répondit Thierry. Garde ce cap et tu nous y amènes comme on va au bal.
— Alors, allons danser ! lâcha Jeff en pointant du doigt les larges cumulonimbus.
— Personne ne nous les avait annoncés, ceux-là !
— Les Marocains et la météo, toute une histoire.
Thierry Caplan, copilote tout aussi attentif aux indications des nombreux
cadrans émaillant le tableau de bord, était également son ami et frère d’armes. Pour le genre de boulot qu’ils étaient en train d’accomplir, Jean-François se reposait entièrement sur ses compétences. Il savait que, chez lui, elles étaient naturelles et particulièrement affûtées. Dès lors que son appareil quittait le sol pour un vol de nuit, il pouvait compter
sur les capacités de son pote. Celui-ci, fermement harnaché à son siège, avait pour mission de vérifier régulièrement le cap et de les guider avec toute la précision que ces sorties périlleuses exigeaient. Jeff focalisait son attention sur le pilotage, Thierry,
sur tout le reste. De plus, quand la tension électrisait parfois le cockpit, son copilote n’avait pas son pareil pour détendre, avec son humour noir, la situation.
Et Jeff savourait sa compagnie, car retrouver son ami n’avait pas été une mince affaire : après un matin de juin 2008, l’homme avait tout simplement disparu de la circulation. Ce sergent du 8e RPIMa* de Castres était pourtant un militaire dans l’âme – un combattant aguerri et amoureux de son job. Quels que soient les ordres, où que son unité soit déployée, il avait toujours été fier d’œuvrer en compagnie de l’élite de l’armée française.
Thierry y avait été recruté non seulement pour ses qualités physiques exceptionnelles, mais également pour son sang-froid à toute épreuve et une réelle capacité d’adaptation aux situations les plus délicates.
Les deux hommes s’étaient rencontrés au camp d’entraînement, dans le courant de l’année 2005, un peu avant l’été. Jean-François avait été frappé par cette gentillesse qui caractérisait les gens du Nord, mais encore plus par la modestie qui paraissait innée chez ce militaire. Ils avaient eu l’occasion d’effectuer plusieurs sorties dans le ciel afghan après que son copilote avait été blessé au cours d’une mission de sauvetage et renvoyé sur le sol français. Caplan lui avait, dès lors, été affecté comme second. « Les ordres venaient d’en haut. Les hélicoptères devaient sillonner les airs. On n’arrête pas de faire la guerre parce qu’un copilote a perdu l’usage de son bras ! » se rappela Jean-François, qui n’avait eu qu’une courte semaine pour accuser le coup.
Fort heureusement, dès les premières missions avec son nouveau coéquipier, une savante alchimie s’était produite. Le courant était passé et, entre les deux hommes, un sentiment de confiance s’était immédiatement installé. En y repensant, Jeff pouvait dire qu’aux commandes de son Tigre EC-665, il avait toujours volé serein, et ce, même lorsque certaines missions s’étaient avérées nettement plus épineuses que prévues.
Elles avaient souvent été mouvementées, mais leur avaient néanmoins permis de faire connaissance et de tisser des liens. La chaleur des
dortoirs ne s’y prêtant que moyennement, ils avaient profité des heures passées à l’intérieur du cockpit pour discuter de tout et de rien – la famille, les amis, les voitures ou la musique.
Après qu’ils eurent survolé de nombreux sujets anodins, leurs souvenirs de guerre avaient rapidement pris
le dessus et monopolisé leurs bavardages. Ceux que l’on n’évoquait pas avec ses proches : une attaque de convois qui avait mal tourné ; la récupération d’un copain dont l’appareil venait d’être abattu ; ou celle du soldat qu’on ne connaissait que de vue, que l’on avait croisé le matin même au mess et que l’on évacuait l’après-midi, les jambes déchiquetées par une mine antipersonnel. Cette réalité dont l’armée préférait taire l’existence, mais qui, pour tous, demeurait un secret de polichinelle.
Et un beau jour, sans que personne sache pourquoi, Thierry avait décidé de tout plaquer. Il avait résilié son contrat sur un coup de tête et avait disparu. Peut-être était-il atteint de stress post-traumatique, syndrome qui revenait régulièrement dans les discours depuis le Vietnam. Cette réaction psychologique dont les jeunes soldats, envoyés combattre les talibans, étaient de plus en plus souvent victimes. Son ami avait-il été confronté à trop d’horreurs sur le terrain de la guerre terroriste ? Mais lui avait-il seulement tout raconté ?
À l’époque, Jean-François n’avait pas cherché à le savoir. Il n’avait pas non plus cherché à revoir son collègue, bien trop occupé à piloter – pour sa patrie, son unité et ses hommes. Le temps s’était progressivement chargé d’étioler ses souvenirs et, semaine après semaine, il avait peu à peu poussé Thierry hors de sa mémoire. Son copilote avait sans doute ses propres arguments et il n’était pas là pour le juger. De toute façon, comme elle l’avait fait une première fois, l’armée lui avait mis un autre second dans les pattes et le boulot n’avait pas attendu.
Puis, insidieusement, les forces militaires avaient également eu raison de lui. La hiérarchie avait changé de visage et les missions s’en ressentaient. Tout devenait plus compliqué. Aux commandes de cette énorme machine de guerre se tenaient des généraux qui ne prenaient des décisions qu’en fonction des courants politiques ou géopolitiques.
Las des modifications répétées au sein d’un gouvernement qui remplaçait régulièrement leurs chefs militaires, après vingt ans de bons et loyaux services, Jean-François avait décidé de voler de ses propres ailes, sinon de ses propres pales.
Au cours des raids qu’il avait effectués au Moyen-Orient, il avait fait la connaissance de quelques personnes particulièrement influentes. Celles qui, au détriment des populations, savaient profiter du moindre état de belligérance pour parfaire leur place au soleil. Une façon de procéder qu’il trouvait abjecte, mais qui lui avait au moins procuré une porte de sortie. De retour chez lui, il avait tout d’abord été engagé comme « chauffeur » pour des patrons exagérément riches. Des hommes et des femmes qui étaient en mesure de payer cash des sommes absolument immorales pour des vols de
quelques dizaines de minutes. La plupart du temps, ces gens fortunés, aux comptes en banque étrangers, se déplaçaient entre Saint-Tropez, Ibiza et Monaco. Ces transferts se faisaient souvent à des heures indues, et particulièrement les week-ends. Au cours de ces soirées festives, il ne lui avait fallu que peu de temps pour comprendre la véritable signification de « nuits de débauche ».
Heureusement, et c’était ce qui le tirait vers le haut dans ce nouveau métier, certains vols de nuit l’amenaient à apponter sur des yachts qu’il n’aurait jamais eu l’occasion d’approcher – magnifiques navires aux allures futuristes, que leurs capitaines ancraient en
dehors des marinas pour se prémunir contre la visite de paparazzis à l’affût de photos indiscrètes. Instants magiques durant lesquels, ses veines gorgées d’adrénaline, aux commandes de son appareil, il se sentait à nouveau vivant. Contrer les éléments pour parvenir à poser avec douceur les patins de son engin à l’intérieur d’un cercle grand comme un demi-terrain de tennis. Il aimait cet exercice et, à force de répétitions, il le maîtrisait à la perfection.
Et puis le temps avait défilé. Les heures de vol s’étaient additionnées et les trajets s’étaient succédé, souvent les mêmes, presque trop réguliers. Une certaine routine avait fini par s’installer dans sa vie et lui gâchait son plaisir. Au bout du compte, Jean-François trouvait de moins en moins de satisfaction à contenter les sollicitations récurrentes de ces personnes. D’autant que, même dans ce milieu où l’argent coulait à flots, la crise se faisait sentir. Certains habitués, Patek au poignet et pas le moins du monde embarrassés, essayaient de tirer les tarifs vers le bas.
La seule personne qui l’empêchait de quitter la France pour recommencer une nouvelle vie ailleurs était sa mère. Il savait qu’elle aurait besoin de lui. Pas dans l’immédiat bien sûr, puisque, à soixante-huit ans, elle était encore parfaitement autonome ; mais un jour viendrait. Alors, comme le font tous les fils, il allait la voir
dès qu’il le pouvait dans l’appartement qu’elle occupait à proximité du port de Nice. Des visites régulières pendant lesquelles ils en profitaient pour déjeuner ensemble. Pour être sûr que tout allait bien, qu’elle ne manquait de rien. Marie-Jeanne était sa seule famille, et il était son unique fils.
De soirées mondaines en fêtes débridées, vagabondant entre notables et stars du showbiz, Jean-François avait semé de petits cailloux sur sa route et avait fini par faire parler de lui. À force de rencontres, donnant logiquement lieu à une multitude d’interactions, il avait été approché. Ceux qui se targuaient d’être ses nouveaux amis lui avaient promis monts et merveilles. Pour l’appâter, ils avaient rapidement fait briller la monnaie. Jeff savait pertinemment
que ses talents de pilote avaient œuvré sur ces gens comme un aimant affolant un trombone. Pourtant, bien qu’ayant toujours eu une certaine philosophie de la vie, du bien contre le mal, du
blanc opposé au noir, les épaisses liasses de billets violets qui passaient de main en main dans les réunions, où il était à présent convié, avaient eu raison de ses principes. L’argent possède une force d’attraction particulièrement puissante.
— Là-bas, désigna Thierry en tendant la main. On y est !
Jean-François tourna la tête vers l’endroit que son copilote lui indiquait et aperçut, à son tour, les marqueurs lumineux qui balisaient la drop zone. Sachant les lieux totalement sécurisés par la garde prétorienne qui patientait au sol, il signala sa position en allumant le projecteur
fixé sous l’appareil.
— Oui, on y est, acquiesça-t-il en prenant une légère assiette vers l’est.
Le champ était immense et, comme la fois précédente, il avait été choisi parce qu’il se trouvait au milieu de nulle part. Une parcelle plane perdue au cœur d’un massif montagneux, autour duquel se greffait une demi-douzaine d’échappatoires et dont personne n’oserait parler.
Concentré sur ses instruments, Jeff n’eut que peu de manœuvres à effectuer avant que l’appareil touche le sol au centre de huit lampes LED. Les patins s’enfoncèrent de quelques centimètres dans la terre meuble et le pilote abaissa une série de commutateurs situés au plafonnier. Thierry l’imita. Les pales de l’engin commencèrent à ralentir, laissant retomber un nuage de poussière brune et d’herbes.
Dès que la visibilité revint à la normale, une volée d’hommes armés sortirent du néant et se précipitèrent dans leur direction. Ceux chargés de la protection du dispositif formèrent un cercle autour de l’hélicoptère. Tournant le dos à celui-ci, chacun désigna de son fusil une hypothétique cible dans la nuit. Si des étrangers décidaient de se montrer sans avoir été invités, ils seraient reçus comme ils le méritaient.
La situation était figée. Deux individus s’approchèrent du cockpit. L’un d’eux, fusil mitrailleur en travers de la poitrine, s’arrêta à trois mètres de l’appareil. Le second déverrouilla la porte de l’Écureuil.
— As-salâm ‘aleykoum, mon frère, lança le Berbère en tendant une main au pilote.
— Bonsoir, répondit simplement Jeff.
L’homme ne releva pas l’affront, mais Jeff savait qu’il l’avait gravé dans sa mémoire.
De toute façon, il n’avait jamais supporté ce gars. De plus, cette façon de le saluer l’horripilait. Lui qui s’était battu contre les intégristes sur leurs propres territoires se demandait comment il pouvait adresser
la parole à cet homme qui prenait un malin plaisir à lui dire bonjour en arabe. De surcroît, il était parfaitement au fait des sauvageries perpétrées sur les pauvres villageois du Rif. Seulement, le job pour lequel il avait été embauché l’obligeait parfois à fréquenter ce genre de personnages, pour qui la vie humaine avait une valeur tout
approximative. Mais il n’était pas là pour juger et, ce soir encore, il allait devoir garder pour lui son
ressentiment, puisque son nouveau patron avait apparemment une grande confiance
en cet individu. D’ailleurs, ce manque d’empathie évident n’était-il pas la source même de sa force ? Jeff s’était évidemment posé la question, car la lueur qu’il avait vue briller dans ses yeux n’avait rien d’intelligent : elle était maléfique.
— Ça s’est bien passé ? demanda Mohamed en posant un regard glacé sur Thierry.
— On est là, c’est donc que tout va bien. C’est mon copilote, ajouta Jean-François en désignant son ami d’un geste de la main.
— Je savais pas que vous alliez être deux aujourd’hui, grogna El-Fassi.
— Avec ces nouveaux problèmes migratoires, les contrôles radars se sont intensifiés à l’approche des côtes. Il a fallu en tenir compte et, à moins d’être inconscient, personne ne vole seul, de nuit, à cette altitude. Et je tenais à arriver entier.
— OK, concéda le Berbère en balayant l’air devant lui d’un revers de main. C’est juste que j’étais pas au courant et j’aime pas ça.
Il tourna la tête vers le copilote.
— Salâm.
Thierry lui répondit d’un simple hochement de tête.
Sur ce, Jean-François détacha son harnais et descendit enfin de l’Écureuil, dont les pales terminaient leur ultime rotation dans un souffle rauque.
L’un des hommes du Seigneur venait de tracter une cuve jusqu’à proximité de l’appareil et s’apprêtait à y brancher un tuyau.
— Y a quoi là-dedans ? questionna Jeff.
— Jet A-1, intervint Mohamed tandis que son homme de main faisait signe au pilote qu’il ne comprenait pas sa langue. C’est ce qu’on m’a dit d’apporter.
— C’est bon, répondit Jeff. Tu peux lui dire d’en mettre trois cents litres.
El-Fassi relaya la demande en berbère et l’employé s’exécuta sans broncher. Sur un claquement de doigts, cinq autres individus quittèrent leurs positions tandis que le Range Rover de Mohamed reculait vers l’engin volant. L’un des gorilles, Kalachnikov en bandoulière, ouvrit le hayon, laissant apparaître quatorze sacs en toile de jute, empilés telle une véritable construction de Lego en lieu et place des sièges arrière. Les hommes s’attachèrent à transférer la cargaison du 4x4 à l’intérieur de l’hélicoptère. Au bout de vingt minutes, le réservoir de l’Écureuil avait reçu la quantité nécessaire à son voyage et les valises marocaines* étaient correctement réparties dans l’habitacle.
El-Fassi s’approcha de Jean-François.
— C’est bon. C’est terminé. Vous y allez quand vous voulez.
— OK. On décolle avant que l’orage se décide à faire demi-tour. Tu les préviendras de notre départ, répondit le pilote en se dirigeant vers son appareil.
— Je les appellerai dès que tu seras en l’air.
— Dis-leur qu’on devrait en avoir pour deux heures et demie à cause des vents contraires.
El-Fassi se contenta d’un signe de la main et d’un sourire narquois. Jeff ne releva pas et verrouilla la porte de son engin.
Deux minutes plus tard, la turbine hurlante de l’hélicoptère arrachait les patins du sol. Les nuages, qui avaient inquiété Jeff, avaient longé la côte sans déverser l’humidité qu’ils renfermaient et s’agglutinaient maintenant plus au sud. L’Écureuil piqua du nez et prit de la vitesse en direction de la mer. L’horizon était dégagé mais, rapidement, il ne fut de nouveau qu’un point sombre au milieu de la nuit. Encore trois heures de pression à gérer, et chacun pourrait rentrer chez soi pour profiter de sa paie et, éventuellement, d’une bière bien fraîche.
Valérie était recroquevillée dans un coin du lit. Les draps portaient les stigmates d’une nuit qui se serait voulue sulfureuse, mais qui, pour elle, n’avait été que souffrance. Ses muscles lui faisaient tellement mal qu’elle n’osait plus les bouger. Contrastant avec la blancheur lustrée de la soie, certains endroits de ses bras avaient viré au mauve. Intérieurement, elle espérait que Marco avait épargné son visage. Elle ne doutait pas que le miroir de la salle de bains répondrait à cette interrogation, mais son corps et son esprit refusaient encore de l’y conduire. Pour l’instant, elle essayait de se remémorer la soirée passée.
Elle savait que, durant les heures qui précédaient chacune des livraisons qu’il recevait, l’humeur de Marco changeait. L’homme, généralement calme et posé, devenait inquiet, tendu. Bien sûr, parfaitement au courant de ses agissements, Valérie comprenait ses préoccupations. D’ailleurs, au vu des sommes engagées et des risques, qui ne serait pas nerveux ? Mais là où le bât blessait, c’était qu’au fil des heures, cette inquiétude se muait en anxiété, puis, inexorablement, en brutalité.
Comme la fois précédente, et celle d’avant encore, cette nuit n’avait pas dérogé à la règle.
La veille, il l’avait conviée à passer la soirée en sa compagnie. Un début de rendez-vous qui avait commencé par un agréable repas, livré dans l’imposante propriété qu’il partageait avec ses chiens. À table, de délicieuses tapas multicolores avaient été arrosées d’une bouteille de Veuve Clicquot. Pendant plusieurs heures, ils avaient parlé de choses et d’autres en profitant des différentes saveurs. Puis, pour accompagner le thé, ils s’étaient délectés de quelques sucreries arabes préparées par l’une des meilleures pâtisseries de Casablanca. Que demander de plus d’une belle soirée bercée par un brin de musique andalouse ?
Pourtant, lorsque 22 heures avaient sonné, Marco Gonzalez – de son véritable prénom Marc – s’était une fois de plus métamorphosé. L’attitude qu’il adoptait dans ces moments lui faisait penser à ces films de série B, où l’humain se transformait en homme-loup quand le soleil disparaissait. L’heure fatidique se rapprochait et son irritabilité grandissait. Comme chaque fois, pour tenter d’apaiser une nervosité croissante, il avait sorti le pochon de cocaïne qu’il gardait pour sa propre consommation. Deux rails inhalés à même la table en verre du salon l’avaient rendu plus dangereux encore. Après un double whisky et quelques minutes, le loup-garou avait fini par s’échapper de sa tanière. Marco s’était effacé, et la bête s’était alors dévoilée. Quant à elle, elle avait compris que, quelques heures plus tard, elle ne serait plus la
même.
Elle avait bien sûr espéré qu’il n’y toucherait pas. Qu’il allait enfin réaliser cet effort et que cette nuit serait différente. Elle avait pensé qu’il devait avoir l’habitude de ce stress et avait appris à le gérer. Mais, hier soir, rien n’y avait fait. Ou plutôt, tout s’était enchaîné exactement de la même façon que les fois précédentes.
Après tant d’années d’une consommation régulière, l’effet de la cocaïne sur son organisme devenait dévastateur. En plus d’augmenter la tension largement présente, la poudre blanche avait en revanche considérablement amoindri ses capacités d’érection, réduisant le plus souvent ses velléités à néant. Pourtant, juste avant de partir pour son rencard, il avait une nouvelle
fois tenté de lui faire l’amour. Une manière, pour lui, d’essayer de se vider l’esprit et de faire baisser la pression. Mais se sentir diminué de la sorte n’avait qu’aggravé une situation déjà explosive.
Devant ce corps divinement excitant, incapable d’honorer cette femme qui le défiait de ses seins pointus, il avait suffi d’un regard mal interprété pour que les coups se mettent à pleuvoir. Et, ce soir-là, la séance avait été plus éprouvante qu’à l’accoutumée. Qu’avait-il bien pu se passer dans sa tête qui aurait pu l’expliquer ? Elle n’en avait aucune idée. Habituellement, il se contentait de cogner deux ou trois fois, puis s’arrêtait devant ses pleurs. Seulement, hier, quelque chose s’était détraqué. Le regard fou avec lequel il l’avait dévisagée lui avait réellement fait peur. Était-ce à cause de la drogue ? L’écaille de poisson était-elle de moins bonne qualité ? Valérie ne pouvait le dire. Elle n’en prenait plus depuis des mois. C’était sa fierté. Et pourtant, ce matin, elle le regrettait amèrement. Sur elle, les coups n’auraient pas eu la même portée. Parce que, cette nuit, elle avait eu l’impression que les effets de la poudre blanche s’éterniseraient à jamais. Les gifles et les insultes, qui étaient venues rassasier ces interminables minutes, l’avaient profondément marquée. D’abord sur son corps, meurtri, mais surtout dans sa tête. Si, il y avait des années, Marco avait eu des sentiments pour elle, elle était à présent certaine de n’être devenue qu’un défouloir. Une chose qu’il convoquait pour quelques heures. Le simple objet sexuel d’un homme épisodiquement impuissant.
Elle pouvait presque dire qu’elle avait pris l’habitude de ses moments d’égarement, qui ne duraient jamais très longtemps et étaient suffisamment espacés dans le temps. Pourtant, la soirée qu’elle venait de vivre avait dévoilé une autre vérité : un jour prochain, il la tuerait. Volontairement ou pas, le résultat qui en découlerait se ficherait bien de cette nuance. Pour lui, il ne s’agirait que d’une énième crise de démence, une volée de coups plus violente qu’à l’ordinaire, un déchaînement à peine abusif. Mais pour elle, ce serait la punition de trop. Parmi celles qu’elle ne méritait pas, un jour viendrait la dernière. Après cela, elle finirait dans un sac lourdement lesté, que deux hommes iraient jeter quelque part entre les côtes espagnoles et le littoral marocain.
Après cette énième partie de déplaisir, Valérie venait de prendre conscience que ce pan de sa vie devait cesser. Elle ne
voulait pas mourir à quarante ans. Surtout qu’elle était clean depuis maintenant six mois. Elle l’avait promis à son père – tout au moins à son portrait, qui trônait sur sa table de nuit. Elle aurait aimé le lui dire en face, mais il était trop tard. Les aléas de l’existence s’étaient chargés de séparer leurs chemins. L’homme qu’elle fréquentait n’y était pas étranger. Pourtant, après dix-huit ans de toxicomanie, elle était enfin parvenue à décrocher. Revers de la médaille, elle avait appris à ses dépens que chaque décision amenait son lot d’incidences. Depuis sa rupture avec la poudre blanche, elle ressentait dans sa
chair chaque coup que Marco lui portait, lui complètement stone, mais elle définitivement lucide.
Heureusement, quel que soit son état de tension, Marco honorait toujours ses rendez-vous. Pour ne pas être en retard, il avait abandonné son corps meurtri à minuit. Elle savait qu’il avait rejoint la ferme dans laquelle la marchandise devait arriver. Elle ne
doutait pas non plus que, si la livraison s’était déroulée sans anicroche, il se métamorphoserait, comme il le faisait chaque fois, en gentleman. Le lendemain
serait une journée shopping et, de boutique en boutique, il la couvrirait de cadeaux. À coup sûr, il lui offrirait ce tailleur Chanel devant lequel elle bavait depuis des
semaines. Au même titre qu’un acteur rangeant son personnage au placard après une scène sordide, Marco redeviendrait celui qu’elle avait connu et jadis aimé.
Pourtant, aujourd’hui, Valérie en avait assez. Cette vie ne lui convenait plus, et le milieu dans lequel
elle évoluait malgré elle lui faisait de plus en plus peur. D’ailleurs, elle ne se rappelait même plus comment elle était tombée amoureuse de cet homme. Pour quelles mauvaises raisons avait-elle tout plaqué pour le suivre en Espagne ? Était-ce le cœur qui l’avait poussée à agir de la sorte ? Sachant qu’il était alors activement recherché par les flics français pour un règlement de compte auquel il avait participé à Cannes, elle ne le jurerait pas. N’avait-il pas plutôt fui d’autres éventuelles représailles que la justice de son pays ?
Néanmoins, elle était bien obligée d’avouer que l’argent facile, la came à discrétion et une vie qu’elle entrevoyait grisante auprès d’un voyou, beau gosse et imposant, avaient certainement contribué à la décider. Cependant, chaque pièce jetée en l’air pouvait présenter son côté pile aussi bien que son côté face. Avant qu’elle s’en aperçoive, les années fastes avaient filé comme une météorite traverse un ciel étoilé. L’homme, qu’elle avait idéalisé, s’était peu à peu transformé en un quinquagénaire bedonnant et violent qui ne supportait plus l’image qu’il renvoyait de lui.
À présent, Valérie était épuisée de devoir mener une vie qui ne lui ressemblait plus. Mais, par-dessus tout,
elle était terrorisée. Un cap avait été franchi. Elle avait la désagréable sensation de glisser sur une pente qui l’entraînait chaque jour vers les entrailles d’un trou noir, un gouffre sans fin qui n’attendait que de se refermer sur elle. La coupe était pleine et elle était en train de s’y noyer.
Pour elle, les plus belles années de sa vie s’étaient évaporées avant qu’elle ait eu le temps d’en profiter. Malgré cela, elle irait jusqu’à en offrir cinq de plus pour renouer avec ses parents. Elle aimerait les
remercier de l’avoir soutenue lors de ses premières incartades, ses premières interpellations. Puis pour avoir été présents au cours des verdicts qui avaient suivi. Les face-à-face avec les procureurs, les démêlés avec les juges des enfants, les JAP*.
Seulement, pour ceux qui n’avaient connu les vicissitudes de la justice qu’à travers les déboires de leur fille, Valérie avait franchi les limites acceptables le jour où elle leur avait annoncé qu’elle partait s’installer en Espagne avec Marco. Depuis, elle n’avait plus aucune nouvelle de leur part. Maintenant que son pain blanc avait
changé de couleur et que ses seules amies n’étaient que compagnes ou copines de dealers, sa famille lui manquait
terriblement.
Son regard bleu se perdit dans les plis de l’oreiller. Fermant les yeux, elle puisa au fond de sa mémoire, se projetant quinze ans en arrière. Qu’avait-il bien pu devenir ? Était-il toujours flic ? Encore célibataire ? Des questions simples qui avaient fait leur bout de chemin dans sa tête.
Pierre avait sans doute changé. Des années étaient passées et Valérie ne voyait aucune raison pour que le cycle des saisons, qui avait méthodiquement tracé de petites ridules autour de ses paupières, n’en ait pas fait de même pour lui. Sans qu’elle sache pourquoi, cette certitude la rassurait. Malgré leurs différences, elle se souvenait de lui comme d’un gars sympa, plutôt mignon et un tantinet introverti. Paradoxalement, elle l’avait senti ouvert et compréhensif. C’était, à l’époque, la perception qu’elle avait eue du flic.
Après les interpellations qui l’avait conduite d’un squat sordide jusqu’aux geôles de la caserne Auvare, elle avait vécu la plus longue garde à vue qui lui avait été donné de subir. Alors qu’elle avait dû supporter les protestations et les hurlements nocturnes de ses congénères, essayant de dormir par épisodes sur le béton d’une cellule glaciale et malodorante, les minutes lui avaient paru des heures, et
ces quatre interminables journées, des semaines. Au rez-de-chaussée du bâtiment qui abritait cette prison de taille réduite, l’un des gardiens lui avait avoué que le chauffage était en panne depuis bientôt quinze jours, mais que, faute de moyens, la direction n’avait pas prévu de faire réparer la chaudière pour le moment. Cette fois-là, elle pouvait dire qu’elle en avait vraiment bavé. En dépit des années écoulées, elle se souvenait de cet épisode comme s’il s’était déroulé hier. Il était gravé dans ses tripes. Entre la bouffe immonde et un avocat commis d’office qui n’avait servi à rien, elle avait compté chaque minute. Si un problème devait survenir, Valérie donnerait le peu qu’elle possédait pour ne pas avoir à revivre pareil cauchemar.
Quand son moral n’était pas au beau fixe et que ses pensées se mettaient à divaguer, le visage de Pierre lui revenait invariablement à l’esprit. Les traits n’étaient plus tout à fait nets, mais elle ne doutait pas de le reconnaître si elle le croisait au hasard d’une rue.
Régulièrement, tout au long de ses soixante-dix-huit heures de captivité, il était venu la chercher dans sa cellule, notamment pour l’auditionner – de longues dépositions durant lesquelles le moindre passage de sa vie avait été décortiqué, fouillé, mis à nu. Des questions en rapport avec leur enquête, disait-il. Il voulait tout savoir : le nom de ses dealers, à quelle fréquence elle leur achetait la came, à quel prix, où elle se procurait l’argent. Pierre n’avait rien laissé au hasard.
À l’époque, elle s’était doutée que plusieurs vendeurs avaient également été arrêtés, mais, lorsqu’elle le lui avait demandé, il s’était contenté d’éluder son interrogation. C’était à elle de répondre aux questions, pas le contraire. De toute façon, elle savait que, si elle était dans le vrai, entre les mains de ce genre de flics, les gars allaient
morfler !
Une fois les principales dépositions couchées sur le papier, il ne l’avait pas pour autant abandonnée derrière sa porte en Plexiglas. Le flic était revenu pour lui faire prendre l’air quelques minutes. C’était ce qui lui avait le plus manqué : pouvoir respirer à l’air libre, sans contrainte. À deux ou trois reprises, il lui avait donné l’occasion de profiter des rayons bienfaiteurs d’un soleil d’octobre pour fumer une cigarette, le temps qu’elle se réchauffe un peu et reprenne des couleurs. Ils avaient parlé de son passé et de son avenir encore incertain. Comme on le disait dans le milieu, sans la
brusquer, il avait essayé de la retourner.
Tout le monde le savait : les flics des Stups avaient besoin d’indics pour exercer leur métier. Mais Valérie était consciente qu’elle n’était que peu accrochée dans cette affaire. Comparée aux dealers qu’elle avait fini par entendre discuter entre eux dans les geôles, elle n’était qu’une pauvre toxico qui avait acheté de la cocaïne pour s’en mettre plein le nez. Elle n’en avait jamais revendu et jamais tiré de profits. Elle avait donc neuf chances sur dix de ne pas être écrouée lorsque la garde à vue arriverait à son terme. Alors, à ses risques et périls, elle avait fait le choix de ne pas répondre aux sollicitations du capitaine. Son futur était à présent entre les mains du juge d’instruction, certainement plus intéressé par le haut du panier que par sa personne. De toute façon, à l’époque, les keufs étaient les ennemis jurés, et elle avait décidé de tenter sa chance devant le magistrat. Un pari qui s’était finalement avéré payant. À l’issue du verdict, elle n’avait écopé que de deux mois de prison avec sursis, avec obligation de soins et contrôles réguliers de sa toxicomanie.
Quelques semaines après le jugement, elle avait croisé Pierre dans une rue piétonne. Il l’avait invitée à boire un café et, sans rancune, Valérie avait accepté. Ce jour-là, il aurait certainement aimé un peu plus que ce qu’elle lui avait donné, mais il n’était qu’un flic des Stups, tandis qu’elle flirtait avec tout ce qu’il combattait. Pourtant, ils s’étaient ensuite revus plusieurs fois et, au cours de ces rendez-vous, l’un et l’autre s’étaient appliqués à éviter certains sujets.
Cependant, Valérie avait gravé dans sa tête le baiser qu’ils avaient échangé, et son ventre s’était littéralement embrasé lorsqu’il l’avait étreinte contre lui. Puis était arrivée la nuit à Villefranche, dans l’appartement qu’il occupait à côté de la rue Droite. C’était un dimanche soir. Elle s’en souvenait, car il n’était plus là quand, le lendemain matin, elle avait ouvert les yeux. Sur la table de la
cuisine, un petit-déjeuner patientait. Lorsqu’elle y repensait, elle se disait que, ce jour-là, sa vie aurait pu basculer du bon côté. Au cours de cette période, elle avait senti que quelque chose en elle avait changé. Ces quelques fois où ils s’étaient retrouvés, ses mains s’étaient mises à trembler, son cœur, à battre plus vite. Elle s’était même demandé si, sur le coup, le manque de drogue ne lui avait pas joué des tours. Elle avait compris qu’il s’agissait d’autre chose lorsqu’un soir, tandis qu’il s’apprêtait à partir en mission à l’autre bout de la France, il s’était approché d’elle pour l’embrasser. Elle avait à peine posé ses lèvres sur les siennes. Elle ne voulait pas qu’il la laisse, mais s’était bien gardée de le lui dire.
Malgré tous ces petits signes, encore fragile et certainement trop gangrénée par le milieu qu’elle fréquentait depuis des lustres, elle avait refoulé cet étrange sentiment de toutes ses forces. Avec le recul, elle était persuadée qu’ils auraient pu construire un futur. Il était toujours attentionné et tellement indulgent dans ses gestes et ses paroles. Elle savait, au fond d’elle, qu’il n’aurait eu aucun mal à trouver les mots pour qu’elle change, qu’il aurait pu lui faire oublier ses démons.
Deux jours plus tard, de la même manière qu’une enfant brave les interdits, elle était retournée à ses mauvaises fréquentations, s’enlisant à corps perdu dans ses anciens mais si présents péchés. Chaque jour que Dieu faisait, elle le regrettait amèrement.
Mais, maintenant, comment allait-elle s’y prendre ? De quelle façon parviendrait-elle à renouer le contact ? Était-il toujours à Nice ? Encore aux Stups ? La seule certitude qu’elle avait était qu’il devenait son unique planche de salut.
Valérie se leva péniblement de son lit. Le miroir, fixé à l’angle opposé de la pièce, lui renvoya l’image agréable d’un corps fin à la peau légèrement hâlée. Elle s’avança vers la glace, s’arrêta à mi-distance et se mit à trembler. Ses grands yeux venaient de se poser sur les marques violacées qui lézardaient ses flancs, ses épaules, et une partie de ses bras et de ses cuisses. Chaque mouvement esquissé amenait son lot de souffrances. Elle se traîna jusque sous la douche, espérant que la douce chaleur du jet estomperait un peu les blessures et calmerait
les douleurs.
— Je dois le contacter, murmura-t-elle pendant que le pommeau répandait l’eau brûlante sur ses cheveux châtains. Si je veux rester en vie, il n’y a pas d’autres solutions.
Vingt minutes plus tard, gonflée d’orgueil, elle quitta la propriété. Pour la première fois, elle n’attendit pas le retour de Marco, ne souhaitant ni le croiser ni profiter de ses
largesses. Valérie n’avait plus qu’une envie à présent : rentrer chez elle, s’attabler avec une feuille blanche et un stylo, et faire une chose qu’elle aurait dû accomplir depuis longtemps.
Pierre était arrivé de bonne heure au service et, comme souvent, il était le premier à l’étage des Stups. En ces tout premiers jours de novembre, une pluie fine, qui
perdurait depuis la veille, maculait d’un millier de zébrures translucides les vitres sales. Aujourd’hui, les rayons du soleil ne parviendraient pas jusqu’à Nice. Machinalement, il appuya sur l’interrupteur en entrant dans le bureau qu’il occupait depuis huit ans. La lumière blafarde de deux antiques néons fixés au plafond se propagea sur une table de travail impeccablement tenue.
Nonchalamment, presque rituellement, il alluma son ordinateur, puis, dans la
foulée, sa machine à expresso.
À l’image de la météo, le week-end qui venait de s’écouler avait été morose. Reprendre le boulot ce matin était presque un soulagement. Même sur la Côte d’Azur, l’hiver montrait le bout de son nez, et les sommets des montagnes que l’on apercevait de sa fenêtre laissaient entrevoir les prémices d’un Noël blanc pour les stations de ski des environs.
Dans quelques semaines, il prendrait quelques jours de repos dans son
appartement de montagne. Il retrouverait là-haut l’unique endroit sur cette foutue terre où il se sentait apaisé. Rien ne lui allait mieux que cette solitude qu’il avait fini par rechercher.
À l’aube de la cinquantaine, Pierre Risso possédait un certain charisme. Grand et svelte, il tenait à ses joggings hebdomadaires pour se maintenir en forme. Ses yeux foncés parlaient souvent pour lui, ce qui lui valait parfois quelques remontrances de
la part des femmes, qui préféraient les discussions plus rationnelles. Néanmoins, il était rapidement pardonné lorsqu’il dégainait ce sourire charmeur qu’il maîtrisait à la perfection.
Flic de terrain depuis presque trente ans, il avait été promu commandant depuis peu et placé à la tête des dix-huit fonctionnaires qui composaient la brigade des Stups de l’antenne PJ. Quand il regardait par-dessus son épaule, ses premières années dans cette administration – qui n’avait cessé de changer au fil des décennies – lui revenaient invariablement en mémoire. Certains étaient convaincus que cette évolution était nécessaire pour qu’elle puisse avancer. Mais, lorsqu’il y songeait, il se disait qu’il ne s’agissait là que de paroles de décideurs – ceux qui ne connaissaient le métier qu’à travers une multitude de comptes rendus, qu’ils se contentaient de lire sans n’avoir jamais mis un pied dans un commissariat. Une bande d’énarques et de hauts fonctionnaires persuadés de posséder le savoir, mais qui étaient bien loin de la vérité. Puis il y avait les autres, fort heureusement plus nombreux : les bosseurs, ceux qui osaient prendre les risques pour l’amour du métier, dynamisés par les poussées d’adrénaline. Les hommes qui jouaient parfois avec le feu pour sortir une belle
affaire, flirtant régulièrement avec le fil du rasoir, et qui, à tout moment, pouvaient se retrouver entre les griffes d’un juge tatillon sur une simple dénonciation calomnieuse.
Au cours des trois décennies qu’il avait passé au sein du ministère de l’Intérieur, Pierre Risso n’avait travaillé qu’au sein de groupes de police judiciaire. Dans les années 1980, alors qu’il officiait dans les bureaux de la 2e DPJ* – où il avait eu le loisir de faire ses premières armes –, le banditisme avait le vent en poupe, et les braquages de fourgons ainsi que
les homicides qui en découlaient trop souvent étaient en constante augmentation. Comme tous les flics à l’époque, il avait appris sur le tas, les mains dans le cambouis, et parfois avec
la boule au ventre. Après un temps passé dans ce service et seulement deux demandes, il avait réussi à intégrer les murs du fameux 36.
Ce lieu mythique du quai des Orfèvres, à un jet de pierre de la Seine, était une construction sans âge dont il n’oublierait jamais l’étroitesse des couloirs, l’escalier tortueux et la multitude d’odeurs qui s’en dégageaient. Dans cet antre du savoir-faire policier, il avait offert la majeure
partie de ses journées, le plus souvent suivies de nuits à n’en plus finir. Après quelques années, qu’il considérait encore comme les plus passionnantes et enrichissantes de sa carrière, la grisaille omniprésente de la capitale avait commencé à lui peser. Il était enfin temps qu’il rentre au bercail. Quelques mois plus tard, il rejoignait la Côte d’Azur. À Nice, ville de son enfance, l’antenne PJ l’avait accueilli.
Était ensuite venue l’heure de la réflexion. Le souhait de fonder une famille dans la quiétude de cette région envoûtante lui avait bien sûr traversé l’esprit. Sa vie parisienne trépidante et envahissante ne lui en ayant jamais laissé l’opportunité, il avait pensé qu’il y parviendrait peut-être ici. Seulement, à son grand désarroi, les dossiers à l’antenne n’avaient pas manqué et, à près de cinquante ans, il se disait qu’il n’avait jamais eu le temps de rien. Qu’il avait subi ce demi-siècle comme on vivait un rêve éveillé et que celui-ci l’avait dévoré jusqu’à la moelle.
Durant toute sa carrière, la police judiciaire avait été son unique maîtresse. Les femmes qu’il avait côtoyées n’avaient pas tenu face à celle-ci. Mais aujourd’hui, il prenait conscience de toute l’ingratitude que pouvait manifester cette difficile compagne. Aujourd’hui, il se disait qu’avec elle, ce serait un divorce à l’amiable.
Celle à qui il avait tant donné se mourait à petit feu, doucement assassinée par d’aberrantes réformes visant à encore mieux protéger les délinquants. Ayant toujours pris son métier à cœur, Pierre ne voulait pas assister à l’agonie de sa maîtresse.
Il ne se faisait plus d’illusions quant à son rôle dans la lutte contre le trafic de stupéfiants depuis belle lurette. Le mieux qu’il pouvait espérer, et ce pour quoi il se levait encore chaque matin, c’était que son travail puisse compliquer un peu la tâche des trafiquants. À l’étage, des dossiers étaient en cours – certains depuis plusieurs mois, d’autres tout juste lancés. Des magistrats avaient été sollicités, des juges saisis. Dans le service, de nombreux collègues étaient à pied d’œuvre. L’ensemble des enquêteurs de sa brigade, jeunes et moins jeunes, étaient volontaires et déterminés. Inconsciemment, il les admirait. Malgré les embûches et les coups bas, ils continuaient à travailler comme si de rien n’était, multipliant les heures de présence, de jour comme de nuit, week-end compris, sans jamais se plaindre. Peut-être que, grâce à eux, tout ne serait pas définitivement perdu.
Après avoir accroché son blouson à la patère, il prit place derrière son bureau. La machine à café venait de distiller un petit noir qu’il remuait inconsciemment à l’aide d’une cuillère en plastique. À cette heure matinale, il pouvait tranquillement prendre connaissance des
affaires du week-end, des télex importants ou moins urgents, et se pencher sur son courrier sans être dérangé.
De l’autre côté de sa table, son regard se posa sur une enveloppe, appuyée contre son parapheur et à laquelle il n’avait jusqu’alors pas prêté attention. Sur celle-ci était mentionné : Police judiciaire de Nice, Brigade des stupéfiants, à l’attention de Pierre, rue de Roquebillière 06000 Nice.
Se trouvant être le seul Pierre à l’étage, il lui sembla logique qu’elle ait été placée là. Son visage se renfrogna.
— Encore des accusations à la con, rumina-t-il en terminant son café.
Le genre de missives inintéressantes au possible que son service recevait deux ou trois fois par an. En
creusant un peu, on pouvait s’apercevoir qu’elles étaient le plus souvent relatives à des problèmes de voisinage ou familiaux. Untel dénonçait anonymement le gars du troisième en signalant des odeurs bizarres sur son palier. Certaines provenaient de parents désirant se débarrasser d’un beau-fils un peu trop typé junkie. La plupart du temps, dès les premières surveillances, les enquêteurs ne pouvaient que constater l’absence d’un quelconque trafic. Le gendre mal aimé ou le voisin tapageur étaient, au pire, de simples consommateurs dont tout le monde se fichait éperdument. Il y avait bien longtemps que les fumeurs de cannabis étaient tolérés.
Pierre décacheta l’enveloppe, persuadé que son contenu finirait, comme tant d’autres, au parquet de corbeille*. Cependant, un détail avait éveillé son intérêt : le tampon indiquait qu’elle avait été postée à l’aéroport de Malaga. Qui pouvait bien lui écrire du sud profond de l’Espagne ? Et pour dénoncer quoi ?
Dès les premières lignes, son auteure attisa sa curiosité. Une écriture claire aux formes arrondies. Un courrier rédigé avec soin, qui différait des missives habituelles – celles aux phrases hachées et criblées de fautes d’orthographe. Ses yeux cherchèrent une signature et Pierre retourna la feuille. En bas de celle-ci, le prénom Valérie était mentionné.
Calmement, faisant son possible pour rester concentré, il reprit sa lecture depuis le début. Malgré ses efforts, son esprit essayait de s’échapper. De lointains souvenirs remontaient à la surface. Se pouvait-il que ce soit elle ?
Avec son point final, le contenu lui certifiait que c’était le cas, et certaines phrases avaient fait disparaître ses derniers doutes. Pierre reposa la feuille sur son clavier. Son regard se
perdit dans un coin de la pièce. Valérie lui demandait de l’aide. Après toutes ces années, elle osait même lui dire avoir quelquefois pensé à lui. Rien que ça ! Heureusement qu’elle n’avait pas écrit souvent ! Quinze ans sans aucune nouvelle ! Comment la croire ? Devait-il seulement se permettre de le faire ? Après cette coupure, comment pouvait-il vouloir assister quelqu’un qu’il ne connaissait plus ? Cela dit, les renseignements amplement détaillés qu’elle produisait ne pouvaient être inventés : ils étaient bien trop précis.
Valérie donnait des noms, des adresses, des quantités, et même quelques dates approximatives. Une rapide recherche sur l’intranet, par pure curiosité, laissa entrevoir qu’il ne faudrait pas beaucoup de temps pour confirmer au moins la moitié des informations fournies. En approfondissant certains passages, une sensation étrange s’instilla en lui. L’une de celles qu’il n’avait plus éprouvées depuis des lustres. Après avoir analysé le contenu de cette lettre, son sens policier se mit en effervescence. Il
sentait qu’à travers cet appel au secours, cette fille, par la proximité qu’elle entretenait avec l’un des principaux acteurs, détenait bien plus que les bribes d’une affaire qui pourrait voir le jour. Et quand il parlait d’affaire, Pierre savait exactement à quoi il associait ce terme. Des mots sur une feuille étaient une chose, la mise en route d’un dossier d’envergure en était une autre. Il fallait qu’il en ait le cœur net. Dans un coin, Valérie avait inscrit un numéro de portable.
— Un coup de fil n’engage à rien, fit Pierre en décrochant le combiné de son téléphone.