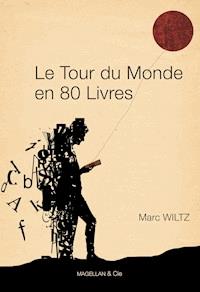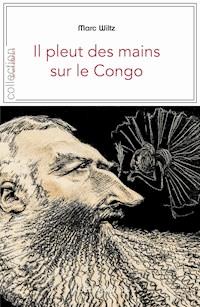
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Vivre ailleurs, s'installer durablement et changer de perspectives : des récits d’écrivains contemporains sur cette expérience fantasmée et vécue, faite d'émotions et de résonances.
Pourquoi tous ces morts au beau milieu de l’Afrique coloniale ? Pourquoi cet oubli incompréhensible ? Ce silence, que rien ou si peu ne vient troubler ? Les faits, pourtant historiques, se sont déroulés au vu et au su de tous, décidés en plein cœur de l’Europe consciente, documentée, active. Tout a été écrit, lu, dénoncé, prouvé, argumenté. À aucun moment, il n’a été possible de l’ignorer, même par courtoisie. Mais comme par un enchantement diabolique, les morts du Congo, victimes de Léopold II roi des Belges, ont disparu sans laisser de traces. Ils se sont littéralement volatilisés. Pas une ligne dans les livres d’histoire. Aucun souvenir dans la mémoire des peuples. Pas de résurgences en ces temps de repentance. À croire que l’existence même de ce crime de masse, qui a précédé tous les autres, est sujette à caution.
On parle aujourd’hui de dix millions de morts et disparus entre 1885 et 1908, soit le tiers de la population concernée. Sans compter les mutilés, impossibles à dénombrer. Dix millions, victimes de la cupidité d’un seul. A-t-on déjà vu cela dans notre époque « moderne » où pourtant les exemples ne manquent pas ?
« Le plus grand crime de tous les temps. » (Arthur Conan Doyle, 1909)
EXTRAIT
Le fleuve Congo, avec ses alentours impénétrables, est resté longtemps un mystère. Autour de lui s’étalait une large tache blanche sur les cartes du monde telles que les géographes les remplissaient de lignes et de contours de plus en plus précis. Et longtemps, cette grande région est restée inaccessible aux yeux des hommes, l’une des dernières, une de celles qui faisaient rêver le futur Joseph Conrad quand il était petit et qu’il pointait le doigt sur ces endroits supposés vierges en disant : « Quand je serai grand, j’irai là ! » Il a tenu parole. D’autres avant lui s’y sont risqués. Nombreux.
D’abord un Portugais, en 1680, Duarte Lopez, précurseur comme tous ses concitoyens de la découverte occidentale du monde ; un autre Portugais, encore, avait traîné dans les parages dès 1482, mais il ne s’était pas attardé, ce qui n’a pas empêché son pays de revendiquer une supposée antériorité de « propriété ».
Joseph Conrad, Mark Twain, Conan Doyle, Roger Casement, Edmund Dene Morel et beaucoup d’autres ont dénoncé ces forfaits à l’époque même où ils se déroulaient. Sur leurs pas, restituant le contexte et les témoignages, Marc Wiltz s’interroge sur cette disparition insensée…
A PROPOS DE L’AUTEUR
Né le 12 septembre 1961 à Saint-Mandé, Marc Wiltz a passé toute son enfance au Havre jusqu'à 22 ans. Diplômé de l'ESC du Havre 1983 (qui lui a appris à gérer des budgets), Marc Wiltz essaye le théâtre, la radio (Porte Océane au Havre), l'édition (Petit Futé en 1983) et un stage de deuxième année à la maison de la Culture (Le Volcan au Havre). Puis il travaille chez IBM, passe deux ans en Afrique, avant de devenir gestionnaire de studios de tournage de cinéma pendant 4 ans.
Marc Wiltz a toujours eu deux passions dans l'existence : les livres et les voyages, ce qui l'a amené à créer MAGELLAN & Cie en 1999 pour les conjuguer. Cette maison d'édition compte aujourd'hui 250 titres au catalogue, pour beaucoup d'entre eux basés sur un montage « cinéma » comme l'éditeur aime à le rappeler, c'est-à-dire en cherchant à trouver l'équivalent des avances sur recettes...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cartedu Congo Belge, début du XXe siècle.
Double page ci-dessus : lithographie à la gloire du Congo de Léopold, en 1891.
AVANT-PROPOS
Pourquoi tous ces morts au beau milieu de l’Afrique coloniale ? Pourquoi cet oubli incompréhensible ? Ce silence, que rien ou si peu ne vient troubler ? Les faits, pourtant historiques, se sont déroulés au vu et au su de tous, décidés en plein cœur de l’Europe consciente, documentée, active. Tout a été écrit, lu, dénoncé, prouvé, argumenté. À aucun moment, il n’a été possible de l’ignorer, même par courtoisie. Mais comme par un enchantement diabolique, les morts du Congo, victimes de Léopold II roi des Belges, ont disparu sans laisser de traces. Ils se sont littéralement volatilisés. Pas une ligne dans les livres d’histoire. Aucun souvenir dans la mémoire des peuples. Pas de résurgences en ces temps de repentance. À croire que l’existence même de ce crime de masse, qui a précédé tous les autres, est sujette à caution.
On parle aujourd’hui de dix millions de morts et disparus entre 1885 et 1908, soit le tiers de la population concernée. Sans compter les mutilés, impossibles à dénombrer. Dix millions, victimes de la cupidité d’un seul. A-t-on déjà vu cela dans notre époque « moderne » où pourtant les exemples ne manquent pas ? On connaît Hitler et Mussolini. On a aimé un temps en Occident la nouvelle impulsion initiée par Mao, en pleine concurrence meurtrière avec les déplacements de populations ordonnés par Staline, autrement appelé le « petit père des peuples ». On redécouvre le génocide arménien, que les Turcs contestent encore avec vigueur. On a subi plus récemment les Khmers rouges de Pol Pot au Cambodge (trois millions de morts et disparus) et l’épouvante du Rwanda avec les massacres au coupe-coupe entre les Hutus et les Tutsis. Et d’autres carnages ailleurs. On dispose de tous les chiffres de ces foisonnements du sang des innocents, de ces geysers rouges en forme de feux d’artifice. On a même reconnu, et presque admis, que le grand Empire américain s’est forgé dans le sang des Indiens, jusqu’à les exclure définitivement de leur territoire légitime en un siècle à peu près – un record sur une géographie aussi vaste –, exterminant au passage treize millions d’individus libres et égaux en droit. Dans ces grands chambardements criminels, il y avait les aiguillons de la politique, de la volonté de puissance, avec la ferveur d’une « religion » du dépassement de soi. On a subi cette époque cruelle, violente, incroyablement violente. C’est notre époque, avec laquelle on compose, qu’on essaye de comprendre, souvent de justifier. Quelques-uns tentent de passer outre pour lui redonner des couleurs d’humanité. C’est tout à leur honneur car la tâche est bien lourde. Ces leaders couverts de sang ont tous voulu mener les hommes. Mais vouloir prendre en charge la destinée d’autrui, si l’on n’est pas animé d’une vraie générosité et d’une abnégation intrinsèque, est une folie.
Tous les grands criminels qui ont pris cette responsabilité ont réussi par leur hargne à mobiliser les foules, à les séduire, à leur faire exécuter les pires exactions au nom d’un intérêt supérieur. Le temps et quelques hommes et femmes de meilleure conscience ont fini par en triompher. Le temps surtout. Celui de passer à autre chose parce que la roue avait tourné. Mais quelle violence ! Quel aveuglement général lorsqu’une affaire pareille s’empare d’une population pour des années, marquant son histoire de façon indélébile et imprégnant les comportements !
Dans le cas du Congo, on parle de dix millions de morts, mais personne ne s’en soucie vraiment. Il n’y a pas eu de commissions d’enquête dignes de ce nom ou de repentir. Il n’y a presque pas de conscience de cette tragédie. Il n’y est jamais fait allusion pour servir d’exemple ou de référence dans les débats nombreux où la barbarie est évoquée. La chose a glissé et rien ne reste. Dix millions. Le chiffre est considérable et se situe en bonne place dans le palmarès de cette modernité sanguinaire. Il est le fait d’un seul, sans une goutte de sang sur ses mains restées propres, laissant agir cette invraisemblable cupidité, transmise, démultipliée et lui rendant compte. Dix millions demorts pour le caoutchouc du Congo, en vingt ans, pour amasser une énorme fortune personnelle. Sans compter les mains coupées et les très seyants colliers d’oreilles. Dix millions de morts sur la conscience de Léopold II, roi des Belges.
En fait, on ne connaît pas précisément le nombre de ces morts et on ne le connaîtra jamais. On a juste une idée approximative de l’ampleur du phénomène. Les plus « conservateurs » sur ce point, les « minimalistes » qui défendent la couronne par principe ou par éducation, parlent de quelques centaines de milliers, ce qui est déjà considérable. D’autres ont poussé l’extrême jusqu’à trente millions, en se basant sur les estimations de populations réalisées par Stanley, l’explorateur prestigieux qui avait compté ces indigènes. Ils étaient venus le voir et l’admirer pendant sa descente du fleuve Congo entre 1874 et 1877. Il a extrapolé, pensant avec sincérité que le pays comptait alors au moins quarante millions d’habitants, mais sans vraiment tenir compte du fait que les forêts profondes sont nécessairement moins peuplées. Ses premiers détracteurs se sont emparés de ses propres chiffres pour mieux le discréditer. D’autres chiffres, plus réalistes, parlent d’une population de vingt-sept millions d’habitants. Mais il n’y a pas eu de recensement. Le rapport Casement de 1904 évoque des centaines de milliers de morts. Un autre expert de la même époque en mentionne cinq millions. L’historien américain contemporain Adam Hochschild en comptabilise dix, et c’est peut-être ce chiffre inouï le plus vraisemblable. Les encyclopédies modernes, avec leurs innombrables sujets traités par des spécialistes, situent le chiffre astronomique de la perte de population entre huit et trente millions de personnes, histoire de ratisser large et de couvrir la marge d’erreur. Alors dix millions, pourquoi pas ? Les derniers chiffres avancés sont inférieurs. Admettons. Divisons même par deux ou par dix ces données aléatoires : le résultat reste démesuré, la cruauté des méthodes employées par l’administration de l’« État indépendant du Congo » est indigne.
Par contre, il n’est guère possible d’entendre ceux qui disent que Léopold n’a pas été informé des exactions commises en son nom, citant pour cela sa correspondance : « S’il y a des abus au Congo, nous devons les faire cesser. S’ils se perpétuaient, ce serait la fin de l’État » (lettre du 13 septembre 1896). Ou bien : « Il faut réprimer énergiquement les horribles abus qui ont été relevés. Il faut que ces horreurs finissent ou je me retirerai du Congo. Je ne me laisserai éclabousser ni de sang, ni de boue et il faut que ces turpitudes cessent » (lettre du 17 janvier 1899). Ces lettres et d’autres écrits prouvent au contraire qu’il était précisément au courant. Fanatique de la presse britannique, il attendait fébrilement les quotidiens qu’on lui apportait chaque matin, les lisait avec avidité et ne pouvait donc rien ignorer. Il avait simplement la capacité de masquer son crime jusqu’à le faire passer pour des élucubrations de pisse-copies. Jusqu’à l’oubli.
Je ne savais rien de cette histoire avant d’y entrer à petits pas. L’opinion publique belge l’ignore encore dans sa grande majorité, ou préfère la minimiser et fermer les yeux. Cent ans plus tard, que peuvent en penser les premiers concernés, les Congolais eux-mêmes ? Une fois sortis de cette barbarie dans laquelle ont disparu toutes les structures traditionnelles d’organisation, tous les chefs, tous les hommes les plus forts, toutes les femmes les plus habiles et une bonne partie des richesses naturelles du plus grand pays d’Afrique noire, que peut-on décemment attendre des héritiers de ce massacre ? Peut-on imaginer qu’ils soient en mesure de reconstruire un pays stable dans lequel puissent exister des valeurs « humanistes » ? La dévastation est telle qu’elle laisse peu d’espoir. Lors de l’indépendance du pays, la population en croissance continue était de l’ordre de douze millions d’habitants. Patrice Lumumba, premier Premier ministre de la nouvelle République indépendante du Congo pendant trois mois, de juin à septembre 1960, s’est exclamé : « Nous avons connu que la loi n’était jamais la même selon qu’il s’agissait d’un Blanc ou d’un Noir : accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Tout cela, mes frères, est désormais fini ! » Peut-on lui donner tort, même si le temps de la décolonisation réelle et celui de la transmission effective des pouvoirs aux autochtones sont plus longs et plus ardus que le temps d’un discours enflammé à la tribune ? Le jeune Lumumba a été l’un des rares Congolais à bénéficier des prémisses de l’éducation « pour tous » voulue par le roi Baudouin, l’un des successeurs de Léopold ; il a cru au début à « l’œuvre géniale » du roi des Belges, au point d’écrire ces mots lui-même, tels qu’on les lui avait appris, avant que sa curiosité le pousse dans les pages de l’Histoire, puis de la politique. De libéral pro-belge, il est devenu nettement et définitivement indépendantiste. Comme d’autres, il paiera de sa vie son impatience légitime, assassiné en janvier 1961 par les services secrets belges, avec l’aide de la CIA, quand le chaos s’installait dans le pays. Il avait trente-cinq ans. Le texte intégral de son discours, qui a tellement choqué les autorités bientôt ex-coloniales présentes dans l’auditoire, est pourtant mesuré, voire doux. Il demande sans violence l’exercice du pouvoir par les Congolais eux-mêmes. Rien d’autre.
Quel que soit le chiffre réel que l’histoire finira par figer dans ses livres, il s’agit bien là d’un génocide, d’un démocide, d’un ethnocide, d’un multi-ethnocide exercé à l’encontre de quatre cents peuples différents, rassemblés sur le cours du fleuve Congo. C’est la destruction à grande échelle de populations innocentes, en dehors de toute guerre, et c’est le premier « génocide » européen avéré. Le terme le plus approprié pour qualifier ces actes importe peu, même si d’aucuns réfutent l’emploi de ce mot-là, expliquant qu’il n’est pas justifié dans cette situation. C’est le cas de David Van Reybrouck, dans son monumental Congo, une histoire (2012), document qui retrace sur huit cent cinquante pages l’histoire de cette région depuis les premiers âges jusqu’à aujourd’hui. La véritable surprise concernant la période plus restreinte liée à Léopold est l’ignorance dans laquelle, volontairement ou non, l’opinion publique se tient depuis si longtemps, alors que tout est connu depuis le premier jour.
Mes seules passions, devenues ma raison de vivre depuis vingt ans, sont le goût des voyages et le goût des livres. Je suis toujours admiratif de ces quelques individus capables de mettre un pied devant l’autre pour aller au bout du monde, à la rencontre de leurs rêves. Henry Morton Stanley, l’un des plus incontestables « découvreurs » de l’Afrique, a éveillé ma curiosité. J’en ai publié une biographie signée Adolphe Burdo, initialement parue en 1888. J’ai republié aussi son récit original (1872) de la recherche du docteur Livingstone, perdu en pleine brousse, et raison première de sa présence sur le continent noir. Puis le sujet s’est élargi. Des bruits alentour ont commencé à résonner. De nombreuses sources disponibles ont étanché mes interrogations sur des points précis, troublants jusqu’à l’insensé. Des écrivains se sont exprimés à l’époque pour en parler à haute et intelligible voix. Je les crois, eux, parce qu’ils sont capables de dire les hésitations d’un individu, de reconstituer une chair avec ses faiblesses, d’inscrire des états d’âme dans une longueur de temps. Ce sont les seuls de tous les analystes en mesure de faire ça, et malgré d’inévitables erreurs, leur rigueur et leur modestie tissent une vérité d’homme. Quand plusieurs, d’une telle qualité, le font ensemble, le doute n’est plus permis parce que la réalité dépasse la fiction. Il ne s’agit pas ici d’un procès de la colonisation, qui serait confortablement intenté a posteriori du haut d’une exigence morale à la petite semaine. Il s’agit seulement de remettre en lumière les témoignages concordants sur une période, des lieux et des gens. Peu à peu, ceux qui en ont parlé m’ont ouvert les yeux. Je les ai suivis, fébrilement, étonné par cette progression dans la douleur. J’ai rassemblé les faits qu’ils mentionnaient, les contextes qu’ils décrivaient et les impressions qu’ils m’ont laissées. La plus déroutante est le sentiment d’assister au concert émouvant qu’ils semblent donner parce que leurs textes se répondent et vibrent plus fort de leur proximité. Dans le cas du Congo, dans l’espace-temps assez bref qui court de 1885 à 1908, les écrivains qui sont intervenus l’ont fait avec vigueur. Ils ont dit leur effarement devant ce qui dépasse de loin la vie d’un explorateur de brousse, fut-il aussi intrépide que Stanley. Pourtant, leurs voix réunies n’ont pas atteint la conscience collective de manière durable. L’affaire était connue, certes, mais déjà oubliée. Comme si le nom du plus grand explorateur de son temps la protégeait définitivement de la révélation, au sens quasi biblique du terme. Mais les convoitises nées du Congo outrepassent cet homme de mille coudées ; il n’a fait qu’ouvrir la porte de l’Enfer. Elles sont le symbole d’une époque où tout bascule de façon officielle.
Même avec un goût prononcé pour tout ce qui agite la surface du monde, soucieux de la précision des faits, et méfiant de toutes les interprétations tardives, je ne suis pas historien et n’y prétends pas. Les spécialistes qui se sont déjà exprimés trouveront sûrement à redire sur des dates, des lieux ou des noms que, malgré le soin que j’ai apporté à les vérifier, il conviendrait de corriger. Mais je sais que toute l’histoire qui suit, terrible, replongée dans son environnement initial, est au moins véridique.
À titre personnel, je n’ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Je suis resté longtemps ignorant, malgré mon intérêt pour la géographie et la littérature qu’elle suscite. Dans ces pages, chacun des acteurs et des observateurs directs du drame s’exprime avec ferveur, avec engagement, avec sincérité, selon son tempérament : Henry Morton Stanley, les participants de la conférence de Berlin en 1885, le révérend américain Williams, Roger Casement, Joseph Conrad, Edmund Dene Morel, Mark Twain, Pierre Savorgnan de Brazza et Conan Doyle. Ils ont vécu la période, l’ont façonnée et en ont rendu compte avec exactitude, dans l’instant même où les faits se déroulaient, sous l’ombre des agissements d’un roi d’Europe.
Pour donner plus de corps à cette impressionnante galerie de portraits, d’autres s’y joignent avec un peu de recul, des années 1920 à nos jours : André Gide, Georges Simenon, Jules Marchal, Adam Hochschild, Emmanuel Dongala, Guillaume Jan, Éric Vuillard, Patrick Deville, Mario Vargas LLosa et David van Reybrouck. Il en manque, bien sûr, et des écrivains congolais en particulier. Une littérature contemporaine de premier plan émerge avec Alain Mabanckou ou Koli Jean Bofane, issus des deux rives opposées du fleuve. Mais ils figurent ailleurs, en exhaustivité. Le propos de ce livre est de montrer que tout était su dès le premier jour, comme à chaque fois que l’Histoire balbutie.
Henry Morton Stanley en 1872.
- 1 -STANLEY L’INCREVABLE
Le fleuve Congo, avec ses alentours impénétrables, est resté longtemps un mystère. Autour de lui s’étalait une large tache blanche sur les cartes du monde telles que les géographes les remplissaient de lignes et de contours de plus en plus précis. Et longtemps, cette grande région est restée inaccessible aux yeux des hommes, l’une des dernières, une de celles qui faisaient rêver le futur Joseph Conrad quand il était petit et qu’il pointait le doigt sur ces endroits supposés vierges en disant : « Quand je serai grand, j’irai là ! » Il a tenu parole. D’autres avant lui s’y sont risqués. Nombreux. D’abord un Portugais, en 1680, Duarte Lopez, précurseur comme tous ses concitoyens de la découverte occidentale du monde ; un autre Portugais, encore, avait traîné dans les parages dès 1482, mais il ne s’était pas attardé, ce qui n’a pas empêché son pays de revendiquer une supposée antériorité de « propriété ». Surtout, il y a eu le plus fameux d’entre eux, le mythe, la figure blanche du noir Congo, le journaliste américain Henry Morton Stanley (1841-1904), qui va en percer le mystère et accomplir l’une des plus phénoménales expéditions de tous les temps. Beaucoup s’étaient déjà essayé à la remontée du fleuve, en partant de l’embouchure sur l’Atlantique parce que son estuaire est séduisant, propice aux esprits aventureux. Chacun s’imaginait que quelques coups de pagaie et une bonne organisation suffiraient à dévoiler tous les secrets de cette impressionnantes voie d’eau. Le défi est devenu une passion partagée. Pénétrer la forêt aux arbres immenses qui l’enserre, qui dissimule aux regards cette foule d’animaux sauvages dont on entend les murmures, les chants et les cris étouffés, séduit les plus intrépides aussi sûrement que le chant des sirènes. Les tentatives sont nombreuses, pleines d’espoir. Plusieurs semblent réussir puisque les premiers kilomètres sont remontés sans trop de difficultés. Mais, à chaque fois, l’entreprenant navigateur se heurte au même mur infranchissable, à cette avalanche d’eau et de végétation. La porte du Congo ne livre aucun indice. L’eau charrie les cadavres des plus obstinés. Tous échouent et finissent par renoncer : les chutes et les rapides situés à cent soixante kilomètres de l’embouchure sont tellement puissants qu’ils ne laissent aucun passage apparent ; et les terrains proches qui auraient permis de les contourner sont impraticables. Les accidents fréquents calment les ardeurs. Les mauvaises rencontres avec des indigènes belliqueux et sauvages, peut-être cannibales, refroidissent les plus hardis et nourrissent les fantasmes, à défaut d’autre chose. Les maladies tropicales, inconnues pour la plupart et donc sans remèdes, affaiblissent les plus forts et achèvent les autres. La limite atteinte la plus à l’est, les vertigineux rapides qui font rebrousser chemin à toutes les expéditions les mieux équipées, s’appelle le « chaudron de l’Enfer » ! Ce mur bouillonnant d’eau se refuse aux audacieux, et la tache reste invariablement blanche sur les cartes du monde connu.
Comme souvent, c’est dans le renversement de perspectives que la réussite s’est manifestée. Non sans mal. Parti des États-Unis, un jeune journaliste a mis au défi son rédacteur en chef de retrouver le célèbre explorateur anglais David Livingstone, dont on est sans nouvelles depuis qu’il est parti en 1865 à la recherche des sources du Nil. C’est l’attrait du scoop, le goût de l’aventure, l’inconscience de la jeunesse qui poussent ce garçon sans attaches. Né au pays de Galles en 1841, mais sans véritable famille, enfant travailleur sur le port de Liverpool à douze ans, mousse débarquant à La Nouvelle-Orléans à dix-huit ans, soldat sudiste, puis nordiste, pendant la guerre de Sécession, changeant son nom pour prendre celui de Stanley, marin au long cours qui s’est déjà rendu en Asie mineure et en Abyssinie, le jeune Henry a tout juste vingt-sept ans quand il pénètre dans le bureau de son patron au New York Herald, où il est maintenant correspondant de presse. Celui-ci accepte de financer une expédition en Afrique pour retrouver le fameux docteur. En janvier 1871, Stanley part de Zanzibar, sur la côte est de l’Afrique, à la tête d’une colonne qui compte presque deux cents personnes. Il s’enfonce en Afrique centrale. Il retrouve Livingstone en novembre sur les rives du lac Tanganyika après des péripéties sans nombre, et lui adresse son fameux salut : « Docteur Livingstone, I presume ? », que la postérité a retenu. L’impact est énorme, la célébrité lui tombe dessus comme une pluie d’orage, on ne parle plus que de cet exploit. Mais Livingstone refuse de rentrer. Il est mieux là où il est. Déjà malade et toujours obsédé par les sources introuvables du plus grand fleuve du monde, il meurt de dysenterie en 1873. Pour Stanley, la vie a pris désormais un autre sens et l’Afrique ne le lâchera plus. En 1874, il monte une nouvelle expédition et entreprend l’exploration du cours du fleuve Congo, toujours inconnu. Il gagne le lac Victoria, parcourt l’Ouganda, explore le lac Tanganyika. Il s’arrête longuement au bord d’un autre lac qu’il nomme le « Stanley Pool », sur les rives duquel seront fondées plus tard Léopoldville (Kinshasa) et Brazzaville et, après trois années d’un voyage épique en pleine jungle, il émerge enfin près de l’embouchure en 1877, au comptoir commercial de Boma, en ayant tout bonnement contourné la région inaccessible des cascades. Après le lieutenant Verney Lovett Cameron en 1875, c’est le premier homme à traverser l’Afrique d’est en ouest. De cette expédition qui a compté jusqu’àtrois cent cinquante hommes, il est le seul survivant blanc. Autant dire une légende. Et c’est bien ainsi qu’il est accueilli à son retour en Europe en 1878. Il a trente-sept ans et il vient de mettre un terme à l’un des derniers mystères de la découverte du continent.
Ses articles dans la presse, les interviews qu’il donne, son livre Through the Dark Continent et ses conférences déchaînent tous les enthousiasmes, qui eux-mêmes nourrissent le sien puisqu’il veut maintenant « capitaliser » sur sa réussite. Il est persuadé que le gigantesque territoire parcouru est immensément riche d’opportunités commerciales et que les lumières de l’Occident doivent l’éclairer sans plus tarder. Il estime que l’éclat de sa notoriété et son prestige vont lui ouvrir toutes les portes sans efforts et que les financiers mettront vite la main à la poche. Sensible aux honneurs qui croulent sur ses épaules, il est tout de même déçu parce que rien ne se passe. Les joies, les sourires, les admirations, les yeux mouillés de tous ceux qui l’approchent pour le féliciter ne sont que le résultat de ses actions précédentes. Ils restent à la surface de ses envies profondes, sans ouvrir d’autres voies possibles vers ses projets immédiats. À titre personnel, il est réconforté, ému parfois, mais son cœur endurci ne laisse pas beaucoup de place aux débordements des sentiments, aux effusions fugaces même si elles sont sincères. Sa vie rude, où la mort est une compagne envahissante, le pousse à aller à l’essentiel. Il veut du concret, et repartir. Il n’ignore