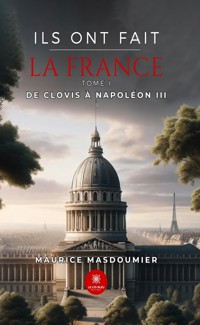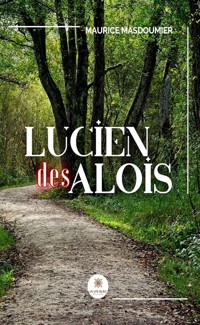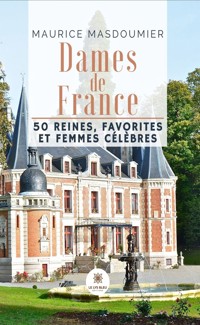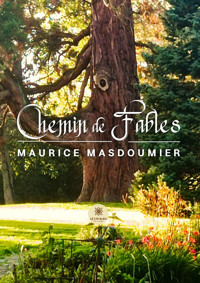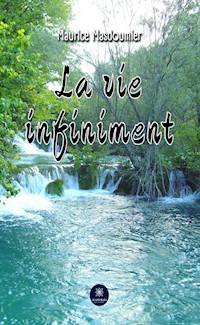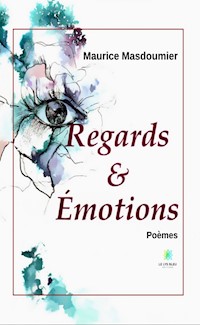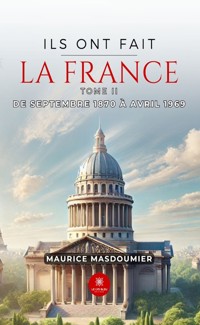
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ils ont fait la France
- Sprache: Französisch
De la chute du Second Empire à la présidence de Charles de Gaulle, ce second tome explore près d’un siècle d’histoire française en mettant en lumière les figures emblématiques qui ont façonné le pays. Politiciens, scientifiques, inventeurs et entrepreneurs se succèdent, animés par une même quête de progrès et d’innovation. À travers cette galerie de portraits finement esquissés, découvrez les ambitions, les triomphes, mais aussi les échecs de ceux qui ont marqué leur époque et laissé une empreinte durable sur l’histoire de la France.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alliant son attachement au terroir à une carrière réussie dans l’industrie,
Maurice Masdoumier déploie sa plume depuis son adolescence. Il explore divers genres tels que la poésie, les fables et la recherche factuelle, tout en étant romancier, conteur et amateur d’histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Masdoumier
Ils ont fait la France
Tome II
De septembre 1870 à avril 1969
© Lys Bleu Éditions – Maurice Masdoumier
ISBN : 979-10-422-6337-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Note de l’auteur
Après un règne de fortes transformations pour la France, Napoléon III termine tristement son passage à la tête du pays. Comme son oncle, il est emporté par la défaite militaire.
Cependant, il a doté le pays d’atouts formidables qui vont lui permettre de traverser les décennies futures avec des forces indiscutables.
Jusqu’à Charles de Gaulle, il n’y aura pas de grandes figures à la tête du pays, mais l’élan est là et nous allons rencontrer des personnalités qui vont porter le progrès et l’innovation et faire rayonner la France.
J’ai tenté d’être le plus large possible dans mes choix de portraits, mais j’ai conscience d’en avoir oublié, ce n’est pas par mépris et le lecteur pourra compléter mon énumération par ses propres recherches.
J’ai considéré qu’à partir de 1968 je risquais de ne plus être objectif, car la France est entrée dans l’Histoire contemporaine et que mon vécu et mes propres pensées ne pouvaient interférer avec l’Histoire de cette France que je respecte et que j’aime tant.
Peut-être faudra-t-il un jour se pencher sur ces temps.
La chute de l’Empire
À l’annonce de la défaite, avec Napoléon III prisonnier, les républicains parisiens organisent une sorte de prise de pouvoir en réclamant « la déchéance » de l’Empire.
Edmond de Goncourt décrit dans son journal la réaction des Parisiens à l’annonce de la défaite de Sedan : qui pourra peindre l’abattement des visages, l’assaut des kiosques, la triple ligne de liseurs de journaux devant tout bec de gaz ? Puis la clameur grondante de la multitude, en qui succède la colère à la stupéfaction, et des bandes parcourant le boulevard en criant « La déchéance ! ».
Léon Gambetta et Jules Favre sont les animateurs de cette réaction populaire.
Le Palais Bourbon est envahi.
L’impératrice qui réussira à s’échapper des Tuileries prend le chemin de l’exil.
Le 4 septembre dans l’après-midi, Gambetta, Favre et les députés républicains entraînent la foule à l’Hôtel de Ville.
Gambetta lit un texte manuscrit rédigé en commun constituant la « proclamation de la République » :
Le peuple a devancé la Chambre qui hésitait. Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République : elle est proclamée, et cette révolution est faite au nom du droit et du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée, demain, vous serez avec l’armée des vengeurs de la Patrie.
Finalement, les événements se déroulent dans un calme relatif, ce qui amènera des remarques de Thiers et Jules Ferry sur les événements : Thiers avoue qu’il n’a jamais vu « de révolution accomplie plus aisément et avec moins de frais » et, selon Jules Ferry, « jamais révolution ne se fit avec une telle douceur ».
Mais c’est une République bien fragile qui est en place, et elle va balbutier jusqu’en 1880, même si la France et son peuple font preuve de courage face à la Prusse.
Dans cette période, la France hésite, ses représentants se querellent, républicains et monarchistes s’opposent.
Mais la guerre n’est pas finie.
Les républicains s’organisent à la hâte et avec des ambitions personnelles de quelques-uns.
Un gouvernement provisoire est formé, dirigé par le général Trochu qui était jusqu’à la défaite le gouverneur militaire de Paris.
Dans ce gouvernement, Jules Favre s’installe aux Affaires étrangères et Léon Gambetta à l’Intérieur.
La France vit dans le chaos et se trouve sous la main de fer de Bismarck qui dès le 19 septembre a fait part de son exigence d’obtenir l’Alsace et la Lorraine pour partie.
Quelques soubresauts vont se produire dans le camp français, mais au prix de nombreux morts et le 18 janvier 1871, Bismarck peut proclamer, dans la galerie des Glaces à Versailles, l’avènement de l’empire allemand.
Le 26 janvier, le gouvernement français accepte l’armistice. Des élections ont lieu pour permettre à un gouvernement légal de signer la paix.
Ce sera fait, non sans avoir vu passer l’épisode sanglant de la Commune de Paris. Le 10 mai 1871 : c’est la signature du traité de Francfort qui voit la France accepter de verser une indemnité de cinq milliards de francs et l’abandon à l’Allemagne de presque toute l’Alsace et de la Lorraine mosellane.
C’est dans ces conditions que démarre cette nouvelle période de notre Histoire.
Scientifiques, entrepreneurs, inventeurs
et architectes
Ferdinand de Lesseps
Né à Versailles en 1805 et mort à La Chesnaye en 1894
Ferdinand, comte de Lesseps, est issu d’une famille de diplomates originaire du Pays basque français, honorablement connue à Bayonne et qui a donné au pays des hommes d’armes et des hommes de loi, dont certains deviennent diplomates.
La famille a été anoblie par Louis XV en 1777.
Ferdinand fait de solides études et devient lui-même diplomate. Sa carrière débute au Consulat général de Lisbonne en 1825.
En 1830, il part au Proche-Orient où il restera jusqu’en 1838, il s’y construit une excellente réputation due à ses actions locales, notamment lors de l’épidémie de peste de 1835 qui met la ville d’Alexandrie en situation de crise, cela lui vaudra la Légion d’honneur.
Il s’implique avec réussite dans la protection des chrétiens en Syrie lors de l’occupation d’Ibrahim Pacha et joue ensuite un rôle fondamental dans la réconciliation du sultan ottoman avec Mehmet Ali, vice-roi d’Égypte.
Par sa proximité avec la famille du monarque et ses talents de cavalier, il se lie d’amitié avec l’un de ses fils, Mohamed Saïd, cela lui servira dans de futurs projets.
Il est alors nommé consul de France à Rotterdam, puis ce sera Malaga pour une courte durée puis Barcelone de 1842 à 1848.
En pleine guerre carliste, il se fait remarquer par sa protection des résidents français, il s’implique également auprès de toutes les populations pour les soutenir et les protéger.
Cette attitude lui vaut la reconnaissance sans limite de la Catalogne.
À Barcelone, une place porte son nom, tout comme l’école française de la ville.
En 1849, il vit des moments difficiles dus à l’installation du Second Empire avec un désaveu à propos de la « République romaine » : il démissionne et quitte le corps diplomatique.
Au même moment, sa femme et son fils décèdent de la scarlatine.
C’est au cours de cette période, précisément en 1854, que son ami Mohamed Saïd qui, suite au décès de son père, est devenu vice-roi d’Égypte et lui demande de le rejoindre pour s’investir dans un projet.
Ce projet est issu des réflexions des saint-simoniens et consiste à relier la mer Rouge à la mer Méditerranée par un canal à travers l’isthme de Suez.
Le projet avait été présenté en 1833 par Prosper Enfantin, le « père » des saint-simoniens, ingénieur et économiste français.
Le monarque lui donne de très gros moyens, mais l’Angleterre est opposée à ce projet et fera tout pour en gêner le lancement tout comme la réalisation.
Il lui est accordé un acte de concession (novembre 1854), puis il crée la Compagnie universelle du canal maritime de Suez.
Pour le financement, il lance un modèle original : il offre au public les actions de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez.
La réalisation est entravée par les Anglais, ce qui provoque des retards, mais il est soutenu fermement par Napoléon III.
Finalement, le canal aboutit, les eaux des deux mers se mélangent le 15 août 1869 et une inauguration fastueuse a lieu le 17 novembre 1869 sous l’égide de l’impératrice Eugénie et en présence de l’empereur François-Joseph d’Autriche.
Ferdinand de Lesseps est au sommet de sa gloire.
Le canal, quant à lui, connaîtra de nombreuses vicissitudes jusqu’à nos jours, mais il est là et c’est un atout majeur pour le commerce maritime.
Ferdinand de Lesseps va ensuite s’intéresser à la création d’un canal dans l’isthme de Panama en 1876.
Il négocie avec la Colombie et fonde une compagnie (1880).
L’idée d’un canal interocéanique remonte à l’époque des conquistadors qui avaient identifié l’isthme de Panama comme le passage le plus étroit en Amérique Centrale.
Charles Quint avait ordonné en 1534 des études pour un canal qui éviterait aux navires espagnols d’avoir à contourner l’Amérique du Sud par le cap Horn.
Pour obtenir la concession Lesseps, trafique les chiffrages et apporte des modifications aux études réalisées : c’est le début de la course à l’échec.
Le coût du projet était estimé, en 1879, à 1200 millions de francs. Lesseps en annonce la moitié et raccourcit la durée du projet de 12 à 8 ans pour faire passer les autorisations.
Un article de Rivages du Monde résume bien cette histoire :
En 1881, les travaux commencent et rencontrent mille embûches : reliefs sous-estimés, patchwork géologique, séisme, problème titanesque des gravats, sans oublier la malaria, la fièvre jaune et les dysenteries qui causeront 6 000 morts.
De nouvelles obligations sont régulièrement émises, mais leur achat s’essouffle.
Devant l’irréalisme du projet initial, les ingénieurs forcent Lesseps, en 1887, à revenir à un projet de canal à écluses.
Mais les banques lâchent la Compagnie qui fait banqueroute en 1888 : 85 000 petits porteurs sont ruinés.
Le « scandale de Panama » éclate peu après, quand la presse révèle que la Compagnie a soudoyé parlementaires et journalistes pour lancer une ultime émission d’obligations.
Parmi les condamnés figurent notamment Lesseps et Eiffel.
La suite de la réalisation du canal sera l’œuvre des Américains.
Le scandale débouchera sur un procès, Lesseps est condamné à 5 ans de prison pour trafic d’influence et détournement de fonds, mais il est dispensé de les effectuer.
Ferdinand de Lesseps meurt à l’âge de 89 ans dans son château de La Chesnaye, à Guilly, dans l’Indre.
Son corps est embaumé, il est inhumé au Père-Lachaise et son sang est placé dans un obélisque au cimetière de Guilly.
Malgré son échec à Panama, il est vénéré et sa réputation comme sa reconnaissance sont universelles :
Grand-croix de la Légion d’honneur en 1869.
Élu à l’Académie des Sciences en 1873.
Élu à l’Académie française le 21 février 1884.
À travers lui, c’est la France qui est reconnue.
Louis Braille
Né le 4 janvier 1809 à Coupvray (Seine-et-Marne)
et mort le 6 janvier 1852 à Paris
Louis Braille est le fils du bourrelier du village fabricant, ceintures, courroies, sacs, rênes…
Dès qu’il le peut, l’enfant va dans l’atelier de son père et s’intéresse au travail, il veut imiter son père, malheureusement en manipulant une alêne, il se la plante dans l’œil droit. Cela se passe en 1814 alors que les troupes alliées occupent la France et certaines résident dans les locaux de sa famille.
Il reçoit peu de soins, on lui bande l’œil qui perd ainsi sa vision.
Deux ans plus tard, conséquence de l’accident survenu à l’œil droit, le gauche est atteint d’une ophtalmie sympathique puis une uvéite consécutive au traumatisme du premier.
Cette situation est irrémédiable et il perd totalement la vue.
Il continue à suivre les cours dans l’école du village de 1816 à 1818, malgré l’accident et la cécité il n’a pas perdu l’envie de travailler le cuir et il s’y investit totalement avec acharnement et passion et sa cécité développe son habileté manuelle.
Ses parents, instruits tous les deux et sachant lire et écrire, sont conscients de la nécessité d’une bonne éducation pour ce garçon handicapé.
Mais ils se heurtent à la difficulté financière pour payer la scolarité et les frais associés dans une école adaptée, en l’occurrence l’institution Royale des Enfants Aveugles et leur demande n’aboutit pas.
Cet établissement qui fut fondé par Valentin Haüy et est situé rue Coquillière à Paris.
Alors, la solidarité va jouer. Vont soutenir les moyens de la famille : le curé de la paroisse, le maire, le marquis d’Aubervilliers, pair de France, et ils obtiennent une bourse pour financer son admission et sa scolarité.
Dans cette école, les enfants apprennent à lire et lisent au moyen de lettres en tissus cousues sur du papier, mais ils ne peuvent pas écrire.
Braille est un élève brillant et le montre dans toutes les disciplines avec l’obtention de nombreuses récompenses.
Il excelle dans les travaux manuels comme dans les disciplines intellectuelles, tant et si bien qu’a à peine quinze ans l’école lui confie des responsabilités d’enseignement.
Malheureusement, l’école ne bénéficie pas de locaux adaptés et la malpropreté, le manque d’aération contribuent à une hygiène défectueuse et le jeune homme va attraper la tuberculose.
En 1821, il assiste à une présentation par Charles Barbier d’un système de nosographie, l’outil est intéressant, mais Braille veut le perfectionner, les deux hommes sont de générations très opposées et Barbier refuse que l’on touche à son invention, Braille travaille avec acharnement et crée son propre outil certes inspiré de l’invention de Barbier, mais assez différent.
En 1829, Braille produit un ouvrage intitulé : Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposés pour eux, par Louis Braille, répétiteur à l’Institution royale des jeunes aveugles.
C’est l’avènement du système Braille qui connaîtra quelques évolutions, mais est toujours celui en vigueur aujourd’hui.
La grande particularité c’est que l’outil est un alphabet calqué sur celui des voyants, il permet donc un accès total à la culture.
Mais ce n’est que 25 ans plus tard qu’il sera officiellement adopté par la France.
Braille fut également un grand organiste, il fut titulaire de l’orgue de l’église Saint-Nicolas des Champs en 1834 et de l’orgue de l’église Saint-Vincent de Paul en 1845.
Il meurt le 6 janvier 1852, emporté par sa tuberculose, il est inhumé le 10 janvier à Coupvray.
Il entre au Panthéon le 22 juin 1952, mais ses mains restent inhumées dans sa tombe de Coupvray, en hommage à son village d’enfance.
De nombreux lieux lui rendent hommage : noms de rues, d’écoles, statues, mais il reste peu connu du grand public.
Eugène Viollet-le-Duc
Né le 27 janvier 1814 à Paris
et mort le 17 septembre 1879 à Lausanne
Son père, Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc, est « conservateur des résidences royales » sous le règne de Louis Philippe, c’est aussi un écrivain et poète.
Sa mère, Élisabeth Eugénie Delécluze, fille de l’architecte Jean-Baptiste Delécluze, est une femme du monde qui a son propre salon où elle reçoit les artistes et écrivains (Stendhal).
Eugène est très proche de son père et du frère aîné de sa mère Étienne, peintre et critique d’art qui reçoit peintres, artistes et architectes dans son salon littéraire, dont Prosper Mérimée qui aida le jeune Eugène dans sa carrière.
Le jeune homme vit dans une ambiance artistique, mondaine et libérale, il se révèle très tôt, excellent dessinateur.
En 1826, il est pensionnaire à l’Institut Morin à Fontenay-aux-Roses.
En 1830, il participe aux émeutes et se retrouve à monter des barricades : c’est un rebelle.
En 1832, pour ses études supérieures, il refuse d’entrer à l’École des Beaux-Arts et renie la formation académique.
Il se met à parcourir la France, étudie et dessine des bâtiments, il revend ses dessins ce qui lui permet de vivre et financer ses voyages.
Ce parcours d’architecte autodidacte lui vaudra la reconnaissance des jeunes architectes réformistes.
En 1834, Viollet-le-Duc devient professeur suppléant de composition et d’ornement à la « Petite école » de dessin (ancienne École royale gratuite de dessin, qui devint plus tard l’École nationale supérieure des arts décoratifs).
L’approche pédagogique est à l’opposé de celle des Beaux-Arts et elle va avoir de nombreux disciples et c’est l’origine de « l’art nouveau ».
En 1836, il effectue un long voyage en Italie, à son retour, il entre au Conseil des bâtiments civils comme auditeur et est nommé sous-inspecteur des travaux de l’hôtel des Archives du royaume.
Sa réflexion et ses créations sont fondées sur l’observation de la nature qui pour lui est le modèle à suivre en architecture.
Et il va l’appliquer dans ses travaux de restauration, mais aussi dans ses travaux de construction.
Il ne s’intéresse pas qu’au bâti, il s’investit dans l’aménagement intérieur.
La liste des lieux où il intervint est immense notamment dans les édifices religieux, les Hôtels de Ville ou les châteaux, parmi les plus célèbres :
Amiens
: cathédrale Notre-Dame ;
Clermont-Ferrand : cathédrale Notre-Dame de l’Assomption ;
Lausanne : cathédrale Notre-Dame ;
Paris : cathédrale Notre-Dame et Sainte-Chapelle ;
Le Puy-en-Velay : cathédrale Notre-Dame ;
Saint-Denis : Basilique Saint Denis ;
Vézelay : basilique de la Madeleine ;
Hôtel de ville de Narbonne ;
Cité de Carcassonne ;
Château de Roquetaillade ;
Château de Pierrefonds ;
…
Et de nombreux immeubles à Paris.
Viollet-le-Duc est architecte, mais aussi écrivain, dessinateur, aquarelliste, alpiniste, archéologue.
Durant sa carrière, il va occuper de nombreuses fonctions :
Chef du bureau des monuments historiques ;
Membre de la commission des arts et édifices religieux ;
Membre de la commission supérieure de perfectionnement des manufactures nationales (Sèvres, Gobelins et Beauvais) ;
Inspecteur général des édifices diocésains ;
Architecte des édifices diocésains ;
Membre de la commission des monuments historiques ;
Professeur de l’histoire de l’art à l’École des beaux-arts.
Il est reconnu dans de très nombreux pays en Europe, en Russie, mais aussi aux Amériques.
Parmi ses distinctions :
L’ordre impérial du Mexique ;
L’ordre de la Rose de l’empire du Brésil ;
L’ordre de Saint Stanislas en Russie ;
Commandeur de la Légion d’honneur en France.
Il s’éteint quasi subitement le 17 septembre 1879 à Lausanne et est inhumé au cimetière du Bois de Vaux.
Marcellin Berthelot
Né le 25 octobre 1827 à Paris,
où il mourut le 18 mars 1907
Son père est médecin et se dévoue sans compter lors de l’épidémie de choléra de 1832 après avoir soigné les blessés sur les barricades en 1830.
Le jeune Marcellin fait de brillantes études au lycée Henri IV où il est pensionnaire : il excelle en histoire et philosophie.
Il entre ensuite à la faculté des sciences de Paris puis à la faculté de pharmacie.
Il est passionné par la recherche, il va être accueilli dans un laboratoire privé et il a carte blanche.
Il entre au Collège de France en 1851, il étudie les composés organiques et particulièrement ceux de nature complexe.
En 1854, il obtient son doctorat avec une thèse sur lastructure et la synthèse des graisses et surles combinaisons de glycérol avec les acides.
En 1859, il est nommé professeur à l’École supérieure de pharmacie.
En 1865, il devient professeur de chimie organique au Collège de France avec une chaire spécialement créée pour lui et il est également professeur à l’École pratique des hautes études.
La chimie n’est pas son seul centre d’intérêt, il œuvre dans le domaine des médicaments, des explosifs et de la physiologie végétale.
Il est également professeur d’histoire et de philosophie.
Dans ses travaux de recherches et découvertes, notons la réalisation de la synthèse de l’acétylène en associant le carbone et l’hydrogène sous la puissance de l’arc électrique, dans un appareil appelé « l’œuf de Berthelot ». Ainsi il ouvrit alors la voie à d’immenses perspectives : depuis la création d’engrais, de colorants, d’explosifs, de matières plastiques jusqu’à la fabrication d’aliments, de médicaments et de produits pharmaceutiques… Bien d’autres synthèses suivront, faisant apparaître des séries de corps nouveaux, ignorés même dans la nature.
Les découvertes de synthèses de Berthelot ont été exploitées par l’industrie, toujours poursuivies et développées afin de mieux répondre aux besoins sans cesse plus exigeants des hommes.
Berthelot s’engage également en politique et en bon patriote, il s’engage pour sa patrie lors de la guerre de 1870.
Après la guerre, il sera ministre, historien, philosophe, financier sans arrêter le fond de son existence : la recherche.
Il a déposé de l’ordre de mille deux cents brevets, des offres mirobolantes lui seront faites pour les racheter, mais il travaille pour la science et fait don de ses brevets, un par un, non pas seulement à l’État français, mais au monde afin que ses découvertes servent le plus grand nombre.
C’est un héritage considérable qu’il laisse à la science.
Il décède à Paris le 18 mars 1907.
Le Gouvernement lui fait des funérailles nationales et la loi du 24 mars 1907 décide le dépôt de ses cendres au Panthéon, accompagnées par celles de son épouse décédée quelques heures avant lui.
Louis Pasteur
Né le 27 décembre 1822 à Dole (Jura)
et mort le 28 septembre 1895 à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine)
Louis Pasteurest le troisième enfant de Jean-Joseph Pasteur et de Jeanne-Étiennette Roqui.
Après avoir servi l’armée napoléonienne, son père est tanneur.
En 1830, Louis suit les cours du collège d’Arbois où réside sa famille, c’est un bon élève qui se fait remarquer pour ses talents de peintre.
Pour la suite de la vie scientifique de Louis Pasteur, nous reprenons la publication faite par l’Institut Pasteur.
Les grandes dates de la vie scientifique de Louis Pasteur :
(Ces données, publiées par l’Institut Pasteur, listent les moments forts de la vie de Louis Pasteur.)
1839 : Départ de Louis Pasteur pour le collège royal de Besançon.
1840 : Reçu bachelier ès lettres à Besançon. Maître d’études au Collège de Besançon.
1842 : Bachelier ès sciences mathématiques à Dijon.
1843 : Admis à l’École normale supérieure, au 4e rang.
1845 : Licencié ès sciences.
1846 : Nommé professeur de physique au lycée de Tournon (Ardèche), mais reste à l’École normale supérieure comme agrégé préparateur.
1846 : Rencontre Auguste Laurent dans les laboratoires de Balard, études des cristaux.
1847 : Docteur ès sciences.
1848 : Nommé professeur de physique au lycée de Dijon puis professeur suppléant de chimie à la faculté des sciences de Strasbourg. Recherches sur le dimorphisme. Communication historique sur le dédoublement du para-tartrate de soude et d’ammoniaque.
1849 : Recherches sur les propriétés spécifiques des deux acides qui composent l’acide racémique.
1851 : Mémoire de Louis Pasteur sur les acides aspartiques et malique.
1852 : Nouvelles recherches sur les relations qui peuvent exister entre les formes cristallines, la composition chimique et le sens de la polarisation rotatoire.
1853 : Louis Pasteur est nommé chevalier de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur.
Il reçoit le prix de la Société de pharmacie de Paris pour la synthèse de l’acide racémique. Note sur la découverte de la transformation de l’acide tartrique en acide racémique. Découverte de l’acide tartrique inactif.
1854 : Louis Pasteur est nommé doyen de la faculté des sciences à Lille.
1855 : Début des études sur la fermentation. Présentation à Lille d’un mémoire sur l’alcool amylique.
1856 : Début des recherches sur la fermentation alcoolique.
1857 : Nommé administrateur de l’École normale supérieure et directeur des études scientifiques de cette école, et également mémoire sur la fermentation lactique et mémoire sur la fermentation alcoolique.
1858 : Installation de son laboratoire dans les combles de l’École normale supérieure à Paris, rue d’Ulm. Début de ses recherches sur les générations dites spontanées.
1859 : Prix de physiologie expérimentale de l’Académie des sciences pour ses travaux sur les fermentations.
1860 : Prélèvements d’air à Arbois pour l’étude du problème des générations dites spontanées. Examen de la doctrine des générations dites spontanées.
1861 : Reçoit le prix Jecker de l’Académie des sciences pour ses recherches sur les fermentations. Publication dans le bulletin de la Société chimique de Paris de l’ensemble de ses résultats sur la question du vinaigre.
1862 : Élection à l’Académie des sciences (section minéralogie). Études sur le rôle des mycodermes dans la fermentation acétique. Reçoit le prix Alhumbert pour ses recherches sur la génération spontanée. Alors que certains pensaient toujours à l’époque que des micro-organismes pouvaient apparaître spontanément, Louis Pasteur démontra que les microbes retrouvés dans des fioles stérilisées provenaient en réalité de l’air ambiant.
1863 : Napoléon III demande à Louis Pasteur d’étudier les maladies des vins. Études sur les vins, de l’influence de l’oxygène, de l’air sur la vinification.
1863 : Nommé professeur de géologie, physique et chimie appliquées, à l’École des beaux-arts.
1864 : Installation à Arbois d’un laboratoire pour ses recherches sur les vins.
1865 : Dépose un brevet pour l’invention d’un procédé de conservation et d’amélioration des vins par chauffage modéré à l’abri de l’air : la Pasteurisation. Aujourd’hui élargi aux aliments, le processus, qui fonctionne par chauffage à une température définie, suivi d’un refroidissement brusque, permettant d’étendre leur période de consommation.
1865 : Études des maladies des vers à soie.
1866 : Publication d’Études sur le vin. Publication d’un essai sur l’œuvre scientifique de Claude Bernard.
1867 : Création d’un laboratoire de chimie physiologique à l’École normale supérieure. Nommé professeur de chimie organique à la Sorbonne. Reçoit le grand prix de l’Exposition universelle pour ses études sur le vin.
1867 : Démission de ses fonctions administratives à l’École normale supérieure.
1868 : Diplôme de docteur Honoris Causa de l’université de Bonn. Est nommé Commandeur de la Légion d’honneur. Publication des études sur le vinaigre.
1868 : Pasteur est atteint d’une hémiplégie gauche.
1870 : Publication des études sur les maladies des vers à soie.
1871 : Recherches sur de nouveaux procédés de fabrication et de conservation de la bière.
1873 : Élu membre de l’Académie de Médecine.
1876 : Publication d’Études sur la bière.
1877 : Note sur l’altération de l’urine, études sur la maladie du charbon, études sur la septicémie.
1878 : Nommé grand officier de la Légion d’honneur.
1878 : Publication du mémoire sur la théorie des germes et ses applications à la médecine et à la chirurgie. Met au point le vaccin contre le choléra des poules à l’aide d’un microbe atténué. Il avait effectivement remarqué que l’injection de souches virulentes laissées plusieurs semaines en culture induisait des symptômes moins graves chez les oiseaux de basse-cour. Il crut que l’efficacité de son vaccin tenait en l’oxydation qui atténuait la dangerosité du microbe, ce qui fut infirmé des années plus tard.
Recherches sur la gangrène, la septicémie et la fièvre puerpérale.
1879 : Note sur la peste. Découverte de l’immunisation au moyen de cultures atténuées.
1880 : Nommé membre de la Société centrale de médecine vétérinaire. Communication sur les maladies virulentes (Louis Pasteur expose pour la première fois le principe des virus-vaccins).
1880 : Début des recherches sur la rage.
1881 : Nommé Grand-croix de la Légion d’honneur. Met au point le vaccin contre la maladie du charbon chez les ruminants. Travaux sur la fièvre jaune près de Bordeaux.
1881 : Élu membre de l’Académie française.
1882 : Note sur la péripneumonie contagieuse des bêtes à cornes, études du rouget des porcs et met au point avec Louis Thuillier le vaccin contre le rouget du porc.
1884 : Nouvelles communications sur la rage. Communication sur les microbes pathogènes et les virus-vaccins au congrès de Copenhague. Louis Pasteur expose le principe général des vaccinations contre les maladies virulentes.
1885 : Première vaccination antirabique chez l’Homme.
1887 : Élu Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, victime d’une seconde attaque d’hémiplégie.
1888 : Inauguration de l’Institut Pasteur, le 14 novembre.
1892 : Jubilé à la Sorbonne, le 27 décembre.
1895 : Mort de Louis Pasteur à Villeneuve-l’Étang, le 28 septembre.
La France lui fait des obsèques nationales. Son corps préalablement embaumé est déposé le 5 octobre 1895 dans l’un des caveaux de Notre-Dame.
La famille, après avoir refusé une entrée au Panthéon, demande le transfert dans une crypte du musée Pasteur et ce sera réalisé le 27 décembre 1896.
La contribution de Louis Pasteur au monde pour les sciences et la médecine est immense.
La reconnaissance se traduit par des noms de rues, des musées, des noms d’hôpitaux ou cliniques, des écoles, des statues, des médailles et monnaies, un cratère lunaire, un cratère martien, un astéroïde, un glacier…
La philatélie, le cinéma, la télévision le célèbrent.
Ses écrits et publications sont régulièrement réédités.
Gustave Eiffel
Né Bonickhausen dit Eiffel le 15 décembre 1832
à Dijon et mort le 27 décembre 1923 à Paris
Gustave Eiffel est issu d’une famille d’origine rhénane, les Bonickausen. Un membre de cette famille, venu s’établir à Paris vers 1710, avait joint à son nom celui de Eiffel, plus facile à prononcer et qui rappelait sa région natale (l’Eiffel). Ce nom additionnel est devenu en 1879 le seul patronyme légal de la famille.
Son père est secrétaire de l’intendance militaire de Dijon, sa mère, Catherine Mélanie Moneuse s’est lancée dans le négoce de la houille et à grands efforts où elle a réalisé une fortune honorable et notable.
De 1843 à 1850, il fait ses études au collège royal de Dijon et obtient son baccalauréat à 18 ans.
Il entre au collège Sainte-Barbe à Paris pour accéder aux grandes écoles et il entre à l’École centrale des arts et manufactures de Paris dont il sort diplômé en 1855.
Il devait s’orienter vers la chimie, mais c’est finalement vers la métallurgie qu’il se dirige.
Son premier emploi sera aux Forges de Chatillon-sur-Seine puis, grâce aux relations de sa mère, en 1856, il est recruté par Charles Nepveu.
Charles Nepveu est un entrepreneur spécialisé dans la construction métallique, mais c’est aussi un pionnier qui dispose d’une maîtrise dans l’utilisation d’air comprimé pour la réalisation des forages. Il est par ailleurs un proche des frères Pereire.
À cette période, l’acier, matériaux résistant, relativement léger, facile à manipuler, commence à s’imposer dans la construction des ponts et charpentes que stimule le développement des chemins de fer.
C’est dans ce domaine que Gustave Eiffel commence à montrer ses talents.
Il travaille conjointement :
Pour la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, pour laquelle il va réaliser son premier ouvrage, le « pont du chemin de fer de Saint-Germain » ;
Pour Nepveu qui obtient le marché de construction d’un pont ferroviaire sur la Garonne.
Nepveu cède son affaire à la Compagnie belge de Chemins de fer dirigée par François Pauwels qui recrute Eiffel.
En 1858, à 26 ans, il va manager le chantier et notamment utiliser la technique de fondation à air comprimé lors de l’exécution des piles tubulaires (technique qu’il va d’ailleurs améliorer et faire progresser).
C’est un succès et sa réputation est fondée.
À partir de là, les réalisations vont se succéder, et l’on pourrait résumer l’action de Gustave Eiffel ainsi :
Plus de 500 réalisations ;
Sur 5 continents ;
Dans 30 pays ;
Durant 60 ans.
Dans différents domaines :
Ponts de chemins de fer ;
Ponts routiers ;
Constructions spécifiques ;
Charpentes métalliques ;
Usines.
Lister toutes ses réalisations relève de l’impossible, mais nous allons citer les dix reconnues comme les plus représentatives et remarquables :
Le Viaduc de Garabit
(Ruynes-en-Margeride, Val d’Arcomie, France)
Peut-être le plus beau viaduc du monde. Un majestueux pont en fer qui enjambe les Gorges de la Truyère, sur la ligne de chemin de fer des Causses.
La Statue de la Liberté
(New York, États-Unis)
Conçue par Auguste Bartholdi, offerte par le peuple français aux Américains pour célébrer le centenaire de la Déclaration d’Indépendance et qui tient solidement sur son socle par la structure conçue par Gustave Eiffel.
La coupole de l’observatoire de Nice
(France)
L’un des plus célèbres observatoires dans le monde. Il fut classé parmi les Monuments historiques en 1994.
Le Viaduc Maria Pia à Porto
(Portugal)
Plus aucun train n’y passe, mais conservé comme monument remarquable de la ville.
La Poste centrale de Saïgon
(Viêt-nam)
Construite par l’Administration française et dont la charpente est l’œuvre de Gustave Eiffel.
Le Paradis latin à Paris
(France)
Détruit lors de la guerre avec la Prusse, il fut reconstruit par Eiffel.
La passerelle Eiffel à Bordeaux
(France)
À l’origine appelée passerelle Saint-Jean, et aujourd’hui classée parmi les Monuments Historiques.
La coupole d’hiver de l’Hôtel Ermitage de Monte-Carlo
(Principauté de Monaco).
La Cathédrale Saint-Marc à Arica
(Chili)
Construite sur le site de l’église mère d’Arica détruite en 1868 par un tremblement de terre.
Le pont Eiffel d’Ungheni à Judet de Lasi
(Roumanie)
Ce pont qui enjambe le fleuve PROUT se situe à la frontière entre la Roumanie et la Moldavie.
Bien sûr, son œuvre la plus connue est la tour Eiffel à Paris, monument emblématique de Paris.
C’est pour commémorer le centenaire de la Révolution, organisé autour de l’exposition universelle de 1889, que naît l’idée d’une tour à base carrée et de 300 m de hauteur. Un concours est lancé et c’est l’équipe de Gustave Eiffel qui est choisie.
La construction commence en 1886, la tour ne fut pas démontée après l’événement et son rayonnement est sans équivalent.
Au début de son édification, elle fut l’objet de commentaires enthousiastes comme de critiques les plus acerbes, mais elle finit par faire l’unanimité.
Au-delà de son positionnement comme constructeur de la démesure et de l’extrême, Gustave Eiffel a changé la vision de l’architecture et lui a apporté de nombreuses techniques et méthodes de construction toujours utilisées.
Gustave Eiffel meurt le 27 décembre 1923 dans sa résidence de la rue Rabelais à Paris.
Ses obsèques sont célébrées le 31 décembre 1923 en l’église Saint-Philippe-du-Roule et il est inhumé au cimetière de Levallois-Perret dans le caveau familial.
À l’occasion du centenaire de la mort de Gustave Eiffel, ses descendants ont déposé une demande de panthéonisation.
Henri Becquerel
Né le 15 décembre 1852 dans le 12e arrondissement
de Paris et mort le 25 août 1908 au Croisic
Fils et petit-fils de physiciens et d’Académiciens des sciences, Becquerel est un enfant du sérail.
Son père, Alexandre Edmond Becquerel et son grand-père, Antoine Becquerel, étaient des physiciens, professeurs au muséum national d’histoire naturelle de Paris.
Il naît même dans ces bâtiments.