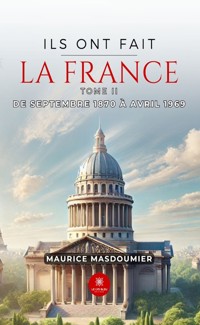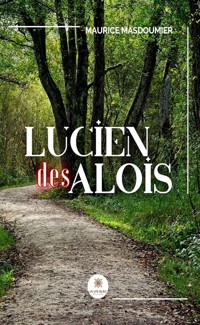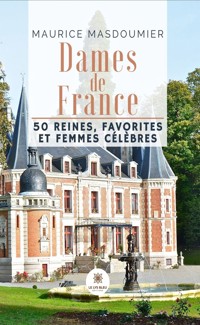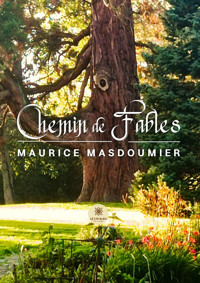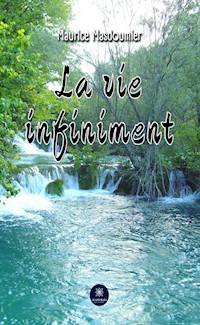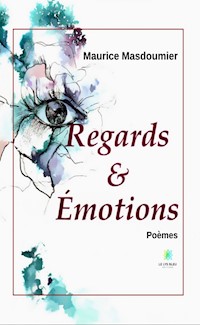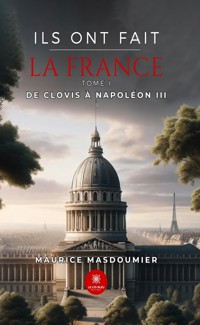
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ils ont fait la France
- Sprache: Französisch
Plonger dans les méandres de notre histoire, explorer les racines de notre pays, la France, est une quête fascinante. Comment est-elle née, comment a-t-elle évolué au fil du temps et qui sont les artisans de sa transformation ? Découvrir ces réponses c’est saisir pleinement le contexte dans lequel nous vivons, rencontrer des figures clés qui ont façonné son destin. Leurs parcours, leurs choix, leurs actions peuvent être une source d’inspiration et d’apprentissage pour comprendre notre propre identité et envisager l’avenir. Regorgeant de portraits soigneusement sélectionnés, ce premier tome est une véritable mine de connaissances et une invitation à un voyage captivant à travers notre passé.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alliant son attachement au terroir à une carrière réussie dans l’industrie,
Maurice Masdoumier déploie sa plume depuis son adolescence. Il explore divers genres tels que la poésie, les fables et la recherche factuelle, tout en étant romancier, conteur et amateur d’histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Masdoumier
Ils ont fait la France
Tome I
De Clovis à Napoléon III
© Lys Bleu Éditions – Maurice Masdoumier
ISBN : 979-10-422-2486-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Note de l’auteur
La France est le résultat d’une fort longue histoire et d’une succession d’événements que j’ai voulu connaître et comprendre. Mais surtout apprécier comment nous sommes arrivés à être ce que nous sommes aujourd’hui et ce qui définit notre entité.
La France est née, s’est formée, s’est divisée, s’est reconstituée avec toujours plus de force et puis, sans doute, devenue majeure, elle s’est enrichie grâce à ses enfants aux dons parfois extraordinaires.
C’est toute cette aventure que j’ai voulu mettre en lumière.
J’ai surtout cherché à recenser ceux qui ont été ses meilleurs serviteurs, qu’ils soient monarques, présidents, conseillers, ministres, architectes, aventuriers, écrivains, artistes, savants, industriels… ce sont ceux qui ont laissé une empreinte, influencé, donné un sens.
Cette énumération n’est pas exhaustive, je n’ai exclu personne par volonté discriminatoire, il se peut qu’à vos yeux j’aie commis quelques oublis, mais je vous suggère tout simplement par vos lectures, vos réflexions personnelles de compléter mon apport.
Toutes ces personnes citées, vous en avez entendu parler, mais les connaissez-vous vraiment ?
Je vous invite donc à approfondir, ce qui vous permettra, à votre tour, de vous approprier notre France.
Cette aventure est réalisée en 2 tomes, le premier commence avec Clovis et se termine avec Napoléon III, le second prend le relais et va jusqu’à la démission de de Gaulle en 1968.
J’ai considéré qu’à partir de là, je risquais de ne plus être objectif, car la France est entrée dans l’histoire contemporaine et que mon vécu et mes propres pensées ne pouvaient interférer avec l’histoire de cette France que je respecte et que j’aime tant.
Des origines celtes à la fin de l’Empire romain
À l’origine étaient les Celtes ! pourrions-nous dire.
La littérature sur l’histoire des Celtes nous rappelle qu’ils sont originaires d’Europe centrale, que ce peuple s’installe et s’organise, à partir du 12e siècle av. J.-C., sur une vaste zone englobant ce que nous appelons aujourd’hui l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la France, une partie de l’Italie ainsi que de la Hongrie.
Puis ils irrigueront la péninsule ibérique et les îles britanniques.
C’est la civilisation de Hallstadt.
Mais cet espace est fluctuant au gré des agitations et des affrontements entre groupes.
D’autre part les populations sont nomades et les déplacements sont fréquents.
Ont-ils des velléités de conquête ou partent-ils à la recherche de nouvelles richesses sur de nouveaux territoires ? Toujours est-il qu’à partir du 5e siècle av. J.-C. leur espace s’étend.
Cette période correspond au dernier âge du fer celtique : c’est à ce moment-là que la civilisation de La Tène supplante celle de Hallstadt.
La Tène se situe sur les rives du lac de Neufchâtel en Suisse à Marin-Épargnier.
C’est le lieu de notre engendrement.
La culture de La Tène, ou second âge du fer, est une culture archéologique qui se développe en Europe entre environ 450 et 25 av. J.-C. Son nom provient du site archéologique de La Tène découvert en 1857 à Marin-Épagnier, sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse.
La Tène donne l’adjectif « laténien (ne) » (Encyclopédia Universalis).
La culture de La Tène est plus rurale et se distingue par son organisation autour d’une chefferie guerrière.
Le bronze est définitivement remplacé par le fer.
Les tribus vont se déplacer en conquérant des territoires et vont aller de plus en plus vers les lieux où elles pensent trouver des richesses.
Cette expansion se fait vers l’ouest (Îles britanniques), mais aussi vers l’est (Asie centrale) ou le sud (péninsule Ibérique) et va durer jusqu’à la moitié de 1er siècle av. J.-C.
C’est un énorme brassage de populations qui se fait, parfois, dans la guerre et le sang, mais majoritairement de façon harmonieuse. Compte tenu de coutumes similaires, même si les Celtes sont plutôt hiérarchisés.
Avant que ne viennent les Celtes, ceux qui vivent sur ces territoires sont appelés « peuples mégalithes », ce sont principalement des nomades qui vivent, au fil des saisons, de la cueillette, de la chasse et de leurs troupeaux.
Ces peuples sont des païens qui vénèrent les éléments : l’eau, le soleil, le feu, alors que les Celtes ont des Dieux auxquels ils vouent un culte organisé.
Pendant ce temps à Rome, la République romaine met en place l’empire à l’initiative d’octave.
C’est la phase la plus connue de l’histoire romaine.
Va commencer la conquête de nouveaux territoires et Rome va s’agrandir de façon inespérée en conquérant peu à peu les territoires Celtes.
Dans leurs conquêtes, les Romains vont désigner, particulièrement, un territoire au sein duquel les peuples étaient connus pour leurs combats de coqs, ainsi ce territoire que César délimite est appelé Gallia (coq se dit Gallus en latin et Galia en Celte signifie « force et bravoure »).
C’est donc César qui crée « La Gaule », bien qu’il désignait cet espace en l’appelant « Les Gaules »
Ainsi une entité est née, elle n’est pas pour autant fondée, car l’unité qui existe est celle de la loi et de l’organisation romaine.
À la fin du 1er siècle avant J.-C., l’Empire romain est vaste et la maîtrise de cet espace est peu évidente.
Cet Empire s’étend de l’actuelle Angleterre à la Turquie et l’ensemble du pourtour méditerranéen.
L’espace est peuplé de nombreuses tribus, groupes de cultures différentes, il n’a pas d’homogénéité.
Jules César bien qu’il ne fut pas empereur est néanmoins l’artisan de l’édification de l’Empire.
L’Internaute nous livre une brève biographie de Jules César qui me paraît suffisante pour alimenter notre propos :
Jules César est sans doute le général romain le plus mythique.
De son nom complet, Caius Julius Caesar, César naît à ROME (Italie) le 12 juillet de l’an 101 avant J-C. Issu d’une famille patricienne, il prétend être un descendant d’Enée, fils de Vénus.
Le jeune Jules appartient à la jeunesse dorée de Rome.
Homme de stratégie politique comme militaire, il gravit tous les échelons, allant jusqu’à se faire proclamer dictateur à vie et conquérir un empire gigantesque jusqu’aux confins du monde connu de l’époque.
Son opposition aux membres du Sénat connaît son apogée lorsqu’il entre dans Rome avec son armée et met en fuite Pompée.
Elle lui vaudra également sa chute : Jules César est victime d’un complot organisé par quelques sénateurs, dont son fils spirituel Brutus.
Il meurt le 15 mars 44 av. J.-C.à Rome (Italie).
La Gaule est vraiment son œuvre, il a vaincu et soumis toutes les tribus de ce territoire.
L’opposition la plus célèbre est celle que lui opposa Vercingétorix, le grand guerrier arverne.
Bien qu’ennemis, les deux hommes avaient du respect l’un pour l’autre.
L’apport de l’Empire est d’abord organisationnel, ainsi apparaissent les « diocèses ».
Les diocèses sont un regroupement de provinces et ils sont sous le gouvernement des préfectures, qui sont elles-mêmes un regroupement de diocèses, sous la tutelle d’un préfet du Prétoire.
Ce type d’organisation va conduire à des évolutions notables dans la société.
La population se sédentarise, les villes se structurent et grandissent, la culture se développe, les constructions d’infrastructures sont légion.
Vers la fin de l’empire, les grandes familles quittent les villes et s’installent souvent dans de vastes domaines ruraux où elles édifient villas et forteresses autour desquelles vit et, parfois, s’abrite la population.
Mais les hommes sont de moins en moins libres, leurs vies et leurs métiers sont régis par des statuts, ce qui entraîne une forte transmission des métiers par l’hérédité.
La rigidité des structures de la société conduit à la création de castes.
En 313, sous le règne de Constantin, le christianisme est institutionnalisé.
Vers la moitié du quatrième siècle, le christianisme est développé dans les villes et la quasi-totalité des campagnes s’y convertit.
C’est ainsi que l’on peut compter une vingtaine d’évêchés sur la Gaule.
Le déploiement organisé du christianisme structure la société.
Les chrétiens pour tenir leurs assemblées édifient des églises où le culte est dirigé par des prêtres.
C’est dans ce contexte qu’au 4e siècle est édifié le baptistère Saint-Jean à Poitiers.
Sous la conduite des prêtres les fidèles d’une région élisent un évêque qui a la responsabilité de superviser un évêché et dont le territoire correspond à une juridiction administrative romaine.
Puis sera instituée la mission d’archevêque dans le chef-lieu de chaque province, ceux-ci ont la charge, entre autres, de faire vivre les conciles provinciaux qui rapportent à l’évêque de Rome (le Pape).
Toute cette organisation constitue le clergé séculier.
À la fin du 4e siècle apparaissent les premiers monastères avec des moines vivant selon leurs règles : c’est le clergé régulier.
On peut citer les monastères de Ligugé et de Marmoutier.
Nous devons à César, la naissance d’un territoire avec son organisation et l’émergence d’une religion, le christianisme, qui apporte des valeurs et par sa hiérarchie contribue à l’organisation du territoire.
La relation entre l’église et l’état n’est pas encore formelle, mais elle s’ébauche.
Ainsi naît ce qui sera plus tard La « France ».
Les Francs, Clovis et les Mérovingiens
Les Francs sont un peuple germanique apparaissant au moment des grandes invasions, ils vivent en tribus sous la forme plus ou moins explicite d’une confédération.
Parmi eux les Francs Saliens qui combattirent Rome, ils furent battus par l’empereur Julien qui pourtant les laisse s’installer après les avoir affranchis : ils deviennent ainsi les Lètes de Rome (Lètes est probablement la traduction d’un mot germanique « lataz » signifiant « laché » ou « affranchi »).
Ils se latinisent et se christianisent.
Ils s’établissent de façon permanente sur un territoire Romain avec la bénédiction de l’Empire qui fait face à son déclin.
Ces Francs Saliens ont un ancêtre légendaire, Mérovée, auquel les rites et croyances attribuaient un pouvoir quasi divin, ce qui légitime son titre de Roi.
Ainsi naît la dynastie des Mérovingiens.
Au cinquième siècle leur roi est proconsul des Gaules, en fait il est un fonctionnaire romain bien assimilé. C’est ainsi qu’ils s’établissent solidement sur le territoire de la Gaule.
Les Mérovingiens vont se développer et porter une renaissance économique avec la disparition progressive de l’Empire romain, de même qu’une évolution positive de l’implantation de l’Église.
Le plus grand d’entre eux fut Clovisné vers 466, fils de Childéric, qui va soumettre les tribus ennemies et conforter un royaume qui contient la Gaule et des provinces germaniques.
Les dix ou quinze premières années de règne ne sont pas faciles, rapporte Bruno Dumézil. Clovis doit batailler contre ses cousins, qui sont comme lui rois des Francs, à coups d’alliances puis d’assassinats.
Jouant habilement des uns comme des autres, il parvient à s’imposer comme le plus puissant des rois Francs.
Il mène alors des opérations de conquêtes contre les autres peuples et annexe tour à tour le royaume Wisigoth, celui des Alamans dans la région du Rhin-Moyen et la vallée du Rhône.
Il absorbe ainsi les autres chefferies franques dans un seul et immense royaume, qui recouvre la quasi-totalité des Gaules de la mer du Nord jusqu’à Carcassonne et de la Rhénanie jusqu’à la Bretagne.
Lorsque l’on consulte les cartes, le royaume de Clovis ressemble déjà à ce que sera la France au XIe siècle.
Clovis se rapproche des Évêques dont il suit les conseils.
Sous l’influence de sa femme Clotilde, d’origine burgonde, mais convertie au catholicisme, ainsi que de l’évêque Rémi de Reims, il se fait baptiser.
Avant la célèbre bataille de Tolbiac, il avait pris l’engagement que s’il était victorieux il se convertirait à la religion chrétienne.
Il tint parole et se fit baptiser à Reims en 496, avec trois mille de ses guerriers.
Le baptême est un événement des plus marquants de notre histoire.
En voici le récit de Grégoire de Tours et les commentaires et apports de Bruno Dumézil.
C’est avec son baptême, en 496, ou en 505, que le roi franc reste dans la mémoire collective. Sur cet événement également, c’est le récit de Grégoire de Tours qui prévaut.
Il arriva que le conflit (avec les Alamans) dégénérât en un violent massacre et que l’armée de Clovis fût sur le point d’être complètement exterminée. Ce que voyant, il éleva les yeux au ciel, et, le cœur rempli de componction, ému jusqu’aux larmes, il dit : Ô Jésus-Christ, que Clotilde (sa femme) proclame fils de Dieu vivant, toi qui donnes une aide à ceux qui peinent et qui attribues la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite dévotement la gloire de ton assistance, si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis et si j’expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu’elle venait de toi, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom.
Comme il disait ses mots, les Alamans tournant le dos commencèrent à prendre la fuite. Et lui, ayant ainsi arrêté la guerre et harangué son peuple, la paix faite, rentra et raconta à la reine comment, en invoquant le nom du Christ, il avait mérité la victoire.
Toujours selon Grégoire de Tours, la reine fait alors venir saint Rémi, évêque de la ville de Reims. La population devance Clovis dans sa conversion, touchée elle aussi par la grâce de Dieu, et scande sa foi nouvelle. Après quoi le roi reçoit le baptême avec 3 000 de ses guerriers.
Grégoire de Tours a mis cet évènement en avant, a posteriori, comme étant la source de toutes les victoires de Clovis, explique Bruno Dumézil, et l’origine du grand royaume franc. Il explique que du fait de ce baptême, Dieu est passé du côté des Francs et c’est cela qui a transformé un groupe de barbares en un royaume chrétien.
Grégoire de Tours décrit l’événement près d’un siècle après les faits et produit un récit plausible, mais sans fondement historique vérifiable. Mais force est d’admettre que la conversion de Clovis est bien l’un des faits marquants de l’Histoire de la future nation française : c’est elle qui fait entrer le royaume franc dans la chrétienté.
Le règne de Clovis et plus particulièrement son baptême à Reims, sont à l’origine des mythes qui légitimeront l’autorité des Rois des Francs. Nombre de Rois porteront par la suite le nom de Clovis (Hlod-Wig, "qui s’illustre au combat"), sous la forme de Louis, et quasiment tous les Rois se feront sacrer par l’évêque de Reims.
Il apparaît donc que le principal héritage de Clovis est bien la tradition catholique, dont ne cesseront de se réclamer les Rois et les dynasties suivantes.
Par la suite il s’efforce d’inculquer les principes chrétiens à tout son peuple qui était encore largement païen.
Il gagne ainsi le soutien des élites et fonde durablement la dynastie des Mérovingiens qui va régner sur l’ancienne Gaule jusqu’au milieu du huitième siècle.
Clovis est à l’origine d’un concile qui se tient à Orléans et auquel participe une trentaine d’évêques.
Ce concile vise à fonder les relations entre l’église et l’état et de ce fait définit les relations et les prérogatives de chaque partie, une organisation se met en place.
Clovis avait la préoccupation de l’accueil et de l’intégration des Francs convertis et des Ariens. Les règles ainsi établies vont mettre un terme à la tradition germanique matriarcale de clans familiaux.
Ce concile établit également le droit d’asile pour toute personne qui se réfugie dans une église.
En 508, après avoir séjourné dans sa région d’origine, à Tournai (Belgique) ensuite à Soissons, Clovis pour des raisons stratégiques et économiques décide de vivre à Paris et d’en faire la capitale du royaume : il s’installe au palais des Thermes sur l’Île-de-la-Cité.
Il est aussi le protecteur des fondations monastiques (Abbaye de Sainte-Geneviève).
Il meurt le 27 novembre 511 et son royaume est partagé, selon la coutume des Francs, entre ses 4 fils Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire.
Il n’est point question de France, mais du Royaume des Francs.
Les principes successoraux des Mérovingiens
À la mort de Clovis, en 511, le royaume, considéré comme un bien patrimonial, est traité selon les règles du droit privé et donc partagé équitablement entre ses quatre fils adultes.
Le royaume est donc partagé en quatre lots équivalents contenant chacun un quart des territoires situés au nord de la Loire ainsi qu’un quart de L’Aquitaine.
L’unité de gouvernance territoriale est rompue, mais la capitale du royaume demeure : c’est Paris.
Il y aura bien, au fil des luttes fratricides, une tentative de regroupement, mais rien n’y fait.
La conséquence est le développement des particularismes régionaux.
Les Mérovingiens règnent sur toute la Gaule, le territoire est géré par plusieurs monarques, mais l’unité territoriale est maintenue par l’application d’un principe unitaire.
L’unité est mise à mal par les intrigues et les querelles.
Il fallut l’avènement de Dagobert en 629 et son règne absolu durant 10 années pour que le royaume retrouve sa force et son unité.
Clovis est à l’origine de l’interpénétration du droit salique et du droit romain, il choisit ce que chaque origine a de meilleur et de plus juste, il fonde un mode et des règles de vie.
L’apport de Clovis est l’ancrage d’une Nation à un territoire, et l’instauration des principes qui vont guider toutes les royautés futures.
Avec son règne s’instaure la relation privilégiée de la Nation avec l’Église catholique.
Dagobert
Né vers 602/605 et mort le 19 janvier 638 ou 639.
Dès 632, il a rétabli l’unité du royaume.
Il rétablit et conforte la capitale à Paris.
Dagobert reçoit de son père le royaume D’Austrasie en l’an 623.
Lorsque son père, Clotaire II, meurt en 629, il récupère le royaume de Neustrie.
Il a laissé à son frère Charibert le gouvernement du Languedoc, ainsi que d’une partie de l’Aquitaine et lorsque celui-ci meurt, en 632, Dagobert est de fait l’unique Roi des Francs d’ailleurs sans concurrence puisque le fils de Charibert meurt assassiné.
Son royaume est bordé par les Pyrénées, la Bretagne, le Rhin et l’Elbe, le grand royaume Franc est reconstitué.
Il sait s’entourer de conseillers de grand talent comme Éloi dont il fait son ministre des Finances, ou Dadon qui deviendra Ouen de Rouen et qui donna son nom à la ville de Saint-Ouen.
Ces deux conseillers furent reconnus saints ultérieurement.
Gallo-Romain originaire de Chaptelat dans le Limousin, « le bon Saint Éloi » appartenait à une famille de paysans aisés.
Il entre comme apprenti orfèvre dans un atelier où l’on frappait la monnaie selon les méthodes anciennes, il devient un expert dans son travail d’orfèvre, et il est aussi très doué pour les émaux.
Il choisit la voie de l’Église. En 660, il est évêque de Noyon.
Il sera appelé à Paris pour diriger les ateliers monétaires du royaume, il fut également un conseiller financier de talent pour Dagobert.
Il fonde le monastère de Solignac, au sud de Limoges ainsi que le 1er monastère féminin à Paris dans sa propre Maison.
Quant à Dadon, il est originaire de Sancy en Auvergne, il entre à la cour du roi en tant que premier chancelier.
À la mort du roi, il entreprend des études théologiques, est ordonné prêtre, devient évêque de Noyon puis de Rouen sous le nom de Ouen.
Dagobert a compris qu’il vaut mieux négocier la paix, tout en étant fort, plutôt que de faire la guerre et c’est un bon négociateur.
Il consolide ses relations avec Byzance et négocie, en 631, un « traité de paix perpétuel » avec l’Empereur Héraclius, Empereur romain d’Orient.
C’est ainsi qu’il confie en 632 la défense de ses frontières de l’orient aux Saxons en échange d’une fourniture annuelle de 500 vaches.
Il n’est cependant pas naïf et n’hésite pas à conduire des expéditions militaires pour lutter contre les menaces extérieures, ainsi il mène une guerre victorieuse de l’autre côté des Pyrénées, détrône un roi Wisigoth et met en place quelqu’un de son choix, dont il est sûr de la fidélité.
À l’intérieur du royaume il visite ses états ce qui lui permet de contrôler ses représentants locaux, écouter ses sujets et rendre la justice.
Ces actions le rendent populaire.
Il fait bâtir des églises et des monastères, apporte son soutien au clergé et reçoit la reconnaissance des grands prélats.
L’envers du décor n’est pas aussi beau : il est avare, cruel et débauché. Il a eu de nombreuses femmes et concubines.
Ce qu’il faut retenir de Dagobert c’est qu’il rétablit et consolide l’unité d’un royaume plutôt éparpillé et qu’il lui apporte une santé financière solide.
Il est d’autre part à l’origine de l’unification de la frappe des monnaies.
Le grand royaume Franc est reconstitué et consolidé.
Lorsqu’il meurt en janvier 638 (ou 639), ses fils n’ont que huit ans et quatre ans, le pouvoir est de fait entre les mains des conseillers.
C’est sous son règne que s’unissent les deux familles de Pépin de Landen, Maire du Palais d’Austrasie et d’Arnoul, évêque de Metz.
Pépin fonde la lignée des Pippinides, il s’empare du pouvoir après la mort de Dagobert.
Les Pippinides sont à l’origine de la dynastie des Carolingiens, qui succédera aux Mérovingiens dont Dagobert fut le dernier représentant.
La légende de la « culotte à l’envers » : en réalité cela n’a rien à voir avec Dagobert, la chanson fut écrite mille ans plus tard sous la Révolution française et visait Louis XVI qu’à l’époque l’on accusait de tous les maux.
Dagobert est le premier roi à être enterré à la basilique primitive de Saint-Denis, selon ses vœux.
La période des Carolingiens
C’est une dynastie de rois Francs qui vont régner sur une bonne partie de l’Europe occidentale, à partir de 751 jusqu’à la fin du Xe siècle.
Carolingien est un dérivé de Carolus dont le 1er fut CharlesMartel, puis son petit-fils Charles 1er le Grand (Charlemagne).
Charlemagne
Né en 747 dans le royaume Franc, mort le 28 janvier 814 à Aix-La-Chapelle.
Il règne de 768 à 814, il est le fils aîné de Pépin le Bref et de Berthe.