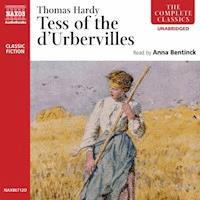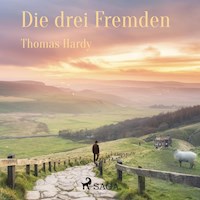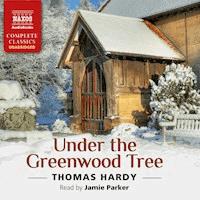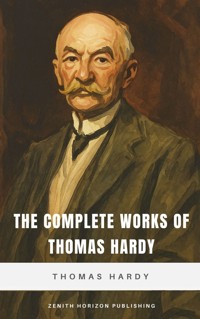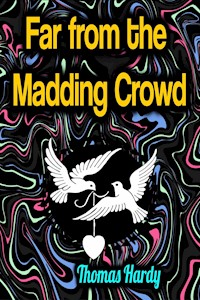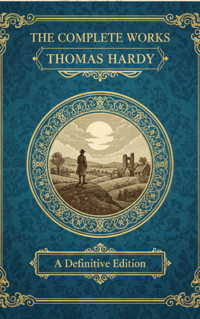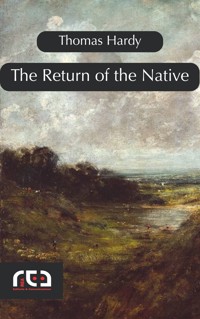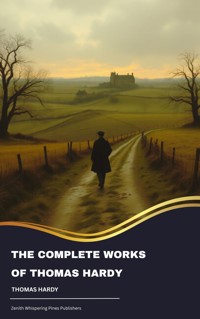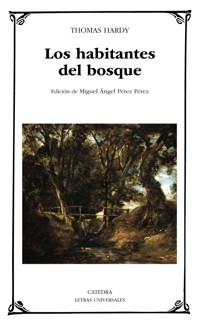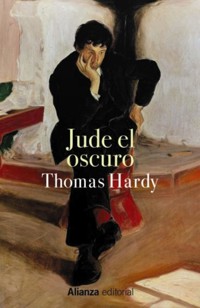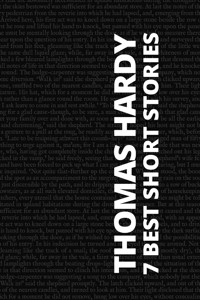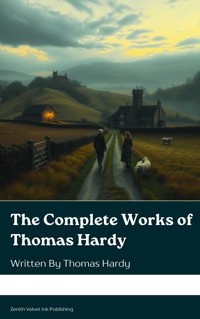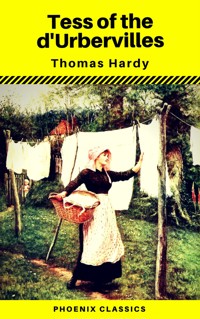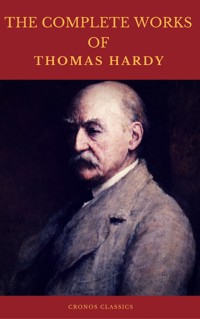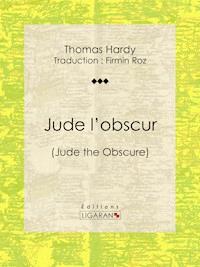
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Jude l'obscur, le chef-d'œuvre de Thomas Hardy, est un roman poignant qui explore les thèmes de l'amour, de la destinée et de la société victorienne. L'histoire se déroule dans la campagne anglaise du XIXe siècle et suit la vie de Jude Fawley, un jeune homme rêveur et ambitieux.Jude aspire à une éducation supérieure et à une vie meilleure, mais il est constamment entravé par les conventions sociales et les attentes de sa famille. Malgré cela, il ne cesse de lutter pour réaliser ses rêves, notamment celui de devenir un érudit respecté.Cependant, Jude est également confronté à des obstacles amoureux. Il tombe éperdument amoureux de Sue Bridehead, une femme indépendante et libre d'esprit. Leur relation complexe et passionnée est mise à l'épreuve par les conventions sociales et les pressions de la société victorienne.Au fil du récit, Hardy explore les thèmes de la religion, de la morale et de la condition humaine. Il remet en question les normes sociales et les institutions établies, tout en dépeignant avec réalisme les luttes et les désillusions de ses personnages.Jude l'obscur est un roman profondément émouvant qui offre une réflexion sur la nature humaine et les limites imposées par la société. Avec sa prose poétique et sa vision réaliste de la vie, Thomas Hardy nous livre une œuvre intemporelle qui continue de captiver les lecteurs du monde entier.
Extrait : ""Le maître d'école quittait le village et chacun semblait attristé. Le meunier de Cresscombe lui avait prêté son cheval et sa petite charrette à bâche blanche pour transporter son mobilier à la ville où il devait se rendre, environ à vingt milles de là. Un tel véhicule était de dimensions suffisantes pour contenir les effets du magister qui s'en allait."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335012217
©Ligaran 2014
Le maître d’école quittait le village et chacun semblait attristé. Le meunier de Cresscombe lui avait prêté son cheval et sa petite charrette à bâche blanche pour transporter son mobilier à la ville où il devait se rendre, environ à vingt milles de là. Un tel véhicule était de dimensions suffisantes pour contenir les effets du magister qui s’en allait. La maison d’école étant meublée en partie par les administrateurs, le seul objet encombrant que possédât le maître, en plus de ses livres empaquetés, c’était un piano de campagne, acheté aux enchères l’année où il avait songé à apprendre la musique instrumentale. Mais son zèle tombé, le maître d’école n’était jamais devenu un fort pianiste ; et son acquisition lui avait été un tracas perpétuel, à chacun de ses déménagements.
Le pasteur était parti pour toute la journée, étant un de ces hommes qui haïssent le spectacle des changements. Il ne devait revenir que le soir, quand le nouveau maître serait arrivé et installé et tout redevenu paisible.
Le forgeron, le bailli et le maître d’école lui-même étaient debout, avec des attitudes perplexes, dans le salon, devant l’instrument. Le maître avait remarqué que, pût-il même l’emporter dans la charrette, il ne saurait qu’en faire lors de son arrivée à Christminster, la ville où il allait, et où précisément il devait habiter d’abord un logement provisoire.
Un petit garçon de onze ans, qui avait assisté tout pensif à l’emballage, se joignit au groupe des hommes, et comme ceux-ci se frottaient, le menton, il parla, rougissant au son de sa propre voix :
– Ma tante a acheté un grand hangar de marchand de bois. Et le piano pourrait y tenir peut-être, jusqu’à ce que vous ayez trouvé place pour le mettre, monsieur ?
– Une bonne idée, dit le forgeron.
On décida d’envoyer une députation à la tante du garçon – une vieille fille du pays – afin de lui demander si elle voulait bien garder le piano jusqu’à ce que M. Phillotson l’envoyât chercher. Le forgeron et le bailli s’élancèrent pour s’assurer si l’abri proposé était praticable ; le jeune garçon et le maître restèrent seuls.
– Vous êtes fâché de mon départ, Jude ? demanda le maître avec bienveillance.
Des larmes montèrent aux yeux de l’enfant. Il ne comptait point parmi les élèves réguliers de la classe du jour qui occupait banalement la vie du maître d’école ; mais il avait suivi les cours du soir, seulement depuis que cet instituteur était en fonctions. À vrai dire, les élèves réguliers se trouvaient fort loin en ce moment, comme certains disciples historiques, et ne manifestaient aucun enthousiaste désir de se rendre utiles.
Le jeune garçon gauchement ouvrit le livre qu’il tenait à la main, et que lui avait donné en souvenir M. Phillotson. Il convint qu’il avait du chagrin.
– Moi aussi, dit M. Phillotson.
– Pourquoi partez-vous, monsieur ? demande l’enfant.
– Ah ! ce serait une longue histoire... Vous ne pourriez pas comprendre mes raisons, Jude. Vous le pourrez, peut-être, quand vous serez plus âgé !
– Je crois que je comprendrais maintenant, monsieur.
– Bon, mais ne parlez de cela nulle part. Vous savez ce que c’est qu’une université et un grade universitaire. C’est le contrôle nécessaire à tout homme qui veut réussir dans l’enseignement. Mon projet ou mon rêve est de prendre mes grades, et alors d’entrer dans les ordres. En allant habiter Christminster, je serai, pour ainsi dire, au quartier général, et si mon projet est réalisable, mon séjour là-bas m’apportera des chances d’avancement plus sérieuses que partout ailleurs.
Le forgeron et son compagnon revinrent. Le hangar de la vieille miss Fawley était sec et tout à fait ce qu’il fallait, et elle paraissait disposée à y donner asile à l’instrument. On convint de le laisser dans l’école jusqu’au soir, où il y aurait plus de bras disponibles pour le transport. Le maître d’école jeta un dernier regard autour de lui.
Jude assista au chargement de quelques petits articles ; puis, à neuf heures, M. Phillotson monta à côté de ses paquets de livres et autres impedimenta et il dit adieu à ses amis.
– Je ne vous oublierai pas. Jude, dit-il en souriant, comme la charrette s’ébranlait. Souvenez-vous d’être un bon garçon, bienveillant pour les animaux et surtout pour les oiseaux. Lisez tout ce que vous pourrez lire. Et si jamais vous allez à Christminster, ne négligez pas de venir me voir, en souvenir de nos anciennes relations.
La charrette cria sur le gazon et disparut à l’angle du presbytère. L’enfant retourna vers le puits, au bord du pré où il avait laissé ses seaux pour aider son bienfaiteur et maître à charger. Un frisson passait maintenant sur ses lèvres. Il enleva le couvercle du puits ; le seau commençait à descendre. Jude appuya son front et ses bras sur la margelle, et son visage prit la fixe expression d’un enfant pensif qui a senti, avant le temps, les aiguillons de la vie. Le puits dans lequel il regardait était aussi ancien que le village même, et, dans la position actuelle de Jude, il lui apparaissait comme une longue perspective circulaire, terminée par un disque brillant d’eau frémissante à la profondeur de cent pieds. Là, il y avait une ligne de mousse verte à fleur d’eau, et, plus près encore, des touffes de fougère de l’espèce dite « langue de cerf ».
Jude se disait à lui-même, avec le ton mélodramatique d’un enfant bizarre, que le maître d’école était venu bien des fois tirer de l’eau à ce puits et qu’il n’y viendrait plus jamais. « Je l’ai vu regarder là-dedans, quand il était fatigué de tirer les seaux, tout comme moi maintenant, et pendant les repos, avant d’emporter les seaux à la maison. Mais il était trop remarquable pour demeurer longtemps ici, dans un village endormi comme celui-là. »
Une larme roula de ses yeux dans les profondeurs du puits. Le matin était brumeux et l’haleine de l’enfant se déployait comme une vapeur plus épaisse dans l’air tranquille et lourd. Ses réflexions furent interrompues par un cri soudain :
– Voulez-vous bien apporter l’eau, jeune paresseux, espèce d’arlequin ?
Cela venait d’une vieille femme qui avait surgi près de la porte d’un jardin, au seuil d’une chaumière au toit moussu, située non loin de là. Le garçon fit aussitôt un signe d’assentiment, tira l’eau avec un effort pénible pour un gamin de sa taille, vida le grand seau dans ses deux seaux plus petits ; et après s’être arrêté un instant pour respirer, il s’élança tout chargé dans la moiteur de l’herbe à travers le bout de pré où le puits était situé, presque au centre du hameau.
Il était aussi ancien que petit, placé dans un pli de terrain, vers les dunes du Vessex septentrional. Le vieux puits était probablement la seule relique locale qui fût demeurée intacte, car, pendant les dernières années, on avait démoli beaucoup de vieilles chaumières à lucarnes et jeté bas beaucoup d’arbres. On avait détruit l’église primitive, ornée de tours en bois, pour en utiliser les matériaux. À la place, s’élevait une nouvelle et vaste église, construite dans le style gothique allemand, peu familier aux yeux anglais. Il n’y avait plus aucun souvenir du temple antique sur la verte pelouse qui avait été un cimetière, depuis un temps immémorial, et les tombes effacées étaient marquées par d’humbles croix de fer garanties pour cinq ans.
Délicat comme était Jude Fawley, il porta sans s’arrêter les seaux pleins d’eau jusqu’au cottage. Sur la porte était un petit rectangle de carton bleu, où étaient peints en lettres jaunes ces mots : « Drusilla Fawley, boulangère. » Derrière les petits carreaux plombés de la fenêtre – cette maison était une des plus anciennes du pays – il y avait cinq bocaux de bonbons, et trois gâteaux sur une assiette à ramages.
Tandis qu’il vidait ses seaux derrière la maison, Jude pouvait entendre une conversation animée qui continuait à l’intérieur, entre sa grand-tante, la Drusilla de l’enseigne, et quelques autres villageoises. Ayant vu le départ du maître d’école, elles discutaient sur les détails de l’événement et se plaisaient à en tirer des pronostics pour l’avenir.
– Qui est donc celui-là ? demanda l’une, qui paraissait n’être pas du pays, quand le garçon entra.
– Vous pouvez bien me le demander, mistress Williams. C’est mon petit-neveu. Il n’était pas ici la dernière fois que vous êtes venue.
La vieille bonne femme qui répondait était une grande maigre ; elle parlait d’un ton tragique sur le sujet le plus trivial et adressait une phrase de sa conversation à chaque auditeur à son tour. « Il vient de Mellstock, dans le Vessex méridional, il y a un an déjà, – il n’a pas eu de chance, Belinda – (se tournant à droite) : son père vivait dans ce pays ; il attrapa le mal de la mort, et mourut en deux jours, comme vous savez, Caroline. (Se tournant à gauche) : C’eût été une bénédiction si la Providence t’avait enlevé aussi, avec ta mère et ton père, toi, pauvre enfant inutile !... Mais je l’ai pris ici pour rester avec moi, jusqu’à ce que je puisse voir ce que je ferai de lui, quoique je sois obligée de le laisser gagner un penny quand il en trouve l’occasion. Précisément, en ce moment, il écarte les oiseaux dans les champs du fermier Troutham. Cela l’empêche de mal faire. – Pourquoi te tournes-tu, Jude ? continua-t-elle, en s’adressant à l’enfant qui sentait pleuvoir les regards comme des soufflets sur son visage et détournait la tête.
La blanchisseuse du pays répondit que Mme ou Mlle Fawley (comme on la nommait indifféremment) avait fait peut-être un très bon calcul en prenant Jude avec elle. « Pour vous tenir compagnie dans votre solitude, chercher l’eau, fermer les volets le soir, et vous aider un peu dans la boulangerie. »
Miss Fawley n’était pas convaincue... « Pourquoi n’avons-nous pas persuadé au maître d’école de le prendre avec lui à Christminster et d’en faire un étudiant ? continua-t-elle avec une plaisanterie renfrognée. Je suis sûre qu’il n’eût pas trouvé meilleur élève. Le garçon est fou des livres, il en est fou. Cela vient de famille. Sa cousine Sue est absolument de même ; je l’ai entendu dire, du moins, car je n’ai pas vu cette enfant depuis des années, quoiqu’elle soit née ici, entre ces quatre murs. Ma nièce et son mari, après leur mariage, n’eurent pas de maison à eux pendant un ou deux ans. Lorsqu’ensuite ils furent installés... mais ne parlons plus de ça. Jude, mon enfant, ne vous mariez jamais : il n’est pas bon pour les Fawley d’entrer dans ce chemin-là. Elle, leur unique enfant, fut comme ma propre fille, Belinda, jusqu’à la séparation. Ah ! qu’une petite fille ait connu de tels changements !... »
Jude, voyant l’attention générale concentrée encore sur lui, quitta la boulangerie, où il avait mangé le gâteau réservé pour son déjeuner. La fin de son court repos était arrivée et, sortant du jardin en escaladant la haie, il suivit un sentier vers le nord jusqu’à une large et solitaire dépression du plateau, ensemencée de blé. Ce vaste creux était le théâtre de ses travaux pour M. Troutham, le fermier ; Jude descendit au milieu.
La surface brune du champ était limitée tout autour par le ciel et se perdait par degrés dans la brume qui envahissait ses confins et rendait la solitude plus saisissante. Rien n’en rompait l’uniformité, si ce n’est une meule formée par les récoltes de l’année précédente, des corneilles qui s’envolèrent à l’approche de Jude et le sentier par lequel il était venu,
– Que c’est laid, ici ! murmura-t-il.
Il s’arrêta auprès de la meule et, pendant quelques instants, il fit vigoureusement résonner sa crécelle. À chaque claquement, les corneilles, cessant de becqueter, s’élevaient sur leurs ailes nonchalantes, sombres comme une cotte de mailles, tournoyaient en regardant Jude avec circonspection et descendaient picorer à distance respectueuse.
L’enfant agita sa claquette jusqu’à ce que son bras fût fatigué, et peu à peu son cœur sympathisa avec les désirs contrariés des oiseaux. Ils semblaient, comme lui, vivre dans un monde qui ne se souciait pas d’eux. Pourquoi les effaroucher ? Ils prenaient de plus en plus l’aspect de gentils amis et protégés – les seuls amis que Jude pût considérer comme siens, car sa tante lui avait dit souvent qu’il ne devait pas compter sur elle. Il cessa de claquer et, de nouveau, les oiseaux redescendirent.
– Pauvres petits chéris ! dit Jude à haute voix. Vous aurez votre dîner, vous l’aurez ! Il y a bien assez pour nous tous, et le fermier Troutham est assez riche pour vous offrir quelque chose. Donc, mangez, mes chers petits oiseaux, et faites un bon repas.
Les corneilles s’arrêtèrent pour manger, taches d’encre sur le sol brou de noix, et Jude se réjouissait de leur appétit. Un fil magique de sympathie unissait sa propre vie à la leur. Ces existences chétives et pénibles ressemblaient à son existence.
Il avait jeté de côté sa claquette, comme un vil et sordide objet, aussi cruel pour l’ami des oiseaux que pour les oiseaux eux-mêmes. Soudain, il sentit un rude choc sur sa culotte, choc suivit d’un sourd claquement qui révéla à ses sens surpris que l’instrument de correction employé était la claquette elle-même. Les oiseaux et Jude s’effrayèrent simultanément, et les yeux effarés du gamin aperçurent le fermier en personne, le grand Troutham, abaissant sur Jude épouvanté un visage coloré par l’indignation, et balançant la crécelle dans sa main.
– C’est cela : « Mangez, mes chers oiseaux ! » c’est cela, jeune homme ! « Mangez, chers oiseaux ! » En vérité ? J’arrive derrière vous et je vous entends dire : « Mangez, chers oiseaux ! » Et vous avez été faire le paresseux chez le maître d’école, avant de venir ici, n’est-ce pas, hein ?... C’est ainsi que vous gagnez vos six pence par jour pour écarter les oiseaux de mon blé ?
Tout en cornant aux oreilles de Jude ce discours indigné, Troutham avait saisi la main gauche de l’enfant dans la sienne, et balançant Jude au bout de son bras, il le fit tourner autour de lui en le frappant avec le plat de la crécelle, jusqu’à ce que l’écho du champ retentit du bruit des coups, distribués deux ou trois fois à chaque révolution.
– Ne me battez pas, monsieur, je vous en prie, ne me battez pas... Je... je... monsieur... je voulais dire qu’il y avait beaucoup de grain – je l’ai vu semer – et que les oiseaux pouvaient en prendre un peu pour leur repas et que ça ne vous ferait pas de tort, monsieur, et M. Phillotson, dit qu’il faut être bon pour eux. Oh !... Oh !... Oh !...
Cette explication sincère parut exaspérer le fermier, plus que ne l’eût fait une protestation. Il continua de balancer Jude et de faire résonner la claquette dont le bruit parvenait jusqu’aux travailleurs éloignés qui croyaient Jude assidûment occupé à sa besogne, et jusqu’à la nouvelle église pour laquelle le fermier avait largement souscrit en témoignage de l’amour qu’il portait à Dieu et aux hommes.
Quand il en eut assez de cette besogne, Troutham remit l’enfant tremblant sur ses jambes, prit six pence dans sa poche et les lui donna comme salaire en lui disant de retourner à la maison et de ne jamais reparaître devant ses yeux ni dans son champ.
Jude s’enfuit hors de la portée de son bras et s’en alla en pleurant, non de douleur, quoiqu’elle fût assez vive ; non même de la découverte qu’il avait faite d’une fêlure dans le système de l’univers, ce qui est bon aux oiseaux de Dieu étant nuisible au jardinier créé par Dieu ; mais il avait la sensation terrifiante de s’être porté le plus grand tort, depuis un an qu’il habitait la commune, et d’être un fardeau pour sa grand-tante durant toute sa vie.
Il y avait, sur son chemin, une quantité de ces vers qui sortent de terre à cette époque de l’année, et il était presque impossible d’avancer sans en écraser quelques-uns. Quoique le fermier Troutham l’eût justement corrigé, Jude était incapable de faire, du mal à qui que ce fût. Il n’avait jamais déniché des oiseaux, sans rester éveillé toute la nuit par la pitié ; et bien souvent, le lendemain matin, il avait remis les captifs dans leur nid. À peine pouvait-il supporter la vue des arbres taillés ou abattus... Cette disposition de caractère, qu’on appelle communément de la faiblesse, révélait qu’il appartenait à l’espèce des hommes destinés à souffrir beaucoup, avant que la chute du rideau sur le spectacle de leur vie inutile ne vienne marquer le moment où tout redeviendra bien pour eux. Il continua sa route sur la pointe du pied, parmi les vers de terre, sans en écraser un seul.
En entrant dans la chaumière, il trouva sa tante vendant un pain de deux sous à une petite fille. La cliente partie, elle demanda :
– Eh bien, pourquoi revenez-vous ici au milieu de la matinée ?
– Je suis renvoyé.
– Quoi ?
– M. Troutham m’a renvoyé parce que j’ai laissé les corneilles manger un peu de maïs. Et voilà mes gages, les derniers.
Tragiquement, il jeta les six pence sur la table.
– Ah ! dit la tante qui suspendit sa respiration.
Elle commença un sermon pour prouver qu’elle allait avoir Jude sur les bras, tout le printemps, sans qu’il pût rien faire.
– Si vous ne pouvez écarter les oiseaux, à quoi êtes-vous bon ?... Là, vous ne semblez pas capable de grand-chose. Je suis meilleure que le fermier Troutham. Mais, comme a dit Job : « Maintenant, les jeunes me tournent en dérision, ceux dont j’aurais dédaigné les pères, comme gardiens de mes troupeaux. » Son père était ouvrier chez mon propre père ; n’importe, j’ai été bien folle de vous laisser travailler pour lui... Jude, Jude, pourquoi n’avez-vous pas suivi le maître d’école à Christminster ou ailleurs ?
– Où est cette belle cité, tante, cette ville où est allé M. Phillotson ? demanda l’enfant après une méditation silencieuse.
– Seigneur ! vous devriez savoir où est Christminster. À une vingtaine de milles environ. C’est un endroit beaucoup trop beau pour vous, mon pauvre garçon, j’en ai bien peur.
– Et M. Phillotson y restera toujours ?
– Est-ce que je sais ?
– Ne pourrais-je aller le voir ?
– Dieu non. On voit bien que vous n’êtes pas d’ici ; ou vous ne demanderiez pas une chose pareille. Nous n’avons jamais eu aucun rapport avec les gens de Christminster ni eux avec nous.
Jude sortit et, sentant plus que jamais l’inanité de son existence, il se laissa tomber sur un tas de paille près de l’étable à porcs. Le brouillard était devenu transparent et l’on devinait le soleil au travers... Jude comprit que l’âge apportait des responsabilités. L’ordre des événements ne ressemblait pas à celui qu’il avait espéré. La logique de la nature était trop cruelle pour le ménager, et son sens de l’harmonie était blessé de ce que la compassion due à certaines créatures portât préjudice aux autres...
S’il pouvait seulement s’empêcher de grandir ! Il n’éprouvait nul besoin de devenir un homme.
Dans l’après-midi, quand il n’eut plus rien à faire à la maison, il sortit du village et demanda le chemin de Christminster, qu’on lui indiqua, dans la direction du champ de Troutham.
Pas une âme sur la route blanche, qui semblait monter et se perdre dans le ciel. Une ancienne voie romaine la croisait à angle droit, allant de l’est à l’ouest sur un espace de plusieurs milles. Jamais Jude ne s’était hasardé si loin, vers le nord, hors du hameau où le courrier d’une petite station l’avait déposé, par un soir très sombre, quelques mois auparavant. Il ne soupçonnait pas qu’une aussi vaste, plate et basse région s’étendit si près de lui, aux confins de son plateau. La contrée septentrionale s’étendait devant lui, en demi-cercle, sur une largeur de quarante à cinquante milles ; et l’atmosphère semblait plus bleue et plus humide que celle où il respirait.
Il y avait, au bord de la route, une vieille grange bâtie en briques et en tuiles et que les gens du pays appelaient la Maison-Noire. Jude aperçut une échelle appuyée au bord du toit où deux hommes réparaient les tuiles. Il grimpa sur l’échelle, et, arrivant près des ouvriers il leur demanda où était Christminster.
– Christminster est par ici, dans la direction de ce bouquet d’arbres. Vous ne pouvez pas le voir par un temps comme celui d’aujourd’hui... Il faut choisir un temps clair. Moi, quand je l’ai vu, c’est à l’heure où le soleil descend dans une auréole de flammes... Alors on croirait voir... je ne sais pas quoi...
– La Jérusalem céleste ? dit le grave bambin.
– Oui... quoique je ne me sois jamais avisé de penser à cela...
Jude abandonna donc le projet de voir Christminster et se mit à errer çà et là en observant toutes choses. Quand il repassa près de la grange, il vit que les tuiliers étaient partis, mais que l’échelle était encore à sa place.
Le soir tombait. Il y avait toujours un léger brouillard. Jude songea à Christminster et désira n’avoir pas marché inutilement pendant deux ou trois milles, sans apercevoir la ville qui l’attirait. Il monta jusqu’au sommet de l’échelle et s’assit sur le dernier barreau, parmi les tuiles... Au bout de dix ou quinze minutes, le brouillard s’évanouit à l’est, et un quart d’heure après, les vapeurs du couchant disparurent ; les rayons filtrèrent entre deux barres de nuages gris. À l’extrême limite du paysage, l’enfant vit briller des points de topaze, qui devinrent peu à peu des girouettes, des fenêtres, des toits d’ardoise, des clochers, des dômes... C’était Christminster ou son mirage.
Le petit spectateur regarda jusqu’à ce que les fenêtres et les girouettes eussent perdu leur éclat, comme des flambeaux brusquement éteints. La vague apparition se voila de brume. Se tournant vers l’ouest, Jude vit que le soleil avait disparu. Le premier plan du paysage s’assombrissait d’une manière funèbre, et les objets les plus proches prenaient des formes et des couleurs chimériques.
Il descendit l’échelle, plein d’anxiété, et s’en alla par la route, essayant de ne pas penser aux géants, à Herne le chasseur, à l’Apollon qui tend des pièges, à Christian, au capitaine qui porte un trou sanglant au milieu du front et chaque nuit lutte contre des cadavres ressuscités et révoltés à bord du vaisseau maudit. Il savait bien qu’il avait passé l’âge de croire à ces horreurs, mais, néanmoins, il fut charmé quand il vit le clocher et les lumières aux fenêtres de la chaumière, quoique cette maison ne fût pas son foyer natal et que sa grand-tante ne se souciât guère de lui.
À travers la solide barrière de froides collines crétacées qui s’étendait au nord, Jude contempla toujours une cité merveilleuse, ce lien qui avait semblé à son imagination la nouvelle Jérusalem. Pendant la morne saison humide, il savait qu’il pleuvait à Christminster, mais il pouvait à peine croire que la pluie y fût aussi triste qu’ailleurs. Souvent il allait jusqu’à la Maison-Noire, fasciné par la vue d’un dôme, d’un clocher ou d’une petite fumée qui lui semblait mystique comme un encens.
Il rêva de s’y rendre après la tombée du jour, et même d’aller un peu plus loin pour voiries lumières nocturnes de la cité. Malgré son appréhension de rentrer seul, il s’arma de courage et mit son projet à exécution. Il n’était pas bien tard quand il arriva à la Maison-Noire, juste à l’heure du crépuscule ; mais le ciel sombre au nord-est, d’où soufflait le vent, paraissait favoriser son entreprise. Il fut récompensé : sans distinguer les lumières, il apercevait un halo de brouillard lumineux. Dans ce rayonnement, Jude crut voir Phillotson se promener, comme dans la fournaise de Nabuchodonosor. Il offrit ses lèvres au vert du nord-est qu’il savoura comme une douce liqueur. Et il crut entendre le son des cloches, la voix de la cité, faible et musicale, murmurant : « On est heureux ici. »
Un bruit le tira de son extase. Il aperçut une voiture de charbon conduite par deux hommes et un gamin.
Celui-ci plaça une grosse pierre contre les roues et donna aux bêtes haletantes le loisir de se reposer.
Jude s’adressa aux deux hommes, demandant s’ils venaient de Christminster.
– À Dieu ne plaise !... Avec ce chargement !...
– L’endroit dont je parle est là-bas.
Jude était si romanesquement épris de Christminster qu’il n’osait prononcer ce nom : tel un amant parlant de sa maîtresse. Il montra la lumière dans le ciel ; elle était à peine visible pour des yeux un peu âgés.
– Oui, il y a au nord-est un point brillant. Cela doit être Christminster.
Ici, un petit livre de contes, que Jude portait sous son bras, glissa et tomba sur la route. Le charretier l’examina pendant qu’il le ramassait et arrangeait les feuillets.
– Ah ! jeune homme, dit-il, il vous faudrait une autre caboche pour lire ce qu’on lit là-bas.
– Pourquoi ? demanda l’enfant.
– Oh ! les gens de Christminster ne s’occupent jamais de rien que nous puissions comprendre. Ils étudient les langues étrangères, les langues d’avant le déluge, quand il n’y avait pas deux familles qui parlaient la même. Et ils lisent ces sortes de choses aussi vite que vole un engoulevent... Oh ! c’est une ville grave... Vous savez, je pense, qu’ils élèvent les pasteurs comme des radis de couche. Il leur faut cinq ans pour faire d’un lourdaud bredouillant un prêcheur solennel, à la longue figure, à la longue redingote noire, que sa propre mère ne reconnaîtrait pas toujours... Voilà ; c’est leur métier : chacun le sien.
– Mais comment savez-vous ?...
– N’interrompez pas, mon garçon, n’interrompez jamais vos anciens... Je ne suis point allé à Christminster, mais j’en ai entendu parler, ici et là, en allant par le monde et en fréquentant toutes les classes de la société. J’ai été renseigné par un de mes amis qui cirait les bottes à l’hôtel Crozier, à Christminster, dans sa jeunesse.
Jude remercia chaleureusement le charretier, disant qu’il aurait désiré pouvoir parler de Christminster, la moitié seulement aussi bien que lui.
Il continua seul sa route vers la maison ; et sa méditation était si profonde qu’il en oublia d’avoir peur. L’enfant se transformait soudain. C’était le vœu de son cœur de s’attacher, de se vouer à quelque chose d’admirable. Trouverait-il à Christminster cet objet d’admiration ? Y avait-il un endroit où sans crainte des fermiers, des empêchements ; du ridicule, il pourrait veiller et attendre, et se préparer à quelque haute entreprise, comme ces hommes d’autrefois dont il avait entendu parler ? Pareil au halo lumineux qui avait paru devant ses yeux un quart d’heure plus tôt, le lieu idéal rayonnait dans son esprit pendant qu’il poursuivait sa route ténébreuse.
« C’est une ville de lumière, » se disait-il.
« C’est là que croit l’arbre de la science, » ajouta-t-il quelques pas plus loin.
« C’est de là que viennent et c’est là que vont ceux qui parlent aux hommes.
« On peut dire que c’est un château gardé par la science et la religion. »
Après cette métaphore, il resta silencieux quelque temps, puis il ajouta :
« C’est là ce qu’il me faut. »
L’enfant marchait avec lenteur, absorbé dans ses pensées – homme déjà vieux par certains côtés de son esprit, et, par d’autres, plus jeune que son âge. – Il fut rejoint par un voyageur alerte, et, malgré l’ombre, il vit que le nouveau venu portait un chapeau extraordinairement haut, un habit à queue d’hirondelle, une chaîne de montre qui dansait follement et accrochait les reflets du jour. Il avait des jambes grêles et des chaussures qui ne faisaient pas de bruit.
Jude, qui commençait à s’émouvoir de sa solitude, résolut de l’accompagner.
– Bien, mon camarade !... Mais je suis pressé et vous irez d’un bon pas si vous voulez me suivre. Savez-vous qui je suis ?
– Oui, je crois... Le docteur Vilbert ?
– Ah ! Je vois que je suis connu partout... Ce que c’est que d’être un bienfaiteur public !
Vilbert était un charlatan ambulant, bien connu de la population rustique, et absolument ignoré des autres, comme il le désirait, d’ailleurs, pour éviter une surveillance gênante. Les paysans composaient seuls sa clientèle. Il traversait à pied des distances énormes, dans la longueur et la largeur du Wessex Jude l’avait vu un jour vendre un pot de graisse colorée à une vieille femme comme un remède certain pour guérir une jambe malade. La vieille avait payé fort cher ce remède précieux, tiré, disait Vilbert, d’un animal particulier qui paissait sur le mont Sinaï et qui ne pouvait être capturé sans danger de mort. Bien qu’il commençât à douter des vertus médicales du personnage, Jude pensa qu’il était bon de l’interroger :
– Je suppose que vous êtes allé à Christminster, docteur ?
– Oui, plusieurs fois, répondit le grand homme maigre. C’est un de mes centres d’opération.
– C’est une ville étonnante par la science et la religion...
– Vous pourriez en parler, mon garçon, si vous l’aviez vue... Les fils des blanchisseuses du collège y parlent latin – non pas le meilleur latin, j’en conviens : un latin de chien, un latin de chat, comme nous disons au collège.
– Et le grec ?
– Le grec est bon pour les futurs évêques qui doivent lire le Nouveau Testament dans le texte original.
– Je voudrais apprendre le latin et le grec.
– Noble désir... il vous faut une grammaire pour chaque langue.
– Je tâcherai d’aller un jour à Christminster.
– Quand vous irez, vous direz que le docteur Vilbert est le seul propriétaire des célèbres pilules qui guérissent infailliblement tous les désordres du système digestif, l’asthme et l’insuffisance de la respiration. Quatre et six sous la boîte, avec autorisation spéciale du gouvernement.
– Pourriez-vous m’apporter les grammaires si je vous promettais de dire cela un peu partout ?
– Je vous vendrais les miennes avec plaisir, celles que j’avais quand j’étais étudiant.
– Oh ! merci, dit Jude avec reconnaissance, et tout haletant, car il suivait avec peine le charlatan au petit trot.
– Je crois que vous feriez mieux de rester en arrière, jeune homme. Voici ce que je ferai : je vous apporterai les grammaires et je vous donnerai une première leçon si, dans chaque maison du village, vous vous souvenez de recommander l’onguent d’or du docteur Vilbert, ses gouttes de vie, et ses pilules pour les dames.
– Où serez-vous avec les grammaires ?
– Je passerai ici d’aujourd’hui en quinze, à sept heures vingt-cinq minutes. Mes mouvements sont réglés comme ceux des planètes dans leur cours.
– Je vous rencontrerai ici, dit Jude.
– Avec des commandes de médicaments ?
– Oui, docteur.
Jude resta en arrière, attendit un instant pour reprendre haleine et retourna à la maison avec la conscience d’avoir fait un grand pas vers. Christminster.
Il tint consciencieusement sa promesse, et, quinze jours plus tard, il était immobile sur le plateau, attendant Vilbert au même endroit où il l’avait rencontré. Mais à sa grande surprise, le charlatan parut pas le reconnaître. Jude, pensant que c’était l’effet d’un chapeau neuf qu’il avait mis, salua avec dignité.
– Eh bien, mon garçon ?... dit l’autre, distraitement.
– Je suis venu, dit Jude.
– Vous ?... Qui êtes-vous ?... Oh !... je sais... Apportez-vous des commandes, petit ?
– Oui.
Jude donna les noms et les adresses des villageois qui désiraient s’assurer des vertus spéciales des pilules. Le charlatan les retint précieusement.
– Et les grammaires grecque et latine ?
La voix de Jude tremblait d’anxiété.
– Lesquelles ?
– Vous m’aviez promis les vôtres, celles qui vous ont servi pour vos études.
– Ah ! oui, oui... J’ai oublié... Vous le voyez, jeune homme, tant de vies dépendent de mes soins que je n’ai pas le temps de penser à autre chose.
Jude mit quelque temps à s’assurer de la vérité ; puis ; d’un ton de profonde douleur, il répéta :
– Vous ne les avez pas apportées ?
– Non, mais vous me ferez avoir quelques commandes de plus pour les malades, et je vous apporterai les grammaires la prochaine fois.
Jude laissa Vilbert passer en avant. C’était un être simple et droit, mais le don de pénétration est souvent dévolu aux enfants et Jude devinait tout à coup à quelle humanité de camelote appartenait le charlatan. Le laurier de sa couronne imaginaire s’effeuilla. Il retourna chez lui, s’appuya contre la porte et pleura amèrement.
Cette désillusion fut suivie par une série de jours pâles et vides. Jude aurait pu faire venir ses grammaires d’Alfredston, mais il aurait fallu choisir ces livres et les payer, et bien qu’il ne manquât pas du nécessaire, il ne possédait pas un liard.
À cette époque, M. Phillotson envoya chercher son piano, ce qui donna une heureuse idée à Jude. Pourquoi n’écrirait-il pas au maître d’école, en le priant de bien vouloir lui envoyer les grammaires de Christminster ? Il pouvait glisser sa lettre dans le couvercle de l’instrument. Pourquoi même ne pas demander à M. Phillotson de vieux cahiers d’exercices, tout imprégnés de l’atmosphère de l’Université ?
Jude mit son projet à exécution sans rien dire à sa tante, et après quelques jours d’anxiété, il reçut un paquet qu’il alla chercher à la poste même. Ce paquet contenait deux petits livres. Jude choisit un coin solitaire et s’assit sur un orme abattu pour le défaire.
Depuis qu’il rêvait de Christminster, Jude avait beaucoup médité sur le procédé probable par lequel on transposait les mots d’une langue dans une autre. Il avait conclu que la grammaire de la langue en question contiendrait d’abord un mode, un procédé, la clef d’un chiffre secret, qu’une fois connue il n’aurait qu’à utiliser pour changer à son gré tous les mots de sa langue en ceux d’une autre. Quand, ayant coupé la ficelle du paquet et pris les livres, il ouvrit la grammaire latine, il put à peine en croire ses yeux.
Le livre était très vieux – trente ans au moins mais ce n’était pas son aspect qui causait la surprise de Jude. Il apprenait, pour la première fois, que la loi de transmutation, supposée par son ignorance, n’avait jamais existé ; et que chaque mot grec ou latin devait être retenu par un effort de mémoire qui représentait des années de pénible assiduité.
Jude jeta les livres, s’étendit sur le large tronc de l’orme, et se sentit profondément misérable pendant tout un quart d’heure. Selon son habitude, il se couvrit le visage avec son chapeau et regarda les flèches brillantes que lui décochait le soleil à travers les interstices de la paille. C’était donc cela le grec et le latin ! Grande déception... Le charme qu’il avait espéré était en réalité un labeur digne d’Israël en Égypte.
Quel cerveau devaient avoir les gens de Christminster et des grandes écoles, pensa-t-il, pour retenir un par un des centaines de mots ! Son cerveau à lui n’était point fait pour un pareil travail ; et comme les petits rais lumineux du soleil continuaient de briller sur lui, à travers son chapeau de paille, il désira n’avoir jamais aucun livre, et de n’en voir jamais aucun ; il regretta d’être né.
Quelqu’un aurait pu passer par le chemin et l’interroger sur les causes de sa peine, le réconforter en lui enseignant ce qu’expliquaient mal les grammairiens... Mais personne ne passa, parce que personne ne passe jamais ; et, reconnaissant avec effroi son immense erreur, Jude souhaita quitter ce monde.
Pendant trois ou quatre aimées successives, on put voir un bizarre véhicule, bizarrement conduit, traverser les chemins et les routes aux environs de Marygreen.
Un mois environ après la réception des livres, Jude était devenu insensible au vilain tour que lui avaient joué les langues mortes. La difficulté de l’étude augmenta sa vénération pour la science de Christminster, et il attaqua l’énorme montagne des classiques avec une patience de souris.
Il s’était ingénié à rendre sa présence tolérable chez sa tante qu’il aidait de son mieux. Les affaires de la boulangerie devinrent plus importantes. On acheta un vieux cheval et une charrette à bâche de toile, et trois fois par semaine, Jude alla porter le pain chez les clients des environs.
L’intérieur de la charrette devint la salle d’étude du jeune garçon. Dès que le cheval prenait la route qu’il avait appris à connaître, Jude, les rênes enrouées autour de son bras, ouvrait un volume et se plongeait dans Virgile, Horace ou César, avec une ardeur qui eût mis des larmes dans les yeux d’un pédagogue. Il suppléait à la science qui lui manquait par une divination qui le servait souvent beaucoup mieux.
Les seuls livres qu’il avait pu se procurer étaient des éditions ad usum Delphini, couvertes de notes qui guidaient utilement l’esprit du lecteur. Tandis qu’il étudiait ces pages, feuilletées jadis par des doigts qui se reposaient dans le tombeau, le vieux cheval osseux poursuivait sa route, et les malheurs de Didon étaient interrompus par l’arrêt de la charrette et la voix d’une vieille femme qui criait : « Deux pains aujourd’hui, boulanger, et je vous rends celui qui est rassis. »
Jude était rencontré fréquemment par des passants qu’il ne voyait même pas, et peu à peu, les gens du voisinage commentèrent cette manière de combiner le travail et le plaisir (car on croyait qu’il lisait pour son plaisir). Le procédé n’était pas sans dangers pour eux et pour les voyageurs qui suivaient la même route. On murmura. La police fut avisée des dangereuses habitudes du garçon boulanger. Un agent attendit Jude et le réprimanda.
Comme Jude se levait à trois heures du matin pour chauffer le four, cuire le pain, il était obligé de se coucher immédiatement après avoir quitté le pétrin. Ne pouvant étudier sur les grandes routes, il était condamné à ne plus étudier du tout. Il résolut d’observer tout ce qui se passait autour de lui et de cacher ses livres dès qu’il apercevrait le policeman. Mais celui-ci n’encombra pas beaucoup le chemin de Jude, considérant que si quelqu’un courait un danger dans ces parages solitaires, c’était Jude lui-même ; et souvent, lorsqu’il voyait la bâche blanche entre les haies, il s’en allait d’un autre côté.
Jude Fawley avait seize ans. Il barbotait dans le Carmen Seculare, certain soir, en traversant le plateau de la Maison-Noire. Le soleil déclinait et la pleine lune se levait derrière les bois sur l’horizon opposé. Tout imprégné de poésie, saisi de la même émotion impulsive qui, peu d’années auparavant, l’avait jeté à genoux sur l’échelle, Jude arrêta son cheval, descendit, et s’assurant que personne ne pouvait le voir, il se prosterna, le livre ouvert à la main, sur le bord de la route. Tourné d’abord vers la déesse brillante, qui semblait le regarder avec douceur et ironie, il commença :
Phœbe silvarumque potens Diana !
Revenu au logis, il médita sur cette curieuse superstition, innée ou acquise, qu’il se reprocha comme indigne d’un chrétien. Il avait lu trop de livres païens, sans doute. Il avait pataugé dans Homère, mais ne s’était guère préoccupé du Nouveau-Testament en grec, bien qu’il en eût un exemplaire, acheté d’occasion. Il abandonna donc le dialecte ionien pour un autre, moins familier, et restreignit ses lectures aux évangiles et aux épîtres. Un jour, à Alfredstone, il fit connaissance avec la littérature patristique en achetant quelques volumes des Pères de l’Église chez un bouquiniste où les avait abandonnés un clergyman insolvable.
Le dimanche, il visitait les églises et déchiffrait les épitaphes latines. Dans un de ces pèlerinages, il rencontra une vieille bossue, fort intelligente et qui lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Elle lui parla plus encore du charme romantique de la cité de lumière et de science. Jude fut plus résolu que jamais d’y aller.
Mais comment vivre dans cette ville ? Il n’avait ni rentes ni métier qui lui permit de subsister pendant des années de travail intellectuel.
Que réclame-t-on à la ville ? La nourriture, le vêtement, le logis. Ne pouvant être ni cuisinier ni tailleur, Jude pensa à son oncle inconnu, le père de sa cousine Suzanne, qui avait taillé la pierre. Il ne pouvait mal faire en suivant l’exemple de son parent.
Il obtint d’abord quelques petits blocs de pierre de taille, sans grande valeur ; puis s’étant fait remplacer chez sa tante, il offrit ses services à un tailleur de pierre pour des gages dérisoires. Plus tard, il entra chez un entrepreneur d’Alfredston, et, sous la direction d’un architecte, il restaura habilement plusieurs églises de village.
Sans oublier que cet humble métier devait servir à réaliser de grands rêves, il prit de l’intérêt à ce travail. Toute la semaine il habitait dans la petite ville, et le samedi soir seulement il retournait à Marygreen. C’est ainsi qu’il atteignit et dépassa sa vingtième année.
À cette époque mémorable de sa vie, certain samedi, vers trois heures, Jude s’en retournait d’Alfredston à Marygreen. Il faisait un beau temps d’été, doux et chaud. Le jeune homme marchait, portant ses outils dans un paquet, sur son dos. Comme il devait faire une commission pour sa tante, dans un moulin du voisinage, il n’avait pas pris le chemin habituel.
Jude était dans un état d’enthousiasme singulier. Il songeait qu’avant deux ans il pourrait s’établir à Christminster et frapper aux portes de ces forteresses de la science qui l’avaient tant fait rêver. Une joie chaleureuse l’envahissait quand il considérait les progrès accomplis.
Il songeait qu’il lisait parfaitement bien les classiques latins ; qu’il connaissait deux livres d’Homère, quelque peu Hésiode, Thucydide et le Nouveau-Testament. Il avait étudié les mathématiques dans le premier, le sixième, le onzième et le douzième livre d’Euclide. Il savait quelque chose de l’histoire d’Angleterre. C’était un commencement, mais il devenait difficile de se procurer les livres nécessaires. Il devait donc concentrer toutes ses énergies pour entrer dans un des collèges de Christminster.
– Je finirai bien par être docteur en théologie !
Il étudierait les auteurs qu’il ne connaissait point ! Tite-Live, Tacite, Eschyle, Sophocle, Aristophane, etc...
– Ah ! ah ! ah !...
Des rires légers bruissaient de l’autre côté d’une haie, mais Jude n’y prit point garde. Ses pensées allaient bon train.
– Je lirai Euripide, Platon, Aristote, Lucrèce, Épictète, Sénèque, Marc-Aurèle...
– Ah ! ah ! ah !...
– Je travaillerai avec acharnement... Oui, Christminster sera mon Alma Mater, et je serai son fils bien-aimé, en qui elle mettra toutes ses complaisances...
En rêvant à l’avenir, Jude s’était arrêté, immobile, regardant la terre. Soudain, il sentit un coup sur l’oreille, et il vit tomber à ses pieds un morceau de vessie de porc.
La haie bordait un ruisseau d’où montaient les rires et les voix qui avaient troublé la rêverie de Jude. Il gravit le talus et regarda par-dessus la clôture. Au bord du ruisseau, il y avait une maisonnette entourée de jardins et de porcheries. Sur la rive, trois jeunes filles agenouillées lavaient des andouilles dans l’eau courante. Leurs yeux se fixèrent sur Jude, puis elles s’entre-regardèrent et continuèrent leur travail.
– Je vous remercie bien, dit Jude, sévèrement.
– Je vous dis que n’ai rien jeté, dit l’une des filles à sa voisine, sans paraître remarquer Jude.
– Ni moi, dit l’autre.
– Oh ! Anny, comment pouvez-vous... fit la troisième.
– Bah !... Je m’en moque pas mal !
Et elles riaient en continuant leur travail.
Jude s’essuya la joue. Il devint moqueur.
– Vraiment, ce n’est pas vous ? dit-il à la plus proche des trois.
Celle qu’il interpellait était une brune aux yeux noirs, qui, sans être parfaitement belle, pouvait paraître belle à quelque distance, malgré sa peau rude et sa chair grossière. Elle avait une gorge arrondie et proéminente, des lèvres pleines, des dents parfaites. C’était véritablement la femelle humaine – ni plus ni moins ; et Jude la reconnut pour l’auteur du délit, la vessie de porc dont elle avait arraché le morceau gisant encore à côté d’elle.
– Ça, vous ne le saurez jamais.
– C’est en tout cas quelqu’un qui ne ménage guère le bien d’autrui.
– Oh ! il n’y a pas de mal : le porc est à mon père.
– Vous voulez que je vous le rende quand même, n’est-ce pas ?
– Oui, si vous voulez me le donner.
– Dois-je vous le jeter, ou bien passerez-vous la planche pour venir le prendre de ma main ?
Les yeux noirs le fixèrent pendant qu’il prononçait ces mots. Une lueur d’intelligence y brilla, muette révélation d’une affinité possible entre cette femme et Jude, qui était bien loin de s’en douter. Elle avait remarqué qu’il l’avait distinguée entre trois, comme une femme peut être distinguée en de telles circonstances, par instinct, non par choix. Elle se leva et dit :
– Ne jetez pas cela. Donnez-le-moi.
Jude posa son paquet d’outils, prit le morceau de parc au bout d’une baguette et escalada la clôture. Tous deux marchèrent parallèlement, sur les deux rives du ruisseau, jusqu’à la planche qui servait de pont. Comme la jeune fille approchait, elle pratiqua, sans que Jude s’en aperçût, une adroite succion dans l’intérieur de ses joues, et cette curieuse manœuvre dessina une fossette parfaite sur la surface arrondie. Cette production des fossettes à volonté est un tour d’adresse bien connu, mais difficile à réussir.
Ils se rencontrèrent au milieu de la planche, Jude tendit sa baguette avec le morceau de porc ; la fille le prit sans y regarder et le posa sur le rebord du pont.
– Vous ne croirez pas que je vous ai jeté cela ?
– Oh ! non !
– Et vous ne le raconterez à personne ?
– Je ne connais même pas votre nom.
– C’est vrai. Dois-je vous le dire ?
– Dites.
– Je m’appelle Arabella Down. J’habite ici. Mon père est éleveur de porcs, et les filles que vous voyez m’aident à laver les boyaux pour les boudins et les andouilles.
Ils se parlèrent encore et encore, regardant le flasque objet qui ballottait sur le parapet du pont. Le muet appel de la femme à l’homme, qui émanait de toute la personne d’Arabella, frappa Jude, contre sa volonté, d’une manière nouvelle à son inexpérience. On pourrait dire sans exagérer, que, jusqu’à ce moment, Jude n’avait jamais regardé une femme en tant que femme, considérant que ce sexe n’avait aucun rôle à prendre dans sa vie. Il examina Arabella des yeux à la bouche, puis à la poitrine, et aux bras rougis par l’eau, mais fermes comme le marbre.
– Quelle belle fille vous êtes ! murmura-t-il, bien qu’il n’y eût pas besoin de paroles pour traduire le charme qui agissait magnétiquement sur lui.
– Ah ! si vous me voyiez les dimanches ! dit-elle d’un air piquant.
– Ce n’est pas impossible ?
– Ça dépend de vous. Précisément, je n’ai pas d’amoureux, bien que j’en puisse avoir un avant quinze jours, si je veux.
Elle avait dit cela sans sourire ; les fossettes avaient disparu.
Jude se sentait aller à la dérive, sans qu’il y pût rien.
– Me permettez-vous de venir ?
– Pourquoi pas ?... ça m’est égal.
Les fossettes reparaissaient.
– Alors, à demain, dit-il.
– Oui.
Elle le suivit des yeux avec un air de triomphe, puis, jetant le débris de porc dans l’herbe, elle rejoignit ses compagnes.
Jude Fawley ramassa son paquet et reprit son chemin, singulièrement troublé. Les beaux projets d’étude s’étaient évanouis sans qu’il sût pourquoi.
« C’est tout simplement une mauvaise farce », se disait-il, sentant qu’il perdait le sens commun et que le Jude épris de belles-lettres et absorbé par le rêve de Christminster ne pouvait sympathiser avec cette fille. Une vestale n’eût pas choisi un tel moyen d’entrer en relation. Jude vit cela, avec l’œil de l’esprit, dans une lueur, comme à la clarté d’une lampe mourante on pourrait voir une inscription sur un mur avant qu’elle ne soit ensevelie dans l’ombre. Puis, la lueur s’éteignit et Jude resta aveugle à tout, devant l’avènement d’un plaisir inconnu... Un instinct insoupçonné le domina. Il résolut de revoir la femme qui l’embrasait.
Celle-ci avait rejoint ses compagnes et recommencé ses lavages silencieusement dans le clair ruisseau.
– Il est pincé, ma chère ? demanda laconiquement celle qu’on appelait Anny.
– Je ne sais pas... J’aurais préféré lui jeter autre chose, murmura Arabella d’un ton de regret.
– Seigneur ! mais ce garçon-là n’est rien du tout, quoi que vous pensiez. Il conduisait la carriole de la vieille Drusilla Fawley avant d’entrer en apprentissage à Alfredston. Maintenant il se croit quelqu’un. Il lit toujours. On dit qu’il veut être étudiant.
– Je me moque de lui et de ses histoires... Qu’allez-vous penser là, ma petite ?
– Allons donc ! N’essayez pas de nous tromper. Pourquoi lui avez-vous parlé, si vous vous moquez de lui ? Il est aussi simple qu’un enfant. Je crois vous revoir sur le pont faisant des grâces, avec ce morceau de porc entre vous... Ce garçon-là est à la première qui voudra le prendre, pourvu qu’elle sache le mettre dans le bon chemin.
Le lendemain, Jude était assis dans sa chambre, devant la petite table couverte de livres. Il s’était proposé d’examiner ce jour-là une nouvelle édition grecque du Nouveau Testament et, la veille encore, cette perspective le réjouissait. Mais un événement imprévu avait brisé le cours égal de sa vie, et il se demandait s’il irait au rendez-vous fixé par Arabella.
Il décida de rester.
Les coudes sur la table, ses mains pressant ses tempes, il commença :
H KAINH ΔIAΘHKH
Et pourtant, si cette pauvre fille allait se morfondre à l’attendre ? Il ne pouvait pas lui manquer de parole. Un après-midi perdu, ce n’était pas un grand malheur. D’ailleurs, il comptait ne jamais revoir Arabella...
Il ferma son livre, poussé par une force supérieure qui ne ressemblait en rien à celles qui avaient dirigé sa vie. Déjà, il avait mis ses plus beaux vêtements, et, en moins de trois minutes, il fut dehors.
Ayant consulté sa montre, il pensa pouvoir revenir dans deux heures, ce qui lui permettrait d’étudier un peu avant le dîner.
Il se dirigea vers la maison d’Arabella, qu’il devina de loin à l’odeur des étables et aux grognements des porcs. Il entra dans le jardin et heurta la porte avec le pommeau de sa canne.
Quelqu’un l’avait aperçu par la fenêtre, car une voix masculine s’éleva dans l’intérieur de la maison.
– Arabella ! voici votre jeune homme qui vient vous faire sa cour. Décampez, ma fille !
Jude hésita, pris de répugnance, car il ne pensait guère à cette cour dont on parlait si délibérément. Il avait tout juste envie de promener Arabella, de l’embrasser, peut-être, mais, quant à la courtiser, il n’y songeait guère. La porte s’ouvrit. Il entra au moment où Arabella, en costume de promenade, descendait les escaliers.
– Asseyez-vous, monsieur Je-Ne-Sais-Qui, dit le père, un homme à mine énergique, à gros favoris noirs, de cette même voix déplaisante qui semblait régler une affaire.
– J’aimerais mieux sortir, murmura la fille à l’oreille de Jude.
– Oui, répondit-il. Nous irons jusqu’à la Maison-Noire et nous reviendrons. Il n’y en a pas pour une demi-heure.
Arabella semblait si jolie qu’il ne regretta plus sa visite.
Ensemble, ils gravirent la grande dune et Jude dut prendre la main d’Arabella pour lui faciliter l’ascension. Ils parvinrent jusqu’à ce lieu qui avait été pour Jude un lieu de pèlerinage quand il souhaitait apercevoir Christminster. Mais il ne s’en souvenait plus. Il prenait aux bavardages d’Arabella le même intérêt qu’aux discussions les plus philosophiques, marchant d’un pied léger, et tout honoré, tout glorieux, lui, futur professeur, docteur ou évêque, que cette jolie fille voulût bien se promener avec lui dans ses atours du dimanche. Arrivés à la Maison-Noire, ils aperçurent une colonne de fumée dans la direction d’un bourg voisin.
– Un incendie ! dit Arabella. Courons le voir. Ce n’est pas loin.
La tendresse croissante de Jude ne lui permit pas de contrecarrer ce désir, qui lui fournissait une excuse pour la prolongation de la promenade. Ils descendirent la colline, marchèrent l’espace d’un mille et virent que l’incendie était plus éloigné qu’ils ne l’avaient cru d’abord. Il n’était pas tout à fait cinq heures quand ils arrivèrent sur le lieu du sinistre. Tout était fini. Après un rapide regard sur la mélancolie des décombres, ils se dirigèrent vers Alfredston.
Arabella ayant dit qu’elle désirait du thé, ils entrèrent dans une toute petite auberge ; mais on les fit attendre assez longtemps. La servante avait reconnu Jude, et témoigna tout bas à la patronne son étonnement de voir cet étudiant, qui semblait si fier de lui, s’abaisser jusqu’à la compagnie d’Arabella. Celle-ci devina la réflexion et jeta sur Jude le regard amoureux et triomphant d’une femme qui voit réussir ses projets.
Ils s’étaient assis et regardaient la salle, la peinture représentant Samson et Dalila, le cercle des chopes d’étain sur la table et les crachoirs pleins de sciure de bois. Le soir venait. Ils ne pouvaient guère attendre plus longtemps et Jude se sentait pris de mélancolie à l’aspect de cette auberge.