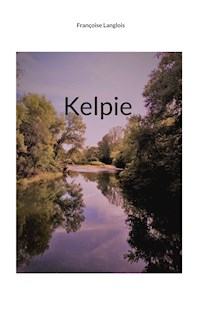
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La kelpie créature magique des légendes écossaises, imprègne l'oeuvre ultime d'un peintre tourmenté et bouleverse la vie de celles et ceux qui croient la posséder. De Portsoy, petit port écossais, fin du XIXe siècle, aux Cévennes gardoises de nos jours, elle est le témoin d'espoirs vains, de vies déchirées et de bonheurs aux fortunes diverses. Dans une ambiance parfois sombre, l'histoire de ces destins évolue peu à peu entre tendresse et légèreté.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes fils Clément et Florent
Nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous,
Puisque c'est par hasard que nous vivons.
Sénèque
Sommaire
Prologue
Première partie
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Deuxième partie
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Prologue
Juillet 1890
Le clapotis de plus en plus insistant des vagues contre la coque, imprime à la petite barque de pêcheur un mouvement désagréable. Depuis quelques instants, le vent s’est levé, gonflant dangereusement l’unique voile usée et rapiécée. Duncan Scott n’est pas téméraire, il se rend à l’évidence : renoncer à sa sortie en mer sera la décision la plus sage, même si depuis qu’il a quitté le port, deux heures auparavant, sa pêche se résume à une seule malheureuse prise.
Il jette le poisson au jeune phoque gris qui l’amuse de ses facéties depuis un bon moment. L’animal tantôt bavard, tantôt silencieux s’est chargé jusque-là de lui tenir compagnie. L’air gourmand, la bête saisit au vol sa récompense et plonge d’un mouvement fluide. Duncan lui envoie un signe d’au revoir, puis, manipulant cordages et barre avec dextérité, il entreprend de tirer des bords jusqu’à la petite crique nichée à côté de Portsoy. La manœuvre est délicate, il ne s’agit pas de manquer la passe et de perdre son embarcation sur les rochers battus par la houle. Ramant avec vigueur, en une poignée de minutes, il arrive, voile affalée. Il échoue son embarcation dans le sable de la crique, ajuste sa veste de toile huilée et court s’abriter un peu plus loin dans une cavité, au pied de la falaise.
C’est la dernière fois qu’il pêche. Vers midi, il ira chez son ami Darren qui l’emmènera, comme convenu, en carriole à quelques miles de là, en direction d’Aberdeen. Maussade, Duncan observe le ressac sans vraiment le voir. Son esprit vagabonde. Il pense à ce qu’il va quitter, et tout d’abord à Aileas, la jolie Aileas ! Ses longs cheveux tressés, ses yeux bleus au regard franc, son rire clair, son allure de fille viking, sa façon de croquer la vie sans se poser de questions. Elle n’exige rien de lui, elle n’attend rien. Lorsqu’il lui donne rendez-vous, elle le rejoint sans se faire prier, après sa journée de travail à l’auberge de ses parents. Il la culbute alors dans la paille de la grange du village. Elle se tortille sous la chatouille de ses mains et glousse d’impatience. Il goûte la chaleur animale de sa peau, la fermeté de son corps, la douceur de son souffle. Elle l’effleure d’une main légère, pétrit ses muscles, se serre contre son ventre, voluptueuse, avant de s’offrir à lui.
La fraîche simplicité d’Aileas le fatigue. Elle ne l’amuse plus. S’il s’en allait, il ne croit pas qu’il lui briserait le cœur. Non pas qu’il souhaite se montrer cruel avec elle, mais il n’a plus envie d’être avec elle. Il n’a d’ailleurs plus envie de rien ici. Le Grampian, un pays où les villages se suivent de loin en loin, linéaires, adossés à des falaises abruptes, ou bien blottis dans des anses, regardant une mer du Nord glaciale, aux reflets gris-vert, mystérieuse, inquiétante. Les hameaux tournent le dos aux Highlands plantés de « crofts », petites fermes misérables, et leurs habitants subissent les colères de la mer avec fatalisme, scrutant la ligne d’horizon qui se fond dans le plomb du ciel, comme s’ils guettaient l’arrivée d’étranges envahisseurs. Un pays qui se nourrit de pêche, d’élevage de moutons, et de croyances millénaires. La vie s’y écoule au rythme du travail, des soûleries à la taverne, des fêtes païennes sur fond de superstitions. Parfois, certains s’en vont, rejoignant la cohorte de miséreux qui convergent vers les mines du sud ou s’embarquent pour l’Amérique. Un croft de plus se délabrera, tombera en ruines dissoutes par les pluies, comme gobées par la tourbe.
Duncan se sent étranger à cet endroit, il ne possède rien, même pas cette pauvre barque dans la crique. Elle appartient au vieux Peter qui la lui prête lorsqu’il le souhaite. Rien ne le retient sur cette terre trop rude. Sans famille depuis longtemps, il se veut libre.
Devenu orphelin, Peter et sa femme Moira l'ont recueilli quand il était encore bambin. Ils se sont attachés à l’enfant. Ils lui ont donné tout ce qu’un gosse peut souhaiter : un toit, une assiette pleine deux fois par jour, des vêtements chauds, une affection bourrue. Ils l’ont envoyé à l’école et, parce qu’il passait des heures à crayonner sur toutes les surfaces imaginables, ils lui ont même trouvé des feuilles de papier et des couleurs, payées une fortune aux colporteurs de passage.
Oui, Duncan aime la peinture plus que tout. Peut-être plus que les gens eux-mêmes… Personne ne lui a enseigné l’art de mélanger les couleurs, ni celui des perspectives ni le jeu des ombres et des reliefs. Il a tout découvert par lui-même ! À huit ans il peignait déjà des aquarelles étonnantes. Fasciné par les reproductions examinées sur les calendriers, qu’ici tout le monde se gardait bien de jeter et qui moisissaient, ficelés dans les soupentes, envoûté par les motifs ornant les boîtes à biscuits, ou les dessins imprimés dans les rares journaux qui arrivaient à l’auberge et que bien peu savaient lire, il avait peu à peu acquis toutes les techniques de base. Puis, solitaire, il avait pris l’habitude, à ses heures libres, de partir sur la lande, avec son matériel, lorsque la bruyère rosie adoucissait le sol de nuances pastel. Quant on ne le trouvait pas dans les terres, c’est qu’il était sur la falaise ou sur la grève, peignant la mer, les embarcations, les ramasseurs de coquillages à marée basse, et parfois le troupeau de vaches aux longues cornes, à frange épaisse, au pelage roux, bourru, ruminant sur le sable. Il avait l’obsession du détail et surtout la volonté de capturer la lumière, l’apprivoiser, la coucher sur le papier, pour qu’elle éblouisse, et jaillisse hors de la feuille.
Mais aujourd’hui Duncan a délaissé son attirail de peintre. Il passe une main longue et maigre dans sa chevelure noire, dégageant ses yeux clairs. Il regarde, au loin, la petite maison à un étage, blanche au toit gris, cherchant le courage nécessaire pour annoncer sa décision à ses parents adoptifs. Il n’a qu’un vague souvenir de sa mère car il est arrivé ici, depuis une ville du sud de l’Angleterre, presque bébé, enfant fardeau, traîné par une fille mère usée et sans tendresse. Elle l’a laissé seul au monde, à sept ans. Son cœur est devenu insensible et solitaire, même s’il est conscient que Peter et Moira l’ont sauvé d’une enfance à l’asile, plus cruelle encore.
Son seul ami est Darren, le fils d’un paysan un peu plus riche que les autres villageois. Le troupeau de vaches que Duncan a si souvent admiré appartient à la famille de ce gaillard. Darren fait partie des rares gosses qui ne se moquaient pas de lui lorsqu’il était écolier. Dieu sait pourquoi, il avait rapidement pris le petit bâtard sous sa protection et lui avait évité bien des ennuis. Duncan et lui ont souvent parlé de Londres. Admiratif, peut-être parce qu’il sait qu’il n’aura pas lui-même le courage de s’inventer une autre vie, Darren n’a jamais tenté de dissuader Duncan, au contraire, il lui a promis son aide le moment venu.
La pluie s’est calmée. Il déplie sa longue carcasse et se dirige à pas lents vers le village. Il s’arrête d’abord à l’auberge pour voir une dernière fois Aileas. La salle est vide à cette heure-là, pas encore ouverte aux clients. Il contourne la maison et entend la jeune fille fredonner dans la cuisine. Elle aime la musique, d’ailleurs elle chante souvent lors des fêtes, parfois elle emprunte le fiddle de son père, un violon rustique d’ici, et joue des airs entraînants ou nostalgiques, suivant son humeur… Ses parents n’apprécient pas le garçon, mais il n’y a aucun risque de les rencontrer, ils se sont rendus, dès les premières lueurs de l’aube, à la foire de Fochabers, un hameau éloigné, et ne seront pas de retour avant la fin de la journée. Il frappe doucement au carreau, Aileas, surprise, s’approche de la fenêtre, elle l’entrouvre légèrement :
— Tu arrives bien tôt, j’ai plusieurs heures de travail devant moi ! Retrouvons-nous comme d’habitude, après la fermeture…
— Non, je ne pourrai pas. Il faut que nous parlions maintenant.
— Bon, d’accord. Je vais ouvrir la salle. Nous serons tranquilles, il n’y a personne. Charmeuse, elle ajoute : personne ne verra que nous nous embrassons…
Ils s’asseyent l’un en face de l’autre. Aileas a allumé une bougie qu’elle a posée entre eux, elle va repartir chercher des chopes, mais Duncan l’en empêche.
— Assieds-toi et écoute-moi !
Elle obéit à son intonation un peu brutale.
— Je ne serai pas là ce soir. Je pars pour Londres. Je quitte Portsoy définitivement. Je ne reviendrai pas. Je t’en ai déjà parlé !
— J’espérais que ce n’étaient que des paroles en l’air…
Aileas s’est exprimée d’une voix blanche.
— Je veux apprendre l’art de la peinture et parcourir le monde. Je ne peux rien construire dans ce village. Je n’y suis pas heureux. Il y a très longtemps que j’y pense, tu le sais, ma décision est prise. Je suis venu te dire adieu.
Pendant qu’il lui parlait, l’expression d’Aileas a changé. Les larmes inondent ses joues et Duncan se rend compte qu’il ne ressent rien. Il est là, comme un étranger. À la lueur de la bougie, il voit le frais visage inondé de pleurs, les cheveux blancs à force d’être blonds, pour une fois non pas tressés, mais coiffés en une savante cascade retombant sur les épaules, il aperçoit la naissance de la poitrine généreuse dans l’échancrure du décolleté, et, à cet instant, il éprouve seulement le désir de la peindre ! Comment s’y prendrait-il pour rendre l’effet mouillé des larmes sur cette figure bouleversée, comment reproduire l’eau dans ces yeux bleu orage, comment donner l’effet gonflé de cette petite bouche rouge, comment imiter la pâleur de son teint ? Il n’a pas d’émotion, il est seulement un œil, un œil de peintre… Quant à Aileas, elle le surprend : elle s’essuie d’un revers de main et chuchote doucement, la gorge nouée :
— Je ne suis peut-être qu’une pauvre fille ignorante, mais depuis toujours je t’ai aimé. Alors que les enfants d’ici se moquaient de toi, j’étais attirée par le mystère qui t’entourait. Pendant tous ces longs mois où je croyais que nous nous aimions, je m’accommodais de tes airs farouches. Je calmais ma peur lorsque tu disais qu’un jour tu quitterais Portsoy, en voulant croire que je comptais pour toi…
Duncan est déterminé, il ne répond rien. Il sait qu’il est abrupt, mais il ne la prendra pas dans ses bras pour la consoler, il ne cherchera pas à adoucir sa peine. Il ne faiblira pas. Aileas brûlante et glacée à la fois, se sent submergée par une douleur bien plus profonde que la tristesse : le désespoir. Déçue, abandonnée, vide, elle reprend son souffle un instant, et hoche la tête comme si elle comprenait enfin une évidence.
— Je ne t’ai jamais parlé de moi, de mes goûts, j’avais peur de t’embêter, et de toute façon tu ne me posais pas de questions. Je souhaitais ton bonheur, et le mien à tes côtés, alors que je n’étais, pour toi, qu’une fille d’auberge bien arrangeante.
Elle se dresse devant lui en pointant fièrement le menton, et termine d’une voix où pointe le mépris, avant de disparaître dans l’arrière-salle :
— Je n’avais espéré que ton cœur, mais tu n’en as pas ! Tu as raison de partir, va-t-en Duncan !
Aveuglé par son égoïsme, Duncan s’est trompé sur Aileas, mais il est trop tard. Sourd à cette poignante déclaration, aussi froid et dur qu’une pierre, il rentre chez lui.
§§§
Peter entend son garçon, et il s’insurge :
— Alors, comme ça, ta décision est prise ?
— Oui, tu le sais bien, je ne t’apprends rien ! J’en ai souvent parlé ! J’ai déjà dix-neuf ans. Je ne vais pas passer ma vie ici ! Je veux aller à Londres. Voir les musées, rencontrer des maîtres, apprendre les techniques, découvrir de nouveaux sujets, apprivoiser les lignes, les formes et la lumière…
— Tu n’es pas encore un homme ! J’ai peur que tu regrettes ton choix !
Duncan soupire, indifférent, puis il regarde Peter droit dans les yeux.
— Qui peut le dire ? Je n’ai plus envie de cette routine, qu’est-ce que cet endroit m’offre d’autre que la mer, avec la pêche, le fumage des poissons et la fabrication de bateaux, où alors la carrière de marbre et la taille de serpentine ?!... Je peux faire autre chose ! Je le sais ! Je veux tenter ma chance, avoir une autre vie ! Les déplacements jusqu’à Aberdeen pour trouver du papier à dessin ou des couleurs sont une véritable expédition, et jamais je n’ai rencontré qui que ce soit pour m’enseigner l’art ! Je veux apprendre… apprendre et découvrir le monde ! Si je reste ici, je n’avancerai pas, je crèverai à petit feu…
Il esquisse un sourire :
— Je pars, mais qui sait, je reviendrai peut-être célèbre…
— En attendant, Moira sera rongée d’inquiétude ! Tu sais combien elle redoute que tu t’éloignes d’elle…
— Mais je ne pars pas à la guerre ! Je pars vivre ma vie ! Je vous donnerai des nouvelles… Je vous écrirai, promis…
Assis sur le banc devant la robuste table de bois brut, Peter insiste. Il a l’air accablé.
— Si encore tu te contentais d’Aberdeen… ou Edinburgh, ou même Glasgow, pourquoi diable faut-il que tu ailles à Londres ! ? Partir, d’autres l’ont fait avant toi, vers le Nouveau Monde, l’Australie et même le pays de Galles pour travailler dans les mines. Aucun n’est rentré, Dieu sait ce qu’ils sont devenus, et eux ne partaient pas pour dessiner !
Maintenant le père adoptif s’échauffe, il a légèrement haussé le ton, son cou se gonfle, ses pommettes sont un peu rouges, ses sourcils se froncent. Il y a de l’indignation dans son attitude. Il n’admet pas le caprice de Duncan même si quelque chose lui dit que le jeune homme n’a peut-être pas complètement tort. Ce gamin les fait tourner en bourrique. Ils ne lui ont jamais rien refusé à celui-là. Lorsqu’il a souhaité dessiner, ils l’ont laissé faire à sa guise, ils ont même consenti des sacrifices pour lui payer du matériel. Duncan n’a jamais été un garçon bavard, chaleureux ou rigolard. C’était plutôt le genre austère, têtu et indépendant mais malgré tout bon travailleur, intelligent, volontaire, on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose, si ce n’était son ingratitude, aujourd’hui !
En réalité, l’homme usé avant l’âge n’ose pas dire ce que la pudeur l’a toujours empêché de confier : il aime ce fils bien qu’il ne soit pas de lui, il est tout autant fier de l’attitude de Duncan, qu’inquiet et malheureux.
Moira a suivi la conversation depuis la pièce d’à côté, celle qui sert d’étable à leur unique vache. Elle se dirige vers Duncan, résignée. Elle sait combien il est rebelle, elle connaît son talent et son indépendance. Ils ont discuté à plusieurs reprises de son désir de quitter Portsoy ces derniers mois. Ce matin, elle a vu son barda caché dans la paille. L’heure est venue, elle sait qu’il ne reviendra plus sur sa décision. Alors que Peter tente désespérément de le retenir avec un : « Mais pauvre fou, tu ne connais personne à Londres !… » Moira s’approche de Duncan, presse sa main entre ses doigts calleux et fixant son jeune et beau visage lui murmure : « Va mon garçon, fais comme bon te semble. »
Duncan sourit, décidément, les femmes de ce pays ne manquent pas de caractère ! Il la serre tendrement dans ses bras, renouvelle sa promesse de lui écrire et l’embrasse une dernière fois, puis il attrape son sac déposé dans l’étable et s’en va rejoindre Darren qui l’attend avec sa carriole à la sortie du village.
Première partie
1
Octobre 1890
Duncan Scott était plus seul et efflanqué que jamais. Depuis son départ de Portsoy sa vie n’avait ressemblé qu’à une très longue errance, croisant parfois la route de pauvres gens, fuyant comme lui une vie sans lendemain. Il était descendu des Highlands au gré de sa fantaisie, admirant les nombreux châteaux, certains habités, visibles seulement de loin, et d’autres en ruines, qui lui servaient de refuge durant les nuits trop fraîches. Il avait couru pour échapper aux morsures des chiens lancés à sa poursuite, lorsqu’il s’approchait trop près des fermes cachant des distilleries clandestines de whisky. Il avait contemplé la lumière sur les monts et les rivières, et rêvé devant le fameux mur d’Adrien, cette antique frontière, ouvrage de tourbe et de pierres, destinée à protéger l’Empire romain des barbares du nord. Elle serpentait à travers la campagne de manière troublante. Le spectacle serein et harmonieux qu’offrait cet édifice se fondant si bien dans la nature ressemblait à un leurre, comme si une menace, invisible, mais terrible, persistait au-delà du temps. Bien sûr, il ébaucha maints croquis sur des feuilles surchargées, où, la place manquant, il rajoutait dessin sur dessin. Ces brouillons venaient se froisser au fond d’un semblant de pochette serrée dans son maigre bagage.
Duncan n’avait vécu que de petits travaux, prêtant son aide pour une soupe ou quelques cents aux paysans lorsqu’il se trouvait à l’intérieur des terres et aux pêcheurs lorsqu’il longeait la côte. Pour économiser son maigre pécule, il s’était nourri de pommes maraudées dans les vergers et de poissons habilement pêchés dans les cours d’eau. Mais, le plus souvent, il s’était couché le ventre creux, recroquevillé sur son estomac douloureux pour étouffer ses appels, et l’esprit torturé par le souvenir d’Aileas qui s’insinuait subrepticement dans son esprit.
Pas un instant il ne regretta son choix, cependant ses pensées le ramenaient souvent vers la jeune fille. Il s’était cru blasé de sa présence, il s’était mépris sur son compte, sur son importance. Souvent il évoquait l’odeur de grand air qui imprégnait ses mèches blondes, et le léger parfum sucré de violette que la savonnette laissait sur son corps. Il revoyait sa peau blanche rosie par l’émotion aussi parfaite que la texture d’un pétale de fleur et son cou gracieux où moussaient de petits cheveux dorés échappés de sa coiffure. Il aurait aimé plonger à nouveau son regard dans ses yeux d’un extraordinaire bleu-gris. Il aurait souhaité sentir la présence discrète de celle qui l’accompagnait avec tant de respect durant les longues heures où il s’absorbait dans la réalisation d’une aquarelle. Elle s’asseyait à ses côtés et le contemplait, silencieuse, attentive, déférente… Il était l’artiste, et elle, l’adoratrice ! Il aurait voulu, encore une fois, poser sa tête sur ses genoux et qu’elle caresse son front de sa main fraîche tout en lui murmurant des paroles réconfortantes, comme elle le faisait lorsqu’il était triste et qu’il doutait de tout. Alors, pour ne pas se rendre plus malheureux encore, il repoussait ses idées mélancoliques et s’absorbait dans des réflexions plus pratiques concernant son itinéraire du lendemain…
Un matin Duncan arriva à Londres. Il n’aurait su dire le nom des quartiers parcourus. Il progressa dans les rues, les yeux écarquillés sur tout ce qui l’entourait, comme un archéologue qui fouille avec précaution des strates géologiques, rencontrant des bonheurs et des déceptions, craignant de manquer un détail, et se réjouissant à la perspective de ce qu’il allait découvrir. D’un abord champêtre, la ville se révéla vite changeante, noire, sale, pauvre et nauséabonde. Il vit des habitations de briques aux murs noircis de pollution, il respira un air épaissi par l’odeur de charbon se consumant dans les maisons tristes, vicié par la puanteur de tanneries. Il croisa le regard d’hommes, de femmes et d’enfants fatigués lui rappelant l’expression de sa mère… Puis il arriva dans des rues populaires, commerçantes, animées, avant de s’enfoncer dans des allées calmes, plantées d’arbres dissimulant des hôtels particuliers de style victorien dont les somptueuses façades blanches ou de briques ocre s’alignaient le long de carrés gazonnés, démarqués de la rue par des murets surmontés de hautes grilles fermées de portails monumentaux. Enfin, guidé par le son des cloches il aboutit à proximité de la Tamise devant le majestueux palais de Westminster et l’imposante tour de l’Horloge, Big Ben. En continuant sa route, il parvint au cœur de la ville, là où les avenues se croisaient, encombrées d’attelages luxueux, d’hommes vêtus de costumes sombres, chaussés avec élégance, de dames couvertes de fatras soyeux et froufroutants, la tête coiffée de chapeaux aussi étranges qu’inutiles.
Plus intéressé encore par les boutiques, il observa, incrédule, la vitrine d’un chocolatier de Old Bond Street regorgeant de boîtes enrubannées, puis la devanture d’acajou d’un parfumeur de Jermyn Street dans laquelle étaient exposés des objets de cristal, d’argent, d’écaille et d’ivoire. À New Oxford Street, il étouffa un ricanement devant la pompeuse boutique de James Smith and Sons, spécialisée dans la vente de parapluies. Il fut surpris par la futilité et de la préciosité de ces magasins. Demandant son chemin aux passants, il se rendit, sans plus se laisser distraire à la National Gallery près de Trafalgar Square, un édifice lourd, surmonté d’un dôme à coupole, divisé en vingt-deux salles, comprenant mille cinq cents tableaux classés par époque et par école.
Il y entra aussi respectueusement que dans un lieu saint, et passa le reste de sa journée à admirer les œuvres, sans jamais se lasser, ému aux larmes devant certaines toiles. Il commença par l’école toscane, et s’extasia devant le portrait d’un jeune homme de Botticelli, puis il enchaîna, au hasard, l’école de Sienne, la vieille école flamande, puis les différentes écoles anglaises, jusqu’à l’époque moderne avec plusieurs tableaux signés de Constable, Tuner, Millais… Il découvrit des œuvres d’artistes dont il ignorait l’existence. Comme s’il avait rencontré des divinités, sa mémoire essaya tant bien que mal d’enregistrer leurs noms. Butinant d’une œuvre à l’autre dans des pièces plus ou moins favorablement éclairées, il savoura chaque seconde écoulée en compagnie des maîtres. La visite aurait nécessité plusieurs jours, et il était très loin d’avoir fait le tour de toutes les salles lorsqu’il resta pétrifié devant « The Hay Wain » – La charrette à foin – de John Constable. Le tableau figurait une charrette délabrée traversant une rivière peu profonde sous un ciel lourd et menaçant. Deux personnages hélaient les chevaux pour les faire avancer comme si l’attelage embourbé s’était figé là, au milieu de l’eau. Sur la rive, au premier plan, à proximité d’une chaumière au toit de tuiles rouges, un petit chien semblait s’agiter en observant la scène, on aurait dit qu’il courait de long en large en aboyant des encouragements inquiets. De l’autre côté du cours d’eau, on distinguait une vieille barque échouée dans la végétation. L’onde brillait d’un reflet d’étain sombre. On devinait au loin, posés sur un relief plat, les prés et les arbres, déclinant différentes nuances de vert, de jaune, de gris, dans une vision typique de la campagne anglaise. À partir de l’instant où Duncan se trouva face à cette œuvre, le temps s’arrêta. Il n’était plus dans un musée londonien, il était dans cette campagne, avec ces gens qui menaient une lutte banale et quotidienne. Il était sur la berge, il respirait l’odeur d’herbe humide et la transpiration des chevaux. Il criait des conseils et rassurait d’une caresse le petit King Charles Spaniel blanc et brun. Ce tableau lui racontait une scène ordinaire, réelle, et pourtant, sans tricher, il la magnifiait, lui donnait une sorte de noblesse ! Le jeune homme, béat, se demandait comment une telle magie était possible…
Duncan sursauta. Quelqu’un venait de toucher son bras.
— Monsieur, vous m’entendez ? Il faut partir. Nous fermons dans cinq minutes.
— Excusez-moi ! Je n’avais pas fait attention… Je sors tout de suite.
Le gardien lui adressa un petit rictus poli. Duncan revint lentement sur ses pas, encore envoûté. Il serra un peu plus contre son flanc sa besace légère, portée en bandoulière et traversa à regret les salles désertées. Il se retrouva dans la rue, le soir, à peine sorti d’un rêve, affamé, assoiffé, désemparé, sans savoir où aller. Oubliant ce qu’il venait d’admirer, pour la première fois depuis son départ il ressentit de la peur. Peur de l’inconnu, peur de connaître l’humiliation de la mendicité, peur d’être contraint de payer sa place pour dormir sur un banc avec d’autres clochards, et d’être chassé au petit jour par les agents de ville, peur d’un danger sans nom…
Frissonnant, il releva le col de son paletot en étoffe de laine, un tweed grossier plutôt mince. Il lui aurait fallu plus que la méchante chemise en coton qu’il portait dessous, pour lutter contre le froid humide qui le pénétrait jusqu’aux os. Un brouillard de plus en plus épais s’abattait sur la ville, effaçant les contours des immeubles, voilant la silhouette des passants, absorbant le halo de lumière des réverbères, dissimulant le trafic de la chaussée, étouffant le bruit des roues sur le pavé et le hennissement des chevaux. Isolé dans cette gangue cotonneuse, il était naufragé d’une cité fantôme. Tous les magasins étaient fermés. Tout était mort. Il longeait des tombeaux, il avançait dans un cimetière ! Repoussant l’angoisse qui lui serrait la gorge, il avisa un panneau indiquant, à peine lisible dans cette brume, une pension de famille à deux rues du musée. Il palpa son maigre viatique caché dans la doublure de sa veste, c’était le moment de s’en servir ! Duncan se rendit à l’adresse, une respectable maison de style victorien. Il gravit les trois marches du perron, tira sur la cloche et poussa la porte d’entrée.
À peine s’était-il introduit, qu’il reçut de plein fouet la tiédeur du logis, le bon fumet de cuisine, la clarté pâle des appliques murales. Il reprenait pied chez les vivants ! Pourvu qu’on ne le rejette pas à la rue, il y mourrait de terreur !
Alertée par le carillon de laiton qui s’était mis à tintinnabuler à l’ouverture de la porte, une femme menue, à la chevelure presque rouge, madame Williamson, une honorable et coquette veuve, comme l’indiquait sa tenue en rucher de dentelles noires et voilettes à sequins, surgit aussitôt d’un salon ouvrant sur le couloir d’entrée et se planta derrière un court comptoir de bois ciré.
— Que puis-je pour vous, Monsieur ?
— Je souhaite une chambre pour la nuit.
— Euh, nous ne sommes pas un hôtel, mais une pension de famille. Je ne peux pas vous admettre.
La petite dame s’était exprimée d’un ton ferme et sans appel, mais elle détaillait Duncan du coin de l’œil : haute stature, accent écossais, aspect crasseux et déguenillé… rien qui ressemblât au style des gens qui fréquentaient sa pension, rien qui inspirât confiance. Son esprit acéré calculait rapidement le manque à gagner, car, d’un autre côté, les temps étaient difficiles. L’établissement n’était pas complet et la vieille tante Lily qu’on ne pouvait pas laisser à la rue prenait une place et coûtait de l’argent…
Duncan se fit implorant, il murmura presque :
— Je vous en prie, je suis fatigué, rien qu’une nuit, s’il vous plaît.
La dame rousse livrait un combat intérieur. Après tout, ce grand jeune homme n’avait pas l’air si méchant mais plutôt désorienté. Sous la saleté, on devinait un beau visage… Il devait avoir à peu près le même âge que son Harry, mort de la diphtérie, deux années plus tôt, c’était encore un gamin. Il la regardait d’un air malheureux, désespéré même. Elle se sentit mollir mais s’entêta malgré les raisons qui s’imposaient à elle pour accepter.
— Je vous dis que ce n’est pas possible ! Il me reste bien une petite chambre et une grande avec salon, mais je ne loue jamais pour moins d’une semaine, payable d’avance, c’est mon règlement, et vous devez prendre votre collation du soir ici, enfin, vous faites comme vous voulez mais elle est comprise dans le prix qui n’est peut-être pas dans vos moyens…
Pincée, madame Williamson lui indiqua les tarifs pour chaque chambre. Duncan, décontenancé, fit un calcul rapide. S’il prenait pension ici, il dilapiderait la moitié de sa fortune, mais il était fatigué et tellement effrayé à la perspective d’une nuit dans les rues de cette capitale gigantesque, il avait perdu ses repères et se sentait vulnérable. En outre, et c’était peut-être sa part d’enfantillage, il se refusait à quitter la proximité du musée et de tous les trésors qu’il renfermait. Il acquiesça en se raclant la gorge :
— Va pour une semaine, dans la chambre simple.
La propriétaire eut un petit hochement de tête sec. Avait-elle raison d’accepter si vite, juste à cause de cette tendresse de mère en mal d’enfant qui la submergeait parfois si douloureusement ? Tapotant son chignon flamboyant, elle ajouta, acide :
— La pension est équipée d’une salle de bains avec eau chaude au robinet, c’est au 1er étage, à trois portes de votre chambre, n’hésitez pas à vous en servir avant de nous rejoindre pour le dîner ! Je vous indique le chemin. Vous voudrez bien vous dépêcher, le repas sera servi dans une demi-heure.
Après un bain chaud, le premier de sa vie dans une baignoire émaillée à pattes de lion, Duncan descendit dîner. Madame Williamson le prit sous son aile lorsqu’il apparut dans la salle à manger du plus pur style victorien.
— Je vous présente le jeune monsieur Duncan Scott qui restera parmi nous quelques jours…
Les pensionnaires étaient au nombre de cinq, six avec lui. Il y avait un couple âgé, débonnaire et très bavard – monsieur et madame Dennyson – qui prenaient toujours leurs quartiers d’hiver à Londres avant de retourner, à la belle saison, dans leur maison du pays de Galles. Une dame aux cheveux grisonnants et à l’air un peu perdu, présentée sous la simple formule de « tante Lily », monsieur Cooper, un bonhomme rougeaud négociant en soieries, et enfin monsieur Smythson, discret et courtois, rentier de son état, d’après ce que Duncan crut comprendre, plus tard, dans une discussion à demi-mot. Secondée par une jeune domestique qui se chargeait entre autres du service à table, de la cuisine, et de la blanchisserie, la patronne, qui partageait les repas avec ses hôtes, gérait son établissement de manière à la fois affable et énergique.
Heureux de cette arrivée imprévue, venue rompre la routine de leur quotidien, les pensionnaires accueillirent Duncan avec une relative bienveillance malgré la pauvreté de sa tenue. Chacun inspectait le nouvel arrivant à la dérobée tout en se persuadant que, si la prudente madame Williamson l’avait jugé digne de séjourner sous son toit, c’est qu’il présentait probablement de sérieuses références.
Habitué à la solitude totale de ces derniers mois, le jeune homme ne se montrait pas très loquace pour sa première soirée londonienne. Emprunté, il souhaitait surtout qu’on l’oubliât. Cependant la pétillante Margareth Dennyson, incapable de résister à la curiosité le dévorait du regard. Ils étaient installés autour d’une grande table ovale, Margareth, assise face à Duncan, lui demanda brusquement dans un grand sourire, tout en écarquillant ses yeux verts avec une ingénuité feinte :
— Alors monsieur Scott, parlez-nous un peu de vous… D’où venez-vous ?
Tous les regards se tournèrent vers Duncan. Pour répondre à ce redoublement d’intérêt il devait inventer une histoire, et vite ! Peu rompu à l’art du mensonge, il s’étonna lui-même de la réponse qu’il servit avec naturel :
— Je viens de Portsoy, en Écosse, un village dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler, mais qui produit un marbre exceptionnel. Ma famille est propriétaire d’une carrière là-bas. Nous en sommes très fiers puisque, dans le passé, nous avons fourni une magnifique serpentine qui a permis de décorer certaines salles du château de Versailles, en France.
Plutôt satisfait, même si seulement une partie de sa réponse était vraie, le tumulte dans sa tête n’eut pas le temps de s’apaiser. Margareth Dennyson, obstinée, enchaînait déjà la deuxième question :
— Oh, comme c’est charmant ! Mais qu’est-ce qui vous amène à Londres aujourd’hui ?
— Je suis venu seconder un de mes oncles, propriétaire d’une grande exploitation agricole dans les Midlands. Il a fait une mauvaise chute de cheval… Puisqu’il est à présent parfaitement rétabli, je n’ai pas résisté à l’envie de visiter la capitale avant de rentrer chez moi.
L’explication semblait convenir à l’assistance. Margareth allait prolonger la torture de Duncan, mais la servante détourna son attention en apportant un plat de côtelettes de mouton accompagné d’une salade de céleri parsemée de croûtons chauds.
— Hum… Comme cette cuisine sent bon ! Une fois de plus, vous allez nous régaler, madame Williamson, votre jeune domestique possède de nombreuses qualités et entre autres celle d’être une véritable cuisinière !
Le coup de tempête était passé ! Les pensionnaires piquèrent du nez dans leurs assiettes, Duncan fut oublié et put enfin se rassasier. On leur servit du vin offert par Mr Cooper, raffinement tout à fait exceptionnel dans ce pays, du Chester et de petits biscuits parsemés de raisins secs. Duncan surprit à plusieurs reprises Mme Williamson l’observant avec scepticisme. Elle finit par lui adresser un léger hochement de tête qui semblait signifier « Je ne crois pas beaucoup à vos histoires, mais vous semblez correct, n’en parlons plus. » Il en ressentit un immense soulagement. Lorsqu’il monta se coucher le ventre plein comme cela ne lui était pas arrivé depuis des mois, les habitants de la pension, aimables, lui souhaitèrent une bonne nuit réparatrice.
Allongé dans son lit, entre des draps propres, Duncan se détendit. Le matelas de crin était agréable. Du papier fleuri appliqué sur les murs égayait la pièce, nette, saine, confortable. Même chez Peter et Moira, à Portsoy, il n’avait jamais connu un tel raffinement, encore moins lors de ces derniers mois de nomade. Alors, dans la sécurité de cette maison, il abandonna tout son réflexe d’animal aux aguets, il oublia tous ses soucis d’homme en quête de devenir. Il n’était qu’un vivant imprégné d’une sensation de fatigue et de bien-être mêlés, qui plongeait dans un profond sommeil. Pour la première fois, il sombra dans un rêve où il rejoignit Aileas. Elle lui sourit et il explosa de bonheur et de plaisir à son contact. Mais très vite elle secoua tristement la tête, agitant sa belle chevelure, se dégagea, et s’en alla sans qu’il puisse la retenir.
Il l’ignorait encore, mais dorénavant, Aileas serait son tourment.





























