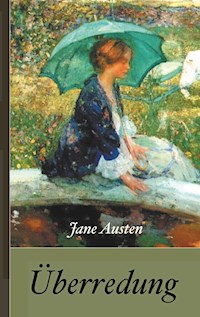Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pretorian Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Plongez dans l'univers fascinant de Jane Austen avec "L'Abbaye de Northanger". Ce roman captivant suit les aventures de la jeune et ingénue Catherine Morland alors qu'elle explore les mystères de l'abbaye gothique de Northanger. Avec une intrigue pleine de rebondissements, des personnages inoubliables et une romance émouvante, ce livre est un véritable bijou de la littérature classique. Si vous cherchez une histoire palpitante et pleine de charme, ne cherchez pas plus loin que "L'Abbaye de Northanger" de Jane Austen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des Matières
TOME I
Notice Biographique.
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
TOME II
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
TOME III
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
Mentions légales
Titre: L’Abbaye de Northanger
Auteur: Jane Austen
Éditeur: Pretorian Media GmbH, Ul. Yanaki Bogdanov 11, BG-9010 Varna
Date: 31/03/2023
TOME I
Notice Biographique.
L’ouvrage que j’offre au public, est la production d’une plume qui a déjà plus d’une fois contribué à ses plaisirs. S’il ne s’est pas montré insensible au mérite : de Raison et Sensibilité — d’Orgueil et préjugé — de Mansfield Park — d’Emma, — quand il saura que l’auteur de ces ouvrages est maintenant renfermé dans la tombe, il lira peut-être avec plus d’intérêt que de curiosité un abrégé succint de la vie de Jeanne Austen.
Une vie remplie par la religion et la littérature n’est pas fertile en événemens.
Il est consolant pour ceux qui gémissent de la perte de Jeanne Austen, de penser que comme elle n’a jamais mérité de reproches, aussi elle n’a jamais eu de chagrins à essuyer dans le cercle de sa famille et de ses amis. Ses désirs étaient raisonnables et généreux : parmi les contrariétés de la vie, elle ne s’est jamais laissé aller au découragement et au dépit.
— Jeanne Austen naquit le 16 décembre 1775, à Steveton, dans le comté de Hantz ; son père avait été Recteur de la paroisse pendant quarante ans. Il administra seul, et toujours avec activité et vigilance, jusqu’à l’âge de 70 ans, qu’il se retira avec sa femme et ses deux filles à Bath, pour y passer le reste de sa vie, qui dura encore environ quatre ans. Comme il était un homme instruit, et qu’il possédait un goût exquis pour tous les genres de littérature, il n’est pas étonnant que sa fille Jeanne, dès sa première jeunesse, ait été sensible aux charmes du style et enthousiaste de la culture de sa propre langue.
À la mort de son père elle alla demeurer pendant quelque tems avec sa mère et sa sœur, à Southampton, et en dernier lieu, en 1809, dans le joli village de Chawton, situé dans le même Comté. C’est là qu’elle publia des ouvrages estimés par quelques personnes à l’égal de ceux des Arbley, des Edgeworth. Elle les conservait long-tems avant de les publier, parce que, se défiant de son jugement, elle avait adopté la méthode de les relire plusieurs fois et à quelques intervalles, pour ne les livrer à l’impression qu’après avoir laissé effacer ou au-moins affaiblir l’effet d’une composition récente.
Sa bonne constitution, la régularité de sa vie, ses occupations douces et tranquilles semblaient promettre au public une longue suite de jouissances, et à elle la gloire d’une réputation chaque jour plus célèbre ; mais dès le commencement de 1816, les symptômes d’une maladie incurable se manifestèrent. Les progrès du mal furent d’abord peu sensibles ; dans le mois de mai 1817, il fut nécessaire de la conduire à Winchester pour y recevoir les secours journaliers de la médecine. Pendant deux mois elle supporta avec la plus grande résignation les douleurs que cause une nature qui se détruit et le dégoût occasionné par les remèdes. Elle conserva jusqu’à la fin sa mémoire, son imagination, l’égalité de son humeur, ses tendres affections, et toutes ses qualités dans toute leur intégrité ; ni son amour pour Dieu, ni son attachement pour ses amis, ne s’affaiblirent un instant. Elle voulait recevoir publiquement les derniers sacremens ; mais son excessive faiblesse ne le lui permit pas. Elle écrivit tant qu’elle put tenir la plume, et quand celle-ci devint trop pesante pour elle, elle la remplaça par un pinceau.
La veille de sa mort, elle composa des stances étincelantes d’imagination et pleines de vigueur. Ses dernières expressions furent des remercîmens pour les soins que son médecin lui avait rendus ; ses derniers mots furent sa réponse à la demande qu’on lui faisait pour savoir si elle n’avait besoin de rien ; je n’ai besoin que de mourir, dit-elle, et elle expira le vendredi 18 juillet 1817, dans les bras de sa sœur, qui aussi bien que l’auteur de cette notice, n’en perdra jamais le triste souvenir.
Jeanne Austen fut inhumée le 24 juillet, dans une chapelle de la Cathédrale de Winchester, où reposent les cendres d’un grand nombre de personnages célèbres.
Elle était douée de tous les avantages qui séduisent : une taille élevée et svelte, des mouvemens gracieux, des traits réguliers ; dont l’expression était celle de la douceur, de la bienveillance, de la sensibilité, composaient l’ensemble de sa personne. Elle était très-blanche et avait le teint très-beau ; on pouvait dire poétiquement et cependant avec vérité, que sur ses joues modestes, on lisait que son cœur était éloquent. Sa voix était de la plus grande douceur : elle parlait avec abondance et précision : elle était formée pour faire le charme de la société. Sa conversation était aussi agréable que ses ouvrages ; elle avait des connaissances en peinture, art dont elle s’était occupée avec succès pendant sa jeunesse, ainsi que de la musique et de la danse ; je ne puis mieux compléter l’idée que je voudrais donner d’elle qu’en disant quelle charmait tous les momens des heureux amis qui vivaient en sa société.
L’opinion générale, qu’un tempérament calme est incompatible avec une imagination vive et un esprit fin est démentie par l’exemple de notre auteur. Tous ceux qui ont eu le bonheur de la connaître en ont fait l’observation. Quoique les fautes, les faiblesses et les folies fussent hors de sa nature, elle était indulgente, et cherchait toujours les raisons qui pouvaient excuser les coupables. L’affectation d’ingénuité est commune ; mais chez elle c’était l’ingénuité même ; aussi parfaite qu’il est donné à la nature humaine de l’être, elle trouvait toujours dans les fautes des autres des motifs pour les excuser, les pardonner, les oublier : quand toute justification était impossible, elle gardait le silence
Elle ne proféra de sa vie une parole de haine, de dureté, de colère ; enfin son caractère était aussi poli que son esprit.
On ne pouvait la connaître sans désirer son amitié, et se féliciter de l’avoir obtenue. Elle était tranquille, sans réserve ni froideur, communicative sans indiscrétion ni vanité ; elle devint auteur uniquement parce que c’était son inclination. Ni l’espoir de la fortune, ni celui de la célébrité n’y contribuèrent en rien. Quelques-uns de ses ouvrages furent composés plusieurs années avant leur publication. Ce ne fut qu’avec bien de la peine que ses amis, dont elle estimait le jugement, mais dont elle craignait la partialité, parvinrent à obtenir qu’elle fît imprimer le premier. Elle était si persuadée qu’elle n’en retirerait pas les frais, qu’elle s’imposa une retenue sur son revenu pour remplacer la perte à laquelle elle s’attendait.
Elle eut de la peine à croire celui qui lui donna la bonne nouvelle que Raison et Sensibilité lui valait net 150 livres sterling ; elle jugeait que cette somme était trop forte pour si peu de peine. Ses lecteurs s’étonneront au contraire qu’elle fût si faible, lorsque certains auteurs ont reçu plus de guinées qu’ils n’ont écrit de lignes. Cependant les ouvrages de notre auteur dureront autant que ceux qui ont eu le plus d’éclat ; et le public lui rendra toujours la justice qu’elle mérite. Sa modestie était si grande, qu’elle ne put jamais se décider à placer son nom à la tête des ouvrages qu’elle publia elle-même.
Dans l’intimité de sa famille, elle parlait volontiers de ses œuvres, en écoutait la critique, était flattée des éloges, mais elle évitait de s’attribuer la réputation d’auteur. Elle lisait parfaitement. Elle aimait passionnément les beautés de la nature, savait également les admirer dans les arts d’invention. Elle avait été touchée du mérite de Gilpin, peintre renommé.
Dans le cours de sa vie elle changea rarement d’opinion sur les hommes et sur les choses.
Ses connaissances littéraires étaient étendues, sa mémoire excellente ; ses écrivains favoris furent John pour la morale, et Cowper pour la poésie. Elle admirait Richardson ; et les beaux caractères, qu’il a tracés dans ses ouvrages, étaient l’objet de ses études. La justesse de son esprit l’empêcha d’imiter le dernier dans la prolixité du style et la minutie des détails. Elle estimait moins les ouvrages de Fielding : pour elle la vérité des détails ne compensait pas suffisamment la honte du choix de sujets mauvais et trop bas.
Son talent pour créer des caractères était naturel et infini. Le style de sa correspondance était le même que celui de ses nouvelles. Tout ce que sa plume traçait était parfait ; elle avait des idées claires sur chaque sujet, ses expressions étaient toujours bien choisies, et je crois ne rien hasarder en assurant qu’elle n’a rien écrit, ni lettre, ni billet, qui ne fût digne de l’impression.
Un seul et dernier trait nous reste à tracer, c’est le plus important de tous. Elle était pieuse et pleine de religion. Elle craignait sans cesse d’offenser Dieu. Elle était instruite sur les principes de la religion, qui était pour elle un sujet de fréquentes méditations ; ses opinions sur ce point étaient parfaitement conformes à celles de l’église anglicane.
L’ABBAYE
CHAPITRE I.
DE NORTHANGER
De toutes les personnes qui ont connu Catherine Morland, dans son enfance, il n’en est pas qui aient dû la croire née pour figurer comme héroïne de roman. Le caractère de son père, celui de sa mère, le sien propre, sa personne, sa position dans la société, tout enfin semblait la destiner à l’obscurité, qui est le partage de la multitude. Son père, Pasteur respectable, n’avait rien de distingué, ni dans la personne, ni dans les manières ; il s’occupait beaucoup du soin de sa fortune, modeste, mais indépendante, et très-peu de l’éducation de ses enfans. Mistriss Morland joignait le bon sens à la bonhomie ; bien constituée, elle avait eu trois fils avant la naissance de Catherine, et, en dépit de la prédiction de plusieurs bonnes femmes de son voisinage, qui lui avaient prophétisé qu’elle perdrait le jour en le donnant à cette dernière, elle eut encore depuis six autres enfans. La santé parfaite de cette bonne mère, heureuse de voir tous ses enfans croître autour d’elle, donnait un grand échec à la science des tireuses d’horoscopes.
C’est une belle famille que celle qui est composée de dix enfans, tous sains et bien conformés ! Voilà ce qu’on admirait dans celle de Mistriss Morland. On y remarquait aussi un trait commun à tous, celui d’une simplicité un peu trop grande peut-être, dont Catherine n’était pas plus exempte que les autres.
Dans la plus tendre jeunesse, Catherine avait de la vivacité dans les yeux, mais son teint était pâle ; ses cheveux étaient noirs, sans boucles et peu épais, ses traits gros, ses membres forts ; enfin son corps ne semblait pas, plus que son esprit, destiné par la nature à représenter, comme je l’ai déjà dit, le principal personnage d’un roman. Elle n’aimait que les jeux des petits garçons ; elle s’amusait plus à tourmenter un hanneton, qu’à faire la toilette de sa poupée ; à élever un moineau, qu’à soigner ces roses, dont les auteurs représentent la culture, comme l’amusement chéri des jeunes beautés, desquelles ils nous donnent l’histoire : voulait-elle des fleurs, elle les arrachait plutôt qu’elle ne les cueillait, encore était-ce pour les effeuiller et les éparpiller aussitôt.
Elle ne montrait de dispositions pour aucune chose ; elle ne faisait attention à rien de ce qu’elle entendait, ne s’appliquait à rien de ce qu’on lui apprenait, n’en retenait rien. Sa mère avait été trois mois à lui faire répéter son Pater, et malgré cela, sa jeune sœur Sally, le savait beaucoup mieux qu’elle.
Toutefois Catherine n’était ni stupide, ni sans moyens : elle apprit, aussi vite qu’aucune autre jeune personne, la fable du Lièvre et de ses amis. Comme elle s’était habituée à faire résonner les cordes d’un ancien instrument qu’elle trouva dans un coin de la maison, elle consentit avec joie au désir que sa mère avait de lui faire apprendre la musique. Elle s’en occupa pour la première fois à huit ans ; mais elle s’en lassa bien vîte. Mistriss Morland, qui ne voulait pas faire de ses filles des virtuoses, en dépit de leur goût et de leurs dispositions, donna son consentement au renvoi du maître, et ce jour fut un des plus heureux de la vie de Catherine.
Son goût pour le dessin n’était pas plus prononcé. Elle ne manquait jamais, à la vérité, de prendre les feuilles blanches des lettres que recevait rarement sa mère, et les morceaux de papier qu’elle trouvait, pour crayonner dessus des maisons, des arbres, des poules, etc. ; mais tous ces objets se distinguaient fort peu l’un de l’autre. Son père lui montrait à écrire et à compter ; sa mère lui apprenait un peu de français. Ses progrès étaient très-faibles ; son principal soin était d’échapper aux leçons.
Son caractère, quoiqu’assez bizarre, n’était cependant pas mauvais ; son cœur était bon. Rarement elle était entêtée, presque jamais querelleuse ; quoique turbulente, et un peu grossière, elle était assez douce avec ses jeunes compagnes ; elle n’aimait pas de rester à la maison ; enfin, elle n’était pas très-propre, et son plus grand plaisir était de se rouler sur le plancher ou sur le gazon.
Telle était Catherine Morland, à l’âge de dix ans. À quinze ans, il s’était opéré en elle un changement remarquable : son teint était devenu plus clair, ses traits s’étaient adoucis, ses yeux s’étaient animés ; elle avait les jolies couleurs de la jeunesse, et un peu d’embonpoint ; sans être belle, elle était devenue assez agréable : les goûts qu’elle avait eus dans l’enfance étaient remplacés par d’autres plus convenables, tels que ceux d’arrangement et de propreté : elle commençait même à soigner sa toilette ; elle avait alors le plaisir d’entendre quelquefois ses parens remarquer ce changement avantageux, et se dire : « Catherine est tout-à-fait gentille… aujourd’hui elle est presque jolie… » Il est bien doux à quinze ans de savoir qu’on est jolie, surtout lorsqu’on n’avait entendu parler jusques là que de ses défauts.
Mistriss Morland était une bonne mère, elle désirait que ses enfans fussent bien élevés ; mais son temps était tellement employé à soigner et à instruire les plus jeunes, que les aînés devaient nécessairement être négligés, et s’occuper eux-mêmes de leur éducation, pour acquérir quelques talens.
Ainsi Catherine, abandonnée à elle-même, n’avait que des goûts et des idées très-simples, et préférait naturellement, à quinze ans, les jeux et les exercices de cet âge, à l’étude et à la lecture, du moins à la lecture des livres sérieux ; car elle lisait assez volontiers ceux qui ne contenaient aucune leçon, aucune réflexion, et qui ne demandaient aucune application.
Mais de quinze à dix sept ans ce ne fut plus la même chose : elle lut, des ouvrages de nos poëtes, ceux dont une héroïne doit avoir indispensablement la mémoire ornée, afin de pouvoir en citer à propos divers passages. Par exemple, elle apprit de Pope à s’indigner contre ceux qui
« Entourent le malheur de mépris, »
« bear about the mockery of woe. »
de Gray
« Qu’un grand nombre de fleurs naissent dans le désert, y brillent, l’embaument et disparaissent sans avoir été admirées. »
« Many a flower is born to blush unseen,
« And waste its fragrance on the desert air. »
De Thompson
« Que c’est une occupation ennuyante que celle d’animer et de développer une jeune imagination. »
— « It is a delightful task
« To teach the young idea how to shoot. »
Dans Shakspeare, ses idées prirent un plus grand essort ; entre plusieurs pensées remarquables, elle retint celle-ci :
« Que pour la jalousie, les soupçons les plus légers, sont des preuves authentiques. »
— « Trifles light as air,
« Are, to the jealous, confirmation strong,
« As proofs of Holy Writ. »
« Que nous faisons éprouver à l’insecte que nous foulons aux pieds sans y faire attention, des douleurs tout aussi cruelles que celles que le plus grand des êtres peut ressentir par une mort violente. »
« The poor beetle, which we tread upon,
« In corporal sufferance feels a pang as great
« As when a giant dies. »
« Que les regards d’une jeune femme sensible sont comme ceux de la résignation, appuyée sur un tombeau et souriant au malheur. »
— « like Patience on a monument
« Smiling at Grief. »
Ce qui était bien suffisant pour son instruction littéraire.
Elle finit aussi par acquérir quelques connaissances sur d’autres objets : sans être capable de faire des vers, elle parvint à goûter ceux qui étaient bien faits ; sans être virtuose, sans s’extasier quand elle entendait un morceau de Rossini, elle parvint à l’écouter sans ennui, et même à juger assez sainement de l’exécution. Mais le dessin était encore resté pour elle une occupation inconnue ; elle n’en avait pas la plus légère notion, et n’aurait pu crayonner la plus simple esquisse ; n’ayant aucune amie de cœur dont elle désirât conserver l’image tracée de sa main, n’ayant encore rencontré aucun homme qui occupât son imagination, elle regrettait peu et ne sentait nullement la privation du plus aimable des arts.
Catherine était parvenue à l’âge de dix-sept ans, sans avoir inspiré une grande passion, sans avoir excité d’admiration, sans avoir entendu les louanges de la flatterie, et celles de l’exagération :
Ce serait sans doute, une chose étonnante, si quelques lords ou quelques baronnets eussent habité dans son voisinage ; mais il n’en existait aucun dans les environs de Fullerton ; mais on n’y rencontrait aucune famille dans laquelle on eût élevé un enfant, déposé avec mystère près du château, aucun jeune homme dont la naissance seulement fut inconnue, M. Morland n’avait point de pupille, le ministre du lieu n’avait point de fils. Toutefois si Catherine est destinée à la célébrité du roman, fut-elle dans un désert, il y viendra Chevalier, Baronnet ou Prince ; gardez-vous d’en douter !
Cependant près de Fullerton en Wiltshire, il existait un bien considérable dont M. Allen, attaqué de la goutte, était devenu propriétaire. Le médecin lui ordonna les eaux de Bath ; Mistriss Allen devait y suivre son mari.
Mistriss aimait Catherine ; elle l’invita à les y accompagner. Celle-ci fut enchantée de la proposition, à laquelle M. et Mist. Morland donnèrent leur consentement avec joie, quand ces excellens parens virent combien elle faisait de plaisir à leur fille.
CHAPITRE II
Notre héroïne va être lancée dans un monde qui lui est inconnu : elle a dix-huit ans, son caractère est doux, son cœur bienveillant, ses manières obligeantes et franches ; elle n’a plus cet embarras ordinaire aux jeunes personnes élevées à la campagne ; cette niaiserie qu’elles conservent presque toujours a disparu ; Catherine peut plaire ; son ensemble est agréable, son esprit a acquis de la justesse et son humeur de l’amabilité.
Aux approches du départ, sans doute que les anxiétés maternelles vont agiter Mistriss Morland ; mille pressentimens funestes vont la tourmenter ; cette cruelle séparation va oppresser son cœur sensible ; pendant les derniers jours, un déluge de larmes inondera ses yeux ; sans doute qu’elle prodiguera les avis pour prémunir sa fille chérie contre les séductions, qui ne manqueront pas de l’environner, et aussi contre les piéges qui de toutes parts vont être tendus à son innocence. Elle la préviendra contre cette foule de jeunes seigneurs, dont la principale occupation est d’inspirer de l’amour aux jeunes beautés, de les enlever, de fuir avec elles en des pays lointains. Que ne devra-t-elle pas craindre enfin pour sa tendre fille ? que ne devra-t-elle pas lui dire, enfermée avec elle dans le cabinet le plus isolé de son appartement ?……………
Mais la bonne Mistriss Morland n’a point de cabinet isolé ; elle n’a jamais connu ni lords, ni baronnets ; jamais elle n’a entendu parler de leurs mœurs ; elle n’a point lu de romans, et n’a pas la plus légère notion des dangers qu’une jeune personne peut courir dans le monde. Sa prudence ne lui suggéra donc point d’autre recommandation à faire à sa fille, que celle de s’envelopper dans son schall, quand elle sortirait le matin et le soir, afin de se préserver des rhumes, et des maux de gorge ; d’inscrire soigneusement sa dépense : elle lui donna un petit registre à cet usage.
Sally, ou plutôt Sarah, (car elle entrait, dans l’âge où les jeunes personnes cessent d’être appelées par le diminutif de leur nom) Sarah, dis-je, étant la meilleure, ou même la seule amie de sa sœur, doit aussi être sa confidente intime, et la dépositaire de ses plus secrets sentimens. Cependant Sarah ne lui demandera ni lettre à chaque courrier, ni le détail de la personne et du caractère de toutes les nouvelles connaissances qu’elle doit faire, ni la relation de tout ce qu’elle doit voir et entendre à Bath : elle se bornera à la prier de lui donner quelquefois de ses nouvelles.
Toutes les choses enfin, relatives à cet important voyage seront, de la part des Morland, simplement et sérieusement disposées…
L’émotion, causée par cette première séparation, sera touchante ; mais sans éclats déchirans, M. Morland, au moment du départ de sa fille, ne lui donnera pas un crédit illimité sur son banquier ; il ne lui mettra pas dans la main, en la lui serrant avec expression, quelques cents livres sterling, en billets de banque, ou en or ; il lui donnera simplement dix guinées, en lui recommandant de les ménager ; ajoutant toutefois que, si elles étaient insuffisantes, il lui en enverrait d’autres.
Tels furent, en effet, les auspices sous lesquels le voyage commença. Il se fit doucement, tranquillement, et sans aucun accident : les voyageurs ne furent assaillis ni par des orages, ni par des voleurs : ils n’eurent d’autre inquiétude que celle que Mistriss Allen éprouva pendant une demi-journée, croyant avoir oublié dans une auberge sa pelisse, qui heureusement se trouva le soir dans un des coffres de la voiture.
En approchant de Bath, Catherine était ravie ; elle regardait avec avidité tout ce qui s’offrait à sa vue ; elle admirait la beauté des campagnes qui entourent ce lieu : entrée dans la ville, les bâtimens qui étaient sur son passage, les rues mêmes qu’elle traversait, tout enfin était l’objet de son admiration et de son enchantement. On prit un logement convenable dans Pulteney-street.
Avant d’aller plus loin, nous croyons devoir donner sur Mistriss Allen quelques détails nécessaires pour que nos lecteurs fassent connaissance avec elle, et jugent comment à l’avenir, si cela arrive, elle aura occasionné les malheurs qui viendront probablement assaillir notre héroïne, malheurs causés soit par imprudence, soit par ignorance, soit par jalousie, soit en interceptant des lettres, soit en ruinant la réputation de celle qu’elle aura reçue dans sa maison, soit enfin en l’expulsant ; tous événemens indispensables…
Mistriss Allen, était de ces femmes qui ne peuvent jamais faire naître d’autre sentiment que celui de l’étonnement qu’il se soit trouvé dans le monde un homme capable de l’aimer assez pour l’épouser. Elle manquait de beauté, d’agrémens, et d’esprit : son air était assez doux, et extrêmement calme ; elle avait de l’indolence dans les manières, de la puérilité dans la conversation ; tels étaient les charmes qui avaient entraîné M. Allen qui cependant ne manquait ni de bon-sens, ni de tact.
Sous certains rapports, elle était excellente pour introduire une jeune personne dans le monde : elle aimait à tout voir, elle aimait à être vue : la parure était sa passion ; elle en parlait sans cesse. Quatre jours passés avec elle suffirent à Catherine pour être parfaitement instruite de ce qui concernait les modes, de l’attention qu’il fallait apporter au choix d’un chapeau, à la forme d’une robe, enfin pour faire l’acquisition de tous ces objets de parure.
Ainsi elles se trouvèrent disposées à faire leur entrée dans le grand salon de l’établissement de Bath. Catherine se para ; sa toilette fut examinée dans le plus grand détail par Mistriss Allen, et par sa femme de chambre, elles la trouvèrent parfaite ; ce jugement pouvait faire espérer à Catherine de ne pas être l’objet de la critique ; quant aux éloges, elle était trop simple pour en rechercher ; et si elle trouvait quelque fois du plaisir à les recevoir, elle ne cherchait jamais à les exciter.
Mistriss Allen mit plus de tems à sa parure, et prit beaucoup de précautions pour se rendre ridicule. Elle se procura en outre l’avantage d’arriver fort tard au salon, l’agrément d’être pressée, d’être foulée en tous sens par la nombreuse et bruyante société qui était rassemblée depuis plusieurs heures. Quant à M. Allen, il sut se glisser jusqu’à la salle de jeu, et laissa ses dames se tirer d’affaire.
Que de soins ne fallut-il pas alors pour pénétrer ! Mistriss devait diriger sa pupille ; plus encore, ne fallait-il pas préserver une robe neuve du danger éminent d’être froissée : rompre un groupe d’hommes qui obstruaient la porte n’était que le premier de leurs travaux ; Catherine se tenait pressée près de sa conductrice, elle avait pris son bras, elle n’osait le quitter au milieu des flots ondoyans de la multitude, et arrivait enfin dans la première pièce de l’établissement, mais bien pour y rencontrer un encombrement plus considérable, et non ces délices qu’elle espérait goûter.
Elle s’était figuré trouver une place commode ; elle croyait jouir du plaisir de voir danser, et ce n’était qu’avec des peines inouïes qu’elle devait arriver jusqu’à l’extrémité de la salle, qu’elle devait y trouver un simple banc, surnommé banquette, placé sur un lieu élevé, d’où elle pourrait apprécier la difficulté vaincue d’un passage hardi effectué au milieu d’une foule toujours croissante, et jouir du plaisir d’être vue comme elle aurait celui de voir.
Arrivée à cette banquette Catherine pensa qu’elle était au bal ; elle put distinguer quelques masses de danseurs, et sentit elle-même le désir de se mêler aux quadrilles. Mais nouvel inconvénient ! Entre mille cavaliers aucun ne se présentait pour être son partener. Mistriss Allen lui disait, dans cette circonstance : « Ô ma chère, que je voudrais vous voir danser ! » Là se bornait son pouvoir, et le même souhait se répétait à chaque nouvelle danse avec tant de monotonie et si peu d’effet, que Catherine ennuyée d’entendre toujours la même chose, n’eut d’autre parti à prendre que celui de cesser d’écouter et de répondre.
Il ne lui était pas donné de pouvoir jouir long-tems sur cette banquette, si laborieusement conquise, d’une tranquillité parfaite. L’heure de prendre le thé vient d’arriver. Un mouvement nouveau s’annonce et porte vers une autre salle toute l’assemblée : nos dames sont encore une fois pressées de toutes parts ; elles sont portées plutôt qu’elles ne marchent… Les peines confiées deviennent plus douces. Mais là pas un voisin, pas un ami, avec lequel on puisse s’entretenir des souffrances que l’on endure dans cette réunion de plaisirs ; changement continuel de voisin équivaut à un délaissement complet.
Quelle contenance garderont-elles dans la salle du thé ? Leur isolement est complet ; M. Allen ne revient pas ; elles n’ont pas une personne, pas un seul gentleman qui vienne leur offrir ses soins. Que faire ? où se mettre ?… Il faut se résoudre, après avoir long-tems regardé de tous côtés, à prendre les places qui restent au bout d’une longue table déjà occupée.
Elles étaient bien embarrassées de leur personne, et ne savaient que dire.
Mistriss Allen, prenant enfin la parole, se félicita beaucoup d’avoir préservé sa robe de tous les accidens dont elle avait été menacée depuis leur arrivée. « Il serait très-fâcheux qu’elle eût été déchirée, n’est-il pas vrai, dit-elle. Cette mousseline est si fine ! Je puis vous assurer que je n’en ai pas vu de semblable dans toute la salle. — Combien il est désagréable, murmurait à demi-voix Catherine, de n’avoir pas une seule connaissance ! — Oui, ma chère, répondait Mistriss Allen de l’air le plus calme, très-désagréable en vérité. — À la manière dont ces dames nous regardent, je crains que nous n’ayons commis une inconvenance, en venant nous asseoir à leur table, ou qu’elles ne pensent que nous voulons indiscrètement nous mêler à leur société. — Je suis vraiment fort embarrassée ; que n’avons-nous ici quelques amis ! — Si nous en appercevions, nous irions bien vîte les joindre. — Assurément, ma chère. Les Skinners étaient ici l’année dernière. Je voudrais les y voir aujourd’hui. — Ne ferions-nous pas mieux, Mistriss, de nous retirer ? Vous voyez que nous ne pouvons prendre ici, ni thé, ni autre chose, n’ayant personne pour nous en présenter. — Cela est vrai et bien fâcheux ; cependant, en considérant la foule qu’il nous faudrait traverser, je crois qu’il vaut mieux rester où nous sommes ; mais, ma chère, jettez un coup d’œil sur ma coiffure, j’ai été tellement pressée, que je crains qu’elle ne soit dérangée. — Elle ne l’est nullement… Est-il donc possible, chère Mistriss Allen, que dans cette nombreuse assemblée vous ne connaissiez personne ? J’ai peine à me le persuader. — Je vous assure cependant que cela est. Voyez donc quelle singulière femme ! Que sa robe est affreuse et antique ! Examinez sa tournure.
Après un tems assez long, un de leurs voisins leur offrit enfin une tasse de thé : elles l’acceptèrent avec reconnaissance. Cette occasion leur permit d’échanger quelques mots de conversation, et ce fut la seule qu’elles eurent dans toute la soirée avec des étrangers.
M. Allen vint enfin les rejoindre. Eh bien, Miss Morland, lui dit-il, j’espère que vous trouvez le bal agréable, que vous vous amusez bien ? — Bien en vérité, répondit-elle, en s’efforçant d’arrêter un long bâillement. — J’aurais désiré, dit Mistriss Allen, qu’elle eût eu un cavalier ; je voudrais que les Skinners fussent venus ici cette année, plutôt que l’année dernière. — Si les Parry eussent exécuté le projet qu’ils avaient formé, elle aurait pu danser avec Georges Parry. — Cela ira mieux une autre fois, dit M. Allen.
Quand le bal recommença, une partie de la compagnie quitta l’assemblée ; on fut plus à l’aise, on put se promener autour de la salle ; ce moment était favorable à une jeune personne qui n’avait encore été pour rien dans aucuns des événemens de la soirée : alors elle devait être vue, remarquée, admirée ; Miss Morland se trouva en effet dans le cas d’être aperçue par plusieurs jeunes gens ; mais il n’y en eut pas qui s’arrêtèrent pour la considérer ; il n’y en eut pas qui parurent éblouis de ses charmes ; on n’en vit pas courir dans toutes les salles, demandant à tout le monde le nom de cette ravissante inconnue ; personne ne s’écria qu’elle était une divinité. Catherine pourtant n’était pas mal ; et si ces mêmes personnes l’eussent vue trois ans auparavant, elles eussent trouvé par comparaison que maintenant elle était charmante.
Une fois, et une fois seulement, elle entendit deux gentlemans qui disaient près d’elle : « cette jeune personne est assez jolie. » Ce peu de paroles dut produire son effet sur elle, lui rendre dès ce moment la soirée agréable, satisfaire sa modeste vanité ; elle dut se tenir plus obligée à ces deux jeunes gens, pour ces simples mots, qu’une beauté de roman, ou romanesque ne l’eût été à un adorateur, pour dix pages de vers composés en son honneur et capables de faire connaître, au monde entier, le pouvoir de ses charmes. Elle dut probablement arriver à ce résultat de quitter le bal contente d’elle-même et satisfaite de toute l’assemblée.
CHAPITRE III.
Les mêmes occupations se renouvelaient chaque jour : parcourir les magasins, visiter quelques parties de la ville, se rendre à l’établissement des eaux, s’y promener de tous côtés, pendant une heure, en regardant tout le monde, et sans parler à personne ; exprimer le regret, toujours croissant, de n’avoir aucune connaissance à Bath, répéter le souhait qu’il s’en trouvât enfin quelqu’une : tel était l’emploi régulier et uniforme des premières journées.
Un jour que Mistriss Allen et Miss Morland furent au petit salon, la fortune se montra enfin favorable à notre héroïne ; le maître des cérémonies lui présenta pour chevalier un très-agréable jeune homme : il se nommait Tilney ; il paraissait avoir vingt-quatre ou vingt-cinq ans ; il était grand, d’un extérieur agréable, ayant des yeux pleins d’esprit ; en un mot, il était parfait, et plein de grâces : Catherine eut à remercier le hasard qui la servait si bien. Pendant la danse, M. Tilney parla peu ; mais quand on fut à la table du thé, Catherine put juger qu’il était aussi aimable, qu’il le lui avait paru d’abord : il s’exprimait facilement et avec esprit, il plaisantait avec légèreté, et quoique Catherine comprît difficilement le sens de ses plaisanteries, elle l’écoutait cependant avec plaisir.
Après avoir causé, quelque tems sur tout ce qui les entourait, il lui dit, que comme son chevalier, il réclamait la permission de lui demander depuis quand elle était à Bath ; si elle croyait y faire un long séjour, si elle y était venue précédemment, si elle était allée au grand salon, au spectacle, au concert, laquelle de toutes ces assemblées elle préférait : je ne devais pas, ajouta-t-il, vous faire toutes ces questions à la fois ; mais si vous le trouvez bon, je vais les reprendre par ordre. — Il n’est pas nécessaire, Monsieur, dit Catherine, que vous en preniez la peine. — Ce n’est pas une peine, je vous assure, Miss, reprit-il avec un agréable sourire et de la voix la plus douce.
Il recommença, avec un air d’intérêt, la première question. — Y-a-t-il long-tems, Miss, que vous êtes à Bath ? — Une semaine, répondit Catherine, en souriant. — Quoi déjà une semaine ! — Qu’y a-t-il là pour vous surprendre, Monsieur ? — Je ne sais : votre réponse, il est vrai, m’a causé quelque surprise ; mais pardonnez, continuons : étiez-vous venue ici précédemment ? — Jamais. — Avez-vous déjà favorisé de votre présence le grand salon ? — J’y suis allée lundi dernier. — Et le spectacle ? — J’y ai assisté mardi. — Et le concert ? — Mercredi. — Et vous amusez-vous bien à Bath ? — Oui très-bien ; et en même tems elle regardait de tous côtés pour chercher à découvrir ce qui devait l’amuser.
Il faut maintenant, dit M. Tilney, avec une gravité affectée, que je vous parle de moi : je présume que je vais figurer tristement sur votre journal de ce jour. — Comment ! sur mon journal ! — Oui, votre journal : je suis sûr que voici précisément ce que vous y inscrirez : Vendredi je suis allée au petit salon, j’avais ma robe de mousseline à petits bouquets, avec une garniture bleue et des souliers noirs ; j’étais très-bien. Mais j’ai été excédée par un indiscret et ennuyeux questionneur, avec lequel j’ai été obligée de danser, et qui m’a fatiguée par une conversation très-insignifiante. — Bien certainement, Monsieur, je n’écrirai ni ne dirai cela. — Eh bien ! permettez-vous que je vous dise ce que je souhaite que vous écriviez ? — Volontiers. — J’ai dansé avec un jeune homme qui m’a été présenté par M. King ; nous avons beaucoup causé ensemble ; il me paraît singulier ; j’espère dans quelque tems le connaître mieux, et pouvoir en parler plus juste… Voilà, Miss, ce que je désirerais vivement voir inscrit dans votre journal. — Mais si je ne tiens point de journal ! — Impossible ! Il serait aussi raisonnable de mettre en doute si vous êtes dans ce salon, si j’y suis assis à côté de vous, que de douter qu’une jeune demoiselle, qui est à Bath, n’inscrive pas dans un joli journal tous les événemens qui lui arrivent, afin d’en faire part à quelque parente ou à quelque amie intime. Dans ce journal sont notés, chaque jour, les connaissances qu’elle fait, les hommages qu’on lui rend : sans un journal, comment se souvenir de l’élégance de ses toilettes, du ridicule de celles des autres, des diverses manières dont on arrange ses cheveux, de l’état de son teint, de celui de ses yeux ? Je connais, vous le voyez, tous ces petits secrets des jeunes personnes : au surplus, c’est à cette habitude d’écrire un journal que les femmes doivent, en général, la facilité et les charmes de leur style ; si tout le monde convient qu’elles excellent dans le genre épistolaire, la nature peut y être pour quelque chose, mais je suis certain que la méthode du journal y contribue pour beaucoup. — J’ai quelquefois pensé, dit Catherine, en hésitant, que les femmes écrivent mieux que les hommes ; mais je ne croyais pas que cette supériorité fût si générale à notre sexe ! — Autant que j’ai pu en juger par moi-même, trois points exceptés, les femmes écrivent en perfection. — Et quels sont ces trois points ? — Ordinairement trop de vague dans le sujet, puis défaut de ponctuation, ensuite ignorance des principes de l’art d’écrire. — J’étais d’abord fort embarrassée de votre compliment ; mais votre explication me prouve que votre opinion, sur ce sujet, nous est moins favorable que je ne l’avais pensé. — Je crois avec tout le monde que dans le style épistolaire, ainsi qu’en tout ce qui demande du goût, de l’esprit, du sentiment, les femmes surpassent infiniment les hommes.
Cette conversation, qui tendait déjà au sérieux, fut interrompue par Mistriss Allen : ma chère Catherine, dit-elle, ôtez, je vous prie, cette épingle ; je crains qu’elle ne déchire ma robe ; j’en serais désolée : c’est ma robe favorite ; elle est vraiment du dernier goût et d’un très-bon choix ; aussi coûte-t-elle neuf schellings ; — C’est précisément ce que je l’aurais estimée, dit M. Tilney, en regardant de près la mousseline, — Vous vous connaissez donc en mousseline, Monsieur ? — J’achète moi-même mes cravates ; j’ai la réputation de bien les choisir : ma sœur me consulte ordinairement quand elle fait ses emplettes : j’ai, il y a quelques jours, acheté une robe pour une dame, et au dire de toutes celles qui l’ont vue j’ai fait un excellent marché : j’ai eu pour cinq schellings, une véritable mousseline des Indes.
Mistriss Allen fut tout émerveillée du mérite de M. Tilney : ordinairement, dit-elle, les jeunes gens ont si peu d’idée de ces choses ! Jusqu’à présent je n’ai pu parvenir à mettre mon mari en état de distinguer une de mes robes d’une autre. Vous devez être d’une bien grande ressource pour Mademoiselle votre sœur ? — Je le crois, Mistriss — Eh bien ! que pensez-vous de la robe de Miss Morland ; — Elle est très-jolie, répondit M. Tilney, en examinant gravement cette robe ; mais je ne sais si elle se lavera bien… — Comment pouvez-vous, dit Catherine en riant, être si… elle allait dire connaisseur ; mais Mistriss Allen, sans l’écouter, l’interrompit en disant : je suis entièrement de votre opinion, Monsieur ; je n’ai pas manqué d’en faire l’observation à Miss Morland, quand elle a acheté cette robe. — Comme vous le savez sûrement ? Mistriss, on tire toujours parti de la mousseline, quand une robe éprouve un accident, des morceaux on fait des bonnets, des fichus : c’est un grand avantage ainsi que me l’a toujours dit ma sœur. — Bath est une charmante petite ville, Monsieur, il y a beaucoup de très-beaux magasins. — Aussi dans le reste du Comté on est très-malheureux ; il n’y a de bons magasins qu’à Salisbury, et il faut faire huit milles pour y aller. — M. Allen assure qu’il y en a neuf bien mesurés ; mais je n’en crois rien ; je suis persuadée qu’il n’y en a que huit : quoiqu’il en soit, c’est bien loin pour envoyer chercher les choses dont on a besoin, au lieu qu’ici il n’y a qu’un pas à faire et qu’un instant à attendre.
M. Tilney, qui était extrêmement honnête, écoutait Mistriss Allen avec attention ; aussi la conversation sur les mousselines et les magasins dura-t-elle jusqu’à ce que l’on reprit la danse. Pendant cet entretien, Catherine réfléchissait que M. Tilney portait peut-être un peu trop loin sa complaisance pour les sottes faiblesses des autres. À quoi songiez-vous si sérieusement, lui dit-il, en la conduisant dans la salle du bal ? Ce n’était pas à votre chevalier, j’espère ; car à en juger par l’apparence, vos réflexions ne lui seraient pas favorables. Catherine rougit, et répondit qu’elle ne pensait à rien. — Voilà de l’artifice ; car si je n’avais pas deviné juste, votre réponse ne serait pas telle que vous la faites. — Vous ne pouvez le croire. — Je le crois cependant très-fort ; et si vous ne voulez pas me dire ce à quoi vous pensiez, je reviendrai sur ce sujet chaque fois que j’aurai l’avantage de vous rencontrer. Rien n’établit une connaissance comme un petit sujet de querelle à reprendre quand on se retrouve. On dansa ; ensuite l’assemblée se sépara. M. Tilney demanda à ces dames la permission de leur faire des visites, et engagea Catherine à penser à lui, quand elle n’aurait rien de mieux à faire.
Qu’elle y ait pensé en faisant sa toilette de nuit, c’est ce qui est assez probable ; il est même possible qu’elle en ait rêvé ; mais ce n’aura été tout au plus que pendant ce demi sommeil du matin, tems où les objets apparaissent légèrement à l’imagination pour s’évanouir aussitôt, sans même laisser de souvenir : car, s’il est vrai, ainsi que l’a dit un auteur célèbre, qu’une femme soit inexcusable de ressentir de l’amour, avant d’avoir reçu l’aveu de celui qui l’adore, il est sans doute plus inexcusable, pour une jeune personne, de rêver d’un amant, avant de savoir s’il a rêvé d’elle. Quoiqu’il en soit M. Allen, ayant cru devoir prendre des informations sur le chevalier de sa protégée, apprit le soir même, pendant le bal, que M. Tilney était un jeune ecclésiastique, d’une famille respectable, de la province de Gloucester.
CHAPITRE IV.
Ce fut avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire, que Catherine fit le jour suivant ses apprêts pour aller à la Pump-room ; elle espérait y trouver M. Tilney, et elle était portée à l’accueillir de la manière la plus gracieuse. Elle arriva de bonne heure à ce lieu, qui servait dans la matinée de point de ralliement pour tout Bath.
La foule allait, venait, circulait en tous sens, Catherine n’y vit qu’inconnus, qu’indifférens ; le seul qu’elle y attendait, le seul qu’elle y cherchait, n’y parut pas. Après s’être promenée jusqu’à l’extrême fatigue, dans tous les endroits où elle croyait pouvoir être bien vue, Mistriss Allen répéta encore une fois : « Que Bath est un lieu délicieux ! que j’y aurais de plaisir si je rencontrais une seule de mes connaissances ! » Combien de fois avait-elle déjà vainement exprimé ce désir !
Cependant elle était au moment de justifier l’ancien adage, qui dit : « que celui qui sait attendre ne doit jamais désespérer, et qu’une constante persévérance réussit enfin. » Elle allait voir ses souhaits accomplis.
Il y avait à peine dix minutes qu’elle était assise, qu’une dame de son âge, placée à quelque distance, et qui depuis ce tems la considérait avec attention, se leva, s’approcha d’elle, et la saluant avec beaucoup de politesse, lui dit : j’espère, Madame, que je ne me trompe pas ; quoiqu’il y ait bien long-tems que je n’aie eu l’avantage de vous voir ; je crois que c’est à Mistriss Allen que j’ai l’honneur de parler : sur la réponse affirmative, l’inconnue se nomma, et soudain, au nom de Mistriss Thorpe, Mistriss Allen se rappela les traits d’une intime amie d’école, qu’elle n’avait vue qu’une seule fois depuis que toutes deux étaient mariées : il y avait quinze ans qu’elles s’étaient perdues de vue et qu’elles n’avaient eu aucunes nouvelles l’une de l’autre. Cette rencontre leur causa un plaisir véritable.
Après les premiers complimens, elles s’entretinrent de la rapidité avec laquelle le tems s’était écoulé depuis leur séparation, du hasard qui les réunissait à Bath, du plaisir que l’on éprouve à revoir d’anciennes amies : puis elles se firent de mutuelles questions sur leurs familles, se demandant ce qu’étaient devenues leurs sœurs, leurs cousines. Comme chacune d’elles était plus pressée de donner des nouvelles que d’en apprendre, elles ne s’écoutaient ni l’une ni l’autre, s’interrompaient réciproquement, ou parlaient en même tems.
Mistriss Thorpe avait des enfans, ce qui lui donna, en matière de conversation, un grand avantage sur son amie. Elle la força à entendre l’étalage qu’elle fit des talens de ses fils, la description de la beauté de ses filles, les détails de leur éducation. John était à Oxford, Edward était négociant, Willaume était marin ; tous les trois dans leurs diverses carrières étaient aimés, considérés, plus que qui que ce fût. Mistriss Allen, qui n’avait point de semblables particularités à conter, ni de tels triomphes à faire résonner aux oreilles d’une amie distraite et un peu incrédule, était forcée de se taire, et de paraître prêter l’oreille à ce déluge d’effusions maternelles. Elle s’indemnisait de cette contrainte en examinant la toilette de Mistriss Thorpe ; et elle devint tout-à-fait contente, quand elle eut découvert que la pelisse de son amie n’était pas de moitié aussi belle que la sienne.
Voilà ce qui l’occupait, lorsque Mistriss Thorpe lui fit remarquer trois jeunes demoiselles qui s’approchaient, en se tenant par le bras. Ce sont, dit-elle, ma chère Mistriss Allen, mes trois filles. La plus grande est l’aînée ; elle se nomme Isabelle : elle est fort bien de figure : on admire beaucoup les autres ; mais je la crois la plus jolie. Elles seront toutes trois charmées de faire votre connaissance ; permettez que je vous les présente : ce qu’elle fit au même instant. À son tour, Mistriss Allen lui présenta son amie Miss Morland ; ce nom frappa les jeunes Thorpe. Après quelques complimens, « comme Miss Morland ressemble à son frère, » dit Isabelle à ses sœurs ! « C’est absolument lui. » « C’est tellement son portrait, dit la mère, que je n’aurais pu voir Miss Morland, sans deviner qu’elle est sa sœur. » « Cela est vrai ; il n’y a pas à s’y méprendre, » répétaient à la fois les jeunes Miss Thorpe.
Catherine fut d’abord étonnée ; mais à peine l’eût-on mise sur la voie, qu’elle se ressouvint que son frère James lui avait parlé quelquefois de la liaison intime qu’il avait formée avec un de ses amis de collége qui se nommait Thorpe, dont la famille demeurait près de Londres, et dans laquelle il était allé passer quelques jours pendant les dernières vacances de Noël. Toutes ces circonstances furent suffisantes aux trois sœurs pour les engager à dire à Miss Morland les choses les plus obligeantes, sur le désir qu’elles avaient de faire une plus ample connaissance avec elle, et même de former ensemble une liaison d’amitié, à l’exemple de leurs frères. Catherine fut sensible à toutes ces prévenances, y répondit comme elle le devait, et pour première preuve d’amitié, elle accepta le bras de l’aînée des Miss Thorpe, et fit, avec elles toutes, le tour de la salle. Elle était dans l’enchantement d’avoir enfin fait une connaissance agréable à Bath. M. Tilney fut entièrement oublié, tout le tems qu’elle causa avec Isabelle. L’amitié est le meilleur baume pour guérir les plaies de l’amour.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)