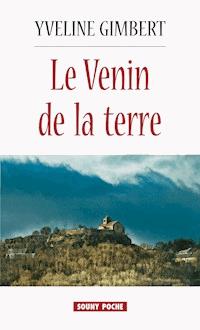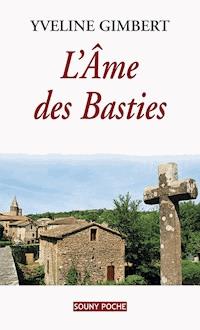
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une passion impossible et dévorante...
Orphelin, Georges Chouvet est élevé par sa grand-mère dans la rigueur et dans la foi. Très tôt, il trouve sa vocation : il sera prêtre. À l’issue de ses études au petit séminaire, il rencontre Laure. Entre les deux jeunes gens naît une passion dévorante. Georges est en proie à un tel tourment que Laure, pour le rendre à Dieu et à la promesse qu’il a faite à son aïeule, prétexte une autre liaison et épouse André, un garçon du village. Pour autant, l’amour aura-t-il dit son dernier mot ? Nommé dans la petite paroisse de Mézères, l’abbé Chouvet enseigne le catéchisme à Catherine, la fille de Laure. Des années plus tard, alors que Catherine est en âge de se marier, éclate un incroyable et passionnel imbroglio qui plonge une nouvelle fois le curé dans un profond dilemme.
Yveline Gimbert explore à travers ce roman les tiraillements d'un homme entre la raison et les sentiments !
EXTRAIT
Je regardai Laure. Dans sa robe bleue à gros pois blancs, serrée à la taille – qu’elle avait toute fine – et avec ses emmanchures garnies de volants, on eût dit une fleur. Elle représentait tous les délices auxquels un curé ne doit pas toucher. Certes, je ne sentais pas encore violemment le désir de sa chair, l’ayant si peu approchée, mais déjà il existait. Il couvait comme une braise n’attendant plus que le soufflet pour devenir un feu ardent. Cependant, ce n’était pas uniquement ce désir du corps qui déjà m’affolait, mais celui de mon cœur, soudain frappé par un sentiment que j’avais cru ne jamais éprouver. Je tremblai et détournai d’elle mes yeux par peur d’être plus sérieusement envoûté. Elle s’écria :
— Alors c’est donc vrai ? Tu vas devenir curé ?
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
[…] Une auteure à recommander. -
Bernadette Wolff, Lucien Souny
À PROPOS DE L'AUTEUR
Native de la Haute-Loire,
Yveline Gimbert est un écrivain prolifique. Au fil des ans, elle a réussi à conquérir et fidéliser un large public avec des romans fortement charpentés et judicieusement construits, aux rebondissements multiples et inattendus, peuplés de personnages troublants ou attachants qui ne quittent pas le lecteur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J’adresse mes plus vifs remerciements au père Daniel Roche pour les renseignements qu’il m’a fournis, nécessaires au bien-fondé de ce roman, pour l’intérêt qu’il a porté à celui-ci pendant la rédaction, et pour sa grande gentillesse. Je remercie également le père Bernard Cuoq dont l’aide me fut aussi précieuse et parce que, dès ma demande, il m’a ouvert les portes d’un univers que j’ai longtemps ignoré, et dont j’ai bâti la toile de fond de ce livre. Je leur fais part à tous deux de ma très grande sympathie.
L’intrigue sort tout droit de mon imagination, aucun des personnages n’a jamais existé. Les noms de lieux sont fictifs.
À Jean Levin
LA VOIE
Le 8 juillet 1978, au milieu de l’après-midi, les cloches de l’église sonnent à toute volée dans la petite bourgade des Basties. Sur le parvis, deux jeunes gens en habits de noces s’enlacent devant une assemblée joyeuse. Près d’eux, un autre couple. L’homme, vêtu d’un complet sombre, la stature imposante et le visage grave, adresse des signes de sympathie parmi les gens. La femme, jeune encore et d’une troublante beauté, vient de se retourner et jette un œil discret dans l’église. Tout au fond, une silhouette se dessine, sans tête ni forme. L’abbé Chouvet ne doit d’être visible dans la pénombre qu’à sa chasuble blanche, qu’il revêt pour les heureuses occasions. Il voudrait porter un dernier regard sur la femme, ainsi que sur la mariée, si jolie dans ses plumetis soyeux. Pourtant, il demeure face au tabernacle, immobile, jusqu’à ce que les cloches se taisent et que la rumeur s’estompe, jusqu’à ce que le silence le surprenne. Alors, il saisit la coupe et se dirige vers la sacristie. Il marche à pas lents, sans lever les yeux, sans rien voir de la beauté du sanctuaire, sans le contempler, comme il l’a fait si souvent, sans s’attarder sur les jeux d’ombre et de lumière qui l’ont tant de fois fasciné et distrait de ses tâches. Il avance, le regard fixe, presque aussi pâle que cette lumière bleue, filtrée par les vieux vitraux, qui papillonne dans les crans de sa chevelure noire. Parvenu devant la porte de la sacristie, plutôtque de l’ouvrir, il s’y adosse brusquement, serrant la coupe dans ses mains moites. Ses yeux se perdent sous les voûtes où la lumière se perd aussi. Sa poitrine se gonfle de l’air que les gerbes de fleurs ont parfumé pendant la cérémonie tels des encensoirs. Il reste ainsi un long moment, encore ahuri et stupide de ce qui s’est passé, accablé par des émotions qu’il ne parvient pas à définir. Soudain, il se met à rire en secouant les épaules. Il murmure : « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m’ôtes-Tu tout discernement ? » Il écoute le silence où gronde cette rumeur intérieure de son corps comme un vent furieux d’automne. Il subit son emprise jusqu’à la plus grande détresse, livré aux souvenirs des jours précédents et au fantôme de Laure. Il revoit le doux visage tendu vers lui dont il a reçu jadis l’empreinte. Un gémissement sort de sa bouche. Il pense : « Je devrais être heureux. » Il voudrait pouvoir examiner sa conscience, trouver le sentiment qui domine en lui, de sa peine ou de sa joie ! Il ne le peut, hélas ! L’envie le saisit de fuir cette ténébreuse chapelle où rien ne lui vient plus en aide. Elle a pourtant été son plus avenant refuge, son havre quotidien au cours de ses pires tourments. Il appuie son coude sur la poignée, donne un coup d’épaule à la porte et se retrouve dans la sacristie noyée d’une intense clarté. Ici, point de vitrail teinté, mais une fenêtre à grands carreaux translucides ouverte sur un jardin peuplé d’oiseaux, dont les ramages retentissent tant qu’on les croirait à l’intérieur, nichés sur les placards ou dans les alcôves secrètes des vieux murs. Ce joyeux concert semble produire un effet d’apaisement sur le comportement de l’abbé Chouvet. Mais lorsque son visage se lève dans la lumière, il exprime encore un bouleversement, lequel n’ôte rien à ce charme étrange qui vaut au prêtre d’être si honoré par ses fidèles paroissiennes, vieilles oujeunes. Toutes fondent sous ce clair regard, souvent plus triste que joyeux, cette bouche ronde ne souriant qu’à moitié entre un nez bien fait et un menton volontaire doté d’une barbe plus noire que noire. Leurs yeux caressent cette chevelure aux crans bleus, ce front étroit barré d’une ride profonde pleine de mystère et ces longues joues creuses qui le font ressembler au Christ sur la croix – tel qu’on le voit dans les images pieuses – que la plupart d’entre elles trouvent si beau dans la souffrance. Faut-il encore qu’il ait ce corps presque maigre, dont les muscles fuselés saillent sous les chemises légères avec une grâce divine ! Lorsqu’elles le côtoient, les cœurs de ces dames s’emballent. Mais peut-on les en blâmer puisque leur émoi résulte plus de leur foi que de leur volupté ? Sauf pour deux ou trois, bien entendu, qui subissent sa séduction d’homme. Celles-là, leurs poitrines se gonflent, leurs yeux se troublent, leurs bouches frémissent, leurs jambes flageolent, leurs… Bref, elles sont de braise et, s’il n’était l’abbé Chouvet, l’objet de leur convoitise se jetterait sur elles, comme le diable sur ses sorcières, toutes cornes en avant ! Alors elles se condamneraient à l’Enfer avec un plaisir satanique.
Les gestes pleins de lenteur, il dépose la coupe près des autres objets du culte dans un placard en bois vermoulu datant sans doute du siècle dernier. Puis il enlève sa chasuble, qu’il glisse sur un cintre au fond d’une armoire comble d’habits religieux, tous de couleur symbolique. Sans accorder un regard à la fenêtre, il pousse une seconde porte. Le voici dans la cure. C’est ici son propre logement, quatre pièces en enfilade accolées contre les murs de l’abside et des absidioles. Voici la raison de l’alignement des ouvertures sur la façade opposée, côté jardin. On va d’une pièce à l’autre, commençant par le bureaudans lequel le prêtre se trouve en cet instant. Viennent ensuite la cuisine, la chambre et le cellier. Là, une trappe donne accès à une cave sombre et froide attenante à la crypte. Dans ce sobre intérieur, c’est au bureau que l’abbé Chouvet passe le plus clair de son temps. Au fil des jours, il y a aménagé des étagères pour ranger les papiers du culte, les vieux grimoires et toute sa littérature liturgique. Mais on y voit divers objets, cachés derrière de gros volumes, telles ces « bondieuseries » offertes par ses dévotes qu’il garde plus par respect que par goût. Ce n’est pas qu’elles soient affreuses, bien au contraire, mais trop ostentatoires. Une immense table trône au milieu de la pièce, à mi-soleil mi-ombre, encombrée de cahiers, de feuillets et de tout un assortiment de stylos à plume ou à mine. Sur un bord, celui que le soleil a terni, une lettre pliée a captivé le regard du prêtre dès son arrivée. Il la saisit d’une main légèrement tremblante, la serre contre sa poitrine. Il a envie de l’ouvrir, de relire les mots. Il voudrait en délecter son cœur. Mais quelque chose le retient cette fois encore, une sorte de sagesse fâcheuse. Désemparé, il s’assoit sur la chaise, pose la lettre sur la table. À proximité, un cahier est ouvert, vide d’écriture, sur lequel il envisageait de noter l’autre jour les annonces à faire à ses paroissiens. Le stylo est là aussi qui, comme par magie, glisse entre ses doigts. Alors, l’abbé Chouvet, poussé par on ne sait quelle sommation secrète, se met lentement à écrire.
Au mois d’octobre 1948, alors âgé de 12 ans, j’entrais à la Chartreuse, petit séminaire de Marleux. Après avoir attendu durant tout l’été l’acceptation de mon admission, j’étais envahi d’un sentiment que j’ai bien de la peine à décrire encore aujourd’hui. C’était du bonheur, certes, celui qu’on éprouve à cet âge candide lorsqu’on obtient l’exaucement d’un souhait très cher. Il était trop intense pour que mon âme ne faillît pas, un tel poids de bonheur frisait une sorte de douleur complaisante. Par instants, j’avais envie de sauter comme un cabri, et à d’autres je retenais mes larmes. Mais, ce matin-là, je cachais à ma grand-mère Marthe ces transports contradictoires. J’avais d’ailleurs été habitué à ne montrer aucune effusion émotive, qu’elle fût de joie ou de chagrin. Nous marchions côte à côte depuis la gare routière, silencieux, l’allure aussi austère que si nous avions suivi un cortège mortuaire. Je ne m’interrogeais même pas sur le silence de mon aïeule. Plus tard, lorsque j’eus à me remémorer ce trajet, je pensai qu’il était peut-être dû à sa tristesse, car elle n’allait pas me revoir avant Noël. Pourtant, je savais que mon entrée au petit séminaire la comblait. L’intensité de sa joie lui faisait-elle le même effet qu’à moi ? Ou songeait-elle encore au grand Mahatma Gandhi dont la disparition brutale, au mois de janvier, l’avait profondément accablée ? Je ne savais rien à cette époque de l’apôtre de l’Inde, sinon que son âme était grande : « C’est pour ça qu’on l’appelait Mahatma », disait-elle. Chaque dimanche, après la messe, elle faisait brûler trois cierges, à la mémoire de mes parents et du leader hindou. Durant cet été, elle en ajouta un quatrième. C’était, me dit-elle, pour me voir admis à la Chartreuse. Malgré les malheurs qui l’avaient éprouvée au cours de son existence, la piété de cette femme était restée intacte. Son éducation, certes, y pourvoyait beaucoup. Je dois préciser ici que deux de ses frères étaient entrés en religion et qu’elle se réservait autrefois la même voie. Je ne sais par quelle circonstance le destin en décida autrement. Elle épousa Urbain Pradier, mon grand-père. Mais ce fut, hélas, je l’ai compris plus tard, une union dans laquelle elle ne puisa aucune satisfaction, ni physique ni morale. Elle se disait destinée à une vie religieuse. Mon grand-père Urbain, sans doute dépité de ne pas avoir su se faire aimer, se consacra uniquement à son travail. Agent de maîtrise à la fonderie de Margeval où nous habitions, il passait outre ses horaires, rentrait tard le soir.
De cette union naquit pourtant une fille : ma mère, Simone. Elle fut leur unique enfant. Grand-mère l’éduqua dans la foi, néanmoins sans la ténacité qu’elle devait employer pour moi des années après. Ma mère rencontra à l’âge de vingt ans un jeune homme dont elle tomba éperdument amoureuse et elle l’épousa en 1935. Il s’agissait de mon père, Étienne Chouvet, que la guerre devait cruellement lui enlever en 1940 pendant la grande bataille des Ardennes. J’avais quatre ans. Cinq mois plus tard, elle partit à son tour, après un jeûne résolu auquel ses parents ne purent mettre un terme. Même si elle ne fut qu’un lent suicide, on considéra sa mort comme naturelle, provoquée par le chagrin et non par l’autodestruction dans laquelle elle avait sombré. Il semblait inconcevable qu’à cet âge elle eût choisi de mourir de sa propre volonté. Seul le chagrin était donc en cause aux yeux de tous, sauf à ceux de grand-mère, qui ne divulgua pas le fond de sa pensée à ce moment-là. Je dis cela car j’appris un jour qu’elle croyait que seule sa renonciation à la foi avait perdu ma pauvre mère. Le médecin conclut à un décès naturel suite à une faiblesse du cœur. À cette époque, on ne m’exposa pas les circonstances de sa mort, j’étais bien trop jeune. Je les ai connues seulement la veille de faire ma consécration à Dieu. J’évoquerai plus loin dans mes écrits l’état dans lequel me plongea cette douloureuse confidence.
Grand-mère me répéta tant que Dieu avait rappelé mes parents à lui et qu’on ne pouvait s’insurger contre Sa suprême volonté que je consentais à leur mort, ne pensais pas combien elle était injuste. Je gardais de mon père un souvenir vague et de ma mère une douceur infinie, tel un trésor que j’allais saisir dans mes tréfonds quand j’en ressentais le besoin. Même si elle souffrait, grand-mère se soumettait à la toute-puissance divine. Elle trouva le réconfort dans sa foi. Je la voyais souvent en prières. Je me suis demandé, dans mes moments d’accablement, si elle avait autant prié par peur de voir tourner son amour de Notre-Seigneur en haine, mais je compris qu’elle avait trop de dévotion pour que cela arrivât. Et puis elle était incapable de haïr. Je sus par la suite que mon grand-père n’avait pas éprouvé moins de chagrin d’avoir perdu ma mère que de n’avoir pas conçu un fils. Il aurait donc pu quérir vers moi quelque recours. Cependant, il s’éloigna. En s’effaçant peu à peu de l’existence de sa femme, il s’effaça par conséquent de la mienne. Il m’ignora, évita les contacts, m’abandonna à elle. Fervent aux jeux, il passait ses dimanches hors de chez lui, n’y rentrait que pour dormir, souvent abruti par les boissons alcoolisées. Mais il ne manqua jamais de subvenir à nos besoins et je crois qu’elle lui réservait en secret sa gratitude, le seul lien existant entre eux. Je m’accoutumai à vivre seul avec elle, dans une ambiance mystérieuse et la connaissance d’un passé qui l’était tout autant. Cependant, même si la chose semble difficile, je crois avoir pénétré bien des vérités dans les pensées les plus secrètes de ma grand-mère. Mais quelle serait l’utilité de les dévoiler ?
Elle se voua entièrement à moi, plus précisément à mon éducation. Je n’eus pourtant jamais à me plaindre de ses égards affectueux, bien qu’ils ne fussent guère éloquents. J’ai souvenance de caresses furtives sur mes joues ou mes cheveux, de paroles très douces, de sourires spontanés. Jamais elle n’éleva le ton ni la main sur moi. Il lui suffisait de répéter maintes fois les instructions auxquelles elle voulait que je sois attentif. Je l’écoutais avec une absolue confiance et une admiration grandissante. Tout ce qu’elle disait était beau, juste, fort. Ses lectures de la Bible m’orientaient vers le christianisme et suscitaient mon goût de la littérature. Elles m’instruisaient sur le vaste monde et les hommes. Et mon esprit ayant l’ivresse de l’aventure et de l’action, je trouvais dans les récits des Apôtres une belle évasion. J’allais ainsi vers tout ce à quoi grand-mère aspirait pour moi.
Je dois préciser ici que mon dessein n’est pas de louer les Saintes Écritures, mais celui de narrer les causes qui m’ont fait sombrer dans un tel état de confusion. Cependant, je me vois obligé d’évoquer mon enfance et ce qui la berça, afin d’apporter plus de compréhension à mon histoire. Histoire, dis-je ? Mais en serait-ce une que ces écrits ? Je les conçois plutôt comme une sorte de confession, car en ayant ainsi livré mes tourments, la lumière se fera enfin en mon esprit.
Grand-mère m’inscrivit dans l’enseignement privé quand j’eus sept ans. Elle contribua à mes bons résultats en m’exhortant à étudier le soir et deux heures chaque samedi après-midi. Le dimanche, avant le souper, je devais réciter mes leçons et montrer mes devoirs achevés. Un rituel s’imposa auquel je ne rechignais jamais. Elle savait me gratifier des efforts exigés. Décelant mon penchant pour la campagne, elle installa dans notre emploi du temps une échappée aux Fourches, chez mon grand-oncle Louis, celui de ses frères qui n’avait pas endossé la soutane. Un dimanche par mois, nous prenions le car après la messe et une visite au cimetière. Nous en descendions sur la place de la mairie. Quand le vent soufflait à l’ouest, il portait jusqu’à nous les douze coups de midi sonnant au clocher des Basties. Ah ! combien j’étais joyeux ! Nous avions à marcher seulement sur un kilomètre de chemin avant d’atteindre la ferme de mon grand-oncle et de ma grand-tante, que j’appellerai oncle et tante pour plus de simplicité. Elle, Mariette, était une femme volubile dont le souvenir m’inspire toujours un sourire. Ils nous attendaient sur leur seuil, visages avenants. Tante me serrait contre sa poitrine volumineuse en s’écriant : « Voilà mon joli Georgeou ! » Puis elle me baisait le front et les joues. J’étais chaque fois gêné, si peu habitué à de tels embrassements, mais je ne pouvais pas être rétif tant ils versaient en moi d’agrément. Puis elle entraînait grand-mère à l’intérieur. Mon oncle Louis m’entourait l’épaule de son immense bras, nous allions voir les bêtes à l’étable.
C’est par lui que mon goût pour la terre s’accentua. Il m’apprit tout de son agriculture au cours de ces dimanches et des vacances que je passai plus tard à la ferme. Ne devinant point encore mes aptitudes à la prêtrise, mon vouloir était à cette époque de devenir paysan. J’aimais ces méthodes anciennes, qui avaient tissé l’amour de l’homme pour sa terre. Je ne me doutais pas qu’un progrès rapide allait tout changer, que nous basculerions dans un monde nouveau où les machines seraient reines. Hormis le plaisir d’accompagner mon oncle aux champs à l’époque des semailles, d’aider ma tante à traire les bêtes, de charger le char de foin pendant la fenaison, je goûtais chez eux à une liberté dont je n’avais pas conscience. C’était un peu comme si des liens qui m’avaient enserré pendant la semaine se desserraient ces jours-là, et finissaient même par se rompre pendant les grandes vacances. Je glissais dans un bien-être que je n’éprouvais pas auprès de ma grand-mère, et Dieu sait pourtant combien elle fut bonne pour moi ! Je crois qu’il dépendait presque entièrement de l’ouverture de mon esprit vers des connaissances nouvelles, que la chère femme ne pouvait m’inculquer. Je ne l’en blâme point ni n’accuse la culture immense, qu’elle avait apprise seule dans ses lectures spirituelles et qu’elle me transmit, et qui devait plus tard me concéder bien des bonheurs. L’affection que je recevais d’oncle Louis et de tante Mariette contribuait aussi à cette détente. Il me faut ici mentionner que cette affection découlait d’une bonne cause : j’étais le seul enfant mâle de la lignée. Le couple avait eu deux filles qui, à leur tour, n’engendrèrent que des demoiselles, au grand désespoir d’oncle Louis. Et bien qu’il les aimât, il ne pouvait les chérir puisque ces familles s’étaient établies bien loin d’ici. Je ne côtoyais d’ailleurs ces petites cousines qu’aux grandes vacances, quand elles venaient aux Fourches.
Pierre, le frère aîné de ma grand-mère, étant abbé en la ville de Besançon, je ne le rencontrai qu’à trois reprises dans ma vie. Mais nous rendions visite régulièrement à mon autre oncle, curé à Vergeyzac, une moyenne bourgade située dans le val de Loire. Je garde plus précieusement le souvenir de nos promenades sur les berges encore sauvages. Je m’extasiais de l’endroit, enchâssé entre de hauts rochers dressés sur l’anse du fleuve. Au sommet de l’un d’eux, les ruines d’un château m’inspiraient des visions du temps où de terribles archers, mi-seigneurs, mi-brigands, se livraient bataille. Grand-mère et son frère Germain s’asseyaient sur l’herbe, me laissant patauger jusqu’aux genoux dans les eaux fraîches pour attraper les vairons. Dans le bruit du flot, je ne pouvais distinguer leur conversation, mais je savais que j’en étais souvent le propos. Lorsque je relevais la tête, je distinguais dans leurs regards posés sur moi une lueur identique de bienveillance inquiète.
Des moments passés dans la cure, ma mémoire retient des images moins rieuses mais aussi fortes. La fenêtre ne donnait pas sur un jardin, comme ici aux Basties, mais dans une ruelle où ne circulaient que de vieilles gens. Je n’y voyais jamais de gosses de mon âge, desquels je me serais volontiers approché. On eût cru que ce bourg n’était habité que par ces âmes séniles, courbées sur leurs cannes résonnant lugubrement sur les pavés. Je ne songeais pas alors qu’en semaine, à l’heure du catéchisme, l’endroit devait être plus bruyant et plus joyeux. Quand grand-mère et oncle Germain paraissaient oublieux de ma présence, je m’échappais dans la nef et me laissais pénétrer de cette aura mystérieuse parfumée de la délicieuse odeur d’encens. Je marchais entre les bancs. Mes pas, si légers fussent-ils, produisaient un son feutré qui montait jusque sous les voûtes et ne semblait jamais mourir. Certaines fois, je glissais dans une sorte d’engourdissement contemplatif. À d’autres, l’envie me prenait de fuir l’endroit, soudain terrorisé par le silence et la pénombre. Mais je demeurais les pieds cloués aux dalles, les yeux fixés sur la sculpture du Christ. Un jour, il me sembla, je m’en souviens encore, que Son regard s’était levé sur moi, strié de rouge. Je tremblais. Ma peur n’aurait point été telle – et sans doute n’eût-elle pas eu lieu d’exister – si je n’avais eu la vision de Son visage transformé soudain en celui du Démon. Je priai jusqu’à ce mon effroi s’apaisât. Puis je me moquai de m’être laissé abuser par mon imagination, mais je restai inquiet jusqu’au soir.
Avant de m’endormir, je cherchai réconfort auprès de grand-mère en l’interrogeant sur le Malin. Elle m’énuméra alors toutes les tentations auxquelles il nous incitait ; je n’étais guère plus rassuré. Sans doute discerna-t-elle mon tourment puisqu’elle ajouta qu’une âme au service de l’Éternel ne devait point craindre cet ange déchu, que si la mienne restait pure, je n’aurais jamais à subir son influence. Quelle ne fut pas mon angoisse ! Je me demandai à quel vice je pouvais être enclin pour avoir été l’objet de cette apparition. Après mûre réflexion, je fis un rapprochement entre elle et le ressentiment que j’avais pour grand-père à cette époque, ainsi que le souhait que j’avais formulé qu’il disparût de nos vies, que la mort l’emportât en Enfer pour ne pas m’avoir aimé. Mais dans les jours qui suivirent, je parvins à oublier l’homme et ma vision, tant je puisais de force dans les paroles sacrées que grand-mère me dictait. Je les écoutais avec une attention si concentrée ! Elles coulaient en mon esprit comme un flot de délices, emplissaient ma mémoire, nourrissaient mon âme. Elles gonflaient mon espérance et me comblaient de certitudes éternelles. Chaque jour, elles me conduisaient vers Dieu.
Voilà pourquoi j’étais inondé par un si grand bonheur ce matin d’octobre 1948. Ma rentrée à la Chartreuse de Marleux, j’en rêvais, je la désirais aussi ardemment que la désirait ma chère grand-mère. Je n’éprouvais aucune peine de ne plus retourner à mon ancienne école ni de ne plus voir les garçons avec lesquels j’avais sympathisé. Le fait tenait peut-être à ce que mon meilleur camarade, Guy Chalendard, entrait lui aussi au petit séminaire. Mon seul souci pendant ces dernières vacances avait été d’attendre l’accord de mon admission. Je sus ultérieurement que cette attente relevait de l’ambiguïté du décès de ma mère que le supérieur interprétait comme un suicide. Je crus même comprendre que mon oncle Germain était intervenu. J’eus également la chance d’avoir une grande partie de mes études payées par L’Œuvre des vocations, les ressources de ma grand-mère n’étant pas des plus considérables. Ce qui ne l’empêcha pas de me fournir en argent de poche et de mettre un pécule de côté dont je bénéficierais plus tard.
Lorsque nous parvînmes à la rue Saint-Benoît, je levai la tête. Pour la première fois, mes yeux ignorèrent la cathédrale, point d’honneur de Marleux, un joyau de l’art mauresque, byzantin, roman. Il se posèrent sur le bâtiment où allait désormais se jouer ma destinée. Je fus médusé par sa grandeur. Pourtant, je l’avais déjà considéré lors de nos échappées à la ville, et en particulier lorsque nous venions communier à Notre-Dame au lieu de notre chapelle de Margeval. Mais ce n’était que pour les grandes fêtes et mon exaltation n’était pas identique à celle de ce matin-là. L’escalier se montra plus large et plus haut que dans mon souvenir, le porche immense. Je ne voyais rien de la grande cour et du parc d’agrément aménagés derrière la bâtisse, ni des autres logis construits dans cet espace. Avant de franchir le seuil, grand-mère me saisit la main brusquement. Étonné, je me tournai vers elle, croisai son regard que toute joie avait quitté. Je lui souris, elle me serra plus fortement les doigts. Voyant ses lèvres s’ouvrir, je pensai qu’elle voulait dire quelque chose, mais elle demeura sans voix et ferma sa bouche qui se ceignit de rides profondes. À ce moment-là, je sentis s’envoler mon bonheur. Une crainte s’installa, qui allait demeurer en moi pendant plusieurs jours.
Un prêtre fort jovial nous accueillit et nous conduisit directement au bureau du supérieur. Après trois coups frappés à la lourde porte, une voix sonore nous commanda d’entrer. Je m’attendais à voir un homme de grande corpulence ou d’une physionomie aussi virile que sa voix. Je fus alors surpris devant un prêtre délicat ressemblant à quelque oiseau dans sa soutane noire. Il avait le visage oblong, les yeux ronds, les narines pincées et la bouche en cul de poule. Loin d’être rassuré, j’éprouvais une impression désagréable, car cette maigreur exprimait pour moi une malignité de l’être. Mais dans les minutes suivantes, j’étais déjà sûr de m’être trompé sur son apparence. En effet, je pus juger par la suite de sa grande mansuétude. Après les préliminaires, je fus invité à visiter mon nouvel univers. Comme il était consigné que la famille devait connaître le lieu où demeurerait désormais son enfant, grand-mère nous accompagna.
Il me faut préciser encore qu’à cause du retard de mon admission, ma rentrée avait été reportée de quelques jours. C’était la raison pour laquelle j’étais le seul pensionnaire à être accueilli ce matin-là. Nous fîmes le parcours de toutes les dépendances, longeant d’interminables couloirs, gravissant les trois étages, du réfectoire jusqu’aux classes et aux dortoirs. C’est dans le premier que monsieur le recteur me désigna ma place, avec lit et placard, perdue au milieu des autres. J’étais impressionné. La vaste pièce, bien qu’austère, étonnait par sa salubrité. Je fus heureux d’être logé près d’une fenêtre ayant vue sur le parc. Je laissais là mon bagage, tandis que le chef d’établissement faisait remarquer la propreté et l’ordre en de brèves paroles. Grand-mère exprimait son accord, hochant la tête. Puis nous redescendîmes le large escalier. Je tentais de me repérer en lorgnant dans le dédale des couloirs. Une rumeur venait jusqu’à nous et je compris que plus elle enflait plus nous nous rapprochions de la cour. Là, en nombre considérable, les élèves attendaient la sonnerie. Âgés de douze à vingt ans, les uns jouaient aux billes, les autres marchaient en groupe, d’autres encore étaient appuyés contre les troncs des arbres dressés au milieu du terrain. Des enseignants s’entretenaient entre eux. Le recteur me présenta à deux ou trois dont j’allais être le potache. Mon inquiétude s’accrut. Pourtant, je crus en être débarrassé lorsque nous atteignîmes le parc, un endroit évoquant la campagne des Fourches par l’abondance des feuillages déjà brunis par l’automne. Une allée filait sous des platanes, des tilleuls, des sycomores et d’autres arbres plus rustiques. Sous leur couvert, je devinais un monde où mon esprit se plairait à errer. Ici, d’autres garçons se retrouvaient et parlaient bas, comme si l’endroit était propice aux choses secrètes. Ce jour, je ne vis pas l’immense potager qui fournissait une grande part de la nourriture engloutie par les pensionnaires de l’école.
Notre dernière étape se fit à la chapelle. Je lui trouvai un air campagnard parce qu’elle était nichée dans les feuillages. À l’intérieur, rien ne différait des autres églises, hormis la surface et la disposition du mobilier. Grand-mère demanda à allumer un cierge. Je sus qu’elle remerciait Notre-Seigneur de ma venue ici. Sans tarder, elle adressa sa reconnaissance au supérieur, puis fit ses adieux. Elle me baisa le front et murmura quelques mots que je ne compris pas. J’ai toujours pensé qu’elle les avait prononcés en latin. Je n’eus pas le temps de voir son regard, car elle se dirigea aussitôt vers la sortie. Lorsqu’elle eut passé les portes de la chapelle, je me sentis égaré, n’ayant pour seule compagnie que cette angoisse qui entravait ma gorge d’une grosse boule. Je réalisai que je ne la verrais plus souvent et qu’un temps aussi long que celui écoulé depuis la mort de mes parents ne nous appartiendrait plus jamais.
À peine un mois s’était écoulé que l’inquiétude m’avait déjà quitté. Je m’adaptais, contrairement à certains de mes jeunes camarades internes. Il n’était certes pas permis à tous de faire face à la rigueur du petit séminaire. Combien auraient préféré se rendormir au lever de six heures, ne pas se laver à l’eau froide, manquer la messe quotidienne et les cours, ne pas se taire à l’étude ! Mais ils finissaient par se plier doucement à ce régime disciplinaire. La plupart des gens studieux, ceux-là même qui avaient désiré leur entrée au petit séminaire, étaient aidés par leur soif de réussite. J’étais de ce nombre, ma seule ambition étant d’obtenir haut la main mon baccalauréat. « Tu seras instruit en toutes choses », m’avait répété si souvent grand-mère. J’éprouvais donc le besoin de la contenter. Guy Chalendard se distingua en grec, je le fis en français. En découvrant Claudel, Mauriac, Hugo, Lamartine et autres génies, mon goût pour la littérature augmenta. Le soir, sous les draps éclairés par la lampe torche, je voyageais en notre Auvergne avec Gaspard des Montagnes.
Le temps passait. Je n’eus d’ami que Chalendard et mon confesseur, le père Junier. Je ne sus pourquoi je confiai un jour à ce jeune prêtre le mystère qui entourait la mort de ma mère. Fut-ce à cause de mes propos – pleins de doute à l’égard de Dieu – qu’il me prit sous son aile et me remit sur le chemin que grand-mère m’avait déjà ouvert. Dès la seconde année, je sus que ma vocation était d’être prêtre. Mon premier souhait s’était envolé loin de moi, et mes futures échappées aux Fourches ne me le firent pas reformuler. J’avais déjà décidé de poursuivre mes études au grand séminaire. Guy Chalendard était habité de la même ferveur. À Noël, Pâques ou Toussaint, je retrouvais la maison de Margeval et ma brave grand-mère. Son époux, quant à lui, passait toujours en courant d’air. Bien que je fusse heureux, je sentais les liens anciens se resserrer autour de moi. L’existence semblait reprendre où nous l’avions laissée, comme si grand-mère n’avait pas vieilli et moi pas grandi. Auprès d’elle, je freinais les impulsions qu’une proche adolescence éveillait en moi. Et bien qu’elle ne me l’eût pas interdit, je n’allais jamais aux fêtes foraines ni aux vogues. Il n’y avait qu’aux Fourches, quand le travail était terminé, que mon oncle Louis m’y poussait. Alors je me laissais vivre, je connus doucement des plaisirs auxquels je ne me croyais pas enclin. Mon regard se porta sur le sexe opposé.
À l’âge de quinze ans, ma sexualité s’éveilla brutalement, me jetant dans bien des tourments. J’avais été mis en garde si souvent par grand-mère quand elle me lisait les passages des Évangiles : « Ceux qui vivent de la chair s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit. Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix. » C’était pourtant au petit séminaire que j’avais acquis mes plus grandes connaissances en ce domaine. Car rien n’aiguise mieux la curiosité et la soif que l’interdit. Lorsqu’un professeur jésuite vint nous instruire de sexualité un an avant le bac, nous en savions déjà les phénomènes essentiels, en particulier ceux que notre jeune force mâle attisait en nous. Et combien de gravures licencieuses, que les externes pouvaient s’approprier à loisir et nous montrer, avaient voyagé entre nos mains !
Pendant les vacances aux Fourches, je découvris la compagnie des filles et les jeux coquins auxquels un cœur juvénile se laisse attirer. Mes cousines en furent les meneuses avant mes plus proches voisines. Mais je ne faisais que jouer, certes émoustillé mais pas suffisamment pour céder à la tentation. Sans doute étais-je trop avisé pour ne pas satisfaire de coupables curiosités, et ces demoiselles n’avaient pas la beauté du diable. Il arriva pourtant à cette époque un fait qui me troubla davantage. Un après-midi, alors que j’entrais à l’étable, j’y surpris mon oncle et ma tante étroitement serrés l’un contre l’autre, en train d’admirer un veau qui tétait goulûment le pis de sa mère. L’oncle palpait de ses larges mains la poitrine généreuse de ma tante ; je me cachai derrière le pilier et les épiai. Puis je les entendis parler :
— Y’a longtemps que ça t’es pas arrivé, hein ? Je te ferai pareil ce soir, tu aimeras ça, tes tétons deviendront durs comme des bourgeons !
— Oh ! Louis ! s’exclama ma tante.
— Quoi Louis, quoi ?
— T’as pas honte ! Et puis à nos âges !
— Y’a pas d’âge, et tu le sais bien ! Tu aimes mieux ça que quand tu avais vingt ans !
Il avait passé une main dans son corsage et soupirait fort. Tante Mariette gémissait doucement. Il reprit :
— Tu es une véritable cochonne quand tu es excitée ! Dis, et si on n’attendait pas ce soir ? Si on se mettait là, dans le foin ? Comme autrefois, tu te souviens ?
— Louis ! protestait ma tante tandis qu’il lui baisait le cou, t’es pas fou, et si le gosse venait ? Et puis, c’est pas l’heure !
— Y’a pas d’heure pour les braves ! Je vais aller mettre la clenche, il ne pourra pas rentrer.
J’eus tout juste le temps de m’esquiver sans être aperçu. Je courus dans la maison, les sens allumés. Ce soir-là, j’osais à peine lever les yeux sur eux, mais, à leur insu, je les considérais. Ils étaient comme d’habitude, mais leurs regards semblaient briller davantage. Lui, vêtu de son gros pantalon de velours noir et d’une chemise à carreaux, sale et grande ouverte sur son torse velu ; elle, fagotée d’une blouse marine dont l’encolure en V descendait dans la ravine de sa gorge pleine. Elle avait encore la taille prononcée, des bras ronds et fermes. Je vis un brin de paille accroché dans ses cheveux sombres, qui luisait sous la lampe comme une épingle d’or. Plus tard, au fond du lit, j’imaginai les seins de tante Mariette, énormes et blancs, sous les mains alertes de mon oncle. Pendant longtemps, cette image m’encouragea à des caresses interdites, mais la honte s’empara de moi peu à peu et finit par calmer mes pulsions. Je m’efforçai à l’avenir de ne plus songer à cet incident. Les années passèrent, presque égales. En juin 1954, je passai mon bac et obtins la mention « Bien » ainsi que je l’avais souhaité. Grand-mère était fière, j’étais satisfait. Dans le même mois, je m’inscrivis au grand séminaire et rencontrai Laure Exbrayat. J’avais alors dix-huit ans.
C’était au mois d’août. La chaleur était particulièrement élevée, et bien que le village des Fourches fût à bonne altitude, on n’y sentait pas plus l’air que dans les bas-fonds. Cependant, personne ne se lamentait car, s’il étouffait durant cinq jours, il rassérénait les deux suivants par de fugaces orages. Cette année-là, le temps faisait d’agréables caprices. Ainsi baignée de soleil et d’eau, la terre respirait de santé. La végétation, grasse et libertine, déployait ses feuillages verts et ses épis d’or, déferlant par-dessus les sentiers et les clairières comme une vague silencieuse porteuse de mille senteurs. Tous ces bocages abritaient des prairies dont l’opulence outrepassait la superficie. Les ruisseaux roulaient sans relâche leurs eaux gonflées et pures jusqu’au fleuve aimé de France.
Je restai l’été presque entier aux Fourches. D’ailleurs, il en était ainsi depuis deux ou trois années. Je me grisais du paysage et participais aux travaux de la ferme. Bien que je n’eusse plus les mêmes intentions qu’autrefois, je chérissais toujours le terroir. Ce que j’aimais surtout, ce n’était pas le travail en lui-même, mais tout ce qui le procurait : la terre, l’herbe, les blés, les bois… J’aimais de cette campagne son relief, ses couleurs et ses odeurs. Mon sentiment pour elle s’alliait au travail. Aux Fourches, je maniais la faux et le râteau aussi bien que le paysan, les tâches ne me rebutaient jamais. Elles développèrent mes muscles et, bien que je fusse toujours mince, je n’avais plus, cette année-là, l’allure d’un gosse. Mon cousin René, de Marseille, séjournant au pays pour deux semaines, monta à la ferme le jour de la vogue. Il m’y entraîna. Je n’ai pas pressenti que quelque chose d’extraordinaire m’y attendait.
Dès notre arrivée dans le bourg, je reconnus des jeunes gens des Basties, de Moyac et autres lieuxdits. Ils nous saluèrent. Des filles, que je n’avais jamais vues pour la plupart, faisaient partie de leur groupe. L’une d’elles attira mon attention. Son teint d’ivoire assombri par de longs cheveux cuivrés, son nez fin aux narines légèrement retroussées, sa bouche charnue couleur coquelicot ajoutaient à la pureté de son visage de madone. Mais ses yeux étaient ceux d’une diablesse : deux lacs bruns où de l’or scintillait et où je me noyais alors comme en des eaux attrayantes, happé jusqu’au fond avec délice. J’étais dans un tel ensorcellement que je n’avais même pas conscience de mon attitude grotesque, aussi figé que si la foudre m’eût frappé. Pourtant je crus déceler dans les prunelles magnétiques une lueur amusée avant que la jeune fille ne fît demi-tour pour parler à son amie. Et quand cette dernière se mit à rire, je sortis enfin de mon inertie. Qu’avait-elle donc entendu de si risible ? Cependant, le flot qui courait en moi ne perdit pas de son débit, je l’entendais toujours cogner à mes tempes. C’est alors que René nous invita à entrer dans l’auberge où le bal commençait. Tous s’y engouffrèrent. Je traînai le pas, n’osant regarder si elle se trouvait dans le groupe. Je me sentis solitaire et triste. Ne venait-elle pas de se moquer ? Je fis brusquement demi-tour et me trouvai face à elle. Elle sourit, j’en fis autant. Puis je perçus sa voix grave qui me bouleversa presque autant que son regard.
— Je n’ai pas envie d’y aller.
— Tu n’aimes pas danser ? demandai-je après un raclement de gorge.
— Si, j’aime danser, mais pas avec André Savel, et il m’attend pour cela. Et toi, tu aimes ?
— Je ne sais pas, je n’ai jamais essayé, dis-je en me sentant stupide.