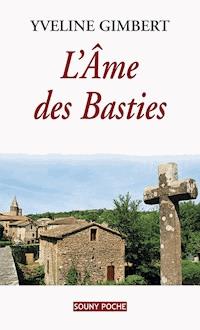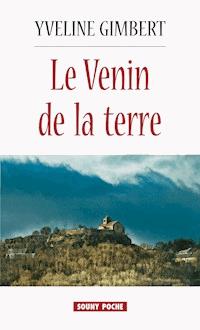
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'amour sera-t-il plus fort que l'appât du gain ?
Seul à connaître l’endroit où est caché le magot de la Résistance que les Anglais ont parachuté au cours de l’été 1944, Jacques Daubrac attend patiemment la fin de la guerre. Au moyen de cette bonne fortune, le jeune menuisier-charpentier espère séduire Fleur Guitton, dont il s’était entiché mais qui lui avait préféré le dénommé Guitton avant de devenir une jeune et belle veuve.
Seulement voilà : Élise, la sœur adoptive de Jacques, ne quitte pas ce dernier des yeux. Non seulement elle est très amoureuse de lui, mais encore elle épie ses moindres gestes et finit par découvrir à son tour le container de billets. Elle comprend en même temps que Fleur, bien qu’ayant un nouvel amant, ne restera pas insensible au charme sonnant et trébuchant de son frère. Sentant la menace se rapprocher et n’écoutant plus que la jalousie qui la dévore, elle décide de précipiter les événements et de retourner la situation à son profit au prix d’une sombre machination.
Un drame que plus rien ne pourra enrayer va dès lors se jouer, entraînant dans une spirale infernale tous ceux qui ont misé sur « l’argent du ciel ». Et c’est le venin de la terre – mais n’en disons rien ! – qui aura le terrible dernier mot.
Yveline Gimbert nous livre là un roman haletant dans lequel l’amour et l’argent sont unis pour le pire.
EXTRAIT
Le mont Palluc devait le terme « diable » à tous les drames survenus sur ce plateau sis à mille quatre cents mètres d’altitude dans les derniers contreforts des Cévennes. Les hivers y étaient longs et rudes, le froid sévissait, la neige volait, la bise hurlait.
Ceux qui s’y perdaient au cours des tempêtes y périssaient après avoir longtemps cherché une issue entre ciel et terre confondus. On retrouvait leurs corps gelés le lendemain, et parfois seulement après la fonte des neiges.
Pourtant, Jacques Daubrac ne craignait pas ce pays, il y était né, il y avait grandi. Il le connaissait par coeur. Pendant des années, il avait défié ses travers et contemplé ses attraits. En toute saison, il avait gravi les chemins, longé les rivières et arpenté ces vastes solitudes accrochées aux nuages. Jacques Daubrac ne pouvait respirer un autre air que celui-ci, même glacial comme il était en ce jour, si glacial qu’il lui brûlait les bronches.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Native de la Haute-Loire,
Yveline Gimbert est un écrivain prolifique. Au fil des ans, elle a réussi à conquérir et fidéliser un large public avec des romans fortement charpentés et judicieusement construits, aux rebondissements multiples et inattendus, peuplés de personnages troublants ou attachants qui ne quittent pas le lecteur !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cette histoire est née entièrement de mon imagination. Toute ressemblance avec des personnages ou des faits ayant existé ne serait que pure coïncidence.
Un matin de janvier 1945, Jacques Daubrac monta sur le plateau malgré le grand froid. De toute sa vie, il n’avait vu ciel semblable à celui-ci et n’avait senti pareille bise. Venue par le couloir de Cornebule, elle frappait de plein fouet le clapier des Hauts, rasait l’herbe et secouait les arbres couverts de givre qui grinçaient comme les essieux des vieux chars. C’était presque mirage de voir leurs squelettes blancs remuer sur le ciel limpide et immense. Toute la campagne tintait d’une musique étrange que Jacques écouta pendant un long moment, assis sur le clapier. Puis il promena son regard sur le mont Palluc, dont la masse noire s’inclinait légèrement vers le sud. La roche lui prêtait des yeux qu’on croyait tournés vers ce monde, insensibles à tout ce qui s’y passait, et une bouche, incurvée jusqu’au sol, pourvue de chaque côté de deux dents, sortes de canines ou de crocs que chacun ici nommait les « dents du diable ». Le mont Palluc devait le terme « diable » à tous les drames survenus sur ce plateau sis à mille quatre cents mètres d’altitude dans les derniers contreforts des Cévennes. Les hivers y étaient longs et rudes, le froid sévissait, la neige volait, la bise hurlait. Ceux qui s’y perdaient au cours des tempêtes y périssaient après avoir longtemps cherché une issue entre ciel et terre confondus. On retrouvait leurs corps gelés le lendemain, et parfois seulement après la fonte des neiges. Pourtant, Jacques Daubrac ne craignait pas ce pays, il y était né, il y avait grandi. Il le connaissait par cœur. Pendant des années, il avait défié ses travers et contemplé ses attraits. En toute saison, il avait gravi les chemins, longé les rivières et arpenté ces vastes solitudes accrochées aux nuages. Jacques Daubrac ne pouvait respirer un autre air que celui-ci, même glacial comme il était en ce jour, si glacial qu’il lui brûlait les bronches. Jacques était habitué aux grands froids comme aux grosses chaleurs. Pelotonné dans sa canadienne en mouton, les fesses bien calées sur une lauze plate, le menton dans les mains, les coudes appuyés sur les genoux, il laissa glisser son œil noir sur les flancs du mont Palluc, sur la lande et sur les pierres grises du clapier. Il réprima un frisson. Pour cause ! À quelques mètres de profondeur seulement, sous ses pieds, l’argent était enfoui ! Sa mémoire le ramena aux événements de l’été 44.
C’était en juillet. Il cachait de jeunes maquisards chez lui, au Fond de Lieu, dans une annexe jumelée à son atelier. Une façon pour lui d’aider la Résistance, nouvellement implantée au pays. Un grand bonheur aussi, même s’il ne participait pas aux actions des MUR (mouvements unis de la Résistance). Mais il ne manquait jamais d’écouter les récits de leurs exploits, surtout lorsqu’il s’agissait de sabotages. Une seule fois, il avait adhéré au groupe, car, l’un des jeunes gens ayant la fièvre, on lui avait demandé de le remplacer lors d’un parachutage d’armes. Quelle fierté il avait ressentie ! Là était la véritable aventure dont il avait toujours rêvé ! Par la suite, on ne l’avait plus sollicité ; à chacun son rôle ! Marcel Friouler, chef du secteur, avait une absolue confiance en lui, et les jeunes maquisards aussi. Tout le monde à Bournay connaissait l’honneur de la famille Daubrac ! D’ailleurs, depuis les débuts de la Résistance, aucun incident n’était survenu ici, même si les délations avaient commencé au moment où l’ennemi avait envahi la zone libre. En effet, les traîtres s’étaient multipliés dès l’apparition des GMR (groupes mobiles de répression) et de la Milice en décembre 43. Mais les attaques les plus meurtrières avaient eu lieu de l’autre côté de la Breuille, rivière qui partageait les basses et les hautes terres.
Le dimanche 9 juillet au soir, Friouler avait annoncé aux gars qu’un parachutage aurait lieu le lendemain sur le plateau du Palluc aux environs de vingt-trois heures. Les jeunes gens, oisifs depuis trois jours, profitaient des ombrages de trois immenses noyers plantés au milieu de la cour. Parfois, ils aidaient Jacques Daubrac à ramasser ses copeaux ou à entretoiser ses planches. À partir de la mi-juin, la chaleur était devenue torride et, dans la combe, l’air manquait. Jacques travaillait dur, sans jamais se plaindre, occupé à la fabrication d’une armoire commandée par un habitant de Bournay. Pendant des heures, il corroyait son bois et assemblait ses pièces, maniant toujours ses outils avec la même adresse. Mais le soir, la fatigue se faisait sentir et il se couchait plus tôt que de coutume. Pourtant ce soir-là, il avait veillé, pressentant qu’il ne pourrait s’endormir avant le retour des maquisards et sans avoir entendu de leur bouche le déroulement de l’action. Vers minuit trente, il comptait les voir arriver quand il entendit soudain des coups de feu. D’emblée, il s’approcha de la fenêtre ouverte tandis que s’ensuivait une longue rafale. Jacques comprit aussitôt qu’elle provenait d’en haut, sans doute à mi-chemin de l’endroit où le parachutage avait eu lieu. Une angoisse lui serra la poitrine, un terrible pressentiment. Lorsque le silence revint, il essaya de se calmer, s’efforçant de chasser les images que lui avait évoquées l’écho de la pétarade. Pourtant, quand son père déboula en pyjama de la cage d’escalier, l’air affolé, les doutes ressurgirent.
— Ça venait d’en haut, à un kilomètre au moins ! s’était écrié Claudius Daubrac.
— Ouais, au moins ! Bon Dieu ! qu’est-ce qui s’est passé ?
Le père resta muet un court instant, l’oreille tendue près de la croisée. Puis il murmura :
— Je crains le pire.
Jacques courut chercher ses souliers dans le cellier. Il les chaussa et s’exclama en nouant les lacets :
— J’y vais !
Voyant les yeux de son père se remplir d’appréhension, il ajouta :
— Il faut bien ! C’était une attaque, c’est sûr, et par ici ! Les pauvres gars, bon Dieu !
— Je viens avec toi ! s’écria Claudius.
— Non, tu restes ici ! Des fois qu’ils arriveraient…
Il ne savait même pas si c’était aux Allemands ou aux maquisards qu’il faisait allusion, les uns comme les autres pouvaient venir. Mais aussitôt, il pensa à sa mère que les tirs de mitraillette n’avaient pas réveillée. Elle était sourde comme un pot. Et si l’ennemi venait semer le malheur chez lui ? Il songea aussi à Élise, qu’il considérait depuis longtemps comme sa sœur, même si ce n’était pas le sang des Daubrac qui coulait dans ses veines. Ses parents l’avaient enlevée à l’orphelinat de Dorland quand elle avait onze ans et ils l’avaient nourrie et chérie comme si elle avait été leur propre fille. Jacques se secoua, manière d’expulser ses craintes. Si les Allemands ou les miliciens surgissaient, ils ne risqueraient pas de dénicher un seul maquisard au Fond de Lieu ! Et il savait bien que ceux-là avaient pris la peine de camoufler dans les recoins de l’annexe tout objet trahissant leur présence. Alors il ravala sa salive. Il fut à nouveau saisi par le désir d’aller se rendre compte de ce qui se passait. Il s’élança vers la porte et recommanda à son père de rester tranquille, d’éteindre la lumière et d’aller se recoucher. Puis, dès le seuil franchi, il se mit à courir en direction des hauteurs dans la nuit chaude et noire. La lune à son premier quartier l’éclairait à peine et Jacques regretta vite d’avoir voulu couper à travers champs. Les buissons freinaient sa course, des mûriers en particulier et des prunelliers en nombre par ici. Il suait et haletait. L’air était encore chaud bien qu’une petite brise se fût levée. Il ne la sentit pas, pas plus qu’il ne huma la bonne odeur du foin qu’elle transportait. Venant du sud-ouest, elle soufflait du côté de Bournay une promesse de pluie pour le surlendemain. En d’autres circonstances, il l’aurait perçue et il aurait pensé au bois livré ce jour et qu’il n’avait pas encore abrité. Arrivé près de la Breuille, il parvint à mieux se diriger en suivant le bord des eaux miroitantes, mais il lui fallut tout de même un long moment avant de trouver la passerelle qu’il croyait plus près. Il connaissait pourtant les lieux comme sa poche, mais l’obscurité trompait les distances, et son angoisse amoindrissait sa souplesse habituelle. Quand il fut passé de l’autre côté de la rivière, il emprunta le chemin de la pâture qui grimpait à travers les pinèdes jusqu’à l’Allombe, la montagne voisine du Palluc. À ce moment-là, il entendit au loin derrière lui un faible ronflement de moteur et lorsqu’il se retourna, il vit deux petits points rouges disparaître dans la nuit. Les phares arrière d’une auto. Elle allait en direction de Dorland. Il fut tranquillisé pour ses parents. Allemands, miliciens ? Sans doute, ceux-là avaient suivi le sentier des Saignes avant de prendre la petite route qui menait au village de Servas et de poursuivre en direction de Dorland. Il en déduisit alors que pour avoir emprunté cette voie, il fallait que l’un des leurs fût du pays. Il maugréa entre ses dents. Rien n’était sûr, mais le doute était fort présent en lui. Il tendit l’oreille. Aucun bruit ! Il poursuivit sa course en tâchant de retenir sa respiration, afin de mieux percevoir le silence de la nuit, n’osant appeler de peur d’entendre seulement l’écho de sa voix. Il longea la première pinède et sentit une odeur de poudre. Ses yeux scrutèrent le sol faiblement éclairé par la lune. Soudain, il vit un corps, puis, non loin, un deuxième. Il s’avança vers eux, le souffle court. Il dut beaucoup se pencher pour reconnaître le jeune Marc Chambon dont la bouche mordait la terre. Il se recula, le mal au ventre et le cœur en bataille contre toute la révolte qui coulait en lui, songeant à la mère du garçon encore en deuil du père. Puis il vit d’autres corps, étendus à deux mètres de là. Il ne tarda pas à les identifier. Il y avait le fils Granget, de la Vernière, âgé de vingt ans. Il l’imagina en train de courir pour tenter d’échapper à la fusillade… L’horreur de la vision lui broya les tripes. La nausée le contraignit à se plier en deux, mais il ne put rien rendre d’autre que des borborygmes. Plus son regard s’appesantissait sur les jeunes gens, plus il voyait les trous des balles dans leurs corps et le sang qui coulait sur une terre trop sèche pour pouvoir l’absorber. Il avait envie de fuir cet endroit maudit et ce silence de mort. Mais un soupir monta à ses côtés. Bien que saisi de peur, il se pencha immédiatement vers Julien Rivier, de Dorland, qu’il avait cru mort.
— Mon p’tit gars ?
Le garçon avait ouvert à demi les yeux. Son visage était déformé par la souffrance. Il gémissait.
— Je vais te sortir de là, p’tit, murmura Jacques.
— Non ! Je suis fichu, je le sais. Il faut que je te dise… ah, laisse-moi parler…
Jacques, pressentant qu’il n’en avait plus pour longtemps, le laissa s’exprimer.
— Je t’écoute.
— On a… on a réussi le parachutage. Ce matin, on avait repéré la cache… On a eu le temps d’aller y mettre l’argent. C’est… Ah !!!
Pendant un instant, il ne sortit de sa bouche que des plaintes difficiles à entendre, et Jacques subissait une souffrance morale égale à sa souffrance physique. Par égard pour lui, il retenait ses larmes, mais une grosse boule entravait sa gorge. Si bien qu’il ne pouvait lui-même émettre une parole. Il pensait que c’en était fini, mais le garçon reprit :
— C’est juste en face de la cabane… la tienne… au milieu du clapier, sous une pierre en forme de sabot recouverte de mousse… tu peux pas te tromper… Je… Ah !
Jacques se pencha plus près de lui encore, il demanda :
— Quoi ?
— Je voudrais que tu dises à ma famille que… je… les… aime…
Il ferma les yeux après un ultime râle. Son visage exprimait de la sérénité. Il souriait à Jacques. Ce dernier l’empoigna par les épaules, le secoua pendant quelques secondes, le suppliant de vivre. Mais il comprit vite qu’il n’y avait plus rien à espérer. Il se releva et approcha de ses compagnons… des fois qu’ils respireraient encore ! Mais la mort les avait happés, sans doute sur le coup. Il demeura un instant immobile, choqué, puis une peur terrible commença doucement à l’envahir. La peur de cette mort si présente, si brutale et si injuste, et soudain une autre… la peur d’être accusé de trahison. Qui d’autre que lui savait que le parachutage était prévu pour ce soir ? Outre Marcel Friouler, qui d’autre ? Il pensa avertir ce dernier du drame, mais la peur le freinait. Et puis à cette heure ! Longtemps en proie à maints atermoiements il décida enfin de rentrer chez lui. Il se mit à courir en direction du Fond de Lieu avec cette peur aux trousses. À son arrivée, il tomba sur le père qui avait attendu dans la cuisine, accoudé à la table. Dès qu’il aperçut son visage, celui-ci saisit la situation, mais il demanda pourtant :
— Alors ?
— Morts ! Ils sont tous morts !
Jacques se laissa choir sur une chaise face à son père. Il prit sa tête entre ses mains.
— C’était affreux, pauvres gosses !
Un silence s’installa pendant cinq bonnes minutes. Seul le comblait le bourdonnement des mouches entrées en grand nombre par la fenêtre ouverte. Jacques revoyait sans cesse l’horrible carnage et il ne parvenait pas à sortir de son anéantissement.
— Il faut qu’on prévienne Marcel, dit le père.
— Maintenant ? s’affola Jacques.
Ses craintes refaisaient surface, et il ne les cacha pas.
— C’est une délation… et si les autres croyaient que c’est nous les traîtres ?
Claudius parut fort étonné. Il s’écria :
— Quelle idée ! Pourquoi le croiraient-ils ? Tout le monde sait ici qu’on peut nous faire confiance ! T’as pas à avoir peur de ça, voyons ! Et tu verras que le traître, ils le trouveront !
Rassuré, Jacques dit :
— Descendre en plein milieu de la nuit chez Friouler, c’est peut-être risqué, tu crois pas qu’il vaut mieux attendre l’aube ?
Faisant allusion aux quatre jeunes maquisards, il ajouta :
— De toute façon, ça ne les ramènera pas !
Claudius n’eut pas à réfléchir longtemps.
— Ouais, ça peut attendre le matin. Allons nous reposer un peu, va.
— Monte, toi, murmura Jacques.
Le père posa sur lui un regard sombre avant de gagner l’escalier. Jacques, lui, savait qu’il ne pourrait pas dormir de la nuit. Il se servit un verre d’eau et se prépara à attendre le petit jour. Chaque tintement de l’horloge le tirait de ses pensées macabres et chaque silence l’y replongeait. Pourtant, un peu avant l’aurore, il s’assoupit, arc-bouté sur la table, jusqu’à ce que des coups frappés à la porte le fissent sursauter. Pris de panique, il alla ouvrir et se trouva face à deux hommes du maquis des Solaines qu’il connaissait bien et auxquels il demanda :
— Que se passe-t-il ?
Tout en pénétrant dans la demeure, l’un d’eux répondit :
— Il y a eu une attaque, ceux d’ici ont tous été tués, tous les quatre !
Jacques recula pour leur laisser le passage. Il s’apprêtait à raconter les faits, mais Pierre Delac le questionna :
— T’as pas entendu les coups de feu ?
— Si, je les ai entendus, ça a duré longtemps.
Il avait envie de dire qu’il était allé sur les lieux, mais à présent quelque chose qu’il ne pouvait comprendre retenait sa voix.
— Mon vieux Jacques, murmura Élie Brenas, t’as l’air d’avoir pas fermé les yeux de la nuit !
— Non, parce que je les attendais… Je me doutais qu’ils étaient tombés dans une embuscade, mais je n’en étais pas sûr. Dans la nuit, j’ai pas bien pu me rendre compte d’où venait la fusillade. Je m’apprêtais à aller voir maintenant.
Tout en parlant, il se demandait pourquoi il mentait.
— C’est ce salaud de Pugnac qui les a trahis ! déclara Delac d’un ton plein de haine. Hier, Martin Solignac l’a vu avec la Milice… il a entendu prononcer le nom d’un des jeunes, mais il est seulement venu nous faire part de ses soupçons hier au soir. On est allé pincer Pugnac, mais quand il a avoué, il était déjà trop tard, nous sommes arrivés bien après l’agression.
Jacques resta un moment interdit, muet, ahuri. Il lui sembla qu’il pouvait maintenant dire la vérité, mais les autres se demanderaient pourquoi il ne l’avait pas fait plus tôt. Il planerait une interrogation, un doute… peut-être en déduiraient-ils qu’il était de mèche avec Pugnac. Jacques soupira au-dedans de lui. Il ne réfléchit pas davantage et décida de garder son secret sans savoir la raison véritable qui l’y contraignait. Les autres déclarèrent qu’il leur fallait aider à lever les corps. Delac ajouta qu’il devait accomplir avec Friouler la dure épreuve d’avertir les familles. Puis, s’apercevant de la mine décomposée du paysan, il lui appliqua une légère tape sur l’épaule.
— T’inquiète pas, Jacques, c’est pas beau tout ça, mais…
Les mots s’étranglèrent dans sa gorge. Il se retourna brusquement et franchit le seuil, suivi de son camarade. Jacques les regarda s’éloigner de ses yeux hagards. C’est alors que son père fit son apparition.
— Mais pourquoi ne leur as-tu pas dit que tu y étais allé, bon Dieu ?
Jacques hésita à lui répondre, puis :
— Je ne sais pas… Cette peur idiote qu’on pouvait croire que c’est nous les délateurs… ça m’a pris soudain… Mais ça n’a pas d’importance, père, que je l’aie dit ou pas, ça ne change rien !
Les paroles du petit Rivier lui revinrent en mémoire : « L’argent est caché… » Il pâlit. L’argent ! Il n’y avait plus pensé ! Et les deux autres ne l’avaient pas évoqué ! Tout était allé si vite ! Et toutes ses préoccupations avaient ôté de sa mémoire le souvenir de cet argent ! Il avait eu sans cesse l’image de Julien Rivier devant les yeux, mais il avait oublié ses paroles. Et maintenant, les dernières lui revenaient et ajoutaient à son désarroi : « Tu diras à ma famille, aux miens que je les aime. » Il ne pouvait plus ! Il essuya la sueur de son front d’un geste rapide. Il eut envie de rattraper les deux hommes et de tout leur révéler. Je n’ai rien dit parce que j’avais peur que vous croyiez que je sois le traître, leur confierait-il. Mais il ne bougea pas.
— Non, je sais que ça ne change rien, répliqua son père, et je comprends que tu aies pu avoir peur. Pourtant, ceux-là ne pouvaient pas avoir des soupçons sur nous !
Ne voyant pas Jacques réagir, il cria d’un ton qui voulait le rappeler à l’ordre :
— Tu entends, fils ?
Alors Jacques s’efforça de reprendre un comportement normal et il annonça :
— J’espère que ce salaud de Pugnac va le payer, qu’ils vont lui faire son affaire.
— T’en fais pas pour ça, avec eux ça ne badine pas, ça fera une crapule de moins sur la terre.
Et comme s’il regrettait d’avoir été plus cruel que le délateur, il murmura :
— Je pense qu’ils feront les choses dans les règles, proprement.
Ce mot signifiait pour lui légalement.
— Quant à toi, ne va pas chanter dans quelques jours que tu es allé sur les lieux, on se demanderait si tu ne perds pas la boule.
Sur ces paroles, il se dirigea vers le fourneau et en souleva la trappe. Puis il prit une feuille de journal et du petit bois dans une caisse placée à côté. Il fourra le tout dans le ventre du fourneau et y mit le feu à l’aide d’une allumette. Jacques le regardait faire, la pensée toujours accrochée à son secret. S’il avait ressenti du remords quelques minutes auparavant, celui-ci le quittait. Il se répétait qu’il n’avait pas eu le temps de promettre au jeune Vivier qu’il irait trouver ses parents. Le sort en avait décidé autrement. Et que pouvait-il contre le sort ? À présent, il ne songeait plus qu’à l’argent. Il se demanda si les autres savaient où il était. Les jeunes maquisards leur avaient-ils désigné la cachette avant d’aller l’y mettre ? Il aurait tant aimé savoir ! Soudain, il se demanda pourquoi une telle envie le saisissait aussi fortement. Et il comprit que la tentation y contribuait beaucoup. Certes, ils n’étaient pas si aisés les Daubrac ! Avec cet argent, la situation pourrait changer ! Mais il éprouva bientôt un autre remords… Les fonds étaient destinés aux pauvres gars qui œuvraient pour la patrie. Il lui fallait chercher une solution pour réparer le mal. Il la chercha, mais ne la trouva pas. Dépité, il espéra pourtant que le temps la lui apporterait bientôt. L’arrivée de sa mère l’arracha à ses pensées et il s’adonna à ses occupations.
Mais à la fin de la semaine, n’y tenant plus, il s’aventura vers le clapier des Hauts. Parvenu près de la cabane, il scruta les environs, aussi déserts que les autres jours. Il n’y avait âme qui vive, sauf les bêtes sauvages. Il grimpa sur les éboulis et chercha la pierre en forme de sabot recouverte de mousse. Il avait arpenté la moitié du clapier lorsque son regard tomba sur une énorme lauze de la forme désignée et verdie par une mousse vigoureuse. Par ce temps sec et chaud, cela aurait pu paraître surprenant à un étranger, mais Jacques, qui avait grandi ici, ne s’interrogea pas le moins du monde. Sur ces clapiers d’altitude, il y avait toujours une humidité, venue d’on ne savait où, d’en haut ou d’en bas, qui gardait les lichens au frais. Par ailleurs, trois ou quatre blocs de taille impressionnante, dressés comme des menhirs, ombrageaient l’endroit pendant une bonne partie de l’après-midi, au moment où le soleil est le plus chaud. La mousse ne séchait donc point, ni ne jaunissait, ni ne disparaissait. La pierre, de quatre-vingts centimètres sur cinquante, reposait sur les arêtes des blocs amoncelés là, et personne n’aurait pu soupçonner l’existence d’une cavité entre eux. Jacques s’accroupit, regarda par une fente et ne vit rien d’autre que du noir. Alors il agrippa la pierre, où la prise était le plus aisée. Malgré son poids, il n’eut aucune difficulté pour la tirer vers lui tandis que le son produit par le frottement résonnait étrangement dans la fosse. Quand le passage se présenta suffisamment grand pour pouvoir s’y faufiler, il arrêta l’effort et se pencha au-dessus du trou, sa curiosité à son comble. La lumière entrait assez pour qu’il se rendît compte que la profondeur était de faible importance, ainsi qu’il l’avait supposé. Un homme de sa taille devait tout juste y tenir debout. Sans plus attendre, il se laissa glisser entre les pierres. Très vite, ses pieds touchèrent le sol. Là, il saisit la torche qu’il avait pris soin d’emporter et en dirigea le faisceau à droite et à gauche, lequel buta les parois formées par les énormes blocs. Ils étaient si nombreux et si bien enchevêtrés les uns dans les autres que la lumière pénétrait faiblement, et bien que l’antre atteignît seulement une dizaine de mètres carrés, il se trouvait presque entièrement dans l’ombre. Jacques réprima un petit frisson en pensant à tout ce poids qu’il avait au-dessus de la tête. Puis il fouilla des yeux l’espace, croyant y voir le container. Mais rien ! Alors il leva sa lampe et découvrit un recoin, sorte de tache plus noire que le basalte. Il fit trois pas et y aperçut un sac en toile de jute fermé en haut par une vulgaire ficelle comme un sac de pommes de terre. Il comprit immédiatement qu’il s’agissait de l’argent. Il eut une pensée pour les jeunes maquisards et se représenta la fierté qu’ils avaient dû ressentir au moment où ils l’avaient caché là. Puis, les revoyant, morts dans la pinède, il soupira. Il se précipita vers le sac, tira sur les liens de ses mains tremblantes. Il braqua la torche sur l’ouverture et étouffa un cri. Il y avait beaucoup plus de liasses qu’il ne l’avait pensé et, de ce fait, il ne put évaluer la somme. Il était trop remué, tant par la vue de l’argent que par le souvenir des jeunes gens longtemps réunis sous son toit. Il renoua la corde et sortit de l’antre aussi rapidement qu’il y était entré. Après avoir remis la pierre en place, il se dirigea vers la cabane, celle que ses aïeux avaient construite autrefois et qu’il avait maintenue en état. Il s’étendit sur la litière et demeura longtemps ainsi, les yeux fixés au plafond. Son cœur battait fort, et une seule pensée occupait son esprit : s’il était seul à connaître la cachette, il pouvait être fort riche.
Il laissa couler les jours, mais, vers la mi-août, il se rendit chez Friouler, auquel il donna comme prétexte de sa venue son désir de reprendre des maquisards chez lui. Or, à cette période, la libération s’opérait dans la région et il n’était donc pas question de former d’autres maquis.
— C’était une belle intention, lui dit le chef de réseau, mais tu as bien collaboré, mon brave Jacques !
Le menuisier demeura silencieux pendant quelques minutes, rongé par le remords. Une nouvelle fois, il eut une forte envie d’avouer à Friouler ce qui s’était passé la nuit du drame, mais une nouvelle fois il ne le put. Il demanda vivement :
— Et le container, vous l’avez récupéré ?
— Quel container ?
— Celui du parachutage du 9 juillet.
Friouler poussa un gros soupir.
— Non, mon vieux, personne ne sait où les jeunes gars l’ont déposé. Nous en avions discuté avant, pensant que la grotte de l’Allombe ferait l’affaire en attendant de distribuer l’argent, mais nous n’étions pas tous d’accord. Ils ont dit qu’ils décideraient ensemble de l’endroit et nous l’indiqueraient le lendemain. Ce fut une grosse erreur de ma part d’accepter ça, car je n’ignorais pas qu’une attaque pouvait se produire, je savais bien qu’il y avait des délations. L’argent est quelque part sur le plateau, mais où ? Il est vaste, le plateau ! Nous avons pensé au clapier des Hauts, mais il est vaste aussi ! Et les trous nombreux ! Deux des hommes sont montés là-haut, mais ils ont vite arrêté les recherches, c’est presque comme chercher une aiguille dans une botte de foin !
Il soupira encore.
— Tans pis pour l’argent, il y avait un gros magot, mais je ne pense pas qu’il fasse faute à qui que ce soit maintenant. C’est à ces pauvres garçons que je pense…
Il baissa la tête, se tut. Jacques murmura :
— Ouais, c’étaient encore des gosses. Et Pugnac ? J’ai entendu dire qu’il avait été exécuté.
— Oui, il l’a été.
Ce fut la seule réponse de Friouler. Jacques ne chercha pas à en savoir davantage. Il se souvenait que son père comptait sur une condamnation dans les règles. Mais qu’avait-il voulu dire ? On racontait que Pugnac avait été fusillé dans le bois des Ronces situé dans la vallée de la Dole. Comme dans tous les pelotons d’exécution, l’un des quatre fusils avait été chargé à blanc. Chaque tireur pouvait donc supposer qu’il n’avait pas tiré sur l’homme.
— Ce n’est pas le seul, il y en a d’autres qui vont payer leurs méfaits.
— Ici ? demanda Jacques.
— Du côté de la Vernière. Tout ça pour de l’argent ! Ils ont fricoté avec la Milice. C’est ignoble !
— Oui, murmura simplement Jacques.
Il ne s’attarda pas davantage chez Friouler, d’ailleurs celui-ci avait à faire. Quant à lui, il avait à fabriquer le cercueil d’Alphonse Michaud dont la famille sentait la fin toute proche. Il rentra donc au Fond de Lieu l’âme tranquillisée. Les paroles de Friouler avaient chassé ses regrets. S’il parlait maintenant, à qui irait cet argent ? Qui en profiterait ? Des gens qui n’en avaient pas plus besoin que lui ! Avec de la joie dans le cœur, il pensa au bon usage qu’il en ferait bientôt, à tout ce qu’il pourrait acquérir après la guerre. Mais il ne savait trop quoi ! Il se demanda s’il lui fallait le placer en banque ou bien le dépenser petit à petit. Il en avait possédé si peu durant son existence qu’il ne savait comment il opérerait et il décida qu’il irait à la grande banque de Saint-Étienne pour se renseigner. Chemin faisant, il se mit à siffloter un air que sa mère chantait quand il était petit, fixant sur l’azur son regard joyeux. L’après-midi, il confectionna le cercueil avec une rapidité qui étonna les siens. Le soir, il s’endormit épuisé, mais satisfait. En lui vivait un autre homme.
Janvier 1945. La bise jetait par à-coups son souffle de glace sur le clapier. Jacques enfonça sa toque en mouton sur ses oreilles violacées. Il tenta de remuer ses lèvres complètement paralysées et les petits glaçons accrochés à sa barbe rendirent un son de cristal. Maintenant, il sentait le froid le pénétrer. Il avait l’impression que ses veines avaient durci et que son sang était en train de geler. Il décida alors de ne pas descendre dans le trou. Pourquoi y retourner encore ? Dix, quinze fois qu’il y était allé ! Peut-être davantage, il n’avait pas compté ! L’argent était bien là ! Personne ne viendrait l’y dénicher ! Il aurait pu en prendre un peu, quelques billets… mais il n’osait. Il serait tenté d’en dépenser et cela éveillerait des soupçons. Il lui fallait attendre la fin de cette foutue guerre. Tout le monde l’espérait, mais les jours passaient sans que la nouvelle survienne. Depuis le départ des troupes allemandes, en août dernier, le pays connaissait une véritable pagaille, même si préfet, maire et évêque avaient invité la population à vivre cette attente dans le calme et la dignité. On continuait à crier « Vive la France ! », une sorte de fièvre révolutionnaire planait encore. Et les dérapages étaient nombreux, en particulier les pillages et les exécutions de traîtres qui avaient travaillé au profit de l’ennemi. Les forces de police et de gendarmerie, de nouveau sous l’autorité française, et l’autorité militaire locale avaient eu beaucoup à intervenir. Des règlements de compte avaient encore lieu au fond des bois ou au détour des chemins, certains injuriaient encore les partisans d’une résistance dont ils ne connaissaient rien. Et des comités avaient été mis en place un peu partout dont le rôle était de désigner des délégations municipales destinées à remplacer celles qui avaient été un « instrument trop docile de Vichy ». Mais si leur constitution n’avait guère causé de trouble en ville, il n’en était pas de même en campagne lors de la régularisation du ravitaillement. En effet, certains paysans qui s’étaient livrés au marché noir n’entendaient pas mettre fin à leur fructueux commerce. Et il n’était pas rare d’apprendre qu’untel avait fourni un peu de beurre contre bon nombre de billets de banque. Les misérables ne paraissaient guère éprouver de honte.
Jacques, quant à lui, n’en avait pas mené large pendant les jours qui avaient suivi la libération, songeant au magot caché dans le clapier. Il écoutait les nouvelles, mais ne se mêlait pas aux conversations. Toutes les accusations et les sanctions prises contre les personnes coupables de fautes graves semaient la peur en lui et il se terrait au Fond de Lieu, travaillant son bois. Mais à force de se dire que l’argent n’avait fait défaut ni à la Résistance ni à ses partisans, l’anxiété avait fini par le quitter. Pas besoin de culpabiliser non plus ! Il n’avait pas volé ceux qui étaient venus se ravitailler chez lui, et il n’avait trahi personne ! Au fil des jours, il avait retrouvé quelque sérénité.
Il se leva en regardant une dernière fois la pierre en forme de sabot. Après lui avoir adressé un sourire, il progressa prudemment sur le clapier glissant, penché en avant comme un vieil homme, manière de se préserver de l’impact brutal de la bise. Il atteignit enfin la lande, puis, d’un pas plus rapide, la pinède où il n’était pas rentré depuis le soir du drame. Il longea le sentier, les yeux fixés sur la vallée de Dorland. Là-bas, une brume légère s’étendait au-dessus des sommets et produisait un effet de rétrécissement de l’espace. Effet sans doute dû à l’éloignement et aussi à l’affaiblissement de la bise qui, après avoir beaucoup soufflé, épuisée, ne parvenait pas à chasser cette opalescence, à épurer l’atmosphère comme sur ces hauteurs. Le soleil inondait les vallées, nulle ombre ne glissait sur les pentes des collines où le givre s’était déjà liquéfié et avait laqué les bois verts d’un beau brillant. On aurait pu croire que l’été s’était réinstallé dans la vallée ou qu’il n’en était jamais parti. Çà et là, les toits de tuiles rouges ajoutaient une note joyeuse. Sur les langues de terre brune, les grains de mica et de feldspath scintillaient comme des pierres précieuses et l’eau des rus miroitait entre les arbres tels des filons d’argent. Jacques était sensible au paysage de la vallée, plus riant que celui du plateau, nu, froid et venté presque en toute saison, mais auquel il était enraciné aussi profondément que les deux dents l’étaient au mont Palluc. Si son regard s’évadait souvent en bas, ce n’était pas par envie d’évasion, mais seulement pour contempler un beau tableau. Parce que Jacques aimait la beauté des choses. Combien de fois, même pendant les grands labeurs, il avait pris le temps de regarder les fleurs, les couchers du soleil, les croissants de lune, les formes des nuages, et tout ce qui dans la nature inspire les poètes !
Pourtant, il était d’un aspect plutôt farouche, Jacques, un peu à l’image de ce haut pays, à cause de sa stature imposante et de sa musculature puissante. Et il avait la démarche lourde, parce qu’il traînait les pieds comme s’ils avaient pesé une tonne. Ses épaules en bouteille et son dos arrondi renforçaient son allure de pachyderme, le tout moulé dans des muscles d’acier qui roulaient au moindre effort sous le tissu de ses vêtements. Sa tête en pain de sucre était limitée par un front large, un menton carré et des joues un peu tombantes toujours rouges et donc en contraste permanent avec le front, lequel conservait la blancheur originelle de la peau sous la casquette ou la toque que Jacques portait suivant la saison. De ce port constant, une calvitie était venue tôt, et seuls quelques cheveux fins persistaient à lui faire une couronne autour du crâne, grisonnante maintenant. Ses yeux paraissaient presque froids, et si souvent ils s’emplissaient de douceur, cela ne se voyait pas, parce qu’ils étaient trop petits et noirs. C’étaient de ces yeux qui n’expriment que les émotions les plus fortes, quand, sous leur emprise, la pupille se dilate et les paupières se soulèvent. Ils étaient si rapprochés que le nez de Jacques ressemblait à une figue fraîche ou à une cloche. Les lèvres, fines et moins colorées que les pommettes, disparaissaient presque entièrement sous une barbe drue, jamais taillée, et que la fumée du tabac avait teintée en roux. Même s’il n’était pas tout à fait laid, Jacques n’avait pas reçu la faveur des dieux en ce qui concernait la beauté physique, mais il n’en éprouvait plus de regret. Il avait fini par s’accoutumer à sa physionomie, bien obligé ! Et à son âge, il n’espérait plus trouver la belle jouvencelle dont il avait rêvé. Il pensait qu’aucune femme, pas même une vieille édentée, ne viendrait vivre avec lui au Fond de Lieu. Il était trop laid, trop pauvre et trop timide ! Il n’avait plus l’espoir de fonder une famille. Cependant, en matière de libido, il n’était pas frustré puisqu’il allait se satisfaire auprès d’Herminie Souleillon, une fille facile de la Vernière qui se donnait pour quatre sous aux célibataires comme lui et aux hommes volages des environs. Son cousin Henri, de la Vernière, l’y avait conduit dix années plus tôt. Lui n’aurait pas été capable d’aller se présenter seul. Ce n’était pas qu’elle soit bien jolie, l’Herminie, mais elle possédait les attributs nécessaires pour inciter certains à la culbuter. Et puis, c’était cette façon qu’elle avait de les inviter à la bagatelle en roulant des prunelles et en balançant son fessier. Un « appel au peuple » qu’ils disaient tous en parlant du séant d’Herminie. Jacques avait droit à ses faveurs deux fois par mois, sauf pendant les gros travaux, telle la pose des charpentes ou si une commande de meuble pressait trop.
Mais ce jour, tout en rentrant chez lui, Jacques renouait avec ses espoirs anciens. Il repensait à la femme qu’il aurait aimé avoir et il se disait qu’avec cet argent il aurait une chance de l’appâter maintenant. Une de ces belles, comme il y en avait à la grand-ville. Elle lui prodiguerait des caresses le soir au coucher, s’occuperait des repas et du ménage dans la journée à la place de sa mère et d’Élise. Et puis, plus tard, ils habiteraient la maison d’en haut. Jacques avait toujours eu une affection plus grande pour la maison d’en haut, celle où ses grands-parents avaient vécu et qu’il gardait en état parce qu’elle était pleine des souvenirs de son enfance. Avec la venue d’une femme, il aurait la vie à laquelle aspirait tout homme, et si elle avait un enfant, il serait heureux de le prendre sous son toit comme ses parents l’avaient fait avec Élise. Avec le temps, il lui vouerait un attachement aussi profond que s’il était de lui. Jacques se mit à sourire tout en essuyant du revers de sa manche la goutte qui lui pendait au nez. Sa condition allait changer et son souhait s’exaucerait. Avec tout cet argent, il garderait toujours sa femme au Fond de Lieu. Elle s’y plairait et en deviendrait la maîtresse. Plus tard, ce serait l’enfant. Jacques aurait un héritier !
Parvenu en haut de la combe, il aperçut le domaine. Au soleil, dans l’entrelacs des arbres, les bâtisses se distinguaient à cause de leur belle couleur grise où les arêtes des murs marquaient de longues lignes verticales couleur de l’ambre. Les toits de lauzes, brillants comme s’ils avaient été laqués d’argent, renvoyaient au ciel toute sa lumière. D’aussi loin, les perspectives trompaient en donnant au domaine l’aspect d’un château ramassé sur lui-même, alors qu’en réalité de larges espaces séparaient les bâtiments. Entre autres, la cour et les allées, l’une plantée de trois énormes noyers et les autres encombrées de lilas sauvages que la mère de Jacques avait toujours voulu conserver, si bien que le passage pour gagner l’arrière du domaine s’était rétréci au fil des ans. Là s’étendaient le potager et un semblant de verger où de vieux pommiers respiraient depuis le père Adam. L’ensemble était établi au fond d’une combe entre les plaines de la Dole et le haut plateau. Un trou en somme, où le domaine du Fond de Lieu avait trouvé son étymologie.
À quelque distance et à quelques étages au-dessus, les maisons de Bournay s’agglutinaient sur des tertres exposés au soleil du matin jusqu’au soir. Bien qu’à 600 mètres d’altitude, la bourgade était abritée des vents par des remparts d’arbres ou de rochers. La végétation y était donc plus riche et plus diversifiée que dans les autres villages des alentours. On y voyait l’herbe verdir, les bourgeons éclore, les fleurs s’ouvrir dès les premiers sourires du printemps. Les paysans qui possédaient une exploitation à proximité de Bournay étaient jalousés de leurs pairs, car la terre était de rendement varié et rentable, fertile, d’une belle couleur noire, et moins argileuse que dans les vallées. La grande difficulté se présentait dans la structure du terrain beaucoup trop morcelé. Des parcelles de petites dimensions et placées sur des pentes abruptes où le paysan et le cheval de trait s’échinaient afin de bien manœuvrer la charrue. Les plus favorisés étaient ceux qui avaient acheté aux Daubrac dont les ancêtres avaient été de gros propriétaires terriens avant de se tourner vers la menuiserie au fil des générations. Claudius Daubrac et son fils ne détenaient plus désormais que les terres entourant le domaine, et celles du haut plateau dont personne n’avait voulu. Jacques le déplorait, car quiconque possédait du terrain près du Fond de Lieu était riche. Heureusement, son grand-père avait conservé les sapinières où il pouvait puiser pour la fabrication des charpentes. Si le client ne fournissait pas le bois, il y gagnait en prenant le sien dont il faisait toujours une bonne réserve. Sauf quand il s’agissait du bois de feuillus, mais il en achetait à la commune. La seule essence importée était le châtaignier, qu’il utilisait parfois dans la fabrication des fenêtres et des cercueils. Il était menuisier-charpentier, Jacques. Il avait appris le métier chez son père, tout comme ce dernier l’avait appris chez le sien. Ses connaissances lui venaient donc des deux hommes. Ainsi savait-il depuis son plus jeune âge l’emploi auquel était destinée chaque variété de bois et toutes les précautions à prendre pour faire de la belle ouvrage. Celles-ci devaient être respectées dès l’abattage des arbres où la lune comptait pour beaucoup. Nouvelle pour les résineux et décroissante pour les feuillus ! Certains propriétaires s’y référaient encore comme Jacques, mais nombreux étaient ceux qui ne coupaient pas leurs arbres en période de sève morte, ou bien ne tenaient pas compte de l’avent. En cette période, l’écorçage était facile, mais les fûts ne perdaient pas leur poids. La manutention du sapin s’en trouvait plus pénible et le pin bleuissait. Jacques n’aimait pas travailler un bois qu’on n’avait pas entièrement respecté.
Chemin faisant, il se disait qu’avec l’argent il pourrait acheter d’autres plantations de feuillus. Il pourrait aussi investir dans des machines, comme une scie à grumes et à ruban, une toupie, une affûteuse… même s’il avait toujours jugé qu’elles gaspillaient le bois et réduisaient la qualité de l’ouvrage. Tout de même, elles soulageraient sa peine et augmenteraient son rendement ! Et il aurait plus de temps pour s’adonner à ses promenades dans la campagne ou maintenir le domaine en état. Son père n’aurait plus à s’occuper dans l’atelier comme il le faisait encore. Il prendrait enfin un peu de bon temps auprès de la mère, elle à manier son crochet, et lui à polir ses cuillères en bois, devant l’âtre l’hiver et sous le tilleul l’été. Mais comment l’empêcher, le père, de manier les râpes ou les gouges ? Élise aussi y trouverait son compte, car il apporterait des commodités au Fond de Lieu. Il ferait amener l’eau et poser un grand évier. Comme elle était lavandière, Élise, elle laverait le linge des autres sans se geler à la rivière ou au lavoir. Et puis, elle finirait bien par trouver un mari ! Il y avait René Chautard, du mas des Brousses, qui lui tournait autour depuis des années, mais elle ne répondait pas à ses avances ! Elle était étrange, Élise, avec ses silences et ses regards fuyants ! Elle n’agissait pas de la sorte autrefois, lorsqu’elle parlait et riait avec lui, lui confiait ses joies et ses peines, comme à un frère. Elle avait changé, avait pris d’autres attitudes… qui intriguaient Jacques et auxquelles il ne parvenait pas à s’habituer.