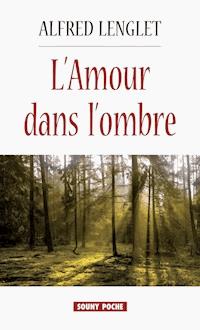
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'histoire d'un héros de la Résistance !
Pierre abandonne sa famille pour échapper au STO et réussit à rejoindre la Résistance. Dans la forêt du mont Mouchet, vaste et tortueuse comme un labyrinthe, il demeure en proie à un profond sentiment d’impuissance et de tristesse, loin des siens. Mais il sait que le devoir l’appelle et il puisera dans la nature la force de se battre pour la liberté.
Fin août 1944, en mal et en manque d’amour, il arrive en pleine nuit chez lui. Il découvre avec stupéfaction que sa maison est occupée par une autre famille et que Hortense a été arrêtée par des miliciens. Ne comprenant rien à ce qu’on lui explique, il se lance dans une course folle pour la retrouver. Il pensait avoir vécu des moments dramatiques dans le maquis. Il va alors connaître une autre horreur, la peur de perdre celle qu’il aime, la trahison et son cortège d’ignominies. La passion qui lie Pierre et Hortense parviendra-t-elle à les sauver du néant ?
À travers des personnages attachants, Alfred Lenglet retrace, avec la rigueur de l’historien et le souffle du romancier, le long parcours des combattants de l’ombre. Il rend ainsi hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et parfois leur vie pour leur pays.
Pierre parviendra-t-il à retrouver Hortence ? Poursuivra-t-il son combat de Résistant ? Découvrez, dans cette fiction historique, l'histoire de ces héros de la Résistance qui ont influencé à eux seuls le cours de la grande Histoire.
EXTRAIT
Pierre abritait désormais dans son cœur un sentiment de haine contre les Allemands, contre les Français collaborateurs… contre la race humaine. Il en voulait soudainement à l’humanité entière de le maintenir en captivité et de le priver des siens, d’amour, de liberté, de travail, de forces, de volonté. Les larmes ne coulèrent pas. Au contraire, elles séchèrent ce jour-là dans le corps de Pierre Issartel et déposèrent sur son cœur un poison subtil.
Ce cruel sentiment fit monter en Pierre un besoin de vengeance et tout son corps se crispa encore un peu plus, par réaction. Sa course folle le privait de force, mais le blocage de son corps, les douleurs qui le parcouraient à chaque instant provenaient uniquement de son âme ridée par la haine et un désir de vengeance. La voix de Marie le tira de ses sinistres pensées.
— Il faut vous relever un peu.
À PROPOS DE L'AUTEUR
S’il n’avait pas rejoint la police nationale,
Alfred Lenglet, originaire du Nord, aurait choisi le métier de professeur d’histoire. Passionné par ce sujet, il tenait à rendre hommage, en écrivant ce roman, à toutes les personnes qui se sont engagées dans la Résistance. Et quoi de plus naturel et logique que de le situer en Haute-Loire, terre de terribles combats mais aussi, région d’adoption de l’auteur. Déjà parus aux éditions Souny :
Le Creux de l’enfer, 2002 (Prix Lucien Gachon, 2003) et
Les Echeveaux du destin, 2003,
Les Vignes de l’aïeul, 2010,
Le Médecin sur les hautes terres (Souny Poche, 2014),
Les Vieux amants du plateau (2015).
Originaire du Nord, il vit à côté de Lyon mais a longtemps travaillé au Puy en Velay (Haute-Loire)
Il est édité aujourd'hui chez Calman Lévy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Couverture
Page de titre
A la mémoire de Clément Beaud et Gabin Savanier, policiers français morts pour la libération du Puy-en-Velay, le 19 août 1944.
Pour Jacky et Véronique
Chapitre 1
L’automne s’était installé avec insistance sur le Velay. Tous les jours, un ciel gris et bas charriait des nuages porteurs de pluie et de froid. Les sourires avaient disparu des visages depuis longtemps. Au Monastier-sur-Gazeille, à mi-chemin entre le Puy-en-Velay et le mont Mézenc, qui continuait à monter la garde à la frontière entre la Haute-Loire et l’Ardèche, la population n’échappait pas à la morosité ambiante. Depuis l’invasion de la zone libre par les troupes allemandes en novembre 1942, puis la mise en place du Service du travail obligatoire par une loi de Vichy, début 1943, suivie de la mobilisation de trois classes d’âge, la guerre avait fini par faire son apparition sur cette terre apaisée mais sauvage. Jusque-là épargné, le Velay subissait désormais les outrages de l’Occupation et ses atrocités.
Pierre Issartel n’ignorait rien de ce climat délétère, et pourtant il gardait sa bonne humeur. Certes, il lui fallait parfois la dissimuler derrière un masque de circonstance, mais la nature reprenait invariablement le dessus. Du matin au soir, il chantait et il sifflait, sur ses chantiers, à la maison, partout. Pierre était heureux et il avait du mal à le cacher. Très jeune, il s’était marié avec la jolie et fraîche Hortense Faure. Ces deux-là se connaissaient depuis l’école élémentaire, quand, seulement séparés par le muret des deux écoles, celle des filles et celle des garçons, ils échangeaient déjà des fleurs et des poèmes, puis un premier baiser, la veille de passer le certificat d’études, comme on offre un porte-bonheur, avant peut-être aussi d’entrer plus franchement dans le monde des adultes. En riant, dans l’insouciance des fêtes campagnardes, leurs parents les avaient fiancés cent fois, avant de vraies fiançailles et un vrai mariage. Ils étaient faits l’un pour l’autre, destinés l’un à l’autre, et rien n’avait pu contrarier la promesse de leurs amours enfantines.
Pierre et Hortense s’étaient mariés en 1930, un jour inoubliable, rempli de chants, de danses, de fleurs et de rires. On avait fait la noce tout le jour et toute la nuit, dans la propriété des parents d’Hortense, à Saint-Victor, un village proche où ils avaient une ferme. Puis les mariés s’en étaient allés au Monastier s’installer dans une petite maison de la vieille ville, non loin de l’église abbatiale et de sa façade aux décors spectaculaires. Pierre la tenait de ses parents. Quelques travaux avaient fini de la rendre habitable, et c’est là qu’Hortense avait donné naissance à deux garçons, Vincent et Louis, aujourd’hui âgés respectivement de dix et huit ans. Ils étaient la fierté de leurs parents.
Pierre était maçon, mais aussi puisatier, cordonnier, agriculteur, génial touche-à-tout. Avec ses mains, il pouvait tout faire, avec un soin quasi maniaque. Il travaillait la pierre, le bois, le cuir, cultivait la terre, s’attaquant aussi bien à un bâtiment qu’à un simple jouet, s’activant dans son grand jardin ou sur l’exploitation de ses beaux-parents. Il ne comptait ni sa peine ni sa sueur et ne négligeait pourtant ni sa femme ni ses enfants. Car il ne vivait que pour eux, pour leur apporter, à son épouse et à ses fils, ce dont ils avaient besoin.
Ce matin de novembre, les premiers flocons tourbillonnaient dans le vent. La neige ne tenait pas encore au sol, mais on sentait bien que le répit serait court. Le froid était vif, humide, désagréable. Pierre travaillait depuis déjà plusieurs jours à Châteauneuf, un hameau en contrebas de Saint-Victor. On lui avait commandé un puits à un endroit où, semble-t-il, autrefois, il en existait un. Alors, il avait sondé, patiemment, et finalement trouvé les restes d’un puits abandonné, complètement éboulé et rebouché. Il avait fallu déblayer de la terre et des dizaines de seaux de gravats. Pour cette activité, Pierre s’octroya l’aide d’un manœuvre un peu simple d’esprit, mais pas fainéant. Il l’embauchait à la journée ou à la semaine, selon l’importance de ses chantiers. Au fond de l’ancien puits, après avoir sorti de tout, et même des os dont il ne savait trop s’ils étaient humains ou pas, Pierre examinait les parois avant de s’attaquer à la maçonnerie, pour finir.
— Tu peux y aller, c’est le dernier !
Il venait de donner le signal. A l’extérieur, Etienne tira de toutes ses forces sur la corde afin de faire remonter à la surface le dernier seau rempli de terre. Le manœuvre s’arc-boutait et pesait de tout son poids, aidé par un système de poulies, pour extraire les débris arrachés par son patron. Affublé d’un casque, à l’instar des mineurs, avec une lampe frontale, Pierre mesurait le travail accompli depuis la découverte de ce puits comblé. Il était fier de lui. Il redonnait vie à ce vieil ouvrage oublié. C’était le début d’une résurrection. Il leva les yeux et vit le visage souriant du manœuvre se dessiner par l’ouverture, sept ou huit mètres plus haut. Etienne connaissait la marche à suivre, il lança une corde.
— C’est bon, je l’ai, annonça Pierre. Assure-moi bien, je remonte doucement.
Par des entailles pratiquées régulièrement dans la roche ou dans la terre, étayées à certains endroits de robustes morceaux de bois, Pierre remonta lentement, alors qu’Etienne tirait la corde, prêt à la retenir, en cas de chute. Juste à la sortie du puits, Etienne tendit sa main que Pierre attrapa fermement :
— Tu as fait du bon travail. Si demain tu es libre, j’aurai encore de l’ouvrage pour toi, déclara-t-il, sitôt à l’air libre.
— Ce n’est pas de refus, tu le sais.
— Alors, c’est dit. Je te prendrai chez toi demain à sept heures. Tu es libre pour aujourd’hui.
Les deux hommes se serrèrent la main. Etienne ralluma un mégot qu’il économisait pour faire le trajet jusqu’au Monastier. Pierre en profita pour rentrer chez ses clients.
Le père Mialon, un vieux paysan avare comme pas deux, l’œil collé à la vitre de sa cuisine, comprit aussitôt l’intention du puisatier. Il ne quittait pas les ouvriers des yeux une seule seconde de la journée, de peur d’être volé. Il en voulait pour son argent et pestait à chaque pause. Il sortit néanmoins sa bouteille de verveine et deux petits verres d’un placard de sa cuisine et les disposa sur la table quand Pierre frappa.
— Entrez donc ! Je vous attendais.
— Je ne vais pas abuser, dit Pierre sur le pas de la porte. Je veux simplement vous dire où j’en suis.
— Mais entrez donc, dit encore le vieux. Venez vous asseoir et racontez-moi tout. Je ne fais pas du feu pour chauffer les environs !
— C’est bon, reprit Pierre. J’ai dégagé tout le puits. L’eau suinte déjà de partout. Il sera rempli rapidement. Je vais vous installer une trappe pour y accéder en toute sécurité…
— Pas du trop luxueux, reprit le vieux.
Pierre sourit avec une petite pointe de tendresse.
— Bien sûr que je ne vais pas vous ruiner, dit-il encore, taquin. Je sais que les temps sont difficiles. Je vais juste vous bricoler quelque chose de pratique et de sûr, que l’on ne vous retrouve pas au fond du puits pour deux ou trois seaux d’eau. Je ne voudrais pas que la mère Mialon me reproche quelque chose.
Le paysan et le puisatier trinquèrent et Pierre s’en retourna chez lui, satisfait de son travail.
Une fois à la maison, Pierre lava ses outils, les rangea soigneusement dans son petit hangar de derrière et entra par la cuisine où l’accueillirent le sourire d’Hortense et le fumet d’une soupe appétissante. Les enfants se précipitèrent pour embrasser leur père. Cette ambiance heureuse et simple réjouissait Pierre chaque jour.
Plus tard, une fois couché, il ressentit curieusement le besoin impérieux de serrer plus fort sa femme, blottie dans ses bras. Dehors, le vent soufflait. Il mugissait, faisant entendre une chanson stridente, angoissante, et faisait craquer le toit de la petite maison. Hortense avait remarqué d’instinct l’angoisse inhabituelle de son mari. Ils restèrent muets, attentifs à la respiration de l’autre, s’imaginant l’un et l’autre endormis. Mais Pierre ne dormait pas. Il écoutait les battements de son cœur, affolé par quelque chose de poisseux, de désagréable. Insidieusement, une petite fêlure s’était faite dans son esprit, pourtant déterminé, phénomène anormal chez lui. Il avait passé une bonne journée, était content de son travail ; il était rentré à la maison, heureux de retrouver les siens… Alors ?
Un sentiment étrange semblait l’étreindre, comme si on voulait l’aviser qu’il se préparait quelque chose, comme si une force supérieure lui commandait plus de prudence. Dans la chambre, Pierre demeura longtemps les yeux ouverts, fixant obstinément le noir, le néant. Dehors, la tempête faisait maintenant rage, alors que rien ne l’avait annoncée. Son imagination aurait pu lui tendre un piège, mais, lucide, Pierre en revenait à chaque fois à la réalité de la situation. C’est vrai que la guerre et son cortège d’horreurs marquaient chaque jour davantage les esprits. Il y avait les morts, les blessés et les disparus de la campagne de 1940, les prisonniers, les privations matérielles, mais ici, où l’on savait encore se contenter de peu, on faisait face. Surtout, il y avait de plus en plus la peur du lendemain.
Pierre avait lu, dans le regard de ses enfants, beaucoup de joie, la confiance en leur père, un éclair de bonheur et de respect. Et les incertitudes du lendemain lui étaient alors sans doute apparues, comme un mur formidable, infranchissable.
Dans sa solitude, toujours en écoutant le souffle régulier d’Hortense, Pierre comprit que tout sentiment de sécurité devenait désormais un danger. Il devrait rester attentif, peut-être inquiet, jusqu’à ce que le cauchemar de la guerre se termine enfin. Sans parvenir à maîtriser son émotion, il frissonna, longuement.
— Tu ne dors pas ? questionna doucement Hortense. Pierre se tut encore quelques secondes.
— J’ai du mal à m’endormir avec ce vent…
Pierre garda de nouveau le silence un moment avant d’avouer la vraie raison de son étrange frisson.
— Et puis je me fais un peu trop de souci pour toi, les enfants, l’avenir, cette guerre qui n’en finit pas et qui nous ronge…
Hortense se serra à son tour contre lui.
A l’extérieur, la tempête se déchaînait un peu plus encore. Parfois, un coup de vent plus violent que les autres soulevait le toit par endroits et faisait craquer étrangement la charpente. Il n’y avait rien d’autre à faire que d’attendre. Alors, les époux Issartel restèrent dans les bras l’un de l’autre, aux aguets, soumis aux caprices de la nature, et finirent par s’endormir ainsi, au cœur de la nuit, quand la tempête se calma enfin en se déplaçant plus vers l’est.
A son réveil, encore en pyjama, Pierre sortit tout de suite afin d’inspecter le toit. Heureusement, il ne semblait pas y avoir de gros dégâts, juste ici ou là une tuile cassée. Chez les voisins, c’était la même chose. Il n’y avait qu’une grange, faite de planches, qui s’était écroulée sous la poussée de bourrasques trop puissantes. Pierre avala vite un bol de lait chaud et une tartine de pain, s’habilla, puis alla frapper chez la famille Exbrayat pour proposer ses services. C’est Léon, le père, qui lui ouvrit la porte et le reçut, avec plaisir. Une vraie solidarité de voisinage, naturelle, spontanée, unissait Pierre à ses voisins. Il dut boire une tasse de mauvais café – en fait, un mélange douteux de fabrication maison, dans lequel on trouvait de tout, sauf du café. D’autres hommes des alentours étaient déjà venus offrir leurs bras et, si le temps le permettait, un rendez-vous était fixé pour le samedi suivant, de bon matin. Pierre promit de se libérer de ses autres obligations pour être présent ; c’était sa nature profonde.
Pierre était un homme de cœur, pour qui le mot « fraternité » avait une vraie signification, de même que « tolérance » et, au-delà, « convivialité ». Après sa visite à la famille Exbrayat, il avait chargé des outils dans sa petite charrette et attelé le tout à son vélo, puis il avait pris la direction de Châteauneuf et récupéré Etienne en route. Ils arrivèrent sur le chantier à bout de souffle, car la pente est raide entre le bourg du Monastier-sur-Gazeille et le hameau.
Profitant d’un répit du temps, les deux hommes montèrent une petite construction avec un toit en pente, puis un treuil en bois afin que la famille Mialon puisse venir ici puiser une eau limpide et précieuse. Durant toute la nuit, le puits avait continué à se remplir. C’était du bel ouvrage. Pierre et son ouvrier mangèrent sur place en quelques minutes ce qu’Hortense avait préparé. Ils eurent le privilège de boire un petit verre de vin aigre dans la cuisine du père Mialon et terminèrent leur travail. Un peu avant seize heures, Pierre donna congé à Etienne après avoir nettoyé et rangé ses outils. Puis il rentra une dernière fois à la ferme Mialon afin de conclure définitivement son affaire et de fixer le prix à payer.
Le vieux paysan fit une petite moue, mais, sans véritables arguments et ne pouvant pas critiquer le bon travail de Pierre, il accepta le prix définitif. Secrètement, il faisait une bonne affaire, le savait bien, mais ne pouvait l’avouer. C’était ainsi.
En descendant la côte de Châteauneuf avec son chargement, tous les outils qu’il avait laissés chez le père Mialon le temps du chantier, Pierre sentit une nouvelle fois monter en lui une angoisse incontrôlable. C’est vrai qu’il n’avait plus rien de particulier en commande, ni comme puisatier ni comme maçon. Et puis les travaux des champs étaient terminés pour tout l’hiver. On tuerait bien un cochon bientôt ; il irait aider à la reconstruction de la grange d’un de ses voisins ; il fabriquerait quelques paires de sabots, les jouets des enfants pour Noël ; peut-être trouverait-il aussi une idée pour le cadeau d’Hortense. Mais après ? Il faudrait vivre sur les réserves de la maison. Elles étaient maigres. Et c’est sans doute cela qui lui faisait peur, pour la première fois depuis le début de la guerre. Comme beaucoup de parents, il craignait de ne pouvoir offrir à ses enfants la même jeunesse que la sienne, faite d’insouciance, de joies simples, de pêche et de chasse avec son père, de liberté. Sa famille n’était pas riche, mais il n’avait jamais manqué de rien, ni de tendresse, ni d’amour, ni de nourriture, ni même de ces petites attentions qui rendent la vie un peu plus douce. Il gardait aussi le souvenir de parents souriants, alors que lui portait depuis plusieurs mois déjà un masque grave. Les souffrances de la guerre le rattrapaient finalement.
Toute la journée, absorbé par son dur labeur, il n’avait plus repensé à ses états d’âme de la nuit précédente. Pourtant, comme une vague inquiétante, menaçante, ils revinrent soudain l’assaillir, à en devenir ses pires ennemis, avant même ces satanés Allemands.
Pierre pédala comme un forcené jusque chez lui, comme si l’effort pouvait définitivement chasser ses idées devenues bien sombres. Il arriva essoufflé, mais toujours inquiet. Il rangea ses outils, tristement, résigné, hésitant même un instant à pousser la porte d’entrée, s’interdisant sans doute de laisser pénétrer sa mélancolie dans son foyer. Il posa la main sur la poignée de la porte, souffla un grand coup pour se donner à la fois un peu de courage et un peu de contenance. Pierre entra dans la cuisine en affichant un timide sourire. Hortense l’accueillit, le visage crispé. Il s’était passé quelque chose. Pierre s’approcha et l’embrassa comme il en avait l’habitude.
— Tu n’as pas l’air d’aller fort, constata-t-il.
Hortense désigna d’un coup de tête leur fils aîné, installé silencieusement à la table de la cuisine, occupé à faire ses devoirs.
— Tu parles ! reprit-elle d’une voix irritée. Nous faisons attention à tout, nous nous privons pour ces messieurs, et ce garnement-là est revenu de l’école avec son pantalon troué, presque perdu. Monsieur s’est battu à la récréation. Résultat : il n’a plus rien à se mettre…
Hortense posa sur son fils un regard froid de colère.
— Et demain il ira à l’école avec son pantalon troué ! L’enfant, penaud, n’avait pas levé les yeux de son livre, mais personne ne pouvait savoir s’il lisait vraiment ou s’il écoutait les reproches de sa mère, espérant peut-être voir l’orage s’éloigner un peu.
— Tâche de finir tes devoirs correctement, tu viendras ensuite me réciter ta leçon. Nous allons parler avec ta mère de la punition qui t’attend.
Les parents s’écartèrent légèrement de manière que leur fils n’entende rien de la conversation.
— Le pantalon est-il vraiment bon à jeter ? questionna Pierre.
Hortense prit un air désabusé.
— Pas entièrement, bien sûr. Mais c’est le dernier que j’ai fait, avec la plus belle toile qui me restait. J’avais mis ce morceau de côté, pour eux, pensant que son frère pourrait par la suite le récupérer. C’est mal parti ! Je vais voir ce que je peux faire, mais tout le côté est déchiré et le pantalon ne ressemblera plus à grand-chose, même rapiécé…
— Après tout, c’est son problème si les copains se moquent un peu de lui à l’école. A l’avenir, il fera plus attention ; il faut l’espérer.
Hortense approuva, pas entièrement convaincue cependant, et posa une nouvelle fois sur son fils aîné un regard désapprobateur.
— Il faut trouver une punition efficace, qui lui serve de leçon, sinon il recommencera, sans se soucier des conséquences de son comportement.
La mère de famille était encore très en colère, plus que son mari. C’est elle qui tenait les cordons des finances familiales, qui gérait la pénurie, les restrictions, qui faisait preuve de beaucoup d’imagination et de débrouillardise, chaque jour et de plus en plus, alors que la guerre n’en finissait pas. On ne trouvait plus de tissu, de cuir ; le superflu avait disparu depuis longtemps et le nécessaire se faisait de plus en plus rare et cher. Il fallait désormais des prouesses d’ingéniosité pour qu’Hortense puisse faire vivre sa famille dignement. Elle se privait beaucoup, sans jamais se plaindre, sans jamais parler de ses souffrances, sans oser dévoiler ses espoirs d’une vie plus facile, simple comme avant la guerre, mais sans l’incertitude de l’Occupation, sans la barbarie et les outrages à la liberté.
— Il faut le punir sérieusement, reprit-elle. Dimanche, il n’aura ni son dessert ni sa pièce. Et puis, ce soir, tu liras ton histoire à Louis. Vincent restera dans sa chambre, il ira se coucher de bonne heure.
Tous les soirs, depuis fort longtemps, Pierre lisait une histoire à ses fils. Ces derniers savaient lire maintenant tous les deux, mais la coutume durait, c’était un moment magique, un partage. Depuis plusieurs jours, il avait commencé L’Ile au Trésor, de Stevenson. Devant les visages toujours très intéressés de ses enfants, Pierre leur avait raconté qui était cet étrange écrivain britannique, né en Ecosse. Stevenson était autrefois passé dans la région : en 1878, accompagné d’une ânesse nommée Modestine, il avait entrepris un voyage curieux, en partant de leur village. S’inspirant de cette aventure, qui l’avait mené jusqu’à Saint-Jean-du-Gard, il avait écrit un livre, Voyage avec un âne à travers les Cévennes. Pierre s’était d’ailleurs promis de dénicher ce livre rare. Très sérieux, Pierre aimait les digressions et les commentaires divers lorsqu’il commençait à faire la lecture à ses enfants. Il leur parla donc aussi de l’âme camisarde, recherchée par Stevenson durant son périple. C’était aussi son côté indépendant, marqué par une profonde tolérance vis-à-vis des autres, surtout les gens différents, originaux, peut-être aussi un peu marginaux.
Ce soir-là, après que Vincent, l’aîné, eut rejoint sa chambre, Pierre fit la lecture à Louis et poursuivit ses histoires de pirates et de trésor. L’imagination, grâce à un ouvrage comme L’île au trésor, trouvait là de vastes territoires où se développer, et Pierre ne manquait pas de mettre le ton à chaque dialogue ou de faire des mimiques en imitant les personnages. Un peu déçu d’avoir Louis pour seul public, Pierre le fit cependant bien rire, n’avançant pas trop dans l’histoire, volontairement, afin que le puni puisse reprendre sa place et suivre dès le lendemain.
Une fois la lecture terminée, Pierre embrassa son fils sur le front et éteignit. Il passa embrasser Vincent, déjà dans le noir, qui simulant peut-être le sommeil, ne bougea pas. Puis, Pierre rejoignit sa femme dans la cuisine où elle travaillait à réparer le pantalon.
— Ils sont couchés ? questionna Hortense.
— Tout va bien, ces messieurs dorment.
— Et moi je répare les bêtises du grand…
Hortense s’était assise sur une chaise de la cuisine et profitait encore de la chaleur du poêle. Elle avait posé son ouvrage sur la table. Pierre passa derrière elle, dégagea les cheveux de son cou et y déposa plusieurs baisers, avec douceur et une pointe d’envie.
— Ne t’en fais pas trop, reprit-il. Nous nous en sortirons. Nous l’avons toujours fait. Et puis, s’il faut encore se serrer la ceinture, nous le ferons, pourvu que les enfants et nous-mêmes restions en bonne santé. Dimanche, on fait le cochon chez tes parents ; nous pourrons ainsi refaire nos provisions. Et puis, si samedi je vais aider le père Exbrayat à reconstruire sa grange, il me donnera bien quelques provisions. Il connaît notre situation et n’est pas du genre à jouer les indifférents. Aujourd’hui, le père Mialon m’a payé mon travail, et sa femme, bien bonne, m’a glissé discrètement un paquet avec du sucre et de la farine ; il doit même y avoir quelques friandises pour les petits.
Un vrai sourire jaillit sur le visage de la jeune femme et, comme elle avait les yeux baissés sur sa couture, Pierre ne le vit pas. Elle tourna la tête pour embrasser sa main, posée délicatement sur son cou.
Les époux savaient s’épauler en fonction de leurs humeurs respectives. Quand l’un avait le moral en berne, c’est l’autre qui faisait tout pour le lui remonter, par une petite attention, un sourire, un geste tendre et protecteur. Ce soir-là, par une pointe d’optimisme, malgré les dangers de la guerre, c’est Pierre qui épaula Hortense.
Le samedi matin, réveillé de bonne heure, Pierre Issartel s’habilla chaudement et prépara quelques outils avant de prendre la direction de la ferme de la famille Exbrayat. Il y avait déjà de l’animation sur place, des voisins et des amis se pressaient dans la cuisine où la mère servait un vilain café agrémenté de chicorée. Heureusement, il y avait de la bonne humeur et de grandes tartines de beurre. Pierre ne se fit pas prier pour en prendre une.
Léon Exbrayat, qui avait fait toute la Grande Guerre dans les tranchées, arriva pour saluer et remercier la compagnie, tout en présentant son projet de nouvelle grange. Il était allé à la scierie, sur la route de Coubon, pour acheter planches, poutres et solives. Après la collation, les hommes formèrent des équipes et se mirent au travail, sous la direction d’un ami du père Exbrayat, charpentier de métier.
La solidarité de voisinage permit au travail d’avancer rapidement. Un peu avant midi, l’ossature de la grange était montée. Pierre avait passé sa matinée à porter des poutres. Il était robuste, mais avoua une certaine fatigue. Il était fourbu par les incessants voyages, le transport de gros morceaux de bois, les efforts pour les hisser à la hauteur de ceux qui les assemblaient à l’aide de clous ou de chevilles. Il ne ménagea pourtant pas sa peine, heureux de rendre service et d’être avec certains de ses amis.
La pause du midi fut courte mais réconfortante. Les hommes se rassemblèrent dans la cuisine un peu trop étroite pour l’occasion. La mère Exbrayat y avait entassé des chaises et des tabourets autour du poêle. Elle servit dans des bols une bonne soupe agrémentée encore de larges tartines beurrées, le tout accompagné d’un peu de saucisson et de fromage.
Fatiguée, l’assemblée resta un moment presque silencieuse. Les hommes reprenaient lentement des forces et laissaient leur corps se reposer et se réchauffer. Puis les langues se délièrent peu à peu. On parla des misères de la guerre, des restrictions, de plus en plus sévères, de cette liberté qui tardait à revenir et qui apparaissait enfin comme un vrai trésor. Mais personne n’osa vraiment parler de politique, ni de cette France de Vichy qui n’existait plus vraiment depuis l’invasion de la zone par les Allemands, ni de cette France de la Résistance, qui s’émancipait timidement dans les forêts de la Margeride et au-delà des mers, à Londres.
Avec la création du Service du travail obligatoire, les hommes de certaines classes d’âge savaient qu’ils pouvaient à tout moment recevoir un courrier et partir pour l’Allemagne. Chacun le redoutait, avec plus ou moins de résignation.
Pierre, demeuré silencieux, par prudence, savait qu’il serait appelé un jour prochain. Même avec Hortense, il n’en avait jamais parlé : il avait peur et refusait d’aborder ce sujet, comme si se taire permettait d’effacer cette menace. Souvent, la nuit, il réfléchissait à l’attitude à adopter quand l’heure viendrait. Et il s’était peu à peu forgé l’idée que jamais il n’irait en Allemagne travailler pour ces salauds de « Boches », et qu’il préférait rejoindre ceux qui déjà devaient former une armée de l’ombre. Par quelques indiscrétions, il savait en effet que des hommes se rassemblaient dans les bois du mont Mouchet, aux confins du département, aux limites de la Haute-Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Lozère.
La voix de Léon Exbrayat le tira de ses pensées.
— Allez, les gars, il est temps d’y retourner !
Alors, les hommes remirent leur veste de travail, vissant pour beaucoup une casquette sur leur tête, à cause du froid, reprenant leur place sur le chantier de la grange.
Toute l’après-midi, on cloua, au rythme des marteaux et d’une musique tonique et répétitive. Parfois, le père Exbrayat descendait du toit et jetait avec satisfaction un coup d’œil d’ensemble. La nuit allait tomber quand les hommes posèrent la lourde porte, récupérée sur l’ancienne grange et remise en état. A la lumière d’une lampe à huile, le vieux Léon servit à ses amis un alcool maison, passant de l’un à l’autre pour remercier, ému, mais aussi sans doute un peu fier d’avoir face à lui des gaillards fidèles en amitié.
Sous l’effet de la pauvre lampe, les visages dansaient curieusement, comme les ombres d’un théâtre. On voyait dans les yeux de ces hommes-là autant de fierté que de fatigue. Chacun dégustait son verre d’alcool en faisant claquer sa langue, comme pour mieux apprécier l’instant, avant de s’en retourner, dans le froid et l’incertitude du temps de guerre. Léon Exbrayat offrit à chacun quelque chose – une bouteille, du fromage, de la charcuterie, un peu d’argent – en fonction des situations différentes de toutes ces familles qui peinaient sous le poids de souffrances cachées. Pierre s’en retourna chez lui, emportant comme un trésor une belle part de fromage et un peu de farine. Hortense l’attendait. Elle l’accueillit avec un large sourire et s’avança pour l’embrasser.
— Alors, vous avez terminé l’ouvrage ? questionna-t-elle.
— On a bien travaillé. La famille Exbrayat a une grange toute neuve. Le père Léon se faisait du souci pour son foin offert aux intempéries. Tout est rentré dans l’ordre. Il n’a rien perdu de ses réserves.
Pierre s’assit près du poêle.
— Je suis fatigué, avoua-t-il.
Hortense posa sur son homme un regard doux et bienveillant.
— J’ai préparé une soupe au lard. Après manger, tu pourras aller te coucher pour récupérer tes forces. Demain, on fait le cochon chez les parents et la journée sera encore bien longue.
A ce moment, les garçons entrèrent dans la cuisine et se précipitèrent pour embrasser leur père.
— Avez-vous bien travaillé ?
— J’ai fait ma lecture, mes opérations et ma poésie, dit Vincent.
— Et moi, j’ai fait aussi ma lecture et ma page d’écriture, reprit Louis, le cadet. Et là on cassait des noix et des noisettes. Elles sont bien sèches, alors nous les préparons pour maman.
— C’est très bien, décréta Pierre. Et cette poésie, tu me la récites ?
L’aîné de ses fils prit une pause, comme l’instituteur le demandait en classe, et, tout en y mettant le ton, il déclama la belle poésie de Victor Hugo, sur la tombe de sa fille. Il y a dans les mots du poète une grandeur d’âme malgré la tristesse et l’accablement.
Lorsque l’enfant eut terminé, Pierre lui sourit.
— Voilà une belle poésie, bien récitée.
Il sortit de sa poche deux pièces et les donna aux enfants.
— C’est votre petite récompense. Quand vous irez chercher le pain chez Maria, si elle a des bonbons, vous prendrez ce que vous aimez.
Hortense installa la table avec l’aide de ses garçons, puis elle servit. Pierre tombait de fatigue, mais il fit honneur à la soupe. Il déballa ensuite son fromage qui, accompagné de cerneaux de noix fut apprécié de toute la tablée.
— Je ne pourrai pas vous faire la lecture ce soir, les enfants, dit Pierre à la fin du repas. Mais vous avez le droit de lire un peu avant de dormir. Je reprendrai L’Ile au trésor peut-être demain si nous ne rentrons pas trop tard de chez grand-père et grand-mère Faure.
Sans protester, les deux garçons embrassèrent leurs parents avant de rejoindre leur chambre.
Lorsque Hortense, après avoir débarrassé, rejoignit son homme au lit, il dormait déjà. Elle aurait aimé partager un petit moment avec lui. Malgré tout, elle le regarda avec tendresse et indulgence. Leur vie durant, les hommes demeurent les grands enfants des femmes qui les aiment.
Le matin, Pierre et Hortense s’étaient levés de bonne heure pour la « tuée » du cochon, une vraie fête dans ces années de guerre et de privations. Pierre s’habilla chaudement. Toute la nuit, des flocons avaient de nouveau tourbillonné dans le ciel altiligérien et une mince couche de neige recouvrait le sol.
Les parents d’Hortense n’habitaient pas très loin, mais pour aller jusqu’à leur ferme, dans le village de Saint-Victor, il fallait emprunter une belle côte. Pierre partit le premier, avec son vieux vélo ; Hortense et les enfants arriveraient plus tard dans la matinée.
Pierre repassa devant la ferme du père Mialon dans le hameau de Châteauneuf avant d’arriver chez ses beaux-parents. Il n’eut pas le loisir d’admirer son travail récent, il peinait et soufflait. Des jets de buée sortaient de ses narines en sifflant. Marcel Faure accueillit son gendre. Les deux hommes se mirent aussitôt au travail. Le cochon n’était pas aussi gros qu’autrefois, mais c’était tout de même une belle bête. Une fois immobilisé, il fut saigné proprement par le père d’Hortense à l’aide d’un long couteau tranchant. Résigné, l’animal semblait avoir accepté son sort.
Pierre avait disposé de la paille à l’entrée de la grange pour brûler les poils et les soies de l’animal.
— Avez-vous du feu, père ? demanda-t-il.
Marcel Faure lui tendit son briquet à amadou. Le vieux paysan avait aussi préparé des petits fagots de paille. Pierre enflamma l’un d’eux et mit le feu un peu partout alors que Marcel grattait déjà le cochon, prêt pour la découpe.
Dans sa cuisine, Louise Faure lavait encore bocaux, casseroles, marmites et toute une série d’ustensiles nécessaires à la préparation des différentes pièces de viande, des pâtés, des boudins. Elle avait sorti de ses placards des flacons de verre remplis d’épices, d’herbes et d’assaisonnements habituels. Chacun a en effet son coup de main pour préparer la viande de porc. Elle avait aussi du sel en quantité.
Le cochon avait été accroché dans la grange et Marcel le découpait maintenant avec application. Sur une table, il disposa les premiers morceaux, alors que le sang partait déjà pour la cuisine afin que l’on confectionnât le boudin. Louise mit un peu de sang de côté et prépara pour les hommes une galette avec des oignons et une pomme de terre cuite en rondelles. Ce serait leur réconfort du matin.
Petit à petit, le cochon disparut sous les coups de couteau et de hachette. A l’extérieur, un abreuvoir était naturellement alimenté par une source dont l’eau coulait, limpide, toute l’année. Au fur et à mesure, Pierre allait rincer les morceaux à l’eau claire. Dans une moulinette antique, Louise passait sa viande et assaisonnait ses pâtés. Elle ajoutait parfois des morceaux de noisettes ou de noix. Le boudin avait été le premier terminé. Elle alla dans la grange servir aux hommes leur bonne galette accompagnée d’un verre de vin coupé d’eau.
— C’est la belle vie, dit Pierre avec un large sourire.
Hortense venait d’arriver avec les garçons. Ils portaient des terrines vides. Aussitôt, les deux femmes se remirent au travail, tout en échangeant les dernières nouvelles.
— Elles en ont à raconter ! persifla Marcel dans sa moustache. Cela fait bien deux ou trois jours qu’elles ne se sont vues !
Pierre termina sa galette de sang et reçut pour réconfort une grande tape dans le dos.
— Allez, mon garçon, on y retourne !
La découpe se poursuivit de plus belle, sous l’œil envieux des garçons qui ne rataient rien de ce vrai spectacle. Eux aussi avaient eu droit à un petit morceau de galette de sang. Leurs yeux brillaient ; ils étaient fiers de se rendre utiles, approchant un outil, une bassine, une serviette, à la demande de leur père ou de leur grand-père. Les jambons étaient fameux. A la cuisine, les femmes s’occupaient de la préparation de saucisses et de saucissons selon un ordonnancement qui ne laissait rien au hasard, avec une rigueur toute militaire. Avec les années, c’était une habitude, il n’y avait jamais vraiment de surprise.
A midi, l’essentiel était fait.
La bête avait été entièrement débitée. Les pâtés cuisaient, la viande se reposait un peu avant de finir au saloir ou dans la souillarde pour sécher tranquillement. Louise avait fait griller quelques morceaux bien choisis. Toute la famille eut grand plaisir à se retrouver à table pour manger et pour fêter cette belle journée. Pierre revivait un peu. Depuis quelques jours, le travail l’avait empêché de trop penser au STO. Il savait que son tour allait arriver, il le redoutait. Alors, entouré de sa femme, de ses enfants et de ses beaux-parents, il se laissa bercer par l’illusion que tout s’arrangerait. Cette maudite guerre finirait bien, les privations aussi ; la liberté reviendrait et avec elle disparaîtrait pour de bon ce nœud qui lui tordait le ventre depuis trop longtemps, cette peur qui chaque jour davantage devenait un poison violent. Pierre posa son regard tour à tour sur Hortense, sur Louis, puis sur Vincent. Ils étaient sa raison de vivre et il les aimait.
Après le repas, Marcel servit à son gendre un petit alcool destiné à leur redonner du courage. Le matin, ils avaient heureusement bien travaillé et bien avancé. L’après-midi, ils reprirent leur besogne avec moins d’entrain, moins d’énergie. La fatigue les accablait. En fin d’après-midi, après avoir lavé les ustensiles, les bidons, nettoyé la grange, Pierre et Marcel rentrèrent enfin à la cuisine pour se réchauffer un peu. Juste le temps de préparer quelques sacs pleins de provisions, Pierre et Hortense redescendirent au Monastier. Les enfants étaient eux aussi fatigués mais heureux d’avoir participé à une telle journée, une telle fête. Ils avaient bien senti leurs parents moins inquiets, moins soucieux de cette guerre qui leur volait une part de leur enfance. Pour quelques heures, toute la famille avait vécu comme entre parenthèses, loin des turbulences du monde. Sur le chemin du retour, Pierre siffla et chanta des refrains de chansons populaires que les enfants et Hortense reprenaient à tour de rôle, comme si cette journée pouvait faire croire à l’innocence du monde.
Mais ce court moment de bonheur n’était qu’une illusion. Une fois allongé dans son lit, après avoir fait la lecture aux garçons malgré la fatigue, Pierre ne réussit pas à trouver le sommeil. Il s’agitait, se retournait, anxieux. Hortense, connaissant bien son homme, comprit qu’il ne dormait pas et que quelque chose devait l’inquiéter. Elle se rapprocha et se blottit un peu plus contre lui.
— Qu’est-ce qui ne va pas ?
Pierre garda le silence, n’osant répondre, bouleversé par ses idées noires.
— Tu peux tout me dire, tu le sais. C’est cela, notre force, reprit Hortense.
— Je ne sais pas quelle attitude adopter, finit par dire Pierre. Je n’ai pas l’intention d’aller en Allemagne, dans leurs usines, fabriquer des armes pour tirer sur nos amis américains ou anglais. Et puis j’hésite encore à m’engager dans la Résistance. Il y a tant de choses que l’on raconte sur ces hommes qui se cachent dans les forêts et qui vont dans les fermes voler des provisions, rançonner et parfois faire du mal aux habitants. Si je me cache ici, on me trouvera. Si je me cache loin, il n’y aura plus personne pour vous protéger, pour gagner de quoi vous nourrir, vous chauffer…
La voix de Pierre s’étrangla sous le coup de l’émotion. Hortense sentit son homme frissonner une nouvelle fois. C’était rare que son corps réagisse ainsi, qu’il se laisse submerger par des ondes négatives.
— Je n’ai pas peur pour moi, reprit Pierre timidement. Je pense à vous, j’ai peur pour toi, tant on entend raconter d’horreurs. Je ne sais pas si tout ce qui se colporte est vrai, mais c’est terrifiant de constater qu’il n’y a plus ni foi ni loi dans notre pays, aucun frein à la barbarie. Je pense souvent à ces pauvres soldats qui se sont battus entre 1914 et 1918, à ceux qui sont morts. Il doit y avoir tant de douleurs cachées… silencieuses…
Hortense se rapprocha encore un peu plus de Pierre. Elle passa une main dans ses cheveux et déposa un long baiser sur ses lèvres. Pierre ferma les yeux.





























