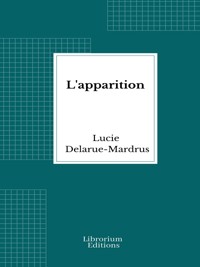
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Laurent Carmin entr’ouvrit la porte de la salle à manger et vit sa mère en discussion avec un de ses fermiers.
Maître Casimir voulait des réparations locatives. Mᵐᵉ Carmin répondait qu’il n’y avait pas urgence. Laurent referma la porte.
De telles démarches se renouvelaient, au château, de la part des herbagers; mais ils repartaient presque toujours sans obtenir satisfaction, car Mᵐᵉ Carmin était Normande comme eux, et bien plus forte qu’eux.
On l’admire pour cela dans le pays, et aussi pour ses biens, qui sont nombreux, espacés les uns des autres, des grands et des petits, fermes et manoirs, pressoirs, herbages et bois-taillis.
—A qui cela appartient-il?
Réponse presque toujours la même:
—Est à Mâme Carmin.
Il y a de ces marquises de Carabas en Normandie, car les traditions de l’ancien temps n’y ont guère souffert du renversement des rois.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
LUCIE DELARUE-MARDRUS
L’Apparition
ROMAN
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743741
L’APPARITION
I LA RENCONTRE DANS LE PARC
II APPRIVOISEMENT
III LA BELLE DÉCOUVERTE
IV A BOIRE!
V ANGOISSES
VI L’ÉPOUVANTE
VII UN FRISSON DANS LA NUIT
VIII UNE LETTRE
IX MATER DOLOROSA
X LORENZO
XI LE MAITRE
XII LE SCANDALE
XIII DES JOURS
XIV LA GRANDE COMPAGNIE
XV DERNIER DU NOM
L’APPARITION
ILA RENCONTRE DANS LE PARC
Laurent Carmin entr’ouvrit la porte de la salle à manger et vit sa mère en discussion avec un de ses fermiers.
Maître Casimir voulait des réparations locatives. Mᵐᵉ Carmin répondait qu’il n’y avait pas urgence. Laurent referma la porte.
De telles démarches se renouvelaient, au château, de la part des herbagers; mais ils repartaient presque toujours sans obtenir satisfaction, car Mᵐᵉ Carmin était Normande comme eux, et bien plus forte qu’eux.
On l’admire pour cela dans le pays, et aussi pour ses biens, qui sont nombreux, espacés les uns des autres, des grands et des petits, fermes et manoirs, pressoirs, herbages et bois-taillis.
—A qui cela appartient-il?
Réponse presque toujours la même:
—Est à Mâme Carmin.
Il y a de ces marquises de Carabas en Normandie, car les traditions de l’ancien temps n’y ont guère souffert du renversement des rois.
Le château, ancien et restauré, noble et charmant, s’entourait d’un parc mal entretenu par économie. L’église du village, située presque dans ce parc, avait l’air d’une dépendance. Il était, au milieu de la grande pelouse, une pièce d’eau sur laquelle naviguaient deux cygnes. Un saule pleureur se mirait.
Allées profondes, fourrés épais, clairières, une étendue qui semblait n’avoir de limites que les horizons bleus et mauves, venait s’achever au pied du perron, quatre marches et leur belle rampe de pierre. Et tout cela, qui écrasait l’humble village, c’était bien la seigneurie d’autrefois, orgueilleuse, isolée au milieu de champs à l’infini, très loin des villes.
Au-dedans, un meuble disparate faisait se côtoyer la camelote moderne avec de précieuses choses. Le grand salon montrait des housses, un lustre de cristal, une pendule Restauration sous globe, des stores de soie bouillonnés, quelques portraits de famille. Le feu de bois de l’immense cheminée y répandait un charme en hiver; la lumière verte des arbres y jetait, l’été, sa mélancolie campagnarde.
En bas, il y avait encore, trop grande, claire, la cuisine et sa dinanderie du vieux temps, la salle à manger brune et sombre, tapissée de verdures admirables, la salle d’étude avec son tableau noir, la salle de billard toujours fermée, un petit salon et ses fauteuils de tapisserie criarde, le vestibule et les couloirs à vitraux polychromes, sans compter la seconde cuisine, la buanderie, l’office et la lingerie. En haut, les chambres sentaient la cretonne et le pitchpin; mais certaines avaient mobilier d’acajou, ciels de lit et rideaux à fleurs, qui furent le décor des grand’mères.
Mᵐᵉ Carmin de Bonnevie, méticuleusement, continuait là-dedans l’existence sans histoire des siens. Etre veuve de bonne heure, pour une femme comme elle, c’est se faire, à trente ans, dévote, comme sous Louis XIV, ce qui veut dire être habillée de noir et vouée à la piété, choses qui n’empêchent en rien de veiller âprement sur l’argent.
Nerveuse et sèche, ses cheveux noirs, lisses, chignon sans grâce, son teint jaune de vieille fille, ses yeux bruns, assez beaux, chargés d’austérité, rien, ni ses habitudes d’ordre et d’épargne, ni son habillement, ni le genre de petits chapeaux étriqués, monopole de la province, qu’elle perchait sur sa tête pour aller à la messe, rien en elle n’indiquait qu’elle eût une passion dans la vie.
Elle en avait une, cependant. C’est la seule qu’on juge légitime chez les femmes. Elle a pourtant la violence et toute l’animalité des autres. Mᵐᵉ de Bonnevie aimait son fils, secrètement, on peut dire, ne voulant rien montrer à ce garçon, ni aux autres, de sa faiblesse cachée. Etant chef de famille depuis plus de cinq ans, elle tâchait de l’élever dignement, afin d’en faire un homme selon son goût, un vrai successeur des hobereaux qui l’avaient engendré, un vrai Carmin de Bonnevie, gentilhomme-fermier qui soigne ses terres, accomplit ses devoirs religieux, chasse au fusil, joue au billard, fonde une famille de deux enfants au plus, et meurt, après une existence si bien remplie, convenablement, comme il a vécu.
Laurent acheva de refermer tout doucement la porte qu’il avait entr’ouverte. Il avait vu ce qu’il voulait voir.
C’était un garçon de douze ans à peu près, droit sur ses reins, bien fait, tourbillonnant. Ses joues rondes, son nez parfaitement enfantin, ses cheveux noirs, paquet de boucles sur le front, lui conservaient, à cet âge, sa physionomie de petit bébé tout brun; et rien n’était puéril comme sa voix trop haute, cette voix qui chantait le dimanche à l’église, angéliquement. Mais le charmant enfant de chœur, parmi ces traits encore indécis, possédait le regard le plus audacieux, une paire d’eux gris sombre, enfoncés et larges, étincelants et rapprochés; sa bouche épaisse, d’un rouge violent, accusait encore l’énergie formidable de son petit menton; et, cachée sous les boucles, la forme bien particulière de son front montrait deux bosses arrondies, vraies petites cornes de faune, prêtes à percer la peau tendue et lisse.
Depuis sa naissance, presque, la maman luttait contre lui.
Il avait commencé par enfoncer ses quatre dents, à dix mois, dans le sein de sa nourrice, au point que cette femme n’avait plus voulu de lui. Dès ses premiers pas, ses caprices, destructions, cris, trépignements, coups à ceux qui le portaient, s’étaient multipliés jusqu’à remplir tout le grand château de sa petite présence atroce. De sept à dix ans, se roulant par terre au moindre mot, crachant à la figure des gens ou leur jetant les objets à la tête, mordant comme un petit fauve, injuriant et taquinant tout le monde, ses férocités avaient bouleversé la famille et la domesticité. Et maintenant qu’il sortait de la première enfance, on ne savait pas trop où s’exerçaient ses ravages, puisqu’il disparaissait dans le parc à la moindre occasion, pour le soulagement général, du reste.
Malgré tout cela, pourtant, on l’aimait. Il était si sain et si beau! Son rire était si frais! Cette enfance turbulente était la vie même du grand château mélancolique.
Cependant, offrant à Dieu la peine inouïe qu’elle se donnait pour élever ce mauvais sujet, la mère, malgré tout son orgueil d’avoir un fils, regrettait parfois, sans oser se l’avouer à elle-même, qu’il ne fût pas plutôt une fille.
Mais la mauvaise foi maternelle reprenait vite la parole:
—Il est trop bien portant, c’est tout. Il deviendra plus traitable avec l’âge... Tous les garçons, c’est connu, sont difficiles à élever... Son père avait mauvaise tête aussi, mais bon cœur.
Il courait, son canif au poing. Son canif était le seul instrument d’étude qu’il aimât. L’ouvrir et le fermer le distrayait quand, le mardi et le samedi, l’instituteur de l’école venait lui donner sa leçon, ou bien pendant qu’au presbytère M. le curé, seul à seul, chaque mardi, l’interrogeait sur le catéchisme et le latin.
Ce canif, il l’avait détourné de ses destinées ennuyeuses pour en faire un joujou passionnant. Tailler des crayons, quelle bêtise! Mais fabriquer des arcs et des flèches dans le sous-bois, poignarder les pêches et les poires des espaliers quand François a le dos tourné, couper en quatre les vers de terre, amputer les grenouilles, et, lorsqu’il faut rester à la maison, taillader clandestinement le bord des meubles du salon, lancer la lame dans la planche à repasser, pour l’épouvante de Maria quand elle est à la lingerie, ou bien hacher furieusement les beaux légumes de Clémentine à ses fourneaux, voilà l’emploi vrai d’un canif...
Son néfaste jouet dans la main, il bondit de toute son âme, ivre de cette récréation illicite qu’il vient de s’octroyer.
—Quand maman va revenir à la salle d’études...
Il rit. Il rit d’être dehors pendant qu’il fait si beau, rit d’avoir, avant de les quitter, donné des coups de pied dans ses livres et ses cahiers jetés par terre, rit du bon tour qu’il joue à tout le monde en se sauvant dans le parc, alors qu’on le croit à son pupitre, apprenant ses déclinaisons.
En passant comme le vent devant la plate-bande inculte où le mois de juin triomphe:
—Rosa la rose!... crie-t-il à pleins poumons.
Sa voix aiguë a déchiré l’air, cri d’hirondelle. Le voilà déjà loin. Ses jambes nues de petit garçon musclé l’emportent, tout son corps dessine des lignes dansantes sous le jersey du costume marin qu’il porte.
Le voilà dans la pépinière où sont rassemblées les essences rares. Brusque, il s’arrête, obéissant à son désir soudain. Vite, ouvrons le cher canif. D’un seul coup, la lame, vigoureusement maniée, s’enfonce dans l’écorce tendre du premier petit arbre. Il l’arrache et recommence.
—Tiens!... Voilà pour toi!... Tiens!... Voilà encore pour toi!
Une fureur joyeuse l’anime. Il voudrait que l’arbre se défendît. Il voudrait se battre.
—C’est toi, Laurent?... Qu’est-ce que tu fais là?
Il s’est retourné. L’oncle Jacques est là, qui le regarde.
L’oncle Jacques est le frère de maman. Il s’appelle comme elle: Carmin de Bonnevie. Car papa et maman étaient cousins. L’oncle habite depuis toujours un petit pavillon dans le parc. Laurent sait comme on le considère à la maison. Il est célibataire et riche. Parrain et tuteur de Laurent, dont il a choisi le nom sans qu’on devine pourquoi (puisque les aînés de Bonnevie se sont toujours appelés Jean), il est aussi l’oncle à l’héritage. Débile, avec sa figure fripée et fade, ses yeux myopes, ses cheveux grisonnants, c’est un original inoffensif qui vit tout seul dans son pavillon, faisant lui-même son ménage par peur qu’on ne dérange ses papiers, souffrant à peine que la fille de cuisine lui prépare ses maigres repas. On ne le voit guère au château que le dimanche, jour où maman l’invite à déjeuner ou à dîner.
Il a des idées à lui. Il porte toujours dans sa poche une barbe de plume dont il se chatouille le dedans du nez, au moins trois fois par jour, pour se faire éternuer, parce que cela évite les rhumatismes. Il fait un peu d’aquarelle et de modelage. Mais sa vraie marotte, ce sont les livres, parmi lesquels il vit, c’est l’on ne sait quels essais historiques qu’il écrit. Il croit avoir, au cours de ses recherches, retrouvé par hasard les traces de la famille, dont l’origine remonterait à la fin du XIVᵉ siècle. Il est en correspondance avec des savants, des bibliophiles, des libraires. Et l’argent qu’il dépense pour ses documents est une des exaspérations de sa sœur.
Grand, voûté, crasseux, mal habillé, l’air d’un pauvre, l’oncle Jacques considérait son neveu.
—Qu’est-ce que tu fais là?...
Il avait, comme eux tous, un rien d’accent normand, cette manière très atténuée que, chez nous, les gens distingués ont de chanter comme les paysans, ce qui, du reste, n’est pas sans charme.
Le petit Laurent releva son menton volontaire. Ses yeux pleins d’éclats regardèrent de bas en haut le grand type sans méchanceté qui ne le gronderait pas.
—Ben, tu vois bien, répondit-il, je massacre les arbres...
Un rêve couva dans les yeux doux de l’oncle. Depuis longtemps, il soupirait aussi, lui, comme sa sœur, au sujet de l’enfant. Ce diable ne ressemblait en rien au neveu qu’il eût souhaité, studieux et sage disciple auquel il eût inculqué l’amour de l’histoire, qu’il eût initié lentement à ses recherches sur l’origine de leur maison.
—Ce n’est pas beau d’abîmer les arbres... prononça-t-il. Et puis, qu’est-ce que tu fais à cette heure-ci dehors? Tu devrais être à ta salle d’études.
Une fois de plus, il soupira:
—Si tu voulais, Laurent, je t’apprendrais, moi... Et sans t’ennuyer, tu sais?
Une petite émotion lui fit avancer sa main, gentiment, comme pour mieux persuader par quelque caresse.
Le gamin, impassible, laissa la main s’avancer. Puis, appliquant dessus une fort grande claque, il répondit par le mot le plus grossier du monde. Et, sans reculer, effronté, provocant, il continua de regarder son oncle.
L’autre, remettant sans rien dire sa pauvre main dans sa poche, attentif, dévisagea le petit. Celui-ci, les yeux égayés par une ironie toute normande, prit exprès le plein accent du pays pour demander, de sa petite voix trop haute:
—Est-y qu’ t’ aurais point entendu?
Et, de toutes ses forces, faisant un pas en avant, le menton haut, il cria de nouveau l’insulte.
Là-dessus, un craquement de branches. Et l’on vit Mᵐᵉ Carmin de Bonnevie, nerveuse et noire, qui venait à grands pas colères.
—Laurent!... Laurent!...
Alors, avec un geste de petit bouc, il secoua sa tête toute frisée et brune, exécuta de côté quelque chose comme une ruade, et, faisant un pied de nez dans la direction de sa mère, à toutes jambes il se sauva, disparut.
L’oncle Jacques, nez à nez avec sa sœur suffoquée, murmura:
—Je te félicite, Alice! Il est bien élevé, ton fils!
A quoi, rouge et méprisante, elle répondit, elle aussi, sur un ton presque paysan:
—Tu t’occuperais de tes dictionnaires, cela vaudrait peut-être beaucoup mieux, tu sais?...
Puis, reprenant sa course, elle se remit, haletante, à la poursuite du petit.
IIAPPRIVOISEMENT
Il avait continué de fuir, était loin, maintenant, tout au bout du parc. Par une brèche, il se coula, sur les genoux et les mains, à travers la haute haie épineuse, et fut sur la route.
Le village commençait là. Quatre heures. Les écoliers sortaient de l’école.
Il y en avait quatre ou cinq avec lesquels Laurent aimait à jouer. Chaque fois qu’il le pouvait, il allait les retrouver en cachette. On le lui défendait expressément, ces enfants n’étant pas de son rang, et connus pour leur mauvais esprit.
Ils étaient de ces petits Normands dits «fortes têtes», qui ramassent des cailloux pour lapider les passants et ne rêvent par ailleurs qu’école buissonnière et maraude.
Ce n’étaient pas des fils de paysans. Ceux-là sont plus pacifiques et plus lents.
L’un appartient à la dame de la poste, l’autre à l’épicier, le troisième...
Laurent s’était battu longtemps avec eux avant de les dominer. Maintenant il était leur maître, celui qui décide des jeux et des promenades.
Après saute-mouton et les quilles, la bande quittait le village et s’en allait à travers les chemins creux, longeant les haies des fermes, en quête de méfaits nouveaux.
Chaque saison avait ses plaisirs. En hiver, ils s’introduisaient, par des trous, dans les granges fermées, afin de jouer à cache-cache dans les bottes de foin, qu’ils mettaient à mal en les piétinant. Au printemps, ils cherchaient des nids, ou bien volaient des œufs dans les poulaillers. En été, c’était la cueillette des groseilles dans les vergers mal gardés. En automne, ils secouaient les pommiers et bourraient leurs poches de pommes qu’ils se partageaient ensuite, avec cris et batailles.
Laurent avait à profusion, chez lui, toutes ces bonnes choses; mais il ne les aimait que dérobées, conquises. C’était pour lui le butin de guerre, avec tout ce que ce mot comporte de risques et d’aventures.
Au retour de ces expéditions, sali, déchiré, les yeux sauvages, il rentrait au château, sachant fort bien quelles punitions l’attendaient.
C’étaient toujours les mêmes, Mᵐᵉ Carmin n’ayant pas trouvé mieux. Elle les graduait selon la gravité des cas. Il y avait la privation de dessert, les lignes à copier, la retenue du dimanche, le dîner au pain sec, le coucher bien avant l’heure, en plein jour. Il y avait aussi le blâme de M. le curé, la menace du collège, et autres paroles qui le laissaient indifférent. Mais personne, jamais, n’avait levé la main sur lui, ce qui, peut-être, eût été la seule chose à faire.
Avec son instinct d’enfant, il se rendait parfaitement compte qu’aucune autorité suffisante, dans cette maison sans homme, ne pouvait mater son indiscipline. Et, sans même le savoir, il méprisait en bloc tout son monde.





























