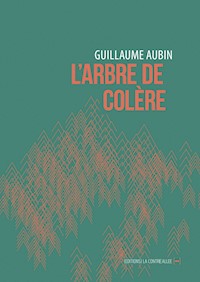
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Née dans une tribu amérindienne du Canada, Fille-Rousse grandit avec les garçons, s’ adonnant avec joie à la chasse, la pêche et la course. Rester au campement n’ est pas fait pour elle ! Dans l’ esprit du chamane de la tribu émerge alors l’ idée que la petite fille, dont la naissance est nimbée de mystère, pourrait être une Peau-Mêlée, un être à part, homme et femme à la fois. Si dans la tribu certains acceptent sa nouvelle condition, d’ autres doutent et ne cessent de mettre la jeune fille à l’ épreuve. Un premier roman au rythme entêtant comme le son du tambour.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Guillaume Aubin a fait des études d’ ingénieur. S’ en est repenti pour devenir libraire. Il est lauréat du Prix du Jeune Écrivain 2015 et 2016, respectivement pour ses nouvelles « Phosphorescence » et « Punk à Chien », publiées dans les recueils Et couvertes de satin et La vie est une chose minuscule, aux éditions Buchet Chastel.
L’ Arbre de colère est son premier roman, et la centième nouveauté à paraître aux éditions La Contre Allée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
I
1.
Les chiens n’aboient pas à moitié. Les chiens ne se trompent pas, ne prennent pas un orignal pour un ours. Encore moins un ours pour un Homme. On les entend dans la forêt à l’aube. À celui qui gueulera le plus fort. Ils vont et viennent, tracent des sentes nerveuses dans l’herbe. Tirent sur leurs cordes jusqu’à s’arracher le poil.
Dans les canots, les pagaies prennent de la vitesse. Vingt-huit mains de bois se font plus fermes sur l’eau, et le calme de la rivière n’arrive plus à couvrir le bruit des rameurs et des corps qui chauffent. Entre les arbres, on aperçoit les premières tentes. Les embarcations accostent les unes après les autres. Les guerriers sautent dès qu’ils ont pied, font bouillonner la rive. Certains courent vers le camp, d’autres grimpent dans les arbres, peau contre écorce, l’arc enfilé autour du cou. Les chiens sont lâchés. Les premières flèches sifflent, d’un côté comme de l’autre. Les bêtes sont criblées avant d’avoir pu mordre. Le soleil éclaire à peine les cimes, et déjà on meurt. Les cris de guerre se mêlent aux cris d’horreur quand les Yeux-Rouges déferlent comme une nuée de mouches.
Le Chef est le premier à mettre le pied dans le village, visage peint, pupilles dilatées, la masse levée. Il ne laisse personne le précéder. Un Longues-Tresses jaillit de sa tente et tend son arc pour le viser. Trop vite. La flèche à pointe de pierre glisse sur le bras du Chef, lui entaille la peau. À peine une piqûre de guerre, une eau-de-vie pour mieux donner la mort. Il s’élance, arme son bras et lâche sa masse. Deux tours sur elle-même et elle défonce la poitrine de l’homme. Il tombe, la main toujours sur la corde. Le Chef désencastre son arme et l’abat sur le crâne. On n’est jamais trop sûr. Puis il entre dans la tente. La pénombre contraste avec le soleil vif du matin boréal. Il plisse les yeux. Une silhouette se jette sur lui, un cri clair de femme qui n’a plus rien à perdre. Il évite le couteau, mais l’élan du corps le renverse. Ils tombent ensemble. Le Chef lui maintient les bras pour l’empêcher de frapper à nouveau. D’un coup de reins, il la fait rouler sur le dos, et s’assoit sur elle pour lui couper le souffle. Il lui serre le poignet jusqu’à lui faire lâcher son arme. Elle se débat, cherche des prises. Il serre les cuisses plus fort. Il a le ventre chaud, le souffle court. Cette femme sans peur attise ses envies de viol. Il y pense depuis qu’il a décidé de l’attaque. Il y pense la nuit, le sexe gros sous les peaux de bêtes. Il y pense à l’aube, quand la peinture sèche sur son visage et fige ses expressions. Il veut en violer plusieurs. Il est le Chef, il en a le droit. Tous ses guerriers en ont le droit. Mais lui plus que les autres. Il frappe la femme au visage pour l’étourdir, comme il l’aurait fait d’un poisson hors de l’eau. Il prend de sa ceinture un mètre de corde et lui attache les mains et les pieds jusqu’au sang, jusqu’à lui faire perdre l’envie de s’enfuir. Il entend un frottement dans le fond de la tente et aperçoit une jeune fille. La mère crie quand il brutalise l’enfant. Quand il lie ses poignets pour la violer plus tard. Elle aussi sera offerte à l’Île-Esprit. Il se relève et repart à l’assaut des hommes.
Dans le village, le combat est inégal. Les Yeux-Rouges sont deux fois plus nombreux que les Longues-Tresses. Le Chef aide un de ses guerriers en difficulté. Il s’élance sur l’ennemi pour le renverser, lui brise la colonne, avant de l’achever. Les flèches se chargent de ralentir ceux qui cherchent à s’échapper. Ce sont souvent des femmes. Elles n’ont pas le devoir de guerre, juste celui d’engendrer et de nourrir. Alors elles courent. Les archers visent les jambes : les fesses, les cuisses, les mollets. Ne pas toucher les zones vitales. Malheur à celui qui fera perdre un corps pour l’offrande. Les derniers Longues-Tresses crèvent dans la douleur. Quelques guerriers ressortent de la forêt, tirant une femme par les cheveux. Le Chef regrette que ce soit déjà la fin. Il coupe une gorge. La sensation de la lame qui mord la peau lui avait manqué. La carotide palpite sous ses doigts, de moins en moins fort à mesure que le sang s’écoule et se perd dans la terre.
Les cris de victoire succèdent aux cris de guerre. Les Yeux-Rouges regroupent leurs morts devant eux, les traînant par un bras, par une jambe. Les couteaux tranchent les oreilles, pour le souvenir, pour la gloire. Puis les têtes des morts retournent à la terre, et ne tressailliront plus que sous les crocs des loups. Le pillage commence. On retourne les tentes, tape dans les réserves de viande. Les habits des femmes sont déchirés. Les filles sont pelotées. Dans le viol comme dans l’amour, chacun a sa technique. Certains préfèrent l’intimité d’un abri. D’autres aiment ça à plusieurs, pour ce côté convivial qu’il y a à passer chacun son tour. Le Chef ne partage plus ses femmes. Chaque corps qu’il prend ne sera pas pris par un autre. Dans le passé, il a prouvé sa valeur en violant au milieu de ses hommes. Maintenant, être vu ne l’intéresse plus. Il préfère laisser la place aux jeunes, pour qu’ils se fassent la main. Il retourne dans la première tente qu’il a visitée et pénètre la mère, puis l’enfant. Les femmes sont regroupées au centre. Les plus jeunes pleurent. Les plus vieilles endurent les insultes et le ventre qui cisaille. Quelques tentes brûlent, épaississent l’air de leur fumée d’écorce. On récupère ce qu’on peut. Fourrures, berceaux, canots. Les morts amis sont alignés : de longues plaintes les honorent, avant qu’ils soient chargés sur des traîneaux de branches. Ils seront pleurés et veillés. Le Chef prend sur son canot la femme et la fille qu’il a violées. Il est attaché à ses exploits de sexe comme à ses exploits de lame.
Pas une larme sur le visage de la mère pendant le voyage. Elle regarde l’eau, le trouble des rapides et les truites qui filent entre les rochers. Comme si elle partait cueillir les baies, un matin comme un autre. Quand ils arrivent à leur camp, les hommes jappent. Heureux. Leurs familles les attendent avec une marmite sur le feu. Et des enfants qui courent.
2.
Une aube, encore. Quand les lacs se découvrent de brume. Quand les castors fendent l’eau en silence, juste un museau au centre d’un miroir. Quand le sable est froid d’avoir passé la nuit dehors. Le Chef n’a pas besoin de beaucoup dormir. Alors il a du temps pour le soleil. Même assez pour le long soleil d’été. Depuis qu’il est chef, les chasses partent tôt. Les pêches rentrent tard. La tribu ne manque pas de nourriture. Il a gagné le respect. Il est écouté. Quand il demande à partir aux aurores, comme aujourd’hui, on le suit. Les prisonnières avancent en file. La tourbe porte encore les traces des animaux de la veille. Les pieds aiment la terre du matin, qui ne colle pas mais garde empreinte. Les femmes vont vers la mort à travers les forêts et par les rivières : leurs sens s’en souviendront quand elles arriveront dans l’autre pays.
Il faut une demi-journée pour atteindre l’Île-Esprit. Lorsqu’ils ne rament pas, les Yeux-Rouges portent leurs canots sur la tête. Parfois s’arrêtent pour manger des baies ou de la viande séchée. Avant de remettre à l’eau, ils posent un genou à terre. S’adressent à l’Esprit du lac et à celui de l’île. Ils demandent à être accueillis. Les Yeux-Rouges ne prennent sur l’arbre que l’écorce nécessaire. Ils ne crachent pas dans l’eau. Il n’y a pas de ruisseau sans Esprit du ruisseau. Et s’il y a deux lieux qu’ils admirent plus que tout, c’est l’Œil-Lac et l’Île-Esprit. Inséparables comme la chair et le sang. L’Œil-Lac a reçu son nom de sa forme d’anneau. L’Île-Esprit est une montagne qui s’élève en son centre. Les Yeux-Rouges disent que c’est la griffe du Grand-Ours qui a loupé le Grand-Poisson, et qui attend encore sa proie. On pourrait prendre le lac pour une large rivière, si on regarde trop vite. Quand ils ont douze hivers, les enfants en font le tour en canot pour l’apprivoiser. Il leur faut plusieurs jours. C’est leur premier rite de passage vers l’âge adulte.
Les prisonnières sont réparties dans les embarcations. Les hommes sont à l’arrière. La pagaie toujours du même côté, la main habile pour maintenir le cap. Leur peau est chauffée du soleil de midi. Ils en profitent. Dans la taïga, on reçoit rarement les rayons à même le corps. Quelques ombres de nuages filent sur la forêt immense. C’est encore une journée magnifique, comme il y en a peu dans l’année. Le Chef est le premier à mettre le pied sur l’île, après avoir adressé une nouvelle prière à l’Esprit. Ils laissent un homme pour garder les canots, et grimpent vers le sommet de la montagne. Le Chef reconnaît son sentier à la forme des arbres. Ils montent dans la tourbe humide, dans les mares qui suçotent les chevilles, dans les sphaignes molles. Ils sautent de tronc en tronc, quand le bois n’est pas trop pourri, ne s’est pas dissous dans cette terre d’eau. Chacun de leurs pas soulève des nuages de moustiques. Le Chef impose un rythme rapide. Les prisonnières rechignent, sont poussées dans le dos avec la pointe d’une branche. Le sommet est nu comme une plaine froide. Râpé par le vent hiver comme été. Les arbres se recroquevillent avec l’altitude, puis disparaissent totalement. Laissent place aux lichens et autres plantes rases de la toundra, coriaces même pour la dent du caribou. C’est là, sur les hautes pierres noires de l’Île-Esprit, que les Habitants sacrifient. Face à l’immensité boisée et à la courbe sans fin de l’Œil-Lac. Le soleil a bien amorcé sa descente vers l’horizon. Le Chef laisse du temps pour souffler.
Les femmes sont regroupées, assises par terre. On leur fait mâcher des morceaux de viande pour les apaiser. La jeune fille pleure : celle que le Chef a violée. Ils l’ont attachée plus fermement que les autres. Elle n’a pas la sagesse des vieilles qui regardent la mort en face. Plusieurs fois pendant le voyage, elle a essayé de courir dans les bois. Mais son instinct de survie n’a rien pu faire contre la vitesse des guerriers. Aujourd’hui, aucune ne sera pénétrée. Le sexe est interdit avant le rite. Ceux qui ont profité des prisonnières l’ont fait avant. Pendant tout le temps de leur séquestration. Ils en prenaient une par le bras, la levaient comme on lève un lièvre, les yeux terrorisés, et l’emmenaient dans une hutte vide pour la posséder. Les hommes ont aimé ces corps étrangers, qui goûtent presque la résine de sapin à force d’en mâcher. Elles sont amères, ces femmes, quand on passe une langue dans leur cou, dans leur con. À force de violence, elles ne refusent rien. Contrairement aux femmes du camp qui parfois disent non, non pas dans le cul. Le rite ne veut pas de sexe, comme pour laisser le temps aux cicatrices de se refermer. Pour ne pas apporter un corps malade à l’Esprit. Pendant que les hommes se peignent le visage en rouge, le Chamane installe les fruits du qaa. Trois fruits par femme, sur la dalle noire. Ronds et rouges. Pas plus gros qu’une noix. Il fourre sa pipe d’herbe et de qaa séché. Alors il invite les guerriers à tirer, et la fumée blanche caresse le crâne de l’Île-Esprit. Les pupilles palpitent quand la pipe arrête de tourner. Les hommes sont vapeur. Le Chamane joue du tambour sacré, fait la pluie et le tonnerre sur sa peau d’orignal. Et chante au nouvel été, aux naissances, à l’harmonie du monde. La danse commence. Une houle de corps qui ne veulent plus s’appartenir, qui se lancent au loin et se rattrapent. Des yeux sans regard, et des pensées vides. Il n’y a pas de danse. Il n’y a pas de danseurs. Juste une forêt qui s’agite de son propre vent. Qui s’arrache pour mieux s’enraciner.
Le Chamane pose son tambour une première fois. Deux guerriers prennent une femme par les épaules et l’amènent sur la dalle noire. Le Chef ramasse un fruit de qaa et le montre au ciel qui tombe. Puis s’adresse à la femme : Je te donne la mort, et tu donneras la vie. Il se met le fruit dans la bouche. Se sert de ses deux mains pour forcer les mâchoires de la femme et, comme un baiser, lui dépose le qaa sur la langue. Il referme. Elle se débat, veut cracher, mais ils lui tiennent le visage. Au bout de quelques minutes, noyée dans sa salive, elle avale. Le fruit est dans son hôte. Des larmes coulent sur ses joues. Elle accepte sans peine les deux autres qaa. Les femmes sont ensemencées les unes après les autres par la bouche du Chef. On coupe leurs liens avec une courte lame. Elles sont libres. Certaines restent. Peut-être dans l’espoir d’inspirer la pitié, qui ne viendra pas. D’autres fuient, s’enfoncent dans les forêts. La mort est souvent une affaire de solitude. Les Yeux-Rouges quittent l’Île-Esprit avant la nuit. L’Île-Esprit n’accepte pas de dormir avec les Habitants. Ils campent sur les rives, coupant quelques branches pour s’isoler du froid, et s’installent sous leurs canots. Le lendemain, ils saluent l’Œil-Lac, et repartent chez eux.
3.
Les femmes se font vomir. Les genoux dans la terre, les doigts loin dans la gorge. Elles se vident de leur bile. Certaines font macérer des feuilles d’arbre dans des flaques. Boivent comme des bêtes, dans l’espoir de se purger. Mais les fruits restent. Ils ont roulé en elles, se sont fait une place au chaud. Et maintenant la pulpe se dissout, pénètre tout leur corps. Les femmes ont le sang drogué. Elles ne savent plus ce qu’elles font. Le qaa assèche les yeux, et même celles qui veulent pleurer n’y arrivent plus. Les bouches sucent le fond de l’air, haletantes. Un groupe de trois creuse pour manger des racines, dépiaute les arbres de leurs jeunes écorces. On ne saurait pas dire si ce sont les plus lucides ou les plus folles. Les autres restent seules. Ont le sentiment d’être bien alors qu’elles se déshydratent lentement, à force de pisser sans boire. Elles ne sont plus étanches, suintent par en bas. Une se rappelle sa vie d’avant, ramasse un peu de mousse à se mettre entre les jambes, comme elle le faisait pour ses sangs. Les forces s’épuisent. Elles hallucinent, titubent dans la boue. Il y a des chants qui se libèrent, et des voix qui s’ajoutent aux premières, comme des corbeaux qui se répondent.
Il faut plusieurs jours pour mourir du qaa. Les Yeux-Rouges pensent qu’il ne fait pas souffrir. Ils pensent que le qaa est une porte vers l’autre pays, une porte que l’on franchit doucement. Il existe des récits d’Hommes qui sont revenus du fruit. Qui ont connu la folie, et qui ont été rappelés dans le monde des vivants. Ces récits se transmettent de chamane en chamane, et nourrissent les enfants autour du feu. Tous les récits sont différents. Et pourtant, tous parlent du sentiment de puissance. Du vertige intense des sens. La peau touche le monde comme si c’était la première fois. Comme si toutes les premières fois étaient concentrées en quelques jours. Chaque écorce est le corps du premier être aimé et les doigts tremblent de désir sur les reliefs du bois. Chaque feuille le soir, quand monte la rosée, devient le premier poisson attrapé, qui nous glisse entre les mains. Chaque branche qui craque nous rappelle le premier tambour qui nous a fait danser. Les Yeux-Rouges pensent que les humains et les animaux se rejoignent dans l’autre pays, et passent par la même porte. Alors les Hommes font l’expérience du monde à travers les yeux de l’aigle, le nez de l’ours, la peau du serpent. C’est comme ça qu’ils expliquent la puissance. Les récits ne se rappellent jamais des faits. Jamais des pensées. Seulement des émotions du corps.
Les unes après les autres, les femmes s’estompent. La pulpe rouge a raison d’elles. Certaines rampent encore, mâchent ce qui leur tombe sous le nez, parfois accélèrent leurs morts avec de nouveaux poisons. Les jambes ne tiennent plus. Les yeux ne voient plus. Les ventres sont maigres. Alors il y a cette vieille ruse du qaa, qui prend le contrôle dans les derniers instants : les femmes se recroquevillent dans un creux, à l’orée des forêts ou dans les clairières, là où la lumière donne. Et la mort va les endormir, comme une sucrerie. Car elles ne sentent plus le vent, et la terre leur donne l’illusion d’être à nouveau dans les bras de leurs mères. L’Esprit du qaa s’est substitué à l’Esprit des Hommes, et le qaa choisit le lieu où il veut prendre racine. Parce qu’une fois son hôte mort, il s’en nourrit durant ses jours fragiles. Ses jeunes jours de graine. Ses jours à devoir endurer le froid, le soleil ras, et les bêtes qui piétinent. Ses jours où les épinettes lui font de l’ombre et lui pompent l’eau et les sels de sa croissance. Les corps restent longtemps. Les loups savent qu’il ne faut pas les manger. Ils le sentent à l’odeur. Ils le voient à la couleur des joues : un hâle jaune qui se mêle au teint doré des Habitants. La chair n’est pas assez toxique pour tuer à son tour, mais elle est indigeste. Le qaa crache dans la soupe, pour que personne n’y touche. Alors il profite des quelques jours de chaleur des morts pour faire une pousse. Cherche dans les chairs de quoi se nourrir et monter, pour enfin percer la peau quelques mois plus tard, quand le printemps est revenu. La fonte des neiges, l’année suivante, exhume des cadavres noirs, gelés et dégelés. Pétrifiés par les saisons et la drogue. Enfin, ils disparaissent avec le temps, quand l’arbuste devient arbre. Quand les corps et les racines se fondent en un même bois.
4.
L’aigle tourne trois fois et repart. Il veut me dire quelque chose, mais je suis avec les hommes, les mains dans la résine qui calfate les canots. Alors je laisse les miens, et ils m’excusent d’écouter les voix de la taïga. Je prends mon bâton et m’enfonce dans la forêt. Là où le vent souffle, je marche. Là où le soleil tache le sol de lumière, je marche. Les Esprits ne dessinent jamais deux fois la même route. N’amènent jamais au même arbre. Et, de retour, je fais parler les feuilles, les cailloux, les aiguilles que j’ai ramassés sur mon chemin. Je les étale devant moi. Je plonge mon index dans une eau de racines, et je jette quatre gouttes en losange, pour faire boire Terre-Mère. Dans l’humide et le sec, il y a un message. Il parle de l’Île-Esprit et du féminin. Il parle de la force de vie. Je dois retourner à l’Œil-Lac. Un chamane qui n’écoute pas les signes est un chamane abandonné. Une proie pour les Mauvais Esprits qui dévorent les âmes. Qui nous arrachent à nous-mêmes. L’aigle m’appelle. Je dois lui répondre.
Le lendemain, je prends la route. Je voyage creux. Le ventre creux, les pieds creux, la tête creuse. L’homme plein roule sur le monde sans voir qu’il écrase les bêtes et les plantes, quand l’homme creux récolte le soleil comme la sève de l’érable, goutte à goutte, et laisse le froid de la nuit s’infiltrer en lui comme un ami. J’ai mes peaux de serpents et mes poupées de bois. J’ai mes plumes de corbeau et mes colliers de dents d’ours. Mais je n’ai pas de viande sèche, ni de haricots, ni d’eau. Et je n’ai pas de pensées pour m’alourdir. Il n’y a qu’ainsi qu’on rencontre l’invisible.
L’Œil-Lac m’accueille avec passion. Avec nuages noirs et trouées lumineuses. Je salue sa puissance. Les canots sont là où les guerriers les ont laissés. Je pagaie jusqu’à l’île. Nous avons sacrifié il y a plusieurs semaines déjà. Mon tambour a aimé cela. Il avait la peau tendue par l’air vif des sommets. Il a sonné au-delà du grand cercle du monde, jusqu’à l’autre pays. Il a invité les femmes à prendre le chemin des âmes. J’ai frappé, et j’ai chanté. Nos guerriers ont été pénétrés par l’énergie des Esprits. J’avais les paumes rouges. Mais quand l’avant-dernière femme est passée, mon tambour s’est percé. Juste une fissure, près de son cadre de bois. Suffisante pour altérer son chant. Pour lui donner un timbre féminin de ventre profond. Il y a eu un temps d’hésitation. Puis le Chef a voulu continuer. Petite fissure, petit présage, il a dit. Nous nous sommes rangés à son avis. J’ai joué encore pour libérer les deux dernières Longues-Tresses de leurs vies. La forêt a pu entendre mon tambour au chant éraillé. Et l’aigle est venu jusqu’à moi, me reprocher de ne pas écouter les signes.
Près de l’île, les énergies sont mauvaises. Froides comme des courants de fond. Il y a des morts qui ne sont pas morts, ici. Des Esprits qui n’ont pas franchi la porte. J’accoste par la poupe, pour ne pas froisser les rives. Le printemps est passé. Les fleurs sont retombées, et l’hiver se prépare déjà dans les branches. Je remonte au sommet de la montagne. Les présages laissent toujours des traces. Je retrouve les lichens usés par les pieds des guerriers. Et, sur la dalle de pierre, une fiente d’oiseau. Noire et sèche. Je me mets à genoux pour l’ouvrir. Dedans, il y a un fruit de qaa. Presque intact. À peine attaqué par les sucs du petit estomac. Je ne suis pas surpris. Certains oiseaux savent lutter contre le fruit. Savent le manger sans qu’il s’installe en eux. Les boissons pour revenir du qaa contiennent du sang d’oiseau, parfois des plumes. Mais la fiente est là où nous avons sacrifié. Il n’y a pas de hasard dans la taïga. Tout est sauvage, tout est Esprit. Alors je demande à l’île si je peux dormir sur place, et elle m’accepte car elle m’a invité. Après quelques heures en tailleur, à écouter les voix des vents, je m’allonge à même la dalle, les yeux dans le ciel noir. L’étoile se fait voir entre les nuages. Il y a les bruits des bêtes qui suivent les sentes entre les arbres. L’eau qui lèche son lit de pierre. Mais j’entends surtout le silence des cadavres, et je crains demain.
Il y a vingt femmes à trouver. Je me lève avec le soleil, et je passe ma journée à sillonner l’île. Je retrouve un à un les corps raides, aux doigts bleus. L’arbuste de qaa perce déjà la peau de certains. Les yeux fermés, je remercie les corps de s’être offerts. La plupart des âmes sont parties rejoindre leurs ancêtres, et je suis heureux pour elles. Mais sur la rive du levant, la forêt n’est pas tranquille. Elle souffle une haleine chargée. Je ne suis pas le bienvenu. Les épinettes se serrent les unes contre les autres, me dessinent des couloirs étroits et des ombres coupantes. Mon ventre est serré. Dans ma main, j’égrène mon collier de dents d’ours pour invoquer son courage. L’aigle veut que je dépasse ma peur. Alors je descends jusqu’à l’eau, et je me sépare de mes habits, de ces peaux devenues peaux d’Homme à force de s’imprégner de mon odeur. Et, pas à pas, je rentre nu dans l’Œil-Lac. L’eau me lave de mon impureté, et de mes Mauvais Esprits collés sur mes lèvres, mes oreilles, mon sexe, mon anus. Ils campent sur nos orifices pour nous pénétrer quand nous sommes faibles. Je m’assois sur le fond de galets, et j’attends que le froid me saisisse. Puis, doucement, je remonte sur l’Île-Esprit, pour entrer dans la forêt épaisse.
La résine suinte sur les troncs. Les branches basses meurent de ne plus recevoir de soleil. Les mousses rampent vers les trouées, vers les troncs abattus par la foudre et le vent. Souvent je crois voir un ours dans une souche, et mon cœur s’emballe. L’aigle me teste. Je lutte pour être à la hauteur. Je remonte vers l’âme qui gonfle de ne pas vouloir crever. Qui tourne en rond, et empoisonne l’air de sa colère. Je trouve le cadavre dans un creux de lumière. C’est celui de la femme au tambour. Je reconnais son visage, même blême, même baigné dans la boue. C’est la femme pour laquelle ma peau de caribou a changé sa voix. C’est la femme qui ne veut pas franchir la porte. Ses ongles sont noirs de terre. Elle a fouillé le sol profond. Son corps est encore modelé par l’angoisse, quand les autres ont retrouvé le calme dans la mort. Alors je vois ce que j’aurais dû voir quand le présage s’est manifesté. Je vois ses formes rondes. Ses seins qui tirent ses vêtements. Ses hanches. Cette femme était une femme pleine. Tout en mourant, elle continuait à grossir. Une âme qui erre est un animal acculé. Qui n’attend rien de ce monde ni du suivant. Qui se nourrit de peur et de haine. Elle n’aime pas que je sois là. Elle me tourne autour, me glisse sur la peau. Je ferme les yeux pour lui parler. Mais il n’y a pas de pardon pour les Yeux-Rouges. Pas plus que nous pardonnons aux Longues-Tresses d’être Longues-Tresses. Je m’approche et je pose ma main sur son front. Raidi par le froid. Crevassé par les pluies et le vent. Puis je veux mettre ma main sur son nombril, mais j’ai un mouvement de recul au moment de poser mes doigts. Un mouvement de fascination et d’effroi.
Le ventre n’est pas mort. Il est encore chaud. Le bébé est vivant. Il lutte contre la faim. Il est faible. Mais il est vivant. Il retient sa respiration en attendant un miracle. Refuse d’être empoisonné par le sang de sa mère. Avec ses pieds, il pèse sur les parois comme on défend une palissade. La plante fait son nid, et il ne partage pas le sien. L’île a entendu son désir de vie et a murmuré à l’aigle de venir me chercher. Parce qu’il n’y a plus de Longues-Tresses pour sauver cet enfant, seulement des Yeux-Rouges dans cette partie de forêt. Mon cœur tremble. Je fais demi-tour. Les dents d’ours sautent sur mon torse quand j’enjambe les troncs et les mares de boue. Je récupère mon couteau dans mon tas de vêtements et je retourne à la femme, sans prendre le temps de me rhabiller. L’âme s’affole quand elle voit ma lame. Elle protège son bébé comme une louve. La paume bien à plat, je l’écarte de mon chemin et me mets à genoux. Je pense aux saumons dont on tire le caviar. Il faut aller vite pour ne pas faire souffrir. J’inspire. Et j’incise le ventre d’un geste vif.
Je dépose le bébé dans ma toque de fourrure, et le tiens au chaud. C’est une fille. Alors l’âme s’apaise de me voir tendre. Et comprend enfin que j’aide ceux qui veulent vivre. Et ceux qui doivent mourir.
5.
J’ai allumé le feu du conseil. J’ai réuni les grandes familles pour présenter le bébé. Pour l’instant, elle dort blottie contre mes côtes. Elle s’enivre de chaleur et cuve son lait. Une femme m’en a offert sans poser de question, heureuse que ses seins nourrissent plus que ses propres enfants. Les flammes font craquer le bois, roussissent les visages dans la nuit sans lune. Je danse mon récit en silence. Personne n’a le droit de frapper le tambour sacré, alors je pense mon tambour dans ma tête. Je mime l’aigle qui survole le camp. Les cailloux qui parlent au contact de l’eau. Les nuages au-dessus de l’Île-Esprit. Le fruit rouge dans la fiente. La forêt qui abrite l’âme malheureuse. Enfin j’ouvre les peaux qui recouvrent mon ventre et je montre l’enfant. L’enfant déesse. L’enfant qui ne voulait pas mourir avant d’avoir vu le monde. L’enfant qui tient tête au qaa. Je la montre bien haut. Je fais le tour du feu pour que chacun puisse la voir. Alors je m’adresse aux Yeux-Rouges, et je leur dis :
— Sages des clans de la truite, du renard et du castor : voici Fille-Rousse, l’enfant de la prédiction. Celle dont parlent nos ancêtres depuis la création du grand cercle du monde. Celle qui est plus dure que le bois. Plus brûlante que la braise. Plus souple que le serpent. Plus adroite que l’ours. Celle qui doit nous montrer le chemin. Mes parents l’ont guettée, et mes grands-parents avant eux. Elle s’est fait attendre. Mais cela se comprend, car nous étions sur le chemin. Et maintenant que les Barbes piétinent nos territoires de chasse, nous sommes divisés. Les Yeux-Rouges des toundras et les Yeux-Rouges des terres intérieures n’arrivent plus à s’écouter. Les camps des uns ne sont plus les camps des autres. Nous hésitons sur la marche à suivre. Voilà pourquoi l’enfant est là. Pour nous donner la direction. C’est une enfant Longues-Tresses. Mais c’est une enfant de la terre. Car rappelez-vous que nous sommes tous du même sang, nous qui avons la peau de résine. Elle est née pour vivre avec nous, et je vous demande de lui faire une place dans vos foyers et dans vos cœurs.
Après moi le silence. Le grand silence des grandes décisions. Les regards sont concentrés sur le feu et l’enfant. Enfin, le Chef se lève pour prendre la parole :
— Chamane, nous avons confiance en toi. Tu as souvent prouvé tes talents. Tu as chassé l’Esprit qui avait trouvé demeure dans ma femme. Tu as vu la victoire contre les Longues-Tresses et le plaisir de l’île qui a reçu nos sacrifices. Mais tu nous dis aujourd’hui que tu as dans les bras l’enfant de la prédiction. Tout le monde connaît Fille-Rousse. Son récit est dans tous les berceaux, pour endormir les bébés. Elle donne le courage à ceux qui passent à l’âge adulte. Elle aiguise nos lames de guerre et les pointes de nos flèches. Elle est même chez les Longues-Tresses, et chez celles et ceux qui ne sont pas nés au-delà du grand lac salé. Alors, je te demande, Chamane : pourquoi serions-nous, nous, élus pour accueillir cette enfant ? Et pourquoi ne serait-elle pas née du ventre d’une de nos femmes, si le gardien de l’île veut nous la confier ?
Face au Chef, je prends mon temps pour installer la toque de fourrure juste devant ses pieds. Dedans, je dépose l’enfant. Même dans la nuit, je peux voir ses petites lèvres téter l’air, et s’étonner de son goût de fumée.
— Je ne connais pas les raisons des Esprits, je réponds. Mais les Esprits m’ont parlé. Et je les ai écoutés. Je suis celui qui met Fille-Rousse dans les berceaux. J’ai raconté Fille-Rousse à tous les Habitants, alors qu’ils n’avaient pas encore reçu leur nom. Je sais reconnaître Fille-Rousse quand je l’ai dans les bras. Fille-Rousse est née dans la terre, et j’ai trouvé cette enfant dans la terre. Rappelez-vous les légendes de Fille-Rousse. Elle est parfois femme et parfois arbre. Et cette enfant est née d’une mère humaine et d’un père plante. Elle a le grand sang. Regardez-la dans les yeux. Regardez ses mains. Regardez ses cheveux noirs. Regardez sa peau. Regardez-la et vous saurez.
Après ça, il y a de longues discussions. Les Yeux-Rouges sont rapides pour tuer un ennemi. Beaucoup plus lents pour faire entrer une nouvelle personne dans la tribu. Seuls les mariages et les prises de guerre mélangent le sang dans les tentes. Autour de moi, les visages sont durs, cuits par la chaleur du feu. Les bras sont croisés. Finalement, c’est l’aîné du clan du renard qui trouve les mots pour faire pencher le débat. C’est un jeune brave. Mais il parle comme s’il avait déjà vécu plusieurs vies. Et, quand je le vois se mettre debout, je sais déjà qu’il va être de mon côté :
— Si je me rappelle bien, dit-il, les récits disent qu’avant d’être Fille-Rousse, Fille-Rousse est comme les autres bébés. Ce sont les saisons qui la baptisent. Ce sont les animaux qui viennent la voir et lui parler. C’est son corps qui affole les hommes quand elle se laisse caresser. C’est sa fougue qui entraîne les tribus sur un chemin plutôt qu’un autre. Laissons-la vivre avec nous. Si elle est Fille-Rousse, Fille-Rousse se manifestera. Si elle n’est pas Fille-Rousse, elle sera un enfant parmi les autres.
Voilà. La nuit a adopté l’enfant. Car cette parole est reconnue comme sage, par les sages comme par les simples. Et les discussions ont beau continuer, la majorité a choisi. L’enfant n’aura le nom de Fille-Rousse que dans la bouche de ceux qui voient Fille-Rousse en elle. Pour l’instant, seulement dans ma bouche. Je suis le seul à avoir assisté à ses exploits. À avoir senti sa force de vie. Pour les autres, elle n’est qu’une enfant sauvage. Mais je sais qu’un jour ils la reconnaîtront. Le reste de la soirée sert à décider qui va s’en occuper. Les uns pensent qu’elle doit être livrée à elle-même. Que c’est le seul moyen de savoir si elle est ce qu’on dit. Mais les récits disent que Fille-Rousse meurt aussi. Et que Fille-Rousse aime la chaleur des tentes. On ne la fait pas dormir avec les chiens si on croit en elle. Alors l’enfant reçoit une mère. Les sages ont décidé. Une mère qui n’a pas pu avoir d’enfant. Elle porte le nom de Roseau-Fendu.
II
6.
Une famille n’a pas survécu à l’hiver. Alors que tous les canots sont revenus de leurs réserves à castors, que les Yeux-Rouges ont chacun descendu leur rivière pour redevenir tribu, il manque encore quatre Habitants. Un homme, une femme et leurs deux enfants. Nous attendons une semaine. Mais le ciel ne s’émeut pas des morts. Et il faut continuer. Il faut remercier l’été avant que l’été nous passe sous le nez. Le soleil ne brille pas pour nous voir pleurer nos disparus. Aucun chagrin ne peut annuler la fête du saumon. On l’appelle comme ça à cause des eaux poissonneuses. À cause des ours qui guettent depuis les passes pour nourrir leurs petits. D’habitude, c’est ma fête préférée. Parce que c’est le début des beaux jours. Parce qu’on retrouve les autres. Mais cette année, j’ai l’impression que l’hiver a été plus long. Je vois ça sur les visages des garçons. Ça ne m’avait pas marquée les années précédentes. Cette année, je les trouve transformés. Les plus jeunes comme les plus grands. Comme si les saisons n’avaient jamais trouvé à se faufiler dans ma tête. Et soudain y étaient entrées, sans que je sache comment. J’ai un pincement au cœur quand Orage-Blanc me salue, après avoir déposé les peaux qu’il portait sur l’épaule. D’abord, je ne comprends pas pourquoi. Je n’ai pas le recul pour interpréter ce genre de sentiment. Je remarque les voix d’enfants qui sont devenues des voix d’hommes. Il y a des filles qui ont la poitrine arrondie. Mes amis ont grandi. Je crois être la seule à être restée comme avant, la même petite fille, mais on me dit que non. On me dit que mon corps s’est allongé, et que mes yeux sont des amandes. Alors je suis heureuse de voir que je n’ai pas été oubliée, et je passe à autre chose. Je m’enfonce de nouveau dans la touffeur de l’enfance.
Ce n’est que bien plus tard que j’y repenserai, me disant que, peut-être, ce sentiment d’angoisse était le premier pas d’un long voyage vers l’âge adulte. Aujourd’hui je suis comme le jeune renard qui saute sur ses frères. Qui mordille les oreilles. J’ai le dos rond de joie. La fête est dans deux jours. J’aime traîner dans les pattes des femmes qui préparent la viande. J’aime regarder les pigments qu’on écrase dans les bols jusqu’à ce qu’ils soient gras, qu’ils s’étalent sur les visages. Suivre les pinceaux qui ravivent les couleurs. J’aime cette excitation des mains qui caressent le bois. Les masques qui s’ébauchent dans un morceau de tronc, laissant derrière eux des nids de copeaux. Les adultes s’agitent et, pendant ce temps, les enfants s’ébrouent. Les beaux jours sont une plaine de jeux. La fête nous embrase. Avec les garçons, on grimpe aux arbres. On fait un barouf d’ours en se faufilant entre les branches, on monte le plus haut possible et les cimes se tordent sous notre poids. Les grands nous voient depuis le village. Ils disent que la forêt rit. Il y a un arbre qu’on aime plus que les autres. C’est un bouleau. Peut-être le dernier des terres froides. Après, il n’y a plus que des aiguilles. Lui, il a fait sa place, et il a grandi au-dessus de tout le monde. Alors on l’aime d’être différent. On aime son teint blanc de galet. Ses branches basses qui se laissent épouser par nos mains, son feuillage clair et rond comme les premières neiges, son écorce lisse, qui ne durcit pas la peau des doigts. Il m’a manqué pendant l’hiver. La première chose que j’ai faite en arrivant, c’est de retourner le voir. J’ai grimpé, me suis assise sur toutes les fourches, pour être sûre que mes fesses se souviennent des sensations. Puis, pour redescendre, je me suis balancée depuis la dernière branche, et me suis laissée penduler quelques secondes, les pieds dans le vide. Je fais toujours ça. Pour le frisson quand je me jette. Et pour le deuxième frisson quand la branche me rappelle en arrière. Alors je comprends que je pèse, malgré ma jeunesse. Pas autant que ma mère et son derrière d’orignal. Pas autant que les guerriers taillés comme des rochers. Mais assez pour que mon ventre se serre quand je prends de la vitesse. Assez pour imaginer la force du choc si je tombe sur le dos. Alors je me dis que mon corps est mon propre jeu, et qu’il ne cesse de grandir. Je suis heureuse, parce que je n’aurai besoin de personne pour m’amuser, s’il n’y a plus personne un jour.
Depuis le printemps dernier, on joue aux guerres tribales. Au début, il y avait ceux qui jouaient les Yeux-Rouges, et ceux qui jouaient les Longues-Tresses. Mais on s’arrangeait toujours pour faire perdre les Longues-Tresses et, à force, on s’est lassés. Alors on a inventé de nouvelles tribus, et le combat est plus équilibré. Il y a la tribu de la Neige, et la tribu des Grandes Chaleurs. Chacun a son camp. La tribu de la Neige s’est fait une grotte de bois et de feuilles. Celle des Grandes Chaleurs vit dans le bouleau. On s’attaque à coups de pommes de pin. On essaye de se surprendre. J’essaye de ne pas penser, ne rien penser, pour oublier qu’on est en guerre, pour rendre le jeu plus vrai. Mais je n’y arrive pas beaucoup, parce que je n’ai qu’une envie : balancer ce que j’ai dans la main sur un ennemi. En pleine tête, si possible. C’est ce qui donne le plus de points. Quand quelqu’un est touché, on le soigne dans la tente tremblante. C’est moi qui ai inventé ça, au printemps dernier. On l’a fabriquée avec des morceaux d’écorce trouvés par terre. Elle n’est pas assez grande, alors le blessé a les pieds qui dépassent. Le problème, c’est que personne ne voulait faire le chamane. Les garçons disaient qu’on peut jouer aux guerriers, mais que le chamane c’est autre chose. On ne peut pas faire semblant d’avoir ses pouvoirs. Du coup, la tente tremblante ne tremblait pas beaucoup. Et les blessés n’étaient pas beaucoup soignés. Je trouvais ça nul. J’ai décidé de prendre le risque. J’ai joué la chamane. J’ai tapé sur un tronc creux pour le tambour. J’ai fait vibrer l’écorce pour chasser les Esprits. D’abord je n’ai pas eu peur. J’étais fière de faire quelque chose que les garçons ne voulaient pas faire. Quelque chose d’interdit. Je me sentais forte, et je riais de les voir mal à l’aise. Mais la peur des autres a fini par entrer en moi. Après, quand je croisais le Chamane dans le camp, je trouvais qu’il avait un regard étrange. Il me souriait comme s’il savait. Pendant plusieurs nuits, j’ai eu peur d’avoir attiré de mauvaises choses et je me réveillais souvent pour surveiller autour de moi. Mais les ombres ne bougeaient pas. Seules les braises au centre de la tente haletaient doucement, et la fumée maigre s’élevait vers l’ouverture. Le calme des étoiles finissait par me rendormir.





























