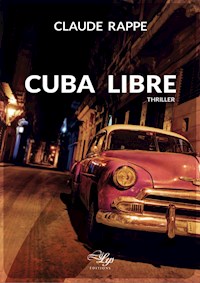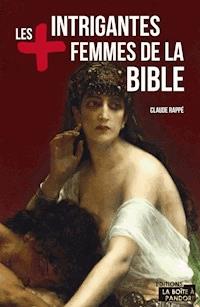Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LiLys Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L’amour n’est pas toujours à l’heure. Trop tôt, trop tard ? Une écolière va transformer un adolescent déshumanisé en un être sensible, capable de croire en lui. Un premier amour, des sentiments forts. Une éducation dogmatique puis la fatalité ! Un hommage, une vérité : la leur.
Ce pourrait être la vôtre... L’amour, plus fort que la mort. Tout est vrai ou presque... et même pire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Claude Rappe a été journaliste et producteur à la télévision (RTL) pendant vingt ans. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres historiques, thrillers, romans, essais et biographies, certains traduits en plusieurs langues. En livrant, dans ce roman autobiogaphique une partie importante de sa vie, Claude dévoile une facette fragile et inattendue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Le temps transperce en sa fleur la jeunesse Et creuse ses sillons au front de la beauté Se repaît ici-bas de rares vérités Rien ne peut résister à sa faux traîtresse Mais aux âges futurs mes écrits subsisteront
À Monique Bouffioux,
INSPIRÉ D’UNE HISTOIRE VRAIE
L’inoubliable chemin
Je ne suis plus venu à Chastre depuis des années.
Mais je mens déjà. Car, à chaque fois que mon chemin passe par la province belge du Brabant wallon, une prégnance de bonheur enfoui se manifeste. Je glisse alors vers Gembloux, petite ville wallonne tournée vers sa Faculté agronomique réputée et déambule dans un labyrinthe de rues connues, comme si, rétif à l’éveil, je souhaitais prolonger le rêve. Mes images restent floues, mais ressemblent au passé, régulant l’incontinence de mon imagination. J’erre comme un chien sans collier. Je vais revoir les lieux et l’école de mon enfance ; j’arrête la voiture derrière le mur de briques rouges et grimpe sur l’appui d’une fenêtre pour espionner une classe vide. Ça sent le bois vernis, l’odeur du parquet ciré, les dallages lavés au savon noir, l’éponge humide, la cellulose de vieux bouquins, le papier neuf et les encriers desséchés. Au bout de quelques secondes, ma mémoire perçoit le tumulte d’élèves excités par le tintamarre d’une récréation chahutée. La voix de l’instituteur impose un court silence. La meute, les mains sur le banc, se soumet à cet instant d’autorité indispensable à la reprise des cours.
Nous avions des « maîtres » en ces années soixante.
Malgré une incoercible rébellion qui gagnait les jeunes esprits de ces années d’or, nous les respections.
Ma mémoire furtive tente de retenir ce moment d’évasion construit d’amalgame de souvenirs : les cahiers Atoma, les fragrances d’amande des colles à papier, les livres scolaires usagés, le dernier Bob Morane au fond du cartable, le cris-sement de la craie sur un tableau aux traces laiteuses. Ces échanges de quolibets soufflés pour que l’instituteur les entende, flirtant avec la tentation d’être surpris et le souhait d’échapper à sa vigilance. L’enfance… Elle n’est déjà plus petite et moins encore grande pour la dire adolescente. Une préadolescence tellement naïve, bien avant nos désirs charnels qui devaient éclore après l’âge des câlins maternels que personnellement j’ai peu connus.
Nous étions mûrs pour grandir, mais pas assez pour délaisser nos jeux. Nous apprenions en classes primaires. Elles se déclinaient vers le haut des chiffres. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième.
Quelques noms surnagent encore avant de sombrer dans l’oubli : Monsieur Letellier, Monsieur Lardinois, Madame Poncin, Monsieur Latour. Nos maîtres à penser…
Ils étaient les piliers d’une culture qui nous fascinait peu, tant les postes de télévision en noir et blanc nous plongeaient dans d’autres passions avec « Thierry la Fronde », « Le Saint », « Chapeau Melon et Bottes de Cuir », puis aussi grâce à ces livres de poche écornés côtoyant les magazines comme « Salut les Copains », « Le Journal de Mickey », les bandes dessinées, « Bob et Bobette », « Bessy » et « Tintin »…
On n’apprend rien si on n’entend pas le murmure des générations. Grâce à quelques-uns de ces hommes dont les noms ne seront pas gravés sur d’orgueilleux mausolées, nous partagions nos jeunes années avant de nous engager, plus tard, sur les voies faussement libératrices des enseignements que nous avions eu la capacité d’assimiler.
J’avais l’âge naïf, l’intelligence instinctive, la culture en appétit, un cœur à l’étale affamé de liberté et paradoxalement repu de confort. La laisse qu’allongeaient mes parents au fur et à mesure que je grandissais me semblait toujours trop courte. L’herbe sentait bon dans le pâturage voisin. Le vent des envies portait plus qu’il ne freinait. Les arbres étaient mes amis, mes refuges, mes tours de Babel. Les barbelés et clôtures des frontières à franchir, des appels à l’école buissonnière, les domaines interdits d’horizons désirables. L’humus du sol champêtre de cette province agricole gembloutoise embaumait nos sorties de classe comme nos rendez-vous secrets. Il s’agissait de partager, à trois ou quatre gamins qui ne rentraient pas tout droit à la maison, une cigarette à la menthe, un fond de whisky camouflé dans une fiole vidée d’eau de Cologne ou une photo froissée déchirée au mensuel pour adultes Lui, acheté par un grand frère, dérobée par un cadet. On aimait se faire peur, un peu comme les chats qui courent après leur queue et s’en effrayent. Il ne fallait être ni riche ni pauvre. Il s’imposait de nous fondre dans la famille d’enfants d’après-guerre, même si nous ne savions plus s’il s’agissait de celle des Boches que racontaient nos pères ou celle du Vietnam que chantaient nos idoles.
Des années plus tard je me suis arrêté devant cette école avec mes enfants, une compagne, des amis. Je m’y sentais plus seul encore. Car on ne partage pas ainsi ses souvenirs. Mieux vaut les réécrire truffés de mensonges auxquels on se plaît à croire, vidés de vérités inavouées.
Un peu moins seul, un rien drogué de mélancolie, j’ai quitté l’Athénée royal de Gembloux, heureux d’y avoir ramené toutes ces âmes errantes d’un monde courtisé par ma légende. Remontant la rue Albert, j’ai ralenti devant la maison de cette enfance, puis j’ai tourné la tête pour entrevoir la vieille bique en tablier noir soulevant les rideaux d’une minuscule fenêtre, dégageant la mèche rebelle de cheveux sombres coupés au carré, épiant mes bêtises. Il s’agissait d’uriner sur le mur du voisin. Il m’en est resté l’envie que dorénavant je réprime par excès de maturité et rébellion prostatique. J’ai tourné vers la droite, me suis faufilé dans l’étroite servitude bardée de haies joufflues pour aller contempler les derniers arbres fruitiers du verger d’antan. Mon jardin d’enfance, aujourd’hui élagué. Tout change. Depuis longtemps, les plus belles images de ma vie sont réduites à des instantanés que je n’arrive pas à oublier. La petite porte de fer, celle qui claquait sous l’effet du vent du Nord, a été soudée. Elle est figée dans la rouille. Remontant avec amertume dans l’automobile, j’ai filé vers Grand-Manil et j’ai rejoué le même scénario devant le chalet de la rue Lucien Petit. Ça, je l’ai fait cent fois, m’obstinant à imaginer les bus scolaires d’après quatre heures, scrutant derrière les vitres embuées le regard inquiet de celle qui a été mon premier amour.
Il n’est aucune émotion qui se disqualifie avec le temps.
Orgeo
S’il faut que je me souvienne, ce sera des odeurs. Celles, brassées d’humus, nourries de moiteur des mousses, de flagrance de lierres acides, d’eau ferrugineuse et d’ardoise écrasée. Celles d’une terre tourbeuse hachée de pierrailles, de silex et d’aiguilles de pin macérées dans leur sève résineuse. Celles de la truite écaillée, de l’urine du furet, de la bave de l’escargot, de l’ortie azotée et des effluves de pâturages sans clôture visible où se perdaient une vache et deux moutons. Les haleines alliacées d’herbes trop hautes et des massifs de feuillus. Toutes ces senteurs métissées s’assemblaient ou divorçaient sur l’étroit sentier pentu qui grimpait vers la porte extérieure d’un grenier aménagé. L’humeur de ce tablier à fleurs bleues trop bien repassé, exhumant les souffrances d’un fer brûlant à l’acier sulfuré de volutes fumigatoires de la cuisinière à bois. Et ce petit rien de savon noir exhaussé par une touche d’essence de violette sur le col de la robe anthracite, seule coquetterie de ma grand-mère maternelle.
Jeanne avait de la fée, derrière de profondes rides de dame au regard qu’il fallait mériter, à la peau attendrie par les ans et les ardeurs à maintenir la vie en triomphe légitime.
Jeanne était Bonne Maman les jours de présence de mes parents et Bobonne devant les triplées de cousins et cousines bien plus habitués à l’aimer que moi, vu qu’ils habitaient la maison d’à côté. Je la rejoignais pour les grandes vacances, à Pâques et à Noël.
Jeanne a été mon tout premier amour. Elle est bien plus qu’une photo en noir et blanc posée depuis un demi-siècle sur ma bibliothèque. Elle est mon lien avec le Ciel, avec ma consanguinité. Elle me dépollue des éducations, m’astreint à des émois indicibles, m’aide à survivre, m’oblige à me taire, moi qui ai sept langues de trop.
Je l’ai perdue tôt. Je n’avais pas douze ans. Elle est morte sans bruit, telle une star qui disparaît, en tombant, comme une athlète qui n’a rien vu venir. Elle a laissé une lettre, un fût de café vert non torréfié d’avant la guerre, un tabouret, un coffre, un lit, une table et quelques casseroles bosselées. J’ai vu pour la première fois ce qu’était la douleur dans les yeux de ses enfants, petits-enfants, amis, voisins. Même les merles imbéciles groupés sur les fils électriques avaient un instant tu leurs moqueries. Nous perdions l’amour et tout ce qui le lie : la force, le courage, la volonté, une autorité qui n’auraient pas laissé le moindre courant d’air méchant se glisser dans les liens sacrés de sa famille. Des mots ont été, je crois m’en souvenir, bien dits. Le silence ne faisait pas moins mal. Nous l’avions tous dans notre cœur : enfants, petits-enfants. Une grand-mère, comme elle ne vous a pas porté, se doit de porter votre âme. La Vierre, cette vivace rivière de mon enfance où à chaque crépuscule se donnait en spectacle un ballet de libellules que d’obsessionnelles costumières voilaient de bleu, se languissait sous sa verte chevelure d’algues mouchetées de fleurs blanches. Elle s’est polluée en quelques années et il a fallu bien des résolutions politiques pour lui rendre sa transparence et quelques truites que je pêchais à la fourchette comme me l’avait appris mon oncle Roger ! Même cela reste romantique, ainsi que le son rythmé du linge battu par une spatule de bois sur la pierre bleue qui servait de plage à nos jeux de glisse et de lave-linge à Jeanne. Elle préférait la rivière au lavoir où bavaient quelques grenouilles de bénitier qu’elle côtoyait trop obligatoirement à chaque messe matinale et vêpres.
Après la prière du soir, à l’heure où les faucheux rentraient dans les maisons, attirés par l’unique ampoule peinte de crottes de mouche, tintait la voix de Tante Madeleine, posant négligemment contre le mur un vélo qu’il ne fallait pas toucher au risque d’en prendre une. Puis, autour d’un café, mère et fille se racontaient la vie au village.
Bobonne ne se plaignait jamais. Même pas de la fournée de pains que le boulanger Lebichot lui demandait de sortir du four dès cinq heures du matin. La boulangerie était en face. Ça sentait bon le pain chaud. Tante Madeleine s’irritait des excès de quelque buveur de bière espérant la main cagneuse qui allait se poser sur elle. Les hommes n’avaient pas grand-chose d’autre que l’alcool. Il fallait bien fermer les yeux.
Et de repartir en sautant sur sa bicyclette.
Bobonne jetait une dernière bûche dans le feu, pour la nuit. Elle allait vider dans le fond du jardin puis rincer d’eau l’unique vase à couvercle trônant dans le grenier. Elle vérifiait qu’il reste quelques papiers souvent issus d’emballage d’oranges de Jaffa. Et se lavait les mains avec une boule de savon dans un bassin en alu.
Le rituel du repas était toujours le même. La soupe ne se lassait pas de mijoter sur le coin de la cuisinière. Un couteau large, un pain rond, le beurre sur une assiette, le jambon d’Ardenne ou le salami gaumais habillés d’un tissu Vichy, le pot de miel, celui de saindoux, deux grands bols, l’eau bouillie qui requinquerait une chaussette à café préparée depuis l’aube, mais qui allait se laisser maquiller par une pincée de chicorée. Ce n’était pas le luxe.
Un soupir…
Son regard posé sur moi…
Un sourire…
J’attendais qu’elle me raconte, pour la centième fois, l’histoire de Godefroid de Bouillon.
— Mangez d’abord ! La croisade attendra.
— Bon appétit, Bonne Maman…
Elle n’espérait pas que sa prière et le signe de croix sur le pain me questionnent et disait :
— Ce soir, vous dormirez avec moi.
Saisissant le pain, elle le tranchait en ramenant la lame vers elle, ajoutant :
— Celui qui ne sait pas couper le pain ne sait pas le gagner !
Une phrase qui lui permettait de citer mon grand-père, un tailleur d’ardoise qui avait travaillé à Herbeumont, dans ce qui est aujourd’hui un musée dédié à cette richesse ardennaise et aux mineurs. Je ne l’ai pas connu. Il est mort avant ma naissance, victime du tétanos.
J’avais hâte de rejoindre la petite chambre. Il y avait deux lits, mais je ne saurai jamais pourquoi, certains soirs, elle m’invitait dans le sien. On s’y enfonçait dans des matelas et couettes en plumes. Il n’y avait pas de couverture Sole Mio comme dans les villes, mais des édredons gonflés de plumes. Ils se creusaient comme un soufflé au fromage au moindre contact. Je m’endormais souvent le dernier, son bras autour de mon cou, épiant un léger ronflement qui m’autorisait à mon tour à rejoindre le monde des rêves. À l’aube, son lever me laissait orphelin, le temps pour elle d’aller défourner les pains, de suivre la messe du matin à l’autre bout du village et de rendre visite à Tante Marie et ses enfants, avant de revenir dresser la table pour mon petit déjeuner. Puis elle repartait chez sa fille où elle passerait le reste de la journée pour l’aider à gérer sa famille nombreuse. Un bol de lait et une tartine m’attendaient sur la table. Je faisais un sort au pot de miel et à la moindre mouche qui me l’aurait volé. Elle aurait dit à Tante Ghislaine, une autre de mes tantes, que, le jour où elle ne serait plus, elle souhaitait qu’on me donne en héritage un album de bande dessinée qui avait été le premier ouvrage de Sirius sur Godefroid de Bouillon édité chez Dupuis.
— Je ne sais pas pourquoi je le lui donne plutôt qu’aux autres.
Les jours de pluie, elle m’avait appris à lire dans les phylactères. Seize ans plus tard, en 1980, alors que je créais ma première pièce de théâtre dans le Château de Bouillon, Sirius m’a signé l’album. Il deviendra et restera mon ami jusqu’à sa mort.
Et Godefroid de Bouillon ne m’a jamais quitté.
La Plante
Je suis né dans une maison bâtie par mon grand-père paternel. Elle se situe en Belgique, à Namur, aujourd’hui capitale politique de la Région wallonne. La façade est en front de la chaussée de Dinant, pas loin de l’écluse de La Plante et en face d’une île au milieu de la Meuse qui avait encore vocation, avant une occupation militaire, d’être un potager. Aujourd’hui elle est en friche. Son nom est révélateur : « Vas’ti frotte »… Derrière notre maison s’élevait un bâtiment ressemblant à un monastère sur une colline où s’étend la majestueuse citadelle de Coehoorn et de Vauban. Histoire de nous rappeler que Namur a aussi été française. Son vaste réseau de souterrains n’avait guère de secrets pour moi. Il lui a valu le surnom de « Termitière de l’Europe » donné par Napoléon Ier. Je m’y suis rarement perdu.
Mon grand-père paternel, avocat puis négociant en vins, avait épousé une jolie bourgeoise de Gand. Je l’ai peu connu : il mourut lorsque j’avais onze ans. Il m’impressionnait. Mais j’aimais les quelques moments de détente qu’il partageait avec moi peu avant 13h00 quand il écoutait Zappy Max sur Radio Luxembourg.
Ma grand-mère Andrée restera dans nos vies jusqu’à ses quatre-vingt-dix-sept ans ! Un bonheur ! Durant ma préadolescence, comme elle était veuve, on la voyait souvent. Issue de la haute société francophone de Flandre, entourée de domestiques, elle avait appris à jouer du piano et aimait lire les chefs-d’œuvre de la littérature classique à haute voix. Elle reconnaissait un opéra à la troisième phrase, relisait inlassablement les grands auteurs français, russes et américains, déclinait ses toujours modestes avis en citant les philosophes grecs. Elle pouvait décrire, les yeux fermés, les détails des peintures des frères Van Eyck, dont L’Agneau Mystique. Lorsqu’elle venait chez mes parents, cette humble érudite se contentait d’un lit de camp et d’une soupe, sauf s’il y avait du vin.
— Voulez-vous un verre de vin, Maman ? lui demandait ma mère les dimanches de gigots.
— Une larme…
— C’est du Rosé d’Anjou.
— Alors non, si vous n’avez pas de vin, je préfère de l’eau.
C’était son seul orgueil. Car, si elle vivait chichement, il n’était pas question de trahir la mémoire d’œnologue de son mari qui lui avait donné le goût des grands crus bordelais.
Elle a été mon phare pendant des décennies, même si apparemment elle traversait le temps en totale discrétion. Elle a eu quatre enfants. Mon oncle Jacques est parti peu après mon grand-père, ce qui a beaucoup affecté mon père. Restaient Michette et le cadet, Guy, qui s’est éteint l’année dernière quelques jours après ma maman. Michel et Jean-Luc seront mes deux cousins. Michel, lui aussi, nous a déjà quittés.
Je n’ai qu’à me féliciter de l’excellence de ces êtres gentils. Ils sont ma famille paternelle et je suis fier d’eux tous.
Ma mère a voulu accoucher à la maison, dans la chambre où je vivrai mes premières nuits, cinq ans durant.
Ma grand-mère maternelle, Jeanne, qui en avait vu d’autres, a été la sage-femme et le médecin, appelé un peu tard (je suis né un vendredi à neuf heures trente du matin), habitait la maison d’en face. J’évoquerai plus loin le drame de cet accouchement qui a meurtri ma maman. Le souvenir de ce deuxième étage de cette grande maison bourgeoise est également construit d’odeurs : la cire à bois des parquets, le cuivre poli d’un calendrier circulaire qui laissait apparaître les jours, les mois, les années sur un cadran, l’encre séchée du papier buvard, les pestilences âcres et envahissantes du poêle à mazout, celles des moteurs de camion qu’on faisait tourner dans le garage au rez-de-chaussée de l’immeuble. En effet, il s’y trouvait un atelier de réparation de véhicules lourds. Mon grand-père avait d’abord voulu une exploitation de maintenance de machines agricoles. Après la Seconde Guerre Mondiale, ses fils n’ayant pu continuer leurs études à cause de la guerre, n’étant pas lui-même enclin à reconquérir de belles affaires au Barreau, ni à vendre du vin dans une Belgique en récession économique, le grand-père Eugène avait décidé d’investir dans une entreprise familiale. Ses fils aimaient la mécanique ? Ils seraient garagistes. Ça évitait de hasardeuses reprises d’études et regroupait presque tout le monde. Des tracteurs aux transporteurs routiers, il n’y a eu que quelques petites années et cela a fini par être une concession de voitures. Toute mon enfance, j’ai roulé dans de grandes puis de petites automobiles neuves ! Alors que la Belgique des bagnoles toussotait, j’ai fait le tour d’Europe. Un autre parfum reste présent, celui un peu musqué de la robe de chambre de mon père, dont le velours plat du col m’apparaissait irritant. Il ne me reste pas grand-chose des souvenirs de fumées de pipes au tabac anglais ni des cigares cubains. Il ne fumait que rarement. Subsiste cette odeur de fraises, lorsqu’à la saison des cueillettes, maman allait rejoindre les coteaux de Wépion. Dès ma première année, elle a suspendu mon berceau à l’ombre d’une cabane en planches. Ça sentait la paille, utilisée pour isoler les plants. Ma grand-mère Andrée préférait préparer des confitures de coings. Depuis lors, j’aurai tout fait pour retrouver le goût et le parfum de cette confiture charnue aux arômes puissants.
Une tragédie a marqué mon enfance. Jean-Jean, un voisin de mon âge, s’est fait renverser par une voiture sur la dangereuse chaussée de Dinant. Cela a été ma première confrontation avec la mort et l’absence. J’avais quatre ans. Puis sont venus les apprentissages dans cette école gardienne où Mademoiselle Chantal veillait sur nous. Pas tant que cela, car une grosse vilaine avait décidé de me dominer. Certains avaient déjà des petites copines qu’ils appelaient fiancées. Pas moi. La moche avait jeté son dévolu sur moi et, sans écouter mes protestations, s’affichait tant qu’elle pouvait, accrochée à mon bras. Elle pesait deux fois mon poids et me dépassait d’une tête. Lors de la fête scolaire de fin d’année, pour le traditionnel ballet en costume, nous devions représenter deux coquelicots. Elle avait l’air d’un rhododendron. Elle me crachait dessus et me faisait des prises indiennes (tordre le poignet). J’ai été martyrisé pour la première fois de ma vie par une femme. En revanche, je draguais de toute la vitesse de mon petit vélo rouge pour obtenir le sourire de Rita, une voisine. J’ai gardé une photo d’elle dans une grange à foin. Nous avions cinq ans à peine. Adolescent, j’ai voulu la retrouver. Acte manqué. Si indispensable à se construire.
S’il fallait mettre un premier prénom sur une liste de tentatives de conquêtes, ce serait Rita.
À cinq ans et demi, mes parents m’ont emmené à la gare de Namur. J’embarquais pour un mois avec une flopée de mômes pour vivre à la campagne dans une colonie. Là commençait mon premier séjour à Cortil-Noirmont. Il s’est poursuivi six mois. J’évoquerai plus loin cet intermède qui, curieusement, m’amenait dans le village où vivait mon futur premier amour.