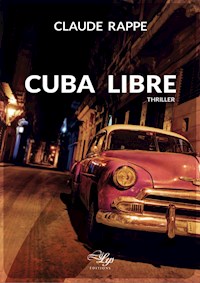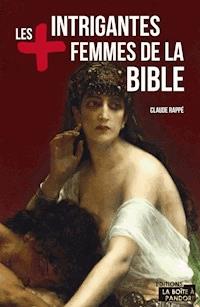Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LiLys Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Thaïlande 26 décembre 2004… 9 h 30 du matin. Anita et Michaël sont en voyage de noces. Elle disparaît dans le tsunami. L’eau nettoie tout, sauf les souvenirs. Michaël veut croire qu’elle vit. Il ne quitte plus la Thaïlande. Petits boulots, tracs en tous genres, filles, alcool, prison, Triangle d’Or, mariage bouddhiste, les Triades chinoises, la mafia russe, Mister Di, Dimitri Vassili Ushak Kartov, le maître du sexe tarifé, propriétaire du tabac russe et de mille bars asiatiques… Pris dans la toile des mafias, Michaël devient une cible à abattre. Incarcéré dans un centre de neuropsychiatrie punitive sibérien, il subit toutes les tortures d’aliénation, dont des expériences de mort imminente où il voyage dans le passé et le futur. Tout arrive à Michaël, tout… Un jour, sur son lit d’hôpital, il entend la voix d’Anita…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Claude Rappe a été journaliste et producteur à la télévision (RTL) pendant vingt ans. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres historiques, thrillers, romans, essais et biographies, certains traduits en plusieurs langues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Ouaïba
Nous sommes de l’étoffe dont sont tissés les rêves Et notre courte vie s’achève par un sommeil.
Cette histoire est une fiction avec des personnages imaginaires.
Cependant, certains événements sont inspirés de faits réels.
26 décembre 2004 10H38 a.m. – PhuketAmbulance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Giratoires. Flashs rouges et bleus. Lacérations de fouets lumineux. Il y a du blanc et du gris, du jaune et du noir. Sirènes stridentes. Elles transpercent les tympans. Fort. Trop fort. Trop près.
Des voix bourdonnent à mes oreilles, à peine audibles. J’ai mal au cou, à la tête, au larynx… Je n’arrive pas à respirer.
— Épinéphrine !
— Administrée !
— Airway position1…
La douleur est intense. On me redresse, on m’assoit, je tombe, on me pose sur le côté et je vomis de l’eau salée. Je crache des glaires et du sang. Je tousse et mes poumons sont déchirés en lambeaux. Je ne parviens pas à trouver une cadence respiratoire.
— Intubation !
— Hypothermie 34°…
— Sang ?
— CO2…
— Hyperkaliémie à 11…
Je me perds, me sens partir. Je n’ai plus de membres, plus de bras, plus de jambes, ma tête est lourde, mon corps se dissout. J’ai froid.
— No way Sir… crie le chauffeur.
— What ?
— No way…This road is broken by the tsunami.2
Puis…
— Breaking… Breaking… Breaking…3
— Ventilation !
— Breaking… Je n’ai plus de pouls…
— Massage cardiaque !
Je sombre dans l’inconscience. Pour longtemps.
1 Position de secours favorable aux voies respiratoires…
2 — Pas par ce chemin, Monsieur…
— Quoi ?
— Pas d’issue… Cette route est détruite par le tsunami.
3 Arrêt cardiaque…
Siam – 24 décembre 2004 Canton – Bangkok
« On ne doit pas accorder sa confiance à quelqu’un qui ne sourit jamais. »
Henry de Montherlant.
L’avion virevoltait au cœur de turbulences. Nos rythmes cardiaques se soumettaient au métronome de nos angoisses. La peur de mourir, de ne pas avoir le temps, de manquer à quelqu’un, de ne plus avoir de réseau.
À Canton, on m’avait parqué comme un animal entre deux barrières de sécurité. Une file de passagers espérait un transfert vers Bangkok. Mais la compagnie China Airlines restait silencieuse. Aucun vol n’était plus annoncé. Des rumeurs, répétées par les touristes, quelques hommes d’affaires et deux hôtesses peu informées, entretenaient notre impatience.
Ma chemise en lin avait perdu sa dignité.
Un adipeux de couleur soufflait son haleine de fauve. Son obésité entravait la circulation des autres. Un agent de sécurité au képi large hurlait. Nous devions nous ranger en cordon humain. Il nous insultait pour qu’on dégage de l’endroit où il nous avait préalablement placés.
— Where is my luggage ? demandai-je à une hôtesse stressée.
— I don’t know Sir. Where’re you from ?
— Paris.
— Paris… For CDG passengers, this way…4
Elle m’indiqua le comptoir de la Kenyan Airways.
— Which connection is there ?
— CDG, the name of the airport of your departure…
— Charles De Gaulle Airport, of course.But Kenyan Airways ?
— Please, Sir…Join this line…5
J’obtempérai. La Kenyan Airways semblait être la seule compagnie disposée à assurer un transfert vers Bangkok. Un troupeau d’angoissés attendait devant des montagnes de sacs en polyester tressé et des cartons maintenus misérablement par du papier collant. Mes Samsonite devaient être en transfert vers la soute à bagages d’un Boeing fatigué de la Kenyan Airways. Elles auraient paru luxueuses sur ce tapis d’enregistrement. Mes vêtements parodiaient un anonymat olfactif comparativement au reçu des effluves de l’entourage qui enregistrait des bagages. L’hôtesse me remit un ticket d’embarquement neuf, m’arrachant des mains mon billet Paris-Canton. Je n’eus pas le loisir de m’inquiéter, poussé par le gros qui voulait qu’on avance. On avança…
— Pas de bagages ? me demanda un préposé à l’enregistrement.
Lobotomisé, il vérifia mon passeport.
— D’après l’hôtesse, mes bagages sortent des soutes du vol interrompu de China Airlines Paris-Canton pour être transférés sur le vol Canton-Bangkok de la Kenyan Airways. Vous pouvez vérifier ?
— Pas de problème Monsieur, répondit-il sans consulter son écran.
— Comment puis-je savoir ?
— Plaît-il ?
— … pour mes bagages ?
— Garder les codes-barres.
Une nouvelle bande codée sortit des machines. L’obèse déposait déjà ses cartons sur le tapis roulant.
— Vous permettez que je termine ?
Il me regarda comme si je l’avais traité de sale nègre.
J’avais pensé « sale ». Pas « nègre »… Relisant mon billet, je me suis dirigé vers la porte d’embarquement.
Je n’eus pas le temps de m’attarder aux toilettes. Mon nom était beuglé en pidgin English6 par des diffuseurs crachant d’autres mots incompréhensibles. Pourquoi le son des haut-parleurs des aéroports est-il toujours inaudible ? Je courus vers la porte 48 qui se ferma à l’instant où je m’engouffrais sur la passerelle avec une dizaine de retardataires. Leurs boubous et djellabas n’avaient rien de tenues de ville. Je posai ma main sur la carlingue bouillante du vieux Boeing, un rituel. L’appareil avait plus de quarante ans de services. Il finirait bientôt à la casse. Je me mis à prier pour que ce fût un autre jour.
Mes rotules pénétrèrent le dossier en face de moi. L’espace réservé aux passagers de classe Economy avait dû être évalué pour des nains japonais. En l’instant, des dizaines d’hommes et de femmes enlevaient leurs chaussures pour étendre leurs jambes dans les couloirs. Je déposai quatre chewing-gums peppermint sur ma langue et mâchai comme un ruminant pour ne pas être asphyxié. J’en profitai pour me jeter un somnifère dans le fond de la gorge.
J’observais mes voisins. Qu’allaient-ils faire à Bangkok ?
— On fait l’aller pour avoir de la place dans le vol au retour. Comme ça, on sera déjà dans l’avion pour Nairobi…
Les mystères de la logique africaine… Une petite hôtesse en uniforme souhaitait occuper le siège voisin du mien, près du hublot. Je me levai. J’avais de la chance. La compagnie d’une femme mince serait plus confortable que celle d’une fat mama7. Elle ferma les yeux. C’était une petite Thaïlandaise aux cheveux d’encre, lisses et soignés. Un parfum d’orchidée sauvage s’échappait de son cou. Sa silhouette aurait pu me faire oublier que j’allais en Thaïlande pour rejoindre ma jeune épouse. J’aimais passionnément Anita. Elle me précédait le temps de réaliser plusieurs séances de photos pour une agence française.
Le somnifère fera lentement son effet. Je recevrai les trois mignonnettes de cognac commandées à un steward homosexuellement transmissible et finirai par ronfler.
Les cris des passagers me réveilleront. L’écran sur le dossier affichait quarante-sept minutes de vol. Nous venions de glisser dans un trou d’air et le copilote annonçait des turbulences. Ma voisine se resserra la ceinture. Une main aux doigts fins et aux ongles longs frôla la mienne. J’éternuai un mot d’excuse avant de replonger en léthargie. Un bang terrifiant nous ressuscitera. Les gens criaient de plus belle. Le commandant éructa un message de réconfort avant de lancer une injure au Fils de Dieu à l’instant où l’avion piqua du nez. Nous étions projetés sur le dossier face à nous, les masques d’oxygène libérés. Des sacs, des valises tombaient des casiers. Un sifflement assourdissant torturait les tympans. Les ailes de l’avion vibraient. Un boucan infernal…
Les yeux fermés, l’équipage ne bougeait pas. Des gens se détachaient, s’agenouillaient, suppliant Dieu de les épargner. Des chapelets croisaient des mains jointes. Ça pleurait, hurlait, gémissait… La petite hôtesse me prit la main. Des larmes lui coulaient sur les joues. J’ai toujours eu peur en avion. Mais là, j’étais terrorisé. J’attendais la mort. On entendit à nouveau jurer le commandant. La porte du cockpit s’ouvrit sur deux pilotes arc-boutés sur les manches. Je fermai les yeux et serrai la main de la jeune femme en priant tout qui je pouvais prier. Un flottement étrange m’inonda la raison. J’eus l’impression d’être bercé dans de l’ouate. Soulevant nos tripes, l’appareil reprit une position horizontale, perdant de la vitesse. Les vibrations augmentèrent. Je jetai un œil par le hublot. Un gigantesque cyclone tournoyait à notre gauche. Quelques cours de météorologie me revinrent à la mémoire. Nous étions à cinq miles de l’œil du typhon.
Selon toute probabilité, les vents y soufflaient à 300 km/h. Un Boeing et ses deux moteurs pouvaient difficilement lutter. Un principe de physique voudrait que l’avion soit aspiré vers le centre. Pour y échapper, le pilote devait faire planer les cent dix-sept tonnes du Boeing et surfer sur les vents ascendants les moins violents. S’il échappait aux profonds trous d’air qui cassaient le parcours des courants dominants, c’était un dieu. C’était aussi une question de chance. Dans la cabine, ça priait, pleurait. Ça brandissait des photos, des écharpes, des chapelets, des Bibles, des Corans. Un cordon de bras et de mains s’unit. Un cantique fut entamé. Un chant allophone en trois ou quatre langues.
C’est dingue ce que Dieu est vivant face à la mort. Ma voisine murmura :
— Sir ?
— Yes…
— Are you a Buddhist ?
— Yes, I am.8
Je n’avais pas desserré les dents. Elle non plus. Avaitelle vu mon pendentif hindou de Ganesh ? Elle sourit. Je ne pouvais pas parler. Elle me pressa les doigts encore plus fort et récita un mantra. Le bruit d’un terrifiant déchirement métallique brisa son isolement. L’avion s’était-il disloqué ? Nous plongions à nouveau. La vitesse augmentait. Les cris reprenaient. Des nuages se jetaient sur les hublots comme autant de gifles. Des grêlons mitraillaient la carlingue. L’eau s’infiltrait des plafonds disjoints. Les yeux hagards de la jeune femme hurlaient son effroi. J’étais paralysé. Je lui criai :
— My apologies…
— Forgive me too ! répondit-elle en s’époumonant. Sorry… Sorry… Sorry…9
Nos mains se libérèrent pendant la descente vers l’aéroport de Bangkok Don Muang. Le commandant nous annonça 33° Celsius au sol et présenta ses excuses pour les turbulences. Je compris pourquoi la compagnie China Airlines n’avait pas voulu faire décoller ses long-courriers. La jeune femme me sourit. Nous étions groggy. Elle semblait gênée de s’être laissé aller à la peur. Nous venions de marier nos angoisses dans la promiscuité de la mort qui pourtant nous abandonnait à la vie, penauds, heureux. Je lui demandai son prénom.
— Siam ! dit-elle en hésitant.
Elle n’écouta pas le mien et refusa poliment de prendre un verre dans un bar de l’aéroport. Elle n’avait pas le temps. Le temps, cette excuse des vivants… On peut mourir avec une femme sans avoir le droit de vivre avec elle. Je la regardai s’éloigner. J’allai féliciter le commandant de bord.
— You’re great10 ! lui dis-je.
Il me remercia discrètement. Il avait les yeux rouges et la nuque trempée.
Une fois le contrôle des passeports terminé, je m’assis un instant devant le distributeur de bagages. Ils passèrent trois fois avant que je ne me décide d’aller chercher les miens. Je n’espérais pas les y trouver.
Le sourire de Siam… Trop de chance nous trahit…
Nous étions le 24 décembre 2004 à 18h37.
4 — Où sont mes bagages ?
— Je ne sais pas Monsieur.
— D’où venez-vous ?
— Paris.
— Paris… Pour les passagers de CDG, par là…
5 — Quelle est cette connexion ?
— CDG, le nom de l’aéroport de votre départ…
— Aéroport Charles De Gaulle, bien évidemment. Mais Kenyan Airways ?
— S’il-vous plaît Monsieur… Rejoignez cette file…
6 Anglais altéré par d’autres langues.
7 Grosse mère.
8 — Monsieur ?
— Oui…
— Êtes-vous Bouddhiste ?
— Oui, je le suis.
9 — Veuillez m’excuser…
— Pardonnez-moi aussi ! Désolé… Désolé… Désolé…
10 Vous êtes formidable !
Anita 25 décembre 2004 – Phuket
« La pire de toutes les mésalliances est celle du cœur ».
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort.
Je l’appelais Phèdre ou Andromaque, selon mes humeurs. Ça la flattait. Elle était tragédienne. Ses tréteaux étaient devenus ceux de Chaillot et d’Avignon après des années de Café-théâtre. Un rôle-titre dans une série télévisée fit le reste. La réussite lui assurait un visage rayonnant, le verbe haut et l’allure d’une diva.
Nous venions de nous marier. Ce voyage allait enfin nous permettre de passer du temps ensemble. Elle avait choisi la Thaïlande. Notre installation dans un luxueux hôtel de Nai Harn Beach à Phuket fut brièvement suspendue par les compliments d’une femme de chambre thaïlandaise qui avait fait un stage à Paris.
— Anita Leitz… Anita Leitz…Here ?Please… heu… une… un… auto… heu…
— Autographe ? Sure !
Une terrasse fleurie, arborée, noyée de pièces d’eau et d’une piscine privée prolongeait les deux cents mètres carrés d’une suite où je me perdais à chaque tentative de rejoindre une des salles de bain. Nous avions projeté d’aller dîner le jour de Noël dans un restaurant gastronomique de Patong. J’avais engagé un chauffeur de taxi qui, pour quelques centaines de bahts11, nous conduirait et nous attendrait partout.
En Thaïlande, la location de services n’est jamais une vente d’âme. Il en va ainsi tant des serveurs de restaurant que des prostituées qui n’en sont jamais vraiment. Les touristes occidentaux, pilleurs de distributeurs automatiques, aiment se conduire en coloniaux. Pour les Thaïs, ils ne sont que des distributeurs de devises. L’assimiler me vaudra un peu de compassion. Pour rendre hommage au bébé né le jour de Noël, décidons-nous, ma jeune épouse et moi-même, d’offrir un soap massage12 au photographe de presse pour son shooting et au chauffeur, enclin à se laisser débaucher par la vertu de billets de bahts à quatre chiffres. Un Petrus suivit par un Cristal de Roederer, je n’avais jamais vécu un Noël aussi consenti. Anita, voyant s’agiter deux cents petites Thaïlandaises derrière la vitrine de « Chez Christine » à Patong, fut prise de nausée. Elle avoua ne pas pouvoir vivre un moment de clientélisme tel que celui-là.
Elle s’en alla trouver un salon de massage plus sérieux dans le centre-ville. Je me retrouvai seul face à un aquarium de sirènes en attente de généreux pêcheurs.
Quel Noël ! Merry Christmas ! Ce n’est pas que je n’aime pas être savonné par des anguilles, mais je m’inquiétais de l’absence de ma jeune épouse, s’émancipant sans moi dans je ne sais quel salon de massage. Ces derniers se voyaient de loin. Ils étaient bien éclairés. Mais les rues restaient un décor de coupe-gorge. Abandonnant une mousse farcie de petites fesses pour courir dans les rues de la ville, je me fis un sang d’encre avant de retrouver mon épouse tout émoustillée par le talent de masseuses plus sérieuses.
— Ton téléphone ?
— Je l’avais mis sur silence.
— C’est malin.
— Ben quoi ? Tu étais noyé dans un filet de sirènes.
— Tu te rends compte que tu es une femme, seule, en pleine nuit, dans une ville inconnue, en Thaïlande.
— Justement. Nous ne sommes pas à Paris…
— Et ça te fait rire ?
— Tu tiens tant à moi ?
Elle me déposa un baiser nappé de gloss et fouilla mes poches.
— J’ai plus un baht… lui dis-je.
— Ce n’est pas cela que je cherche. Je vérifie si les petites ont fait leur travail.
Voilà comment, à peu de mots près, une dispute était éventée par Anita. Le chauffeur et le photographe, plus joyeux qu’à l’aller, étaient devenus potes d’alcool sur la terrasse du « bordel ».
— Arrêtez de rire sans arrêt… On dirait que vous sortez d’un bar à opium…
— Kha Poun Khrap13 ! éructait de manière répétitive notre chauffeur.
— Can you drive a car, now ?demanda Anita au chauffeur.
— Yes ! I can. I’m not drunk, not drug-addict. Never opium in Thailand. Just the country of smiles, beautiful girls and Singha14beer…15
Occulter les rumeurs, une religion en Thaïlande. Il n’y a pas de prostitution, pas de drogue, rien que des yims16, de rares sopenis17, parfois katoeys18, et du Ya Ba19 oui, mais seulement à Chang Maï ou à Bangkok… Ici, il n’y a que de la bière et des mamasan20 qui maintiennent l’ordre dans les beer bars21 où on joue au billard américain. Non, mais…
Cent virages plus tard, nous arriverons à l’Hôtel Méridien où je rassurerai ma femme sur l’état de nos copropriétés intimes. Ce fut un Noël illuminé de bonne humeur. Le dernier…
LA PREMIÈRE VAGUE
Tsunami 26 décembre 2004 – Mer d’Andaman
« Celui qui a fait naufrage tremble devant les flots tranquilles. »
Ovide.
Il y a longtemps, en 1969, Mayol nous forçait à rejoindre la piscine et à plonger alors que nous bavardions encore sous la douche. On abandonnait palmes, masque et tuba. On se jetait en pagaille dans l’eau chlorée. Il nous était interdit de remonter avant trois minutes. Jacques avait sa façon à lui d’être pédagogue. Le premier qui craquait devait porter les douze bouteilles d’air comprimé et le deuxième héritait de la corvée de monter tous les détendeurs. Les suivants se faisaient engueuler copieusement et le dernier à rester au fond, toujours moi, devait, après avoir respiré profondément, replonger immédiatement et rester au fond une minute supplémentaire, histoire de se surpasser. C’était la règle. Jacques Mayol était une célébrité de la plongée libre bien avant le film (Le Grand Bleu) que Luc Besson lui consacra en 1988. Il était craint, respecté et adulé par beaucoup d’entre nous. On ne le voyait guère.
Il passait au club à l’occasion d’une invitation, d’une conférence ou d’un film commenté. J’obtins mon premier brevet puis, complètement conquis par le monde du silence, accumulai les palanquées, partout où il y avait un endroit à explorer. J’avais, lors d’une compétition amateure, battu un record d’apnée : cinq minutes et quarante-sept secondes. En « surventilant » mes poumons, suçant des barres de saccharine, le corps graissé avec une crème isolante, j’étais prêt, tant psychologiquement que physiquement. Je fus consacré plongeur sous-marin, champion d’apnée, avant de devenir moniteur de plongée.
Ici, en Thaïlande, en cet hiver 2004, accroché sous la coque du speed boat1 à un filin opportun, mon apnée ne durerait guère. Je n’avais plus vingt ans. Je ne m’étais pas entraîné depuis des années. Il faut reconnaître objectivement que nous étions le lendemain d’une virée très arrosée. Mon pied gauche me faisait horriblement mal. Un filet de sang s’en échappait sans que je puisse évaluer l’importance de la blessure. Je venais de tomber du bateau au moment où les marins poussaient les moteurs à fond. Sans le fil d’acier, j’aurais été broyé par le couple d’hélices des hors-bord. Je m’y cramponnais. Il tenait par un boulon d’anode érodé par l’eau de mer.
Dehors, le vacarme sourd de gens courant sur le pont, des cris, les gifles violentes des vagues.
Les hélices me transformeraient en viande hachée si je lâchais. Je pensai à Anita, qu’avant de tomber à l’eau, j’avais portée jusqu’au bateau, au photographe qui avait tenté de sauver ses appareils avant sa propre vie, et à cette vague, irréelle, dantesque, qui avait tout submergé en quelques secondes. Une première, surprenante, haute, puissante. Un tsunami… L’étale, faussement rassurante, et ça repartira en arrière, emportant tout ce que l’eau avait pu dérober sur terre.
Un choc… violent… fatal…
Je sentis mes poumons se remplir d’eau, mes yeux imploser, ma tête s’alourdir. J’eus le temps de prier un mot d’amour au Bouddha.
— Sauve-la !
Je venais de me noyer dans la vague du tsunami du 26 décembre 2004, au large d’une île déserte de la baie de Phang Nga, à plusieurs milles de Koh Phi Phi, dans la mer d’Andaman.
1 Bateau rapide (souvent propulsés par d’énormes moteurs hors-bord).
Tsunami 26 décembre 2004 – Nai Harn Beach
« Les morts sont toujours loués. »
Thucydide.
Elle portait un bébé sur le bras. La tête de l’enfant était recouverte d’un châle orange. Elle le nourrissait au sein. L’enfant avait les yeux fermés. Je la saluais par un waï2. C’était miraculeux d’avoir pu sauver son enfant. Les vagues du tsunami avaient déferlé violemment sur les plages bondées de monde.
Je grimpai vers l’hôtel. On aurait dit un immeuble bombardé. Seules les structures extérieures et les derniers étages en terrasses, accrochés au flanc d’une montagne, avaient tenu. Le reste n’était que débris, amas de béton brisé, arbres arrachés, corps mutilés par les objets emportés par l’eau. Au loin, sur la route, un bateau déposé au milieu des terres. Sur la mer, un bus n’en finissait pas de couler, une maison en bois de se disloquer. La directrice de l’Hôtel Méridien avait improvisé un comptoir de réception sur le trottoir. Un téléphone-satellite en main, elle tentait de joindre des gens.
— Vous avez des nouvelles de ma femme ?
— De votre femme ?
Un regard triste barra son visage. Elle voulut me répondre, mais ne savait que dire.
— Elle était sur le bateau quand je suis tombé à l’eau…
— Excusez-moi Monsieur…
Un policier au costume trempé venait de poser le corps inanimé d’une gamine sur un brancard. La directrice hurla, courant embrasser la jeune fille. Elle me jeta un regard perdu. La petite était morte.
— C’est… c’est ma fille…
Elle s’évanouit dans les bras de son enfant.
— Vous savez où est ma femme ? demandais-je à une femme d’étage.
— Ho… sorry Sir… No news… Sorry… Madame ? What’s her name ?3
— Leitz…Her name is Leitz… like me. Anita Leitz…She is my wife.
— Liit… Ta Lit ?Same same Italy ?
— No. Leitz…4
Je grimpai vers la chambre. Les escaliers transformés en cascades d’eau étaient encombrés de branches et de boue. La porte était ouverte. Passé le seuil vaseux, il y avait moins de dégâts. Je refermai la porte espérant qu’il n’y ait pas eu de cambriolage. Je pénétrai dans la chambre. Je crus la voir endormie sur le lit. Je me couchai à côté d’elle, évitant de la réveiller, la serrant délicatement dans mes bras, lui répétant « je t’aime ».
Quelques heures plus tard, des infirmiers de la Croix-Rouge m’arrachèrent à mon rêve.
— Monsieur… Monsieur… Nous avons retrouvé un corps… peut-être celui de votre femme… Vous pouvez nous aider à l’identifier ?
2 Waï : salut bouddhiste – mains jointes devant le front ou le plexus.
3 Ho… Désolé Monsieur… Pas de nouvelles… Désolé… Madame ? Comment s’appelle-t-elle ?
4 Leitz… Elle s’appelle Leitz… Comme moi. Anita Leitz… Elle est ma femme. Liit… Ta Lit ? Même que Italy ? Non. Leitz…
Franca 31 décembre 2004 – 1er janvier 2005 Nai Harn Beach
« La justice est le seul ami qui accompagne les hommes après la mort, car toute affection est soumise à la même destruction que le corps. »
Manava-Dharmasastra (lois hindoues de Manu).
Je ne mangeais plus depuis cinq jours. Je buvais de l’alcool et des litres d’eau. En bas, sur la plage, la maman allaitait toujours son bébé. L’enfant était bleu. Elle lui souriait. La mère thaïlandaise est une déesse.
Invité à une parade hypocrite des clients de l’hôtel pour la soirée du Nouvel An, je me suis trouvé face à un buffet honteux, où tout ce qui réjouit les Occidentaux était exposé. Comme si un foie gras du Périgord et un caviar iranien allaient nous faire oublier que nous étions pour la plupart, veufs ou laissés pour tel, orphelin ou parent sans nouvelles de nos enfants. À minuit, on entendit des gémissements, des pleurs. Personne n’osa le moindre vœu. L’orchestre entonna un air mi-gai mi-triste. Le personnel tenta de joindre des mains pour que des couples se forment sur la piste de danse.
Je me retrouvais avec Franca, qui noyait ma chemise de larmes. Je l’avais élégamment draguée cinq jours plus tôt. Nous avions, Anita et moi, une telle confiance en nous. La jalousie était restée au vestiaire de nos célibats.
— Si tu tombes amoureux d’une autre, ne fais pas offense à ma dignité, dis-le-moi et, si tu le souhaites, quitte-moi. Je ne voudrais pas que nous soyons, à l’instar de tant que couples, cocus ignorants ou pire, silencieux. Mais si tu veux t’amuser, du moment que tu me racontes tout…
Ainsi, nous avions convenu de jouer avec cet inéluctable besoin des deux sexes à se faire du charme. Nous allions jusqu’à provoquer des regards compromettants. Puis nous rentrions chez nous pour faire l’amour. C’était comme un défi permanent. Nous nous mariions tous les jours, dans le désir et la peur de nous perdre, éprouvant notre attachement. Franca avait été la consentante d’un instant de jeu. Anita avait remarqué que je commandais trois margaritas. Allongée sur un transat avec un thriller, l’œil attentif derrière des lunettes de soleil, elle sourit en me voyant tendre le troisième verre à Franca. La belle Italienne était sous la douche de la piscine de l’hôtel. Elle accepta le drink, libérant sa poitrine de ses mains pudiques. Son mari, du moins celui qui semblait l’être, ronflait sur le transat voisin d’Anita. Franca m’invita à lui baiser la main et porta un toast en lançant :
— Alla vostra salute !
— Salute !5 répondit Anita, le bras levé pour que je lui emmène son verre de Margherita.
Aujourd’hui, 1er janvier 2005, nous étions, Franca et moi, veufs ou comme tels…
— Elle est belle votre femme… me souffla-t-elle.
— Votre mari aussi… dis-je en me rendant immédiatement compte de ma bêtise.
Elle pouffa. Moi aussi, puis m’excusai.
— Il vous détestait.
— Moi ?
— Oui. Il avait vu votre manège et il m’a dit le soir même qu’il se ferait votre femme.
Une brise du large nous rappela que la mer venait de détruire notre vie. Plus rien ne comptait.
— Je vais rentrer à Rome.
Nous étions là, tous deux, immobiles sur la piste de danse. Des gens nous regardaient. Les yeux étaient hagards. De rares couples nous souriaient, à la fois heureux d’être toujours deux, coupables de n’être pas dans notre tristesse.
— Je vais aller à Bangkok. De nombreuses victimes ont été acheminées à l’aéroport. Je dois vérifier.
— Vous n’avez pas identifié le corps d’Anita ?
— Ce n’était pas elle…
Je fondis en larmes. Le visage de la jeune femme identifiée par la Croix-Rouge, dévoré par des blessures profondes, m’avait empêché de la reconnaître. Sa chaîne en or et son pendentif de Bouddha n’étaient plus là. Ses mains étaient décharnées et ses doigts arrachés. Pas plus d’alliance que de bague… Son corps entier avait été mutilé par la mer.
— Ils ont fait un test ADN ?
— Non. Trop de cadavres. Ils ont pris les empreintes dentaires. C’est aléatoire, mais…
— Et ?
— Je n’ai pas encore les résultats. Mais je suis sûr que ce n’est pas elle.
— Sûr ?
— Oui. Elle est en vie.
Nos regards fixaient la même part de gâteaux servis par des serveuses thaïlandaises souriantes. Elles aussi, pour la plupart, avaient perdu un parent, parfois un conjoint, un enfant. On ne parlait plus, on balbutiait, on ne voyait plus, on épiait. Comme si un dessert allait adoucir notre peine, on l’avalait avant de le cracher. Je remplis nos verres de champagne. Nous les avons levés.
— À Ennio et Anita !
— À Anita ! Ennio est mort. J’ai identifié son corps.
— Je suis confus. Mes condoléances…
— C’est mieux ainsi, nous aurions divorcé en février.
— À cause de…
— De lui et moi. Il avait une maîtresse. Et je cherchais un amant.
Elle but la coupe d’un trait.
— C’est mieux ainsi !
5 — A votre santé ! — Santé !
Don Muang 9 janvier 2005 – Bangkok
« La chandelle éclaire en se consumant. »
Henry George Bohn.
L’aéroport de Bangkok Don Muang était encore en service multinational. Il sera supplanté plus tard par Suvarnabhumi. Les allées ressemblaient à des quais ferroviaires et dans les semaines qui suivirent à des supermarchés de vies humaines. Partout, sous des drapeaux identifiant les nationalités, se dressaient des panneaux sur lesquels on épinglait les photos, les descriptifs ou des profils esquissés de disparus. Une dizaine de milliers d’icônes consultées par des gens perdus, dépressifs… Rarement s’élevait un chant de joie. Souvent des cris, suivis de sanglots. L’Ambassade de Belgique, pays d’où nous étions originaires Anita et moi, avait coupé le téléphone « pour cause de tsunami ». Je n’eus que l’Ambassade de France pour tenter de retrouver mon épouse. Nous étions résidents en France, décollant de l’aéroport Charles De Gaulle. Ce qui facilita ma tâche car les passagers de la Thaï Airways y étaient tous répertoriés, ce qui n’était pas le cas des étrangers venant de petites compagnies asiatiques. Anita n’était pas à mes côtés lors de ma mésaventure sur un vol kenyan.
Je restais accroché à une photo qui n’était pas celle de mon amour. Juste une ressemblance… Me vint à l’esprit que si elle était morte noyée en tombant d’un speed boat, elle n’aurait pas sa photo ici. À part son photographe, disparu lui aussi, j’étais son seul entourage. Je n’aurais jamais épinglé une photo d’elle alors que j’étais seul à la chercher.
Après avoir obtenu une photocopie de la liste des disparus de l’Ambassade de France, je décidai de revenir sur les côtes de la mer Andaman. Anita était sur cette liste. J’étais en vie par la grâce d’une apnée. Je voulais suspendre ma vie à l’espoir de la retrouver. Le chagrin est lié à la perte de l’autre, mais la douleur est marquée au fer par son silence. La plus grande souffrance est de ne pas savoir. Je quittai Bangkok, déçu de n’y avoir pas retrouvé mon ange.
Jordan Février 2005 – Phuket
« On reconnaaît l’homme magnanime dans la colère, l’homme courageux dans la guerre et le véritable ami dans le besoin. »
Proverbe arabe.
Je n’eus pas grand mal à me faire engager dans le journal local, le Phuket News. Je rencontrai Jordan dans un pub tenu par un Britannique au centre de Phuket Town et situé dans une rue entrelardée de boutiques chinoises et de beer bars. Voué depuis dix ans à l’écriture de romans et de récits de voyage, je rédigeai aussi des articles pour une agence de presse et un journal musical réputé. J’avais gardé la plume journalistique. Peu d’Occidentaux auraient accepté les misérables piges qu’accordaient les éditeurs thaïlandais, mais je n’avais pas les moyens de rester sans un minimum de revenus financiers. De plus, un contact privilégié avec les médias me paraissait indispensable. À Paris, mon agence m’avait mis en congé provisoire. Je connaissais la sentence si je ne rentrais pas au bercail. Une carte de presse n’est pas une carte de banque. Elles sont toutes les deux soumises à la rentabilité de leur propriétaire. Jordan avait apprécié mon souci de couvrir sans démagogie les déboires des oubliés de l’après-tsunami. C’étaient les Sea Gybsies que les Thaïlandais appelaient les Urak Lawoi, les Mawken, Moklen, Orang Sieh ou Orang Lanta. Considérés comme des intouchables, ils étaient écartés du système socioculturel par leur langue austronésienne apparentée au malais. Ils s’isolaient de l’urbanisme thaïlandais. Leur peau plus noire et leur vie autarcique dans des villages souvent lacustres toujours miséreux les écartaient de l’occupation des plages des petites villes balnéaires de Phuket. La mer les avait convertis en pêcheurs, en constructeurs de bateaux, en tisseurs de filets et tresseurs de nacelles. Pendant le tsunami, ils avaient péri en nombre, en mer, mais aussi sur les plages où les femmes réparaient les filets avec les enfants qui jouaient. Quelques hommes revinrent sur terre et n’y trouvèrent que mort et désolation. Il y avait eu beaucoup de victimes. Nombre de leurs embarcations instables n’avaient pas résisté aux vagues. Le peuple de la mer d’Andaman ne survivrait pas au tsunami. Leur statut étant fragile et les aides absentes, beaucoup gagnèrent les montagnes pour se sédentariser. La pêche fut assurée par des chalutiers chinois. Le surgelé tua un peu plus les pêcheurs de Thaïlande. Les médias évoquaient sans cesse les touristes noyés par le tsunami, mais ne parlaient pas des Sea Gybsies. Je ressentis la nécessité d’écrire des articles pour éveiller les consciences. Jordan parvint à m’en placer trois. Je contactai le Rotary Club, la Croix-Rouge Internationale et le Secours Populaire Français. Tous me permirent de finaliser un projet de construction de bateaux. Mais lorsque six cents longtails6 furent terminés, les moteurs restèrent bloqués à la douane… J’écrirai un dernier article. Il ne plut guère. On ne pouvait pas tout dire. Jordan m’invita à boire l’apéro dans le pub anglais.
— Ton avenir n’est pas ici. Tu dois faire le deuil de ta femme et quitter la Thaïlande.
— Elle est vivante.
Il plongea ses yeux vers le plancher de la terrasse. Un coucher de soleil rougissait le ciel et l’air flirtait encore avec plus de trente degrés Celsius.
— Quoi ? Je suis fou ? Tu penses que je deviens dingue ?
— Oui.
Je sortis la photo d’Anita de mon portefeuille et l’obligeai à la contempler.
— Regarde ! Regarde-la ! Elle est tellement belle que Dieu ne peut l’avoir rappelée à lui.
— Elle était belle, Michaël… mais elle est morte.
— Tu sais ce qui ne va pas chez toi ? Depuis le temps que tu te fais rincer les oreilles par la philosophie bouddhiste, tu as perdu la foi.
— Peut-être. Mais je me dis que rester bloqué sur le 26 décembre 2004 ne t’apportera rien d’autre que la démence. Si elle vit, elle te contactera, tôt ou tard. Sinon, tu deviendras comme tous les expatriés de Thaïlande : alcoolique, ruiné, au bras d’une exdanseuse de gogo-bar7 qui ne te sucera même plus la bite, mais le fond de ton compte en banque.
— Pauvre con !
Je quittai Jordan et traversai la rue. Elle me parut large. J’imaginais son regard attristé dans mon dos. Je croisai un Britannique qui me montra une photo délavée de sa femme et de sa fille. Il hurlait :
— Where are my daughter and my wife ?8
Titubant, imbibé, avec le regard vide d’un zombie, il me laissa à mes propres démons. La mort est acceptable. Survivre la rend insupportable.
6 Longtails : bateaux à longue queue (hélice au bout d’un axe plongeant).
7 Gogo-bar : bar à danseuses
8 Où sont ma fille et ma femme ?
Jun & Pum Mars 2005 – Khao Lak
« Le vrai moyen d’adoucir ses peines est de soulager celles d’autrui. »
Madame de Maintenon.
Jun était la plus belle. Elle portait comme moi un petit médaillon en argent représentant Ganesh, dieu hindou adoré en Thaïlande bouddhiste. Il symbolise le souvenir de ceux qu’on aime.
— Memory of Mamma9… me dit-elle, les yeux noyés de larmes.
En adoptant Jun, je savais que je m’engageais financièrement, affectivement et pour longtemps. Mais vu sa beauté, je lui évitais un aller simple pour les bars de Pattaya ou de Bangkok.
— My sister10… ajouta-t-elle en me montrant une petite bouille triste de plusieurs années sa cadette.
La gamine avait la peau basanée et les yeux brillants des gitans de la mer. La directrice de l’Hôtel Méridien se mit à fouiller dans ses fiches. Elle m’avait emmené ici, dans cette immense école de Khao Lak, pour que je choisisse un enfant à sponsoriser. Il ne s’agissait que de verser mensuellement sur le compte d’un tuteur désigné par l’État un montant équivalent aux frais de scolarité.
— Ce n’est pas sa sœur ! trancha mon accompagnatrice.
— Ah ?
Je me tournai vers Jun…
— Yes, she is… insista-t-elle, l’air désespéré.
— What’s her name ?
— Her nick name is… Pum.
— Pum ?11
Je me suis avancé vers la petite fille.
— What’s your name ?12
Elle haussa les épaules, me fixant de ses yeux étincelants. J’insistai. Elle regarda Jun et me répondit :
— Pum…
Elle se mit à pleurer. Jun se précipita, la prit dans ses bras et essuya ses larmes avec son chemisier.
— Ce n’est pas sa sœur. Elles sont dans la même école.
— Elles sont orphelines de père et de mère toutes les deux ?
— Oui.
— Pas d’oncle, de tante, de grands-parents ?
— Non, personne. Ni l’une ni l’autre.
— Alors si elles veulent être sœurs, ell0es en ont le droit.
La gérante de l’hôtel leva son stylo de ses fiches.
— Donc ?
— Je les prends toutes les deux sous ma protection.
Je voulus embrasser Jun, mais elle refusa. Pum aussi me boudait.
— Elles sont très pudiques, me dit l’institutrice de l’école.
Je renonçai à m’approcher de Pum, mais lui tendis une peluche représentant un petit éléphant. Elle s’en saisit et la cacha sous sa robe.
J’étais peut-être veuf.
Je venais d’adopter deux enfants.
Je n’avais aucune envie de quitter la Thaïlande.
9 Souvenir de Maman…
10 Ma sœur…
11 Si, elle l’est… Comment s’appelle-t-elle ? Son surnom est… Pum. Pum ?
12 Comment t’appelles-tu ?
Le Liégeois 20 novembre 2005 – Pattaya
« Il faut recevoir le passé avec respect et le présent avec défiance, si l’on veut pourvoir à la sûreté de l’avenir. »
Joseph Joubert.
Mes comptes bancaires européens furent bloqués sous la rigoureuse gestion d’un conseiller qui n’avait vécu ses vacances qu’au Club Med. Mon appartement parisien fut mis sous scellés par un huissier d’injustice qui se prostituait pour récupérer quelques centaines d’euros dus au syndic. La famille d’Anita porta plainte contre moi pour homicide involontaire. Les belles-familles sont moches. Toujours. Des chiens… Je vérifiai si j’avais encore des amis en Europe. Je n’en avais plus. La Croix-Rouge avait envoyé des empreintes dentaires à l’A.R.P.D.13Sous l’auspice du Ministère de l’Intérieur et chez l’orthodontiste que je leur avais signalé, celui qui soignait Anita. Une presse assoiffée de scandale avait annoncé sa mort en même temps que le sida de son mari veuf, alcoolique et sans domicile, continuant à courir de bars en filles. Anita n’était pas morte, je n’avais pas le sida. Mais je courais de bars en filles, souvent de soif étanchée, rarement repu d’ivresse. Je logeais chez mes potes de soûlographie ou chez des copines d’un soir qui me répudiaient le lendemain pour cause d’impuissance sexuelle. C’était déjà un exploit. Je ne faisais pas partie des milliers de farangs14 qui payaient leurs short time15 et long time16de sexe tarifé. Il suffisait de jouer le même jeu qu’elles… Simuler. Mentir sentimentalement était devenu ma philosophie. Comme elles mentaient aussi, nous attendions, elles, moi, que l’un de nous ose la vérité. Alors, je prenais mes jambes à mon cou et quittais la région. On est vite mort par amour simulé. C’est ainsi que de Phuket à Khao Lak, de Krabi à Hua Hin, je finis par m’installer dans une ville où l’argent, le sexe et l’alcool sont des institutions. Me fondre dans la corruption me permit de tenter une réincarnation. C’est un gogo-bar qui me permit de me refaire financièrement. Las de m’espionner, le patron m’aborda, flanqué de deux ceintures noires de karaté, pour m’expliquer que no money, no drink et no tip, no honey. Comme il était belge, de Liège, il s’autorisait en franglais une grossière allusion à Magritte : no tip, no pipe… Son accent à couper au couteau ne masquait pas sa fureur.
Je le suppliai de ne pas faire tabasser un frère de Jupiler. Il allait me mettre à la porte. Je n’avais pas encore assez bu. Aussi, je lui annonçai que j’allais travailler pour lui.
— Tes filles sont moches ! Je peux t’en trouver d’autres.
— Tu te fous de ma gueule ?
— Non. Demain je vais dans l’Issan. Je t’en ramène au moins quatre. De vraies poupées…
— T’es qui toi Ducon ?
— Un rescapé du tsunami. J’y ai perdu ma femme.
Son regard de pitié me rassura.
— T’as plus de tunes ?
— Ma carte est bloquée. Trop de débit. Ce n’était pas prévu.
— Pourquoi tu ne rentres pas ?
— Ben…
— Ta femme ? Bon… C’est quoi, ton job ?
— Journaliste.
— Et ici ? Tu te démerdes comment ?
— Journaliste pigiste.
— Où ?
— Au Phuket News.
Il tapota un numéro de téléphone sur son portable.
— Qui est ton employeur en Belgique ?
— En France… Une agence de presse…
— Laquelle ?
Je sortis une carte de visite écornée.
Il baragouina quelques mots en thaï dans son téléphone avant de couper. Il avait l’air rassuré.
— Tu connais Jordan ?
— Ben oui.
— Bon, attends-moi ici.
Il alla vers la mamasan vissée à la caisse derrière le bar. Puis revint vers moi.
— Tu as un passeport ?
— Oui.
— Donne-le !
Je lui tendis. Il le feuilleta sans s’émouvoir.
— T’as fait le tour du monde.
— Presque…
— Reviens demain, je te fais tamponner un visa prolongé. Et prends ça. T’auras le double.
Il me tendit dix mille bahts.
— Tu peux les boire. Mais si j’étais toi, je les utiliserais pour faire le job.
— D’ac…
C’est ainsi que je devins recruteur de filles pour un bar de Pattaya.
On se marie par amour quand on croit en la vie et on devient proxénète quand on n’y croit plus.
13 A.R.P.D. : Assistance et Recherche de Personnes disparues
14 Farang(s) : étranger(s) blanc(s)
15 Short time : court instant – long time : long moment (évaluation du temps passé avec une prostituée)
16 Pas d’argent, pas de boisson, pas de pourboire, pas de douceur
Elephant Round-up 26 novembre 2005 – Surin
« L’homme a besoin de ce qu’il a de pire en lui s’il veut parvenir à ce qu’il a de meilleur ».
Friedrich Nietzsche.
Je ne m’attendais pas à un tel tohu-bohu. Des dizaines d’éléphants peinturlurés défilaient dans les rues de la capitale de l’Issan. Le car m’avait emmené au cœur du Festival des Éléphants. Épuisé par onze heures de route, l’estomac en grève forcée, je me ruai sur le premier resto italien qui affichait des pizzas au menu. Une heure plus tard, je louai une chambre pour touriste fauché et un scooter pour me rendre dans les villages d’alentour. Je m’étais renseigné auprès des prostituées de Pattaya. J’avais quelques noms de patelins et de bars à visiter dans la capitale de la province. Le Liégeois m’avait rendu un passeport tamponné d’un visa d’un mois supplémentaire et avait honoré l’autre moitié de l’avance financière.
— Je ne veux pas d’autres frais. Tu te démerdes.
— Et pour ramener les filles ?
— Tu te démerdes !
— En train, en car ?
— En voiture privée, deux par deux.
— D’abord deux ?
— Démerde-toi !
— Bon.
— Je veux des nibards, des fesses sans cellulite et des ventres sans vergetures… Démerde-toi !
— Putain !
— Tu l’as dit.
— Et je gagne quoi ?
— T’as eu vingt mille bahts.
— Et après ?
— Si tu es bon, tu feras des allers-retours.
— OK…
— Hé ? Pas de katoeys… pas de ladyboys17… pas de tomboys18…
— C’est quoi, la différence ?
— Démerde-toi !
— Heu…
— Essaie ! Tu verras bien. Moi, je veux de la gonzesse, de la femelle, et pas enceinte, même de trois jours, d’ac ?
— Oui, oui… mais je me vois mal…
— Démerde-toi !
— Dis-moi, le Liégeois, t’as pas des forceps pour les examens gynéco…
— Ris pas avec moi ! T’as mon pognon, un visa pour un mois, et un job. Alors… démerde-toi !
La fille qui dansait sur le zinc de ce bar de Surin n’était pas de première fraîcheur, mais le mot « bar » ne désignait pas seulement un endroit où boire, mais aussi un quai pour trouver l’âme sœur… à condition que ce soit pour un short ou un long time proportionnel à ma capacité financière. Étais-je encore un homme ? Un tsunami m’avait pris le seul être qui m’avait rendu bon. Jun et Pum, mes deux filles adoptives, m’avaient immédiatement été enlevées par leurs tuteurs et la barrière de la langue. J’étais juste bon à payer. Les ordres permanents avaient été envoyés à ma banque française qui m’avait offert la gratuité des transferts mensuels aux tuteurs des deux filles. Mais ma Visa toussotait dès que je dépassais les mille bahts… Mon banquier attendait que mon nom ne soit plus dans les journaux pour bloquer définitivement mon compte.
Un humoriste français prétendit que j’avais profité du tsunami pour quitter ma femme et vivre avec des prostituées transsexuelles. Applaudissement du public.
Un autre bavard scénique ânonna que je n’avais jamais su écrire, ce pour quoi je n’éditais plus en France. Je bénéficiais d’une irritante célébrité en France et en Belgique grâce à ces vérolés de l’humour. Sans bénéficier d’aucune identité sociale ou culturelle en Thaïlande. Je n’avais jamais été bégueule avec les filles de joie, mais ce statut de proxénète improvisé troublait ma conscience. J’aurais proposé n’importe quoi au Liégeois. J’avais voulu le provoquer et j’étais mal. Il fallait que je sorte de cet engrenage. Être consommateur oui, mais pas dealer. Le slogan du Liégeois était : « Si t’as rien à vendre, t’as pas d’acheteur… » Ma survie était liée à celle de ces pauvres filles. Curieux… Passer du statut de rescapé à celui d’exploiteur…
La Bible a-t-elle oublié de dire que, pour tout Jésus il faut un Judas qui tienne la caisse ?
17 Katoyes – ladyboys : transgenres, hommes efféminés.
18 Tomboys : garçons manqués, filles au comportement masculin.
Pee 7 décembre 2005 – Surin
« Au pays des boiteux, chacun pense qu’il marche droit ».
Proverbe allemand.
Jusqu’alors, c’étaient de timides sourires entre potes, le sujet de vantardises ciblant principalement des voyages en Asie. Ici, courait la rumeur qu’une telle était devenue Miss Monde, là se susurrait à mi-mots une histoire de mec qui s’était fait surprendre dans une salle de bain subitement éclairée sur l’attribut masculin d’un(e) magnifique top-modèle.
— Il faut tout essayer ! m’avait un jour soufflé dans un aveu étrange un macho anabolisé.
J’avais peu l’habitude des excès. Une expérience sexuelle avec un transgenre constituait une trop importante trahison à mes tendances. Après des dizaines de mises en garde sur les glottes, bras et autres signes visibles chez les transsexuelles, je me disais que, pour me faire avoir, il faudrait que je sois ivre, ce que j’étais tous les soirs en pleurant sur la photo d’Anita.
Après dix nuits à errer dans les bars à filles de Surin, à marcher dans la bouse d’éléphants, à boire de la Chang parce qu’elle est moins chère que la Singha, à tuer les cafards qu’avalaient bruyamment les geckos dans ma chambre sans climatisation, je me suis réveillé au petit matin avec une fille tellement moche que je me suis juré d’arrêter la bibine tant que je n’aurais pas trouvé quatre beautés à ramener au Liégeois. Par compassion, je lui offris assez de bahts pour donner à manger à une famille thaïlandaise pendant un mois. Ses yeux perdus me remercièrent d’avoir accepté de la laisser dormir sans la toucher. L’élégance thaïe. Mais il fallait que je me ressaisisse. La région d’Issan était réputée pour la beauté de ses femmes, mais aussi pour leur pauvreté. Je l’avais choisie pour cela et pour sa proximité avec Bangkok et Chon Buri, capitale de la province où se dressait la ville balnéaire de Pattaya. Des filles jolies et pauvres, ce n’était pas cela qui manquait. Mais je n’avais aucune notion de la démagogie indispensable à tout abord avec les Thaïlandaises. On pouvait tout faire, mais rien ne se disait tel. Inviter une jeune femme à venir travailler à Pattaya pour y servir dans un restaurant n’était pas innocent, ni pour elle ni pour moi, car si rien n’était évoqué, tout était entendu, surtout les promesses financières. Je venais de passer une nouvelle nuit à pleurer jusqu’à tenter de me jeter par la fenêtre de ma chambre. Je voulais mourir. Le faux whisky thaïlandais SangSom imbibant mes muscles m’en empêcha. Je me réveillai sur le plancher à blattes.