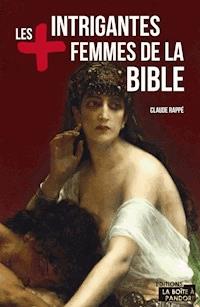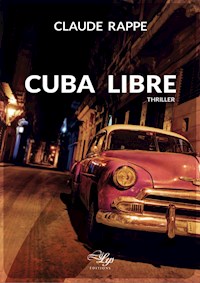
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LiLys Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jules Danver est depuis dix ans présentateur vedette du journal télévisé. Au sommet de sa popularité, compromis par le versement financier d’un parti africain, il est retiré de l’antenne et contraint de se cacher des médias. Sa vie bascule et surtout ses relations avec sa fille adorée, Judith. Lâché par tous, il doit fuir son pays et se réfugie à Cuba où il y fera d’étranges rencontres : Fidel Castro, Che Guevara et Ernest Hemingway. Puis ce sera le Venezuela exsangue et l’enfer de l’Amazonie. Mais Hemingway veille sur lui : il faut écrire pour survivre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Claude Rappe a été journaliste et producteur à la télévision (RTL) pendant vingt ans. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres historiques, thrillers, romans, essais et biographies, certains traduits en plusieurs langues. En parcourant la correspondance d’Ernest Hemingway, lui vint l’idée de tenter une alchimie entre la passion amoureuse et la solitude. Ce qui donne à lire un flamboyant et intriguant thriller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
« C’est toujours dans l’innocence que le mal véritable prend sa source. »
Ernest Hemingway
à mes filles, Esther et Catherine
Ce roman est une fiction. Tous les personnages cités, même historiques, sont placés dans des situations imaginaires et leurs propos sont fictifs.
Les citations en haut de chapitres sont extraites des écrits de Ernest Hemingway traduits de l’anglais et sortis de leur contexte
Chapitre 1
« La seule écriture valable, c’est celle qu’on invente… C’est ça qui rend les choses réelles. »
Un vent chaud soulage ma peau d’humeurs éthyliques. Ma chemise gonfle sous l’effet de la brise marine. C’est insuffisant pour me rafraîchir. Mes pas s’alourdissent. Mes pieds butent sur les pavés. J’entends vrombir le moteur d’une Chevrolet Bel Air 1953. Le chauffeur s’arrête à ma hauteur. Je perçois une voix féminine. Quelques mots gracieux à peine articulés chantent l’accent du Midwest américain :
— Do you have some light, please?1
Je m’efforce de fixer mon interlocutrice à peine posée sur le siège arrière du cabriolet étincelant de chrome et à la carrosserie d’un rouge intense. Elle est coiffée d’un carré Hermès. Son cou est fin, serti d’un collier de perles noires polynésiennes. Sa robe est soyeuse, involutée de franges blanches. Elle tend dans ma direction un fume-cigarette noir d’ivoire, prolongé d’une Lucky Strike au tabac blond.
— Of course!2
Elle plante ses yeux dans les miens. Je n’arrache même pas un sourire à sa reconnaissance.
— Thanks! You’re American?
— No, I’m French.3
Et de jeter sa main gantée de soie en direction du chauffeur qui démarre dans des volutes de fumée d’échappement. Un évasif salut se hisse du fond du siège arrière de la décapotable. Je reste là, surpris par ma galanterie et par ma faculté à rester debout. Je me pose un instant sur le muret qui surplombe la digue maritime et reçois un paquet de mer craché par une déferlante plus vaillante que les autres. La Havane s’illumine de ses feux crépusculaires. Je titube jusqu’à l’un d’eux et, m’appuyant sur un buffet zingué, commande un Papa Doble.
Le serveur dépose un Daiquiri.
— We don’t have Marasquino4, s’excuse-t-il.
J’avale le verre d’un trait et en commande un deuxième.
Un plateau garni de citrons verts, d’un pamplemousse, d’une bouteille de sirop de sucre de canne et d’une autre de Bacardi blanc glisse vers moi. Je lève les yeux sur un homme, la joue droite collée sur le zinc, le reste du corps vautré sur une chaise bancale devant un mur tapissé de portraits de Fulgencio Batista.
— À ma santé ! lance-t-il sur un ton presque agressif.
Je lui réponds par un rot disgracieux. Il rit.
— Deux limons, un demi-pamplemousse, quelques gouttes de marasquin et deux à trois doses de rhum blanc. C’est selon… Un batteur électrique et, une fois le tout vigoureusement secoué, vous dégustez la mousse…
Je tends les ingrédients au barman qui me sourit sournoisement.
— Ne vous offusquez pas, continue mon étrange interlocuteur, ils savent préparer les cocktails, mais ils sont fainéants. C’est pourtant nous qui leur avons fourni les batteurs électriques.
Je glisse plus que ne marche vers lui, lui tend la main et fixe ses moustaches pour ne pas tomber.
— Vous êtes saoul ! constate-t-il.
— Jamais !
— Comme moi. Je ne découvre jamais l’ivresse, je la couvre…
— Jules Danver. Je suis français.
— Ernest Hemingway, je suis américain.
Le sol est dur quand il est carrelé et douloureux quand on le rejoint lourdement.
— Je sais ce qu’il vous faut ! dit-il en m’aidant à me relever.
Je perçois le flou de deux verres et d’une bouteille de rhum noir.
— Il n’y a qu’une manière de masquer la lumière…
Je le dévisage, dubitatif.
— La nuit…
— Vous êtes vraiment l’écrivain ?
— Et vous ? L’êtes-vous enfin ?
— J’essaye… Mais je bois trop.
— Un homme intelligent est parfois obligé d’être saoul pour passer du temps avec les imbéciles.
Ma main saisit un verre noirci de rhum.
— Je prends les Blanches ! dit-il en remplissant à ras bord l’autre verre.
— Et moi les Noires !
— Vous devez avoir raison, tant qu’à faire que de jouer aux échecs, assumons ! La négritude est à la peau ce que le sel est à la tequila.
Un parfum de pavot bleu et de fleur de Datura épouse subitement les relents épicés de rhum et de tabac blond grillé. Un vent chargé d’iode rafraîchit le bar et une femme blonde s’avance vers Hemingway.
— Hem ?
— Yes, Gellhorn.
Elle fait un signe de la main et le serveur lui tend une coupe de gin. Elle repousse le verre, se saisit de la bouteille de rhum noir qu’elle vide au goulot et se tourne vers moi.
— Thank you for the light!5
Ernest Hemingway me regarde, ahuri.
— Si vous cherchez une quelconque liberté… écrivez ! me dit-il sur un ton désespéré.
Enfin, fixant la femme comme un marin l’horizon.
— Vous connaissez ma femme ?
— Non.
Il balaye le bar d’un regard inquiet puis incline légèrement la tête pour, dans une révérence inutile, proclamer haut et un peu fort :
— Martha, voici Jules Danvers, alcoolique français.
— Danver… pas Danvers…
— Jules, voici Martha Gellhorn… nymphomane américaine.
Et d’ingurgiter le fond de son verre.
— Ma… mon épouse ! ponctue-t-il en sombrant au pied du bar.
1 Vous avez du feu, s’il vous plaît ?
2 Bien sûr !
3 Merci ! Vous êtes américain ?
Non, je suis français.
4 Nous n’avons pas de marasquin.
5 Merci pour le feu !
Chapitre 2
« Quand on a du succès, c’est toujours pour les mauvaises raisons. »
— Mesdames, messieurs bonsoir ! Il n’est pas fréquent d’ouvrir ce journal par une information politique insolite en Afrique noire.
L’écran diffuse des images de l’arrivée d’une jeune femme sur un podium décoré de drapeaux tricolores, acclamée par une foule bigarrée de gens enthousiastes. Le présentateur continue son commentaire en off…
— Nous sommes au Haut Bangui, un état d’Afrique de l’Ouest d’à peine deux millions de citoyens. Le peuple réclame la démission de son dictateur, le Général Kolé M’bémé, au pouvoir depuis quarante et un ans. Des élections présidentielles et législatives devraient être organisées avant l’été et la toute jeune présidente du parti « Liberté et Dignité » est considérée, à la suite de ce putsch pacifique, comme une des candidates favorites au scrutin démocratique du pays. Quelques éléments d’analyses avec le reportage de Fabien Darlier et de Françoise Quévélan…
Les postes s’animent sur un montage d’images d’une durée de deux minutes. Le présentateur ajuste son oreillette. Une voix s’y glisse.
— Elle pourrait gagner Miss Monde, c’te p’tite négresse !
— Ouais… On peut inverser le sujet Yémen avec l’engueulade à l’Élysée ?
— Heu… oui. Mais Catherine me dit que Matignon vient de téléph…
— Je m’en fiche. On diffuse.
— T’es sûr ?
— Je le prends sur moi.
— OK, l’Élysée en deux et le Yémen ensuite. Sophie… Le décompte…
— Jules, ça va être à toi. On n’a pas de prompteur sur l’Élysée. Tu improvises. Neuf secondes… Cinq… Trois…
Le présentateur apparaît à l’image. Il a l’air détendu, la cinquantaine, le cheveu teint peu épais, l’œil bleu et la peau bronzée dans les cabines d’UV.
— Ce n’est pas le même climat d’euphorie qu’a connu ce matin le Président de la République lors d’une rencontre avec les agriculteurs bretons invités en délégation à l’Élysée. Ce qui devait être une démonstration de solidarité du gouvernement a tourné à l’affrontement, comme vous allez l’entendre, criblé de mots d’oiseaux à l’égard du Président de la République…
Le reportage démarre. Le réalisateur de l’émission peste.
— On va se faire allumer là, Jules ! Le téléphone chauffe.
— Je m’en branle.
— OK… Yémen ?
— Non. D’abord l’Assemblée Nationale.
— Tu cherches un licenciement ?
— Mets l’Assemblée Nationale puis le Yémen.
— D’accord. Mais pense à écrire ton testament.
Une nouvelle image remplit les téléviseurs.
Assise dans son salon, Angélique diminue le son et se sert un verre de Pulignet Montrachet. Elle soupire profondément.
— Ton père est à nouveau en crise, dit-elle à une jeune adolescente de quinze ans.
La gamine est soudée à son smartphone. Elle n’entend rien de ce qui se passe.
— Oh ! Houston appelle iPhone…
— Hein ? Quoi ? Ça va Maman, je le connais. Il teste.
— Il teste ?
— Son « quatrième pouvoir ». T’inquiètes, il finira par se faire virer…
— C’est bien ce qui m’inquiète.
— Vous êtes divorcés.
— Avec une pension compensatoire. S’il est au chômage, on compensera comment ?
La gamine se lève brutalement et sort du séjour en claquant la porte. La mère l’ouvre tout aussi violemment.
— Doucement Judith ! Doucement !
— Oh ça va ! Quand tu parles de Papa, c’est comme d’une planche à billets…
— Oui ben, c’est tout ce qu’il représente ici.
— Pour toi peut-être ! Pas pour moi.
— Ah oui ? Tu l’as vu quand pour la dernière fois ?
— À mon anniversaire, avec mon cadeau, un Mac.
— Il y a plus d’un an ton Mac. Tu as eu quinze ans le mois dernier. Il n’est pas venu. Un coup de fil, un billet pour aller voir Rihanna et basta !
— Deux billets ! On va la voir ensemble, lui et moi.
— Il se gratifie au passage ?
— Non. Il n’en a rien à foutre de Rihanna. Mais on va bouffer avec elle après. C’est ça, son cadeau.
— Ah oui ! J’oubliais que ton père est V.I.P.
— Sans lui, on serait S.D.F.
La télévision continue de diffuser son et images.
— Merci de nous être fidèles, vous avez rendez-vous dans un court instant avec la météo de Jean-Louis Sifra, bonne soirée à toutes et à tous…
Un clic. Une télécommande qui atterrit sur le canapé.
— T’as raison de citer des mots que tu ne comprends pas Danver : « être fidèle »…
Le téléphone sonne
— Oui. Ah c’est toi ? Oui… Je te la passe.
— Judith !
— Quoi, encore ?
— Ton père au téléphone…
Chapitre 3
« Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. »
Être seul est rarement un choix. La solitude devient maladie. Bercé par les vibes d’Alicia Keys, planant sur les 45° du Lagavulin de seize ans d’âge, enfoui dans un canapé en chamois, les mains pétrissant l’épais manteau de poils blancs de Nefer, une tendre chatte persane aux yeux verts, Jules ne craint qu’une seule agression, celle de la sonnerie du téléphone. Le vibreur insiste sur la table du salon. Des objets ramenés du monde entier la surchargent et la rendent impraticable, sinon au dépôt d’un smartphone. Les vibrations secouent ces souvenirs de vingt ans de voyage.
— Danver…
— Jules. C’est Jacques.
— Quoi ? Je suis viré ?
— Non. Mais Étienne veut te voir ?
— À propos de quoi ? L’Élysée ?
— Non, ça l’a amusé. Il veut qu’on « investigue ».
— Quoi ?
— Le Haut Bangui. La Blackette… Elle l’excite.
— Tu rigoles ?
— Évidemment. Mais on est les premiers sur le sujet. Il veut envoyer Duvivier.
— Ah non pas Duvivier ! Moi, j’y vais.
— Tu ne peux pas ! Le « Vingt heures »…
— Je n’ai besoin que d’un week-end. Du vendredi matin au lundi matin. Je vois ça avec Étienne…
— Jules ! Freine un peu…
— Ça va…
— Le whisky et les femmes, ça ne repose pas, ça distrait, c’est tout ! Fais gaffe à ta santé, mec.
— Ça va, je te dis.
Danver pose le portable sur la table après avoir coupé le vibreur. Il se dirige vers un buffet orné d’un dragon en bois de Java et met un autre téléphone portable de couleur rouge sur sonnerie. Il n’est utilisé qu’en cas d’urgence et uniquement par la rédaction.
— Seulement si une troisième tour s’effondre à Manhattan, répète-t-il non sans humour à ses collaborateurs depuis la couverture du 11 septembre 2001 en direct.
C’était il y a neuf ans. Lors de sa première année de présentation du « Vingt heures ». Depuis lors, le téléphone n’avait sonné que trois fois, pour deux tsunamis et un krach boursier. Il ne le branchait que lorsque son numéro privé était sur répondeur. Personne n’avait le droit de l’appeler sur ce téléphone rouge.
— Sinon Dieu, pour que j’annonce la fin du monde ! s’exclamait-il souvent.
La sonnerie retentit.
— Seigneur ? répondit-il.
— Tu sais quelle date on est ?
— Le 14 février.
— Et ça ne te dit rien ?
— Heu… c’est la Saint-Valentin ?
— Oui, la Saint-Valentin… Que je fête, le mot est faible, toute seule dans un restaurant à sushi.
— C’est mon portable d’urgence là…
— Je m’en fiche. Tu es avec une pute ?
— Seize ans d’âge.
— Salopard ! Je m’en doutais.
— Elle est fiévreuse. Quarante-cinq degrés.
— Elle suce bien, je présume ?
— Sais pas. Mais j’avale volontiers son élixir. Ça me calme. Je vais m’en reprendre une branlée tiens !
— Vicelard. Je ne t’aime plus. Je te quitte.
— Bien. On est au même point. Je ne conjugue pas au même temps, c’est tout…
— Qu’est-ce que tu… quoi…
— Je ne t’aimais pas et je t’ai déjà quittée, Agnès…
— Tu vas me le payer.
— Bon sushi ! Content que ça se passe sans moi. Tu auras été mon dernier thon.
Pour ne plus être dérangé, il coupe la sonnerie du smartphone rouge.
— Dieu attendra, se dit-il.
Chapitre 4
« Aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n’y a pas de signalisation. »
Jules Danver est entré dans le journalisme par la presse écrite. Un apprentissage heureux pour la rédaction d’un hebdomadaire qui avait une semaine de trois jours pour boucler les sujets urgents et plusieurs semaines de sept jours pour mijoter les sujets dits « marbres », culturels, analyses ou rubriques pratiques. Jules avait choisi le culturel et y avait, par goût, accouplé le show-biz, principalement la chanson de variété, car le cinéma restait l’affaire d’érudits. Une aventure qui l’avait amené à fréquenter les stars du box-office et notamment les chanteurs de pop music. Il se targuait d’avoir interviewé Michaël Jackson et dîné avec Paul McCartney. Il taisait, non sans regret, la narration de ces nuits de palaces avec des chanteuses addictes au champagne. Mais ce qui le réjouissait le plus, c’était d’avoir, en tant que musicologue confirmé par des prix de Conservatoire, décelé les talents les plus improbables de ces dix dernières années. Ce qui en faisait un funambule entre Mozart et Coldplay. Il y a cinq ans, alors qu’il assistait à une émission de téléréalité en direct, un show télévisé avec les plus belles voix de chanteurs sélectionnés par un concours, il voulut rejoindre en coulisse le présentateur du programme. Les backstages étaient noyés de monde, de champagne et de futures stars. Sauf une, l’invitée vedette du show qui ne parlait à personne. En réalité, personne n’osait l’aborder, tant elle était déjà une icône aux U.S.A. Elle venait d’interpréter : « Unfaithful ». Il s’approcha du mètre soixante-treize et capta un crépuscule d’authenticité dans les yeux brun vert de la chanteuse.
— Bravo pour votre prestation ! lui dit-il.
— Oh… Thank you very much…6
— Dans dix ans, vous serez la plus grande star du monde…
— Sorry7…
Elle se tourna vers son attachée de presse qui lui traduisit.
— Oh, thank you… You’re very kind… But, I’m just a singer…
— No! You’ll be a big star around the world!
— Thank you! Why do you say that?
— Because you have a voice of a goddess…8
La jeune femme faillit renverser sa coupe de champagne et ne quitta plus Danver du regard au cours des minutes qui suivirent. Personne n’est arrivé à rompre le lien visuel fort que ces deux-là avaient noué en quelques mots. Elle est devenue une star internationale et il s’est pris à croire qu’il était le plus grand critique musical du siècle. Il a souhaité convertir sa fille à sa ferveur. Judith est devenue fan de la chanteuse. Voilà pourquoi elle était heureuse d’assister au concert de Rihanna et d’aller manger au restaurant avec elle après le spectacle.
En rentrant, un peu éméchée par l’émotion et trop de champagne, Judith a demandé froidement à son père :
— Tu te l’es faite ?
— Qui ?
— Rihanna…
— Ça va pas la tête ?
— On dirait… Vous vous regardez comme…
— Comme quoi ? On se connaît c’est tout… Cinq ans… Ça marque… C’est une amie.
— Tu te les fais toutes !
— Ben non. Je n’ai pas envie et, quand j’ai envie, je prends des râteaux comme tous mes potes.
— T’as pris un râteau avec Riri ?
— Je n’ai pas essayé.
— Pourquoi ?
— Je l’aime trop sans doute…
— Les femmes que tu aimes trop, tu ne les baises pas ?
— Je ne « baise » pas toutes les femmes parce que toutes les femmes ne le souhaitent pas. Et moi non plus, je ne le souhaite pas.
— Tu leur as demandé ?
— Pas à toutes, mais… presque…
Ils éclatent de rire. Judith allume une cigarette.
— Non Judith !
— Ben quoi ? Tu fumes, je fume.
— Et le jour où je meurs, tu meurs aussi ?
— Oui. Je te le jure. Je ne pourrais pas vivre sans toi.
Il lui posa la main sur l’avant-bras qu’elle a soulevé pour le porter à ses lèvres. Il l’a embrassée et s’est reconcentré sur la route.
— Maintenant, je sais, dit-elle sur un air effronté.
— Tu sais quoi ?
— Pourquoi tu ne m’as jamais baisée…
— Judith ! Tais-toi ! Tu dépasses les bornes, là !
— Parce que tu m’aimes trop.
6 – Oh… Merci beaucoup…
7 – Désolé
8 – Oh, merci… C’est très aimable à vous, mais je suis juste une chanteuse.
– Non ! Vous serez une grande star internationale !
– Merci ! Pourquoi dites-vous ça ?
– Parce que vous avez la voix d’une déesse.
Chapitre 5
« Les plans de nuit ne valent plus rien au matin. »
Il ne me faut même plus réserver. Un clin d’œil à la cheffe de salle et je retrouve ma table, unique en son genre, engoncée dans une alcôve que seuls les habitués peuvent connaître. Personne ne s’y installe jamais. Il n’y a pas de vue sur l’extérieur, pas de profondeur de champ, rien qu’une table plus courte que les autres et deux fauteuils. Mais j’y suis à l’abri des demandes d’autographes et des regards curieux. Il suffit de traverser le restaurant rapidement sans lunettes solaires ni couvre-chef. Le contraire est un appel. Ma consœur Évelyne, présentatrice du journal le week-end, fait tout pour être reconnue : manteau de star, lunettes à verres teintés, écharpe griffée enveloppante et sourire permanent.
— C’est péniii… ble d’être sans cesse haaar… celée… se plaint-elle.
— Moi, personne ne m’importune !
— Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je ne peux plus faire mes courses, aller au restaurant tranquille.
— Sois toi !
— C’est-à-dire ?
— Cesse d’être le portemanteau des produits de l’avenue Montaigne. Ne scanne pas les gens. Reste simple.
— Ça doit être parce que je suis une femme.
Oui, me dis-je, ce doit être ça…
J’aime être seul au restaurant. Je courtise tous les velours rouges de la Porte d’Auteuil, Le Murat, la Brasserie du Congrès ou les petits nouveaux encore plus prétentieux que leurs aînés. Histoire d’être en plein banquet d’enfants de la télé et, en même temps, avec la même stratégie d’épier tout le monde sans que personne ne vous remarque. Ma recette : ne pas me prendre pour une personne connue. Et ça marche ! Ne plus être, avant de n’être plus. Toutes ces vedettes regretteront un jour de ne plus être que has been. Alors, qu’ils en profitent !
Aussi, à peine mes jets de houblon au vin blanc entamés que me voici marri d’être le nez sur le décolleté d’une bombe sexuelle assise en face de moi. Je ne l’y ai pas invitée. N’ayant acquis que peu de galanterie, mais beaucoup d’agressivité quand on me dérange, surtout quand je mange, je sors illico l’artillerie de mes adjectifs les plus soyeux.
— T’es qui, poupée gonflable ? Tu cherches une rustine ?
— Je savais que vous étiez un habitué.
— Je ne m’habitue à rien, surtout pas au harcèlement d’une machine à traire.
— Je savais aussi que vous étiez un mufle, mais je prends ceci pour un compliment.
Je lève le bras en direction du tueur qui tient lieu de garde de sécurité, engagé ici pour veiller sur la quiétude des innombrables drogués de popularité.
— Émile, pourriez-vous signaler à cette dame que je désire dîner seul ?
— Je lui ai dit, Monsieur Danver, mais elle m’a soutenu qu’elle était votre… enfin… excusez-moi… heu… Mademoiselle, merci de libérer cette place…
— Vous êtes ma… quoi ?
— Votre maîtresse…
Je fixe la demoiselle dans les yeux. Je ne la connais pas, mais elle a de quoi séduire la moitié de la population masculine de la planète, voire même un autre quart de femmes…
— Vous êtes fan ?
— Non, je vous suis reconnaissante pour le sujet d’hier.
— Quoi ?
Émile est occupé à dégager la chaise de mon interlocutrice. Comme je le connais, il va la soulever par les cheveux.
— Attends, Émile… Vous parlez de quel sujet ?
— Je suis Malaïka Lisumbu, la Présidente du parti « Liberté et Dignité » au Haut Bangui.
Je reconnais vaguement le visage de la jeune femme aperçue quelques secondes sur le reportage diffusé dans le journal d’hier.
— Vous venez du…
— Du Haut Bangui, d’Afrique… pour vous voir… et vous remercier.
— Voilà qui est fait. Ne préféreriez-vous pas que nous nous voyions dans un endroit plus discret, à la télé ? Pourquoi d’ailleurs ?
— Pourquoi ? Il faudra votre assentiment. Mais le 23 rue Saint F…
— Taisez-vous, malheureuse ! Qui vous a donné mon adresse ?
— Toutes les femmes françaises de moins de quarante ans la connaissent.
— Trêve de sarcasmes ! Pourquoi voulez-vous me parler ? Je ne fais pas de politique. Surtout avec une Africaine…
— Raciste ! Je veux vous témoigner ma reconnaissance et vous consulter.
— Tout à l’heure alors… À L’Oriente… 23 h 30…
— C’est où ?
— Voici ma carte de membre. L’adresse est dessus. Merci de me laisser dîner maintenant.
— À tout à l’heure, Jules…
— Et… vous, je veux dire… votre nom ?
— Je vous l’ai dit. Ciao !
Je ne peux m’empêcher de cadrer le popotin qui s’éloigne dans une impudique robe de velours rouge. Ses jambes doivent mesurer un mètre. Elle vient de larguer plusieurs missiles : le premier, ses yeux azur, le deuxième, ses cheveux noirs amples et frisés, enfin un sourire large et puissant qui rendrait la vue à un non-voyant. Mais le plus destructeur est sa voix.
— Faudra que j’en parle à Jay-Z, dis-je à Émile, plutôt heureux qu’elle s’en aille.
— OK patron ! À votre service.
— Merci Émile.
Il n’en fallut pas plus pour qu’Évelyne vienne me glisser à l’oreille :
— Bravo ! La sœur du futur président banguais. Tu es rapide en besogne. Il paraît que tu y vas pour un reportage. Bonne bourre !
— Oh, ta gueule ! Je ne me suis pas tapé le directeur de la rédaction pour devenir journaliste, moi…
— Tu devrais…
— Quoi ?
— Devenir journaliste !
À ce stade de l’inimitié que dégagent les rivalités, je savoure encore le discours du Président du Conseil d’Administration de la chaîne qui, lors de ses bons vœux annuels, évoquait notre « belle famille »…
Je me dis qu’un demi-homard suffira à faire taire mon appétit et à étancher mon incontinence de mépris à l’égard de la gent télévisée. Je décommande le baba au rhum.
Avant de jeter l’ancre à L’Oriente…
La route du rhum se gagne sobre.
Chapitre 6
« Je voudrais dépouiller le langage pour le purifier, le mettre nu jusqu’à l’os. »
Son bras gauche est tatoué d’une petite femme aux cheveux rouges et aux ailes noires. Elle tend une pomme et est enlacée par un serpent. Les légendes m’ont toujours inspiré. Celle de Lilith, mi-ange mi-démone, vient de transformer mes draps de lit en rizière. L’autre bras est griffé d’un tatouage de la lettre R.
— T’as deviné ?
— La femme noire aux cheveux rouges ? Lilith…
— Bravo ! Et l’autre bras ?
— Je ne vois pas.
— Le R de Rihanna ! Ma star…
— Je peux comprendre. Je l’aime bien aussi. Ses chansons… Ses engagements humanitaires en Afrique…
— Elle m’a permis de créer une école privée à Cotavu.
Ma rétine n’arrive pas encore à faire le point précis sur ce que je regarde. J’essaye de me déculpabiliser en comptant les bouteilles de champagne terrassées par cette folie nocturne. Décoiffée, enroulée comme un nem dans la couette, elle murmure une chanson de Serge Lama.
— Je ne baise plus, je ne jouis plus, je ne…
— Qu’est-ce que tu dis ?
— Je suis malâââdeu…
— T’as trop bu ?
— Trop niqué ! T’es un sacré Nom de Dieu de bon coup, White Ass9 !
— J’étais inspiré.
— Par moi ?
— Oui et… par la couleur de ta peau.
Elle éclate de rire. Impudique, comme souvent les Noires, avec un accent d’authenticité, comme rarement les Blanches.
— Je ne savais pas que tu honorais aussi les Blacks…
— Tu veux rire ? Elles sont ma came…
— Heu… toi, c’est plutôt le rose que tu recherches…
Et de partir dans un nouveau rire ponctué par un baiser qui m’emmène aux limites de l’apnée.
— On déjeune ?
— Petit…
— Non, il est midi.
— D’accord.
Je traîne mon peignoir de bain jusqu’à la cuisine, ouvre le frigo et constate que mon statut de célibataire affecte sérieusement mes capacités à nourrir quiconque.
— Malaïka ? Ça te dit si je nous fais livrer des croissants ?
— Yes, man!
— Parce que je n’ai que quatre mignonnettes de confitures volées dans un hôtel.
— Tu as du café ?
— Ouais, je crois. Nespresso…
— Ah non pas du Negresco… C’est du café cloné…
— Joli. Mais j’ai un Maragogype nicaraguayen et un AA kenyan… peut-être même un colombien.
— Tu rigoles ? Et un perco italien ?
— Bialetti. Plus une machine achetée d’occasion dans une trattoria de San Remo. Je suis très café.
Elle se lève et me rejoint, drapée dans la couette qui s’étend derrière elle comme une robe de mariée.
— Un cul blanc qui aime le café et le rose… Je t’épouse.
Le boulanger me promet une livraison dans la minute. Dix minutes plus tard, les croissants chauds effacent notre début de gueule de bois. Le café est tel qu’il doit être… Fort. Je la regarde engloutir deux cents grammes de farine de blé étouffée de beurre et de confiture. Elle fait comme si je n’étais pas là. Nous n’avons pas pris la peine de nous mettre à table. Elle s’est répandue telle une gorgone qui vient de sortir de la douche, parfumée à l’Ushuaïa de supermarché, enveloppée d’une de mes chemises en soie réservée aux grandes occasions. Nous avons trouvé refuge entre le canapé et le kilim du salon, assis par terre, le sexe en grève, les lèvres gercées, les corps en berne.
— De quoi voulais-tu me parler ? On n’a pas pu en discuter hier à L’Oriente. Il y avait trop de bruit.
Elle semble désarçonnée par ma question.
— Euh… non, rien.
— Ne me dis pas que c’était pour…
— Cette nuit ? Non ! Ce n’était pas dans mes…
— Tes ?
— Intentions…
— Malaïka, tu es arrivée en dégageant trois milliards de phéromones, les seins révoltés, la robe moulante, le sourire gloss et les yeux en papillons.
— C’est quoi les yeux en papillons…
— Je te le fais, regarde !
Je cligne les paupières rapidement.
— Oh… Minnie Mouse.
— Voilà… Ben merde alors, j’essayais de ressembler à Marilyn. J’insiste. Pourquoi ?
— Mon frère est élu par le parti. Grâce à toi. Grâce à ta télé. Ils regardent tous ton journal là-bas, en rediffusion. Mon oncle est un leader, mais ne veut pas monter au créneau et moi, je ne suis qu’une femme…
— Alors ?
— Alors on doit gagner au second tour, faire élire un président. Il faut faire élire mon frère. On a deux mois.
— Donc ?
— Tu dois m’aider.
— Je dois ?
— Oui. Tu m’as baisée. Maintenant, tu dois…
— Et c’est toi qui ramènes la démocratie dans ton pays… Je ne suis pas bien sûr d’avoir suivi les mêmes cours de socio politique…
— Tu baises une Black, tu paies… Normal non ?
— Heu…
— Je ne suis qu’une négwesse qui a fait nombril-nombril avec le méchant bwana blanc !
Elle rit.
— Allez ! Sois mon Jules !
— Et je devrais faire quoi ?
— Écrire ! Écrire tout, les discours, les interventions à la télé, le programme du parti, les changements à effectuer dans la Constitution… Tout quoi… Attention, ça resterait entre nous. Discrétion. Tu n’apparaîtras pas. Jamais. Tu seras juste mon nègre…
Et de rire de plus belle…
— Je ne sais pas faire ça.
— Tu fais tout très bien.
Elle me sourit.
— Tout ! Même le café !
9 Cul blanc
Chapitre 7
« Je n’ai jamais connu un matin en Afrique où je ne me réveillais pas heureux. »
S’il fallait un jour communiquer aux extra-terrestres une image intemporelle et internationale de l’architecture humaine ou laisser dans nos livres d’Histoire une trace de la civilisation du vingt et unième siècle, il faudrait joindre une photographie de nos aéroports internationaux.
Rien n’est plus mondialisé, plus représentatif de nos mœurs communes que l’intérieur d’un aéroport international. Le même fournisseur de barrières antiémeutes canalisant le même défilé de gens, certes vêtus différemment, mais portant à la main le même petit livret d’identité aux couleurs ternies, brun chocolat périmé, vert olive écrasé, bleu water-closet, marchant vers une vitre, derrière laquelle roulent les yeux d’une femme ou d’un homme poisson qui cherchent sa daphnie. Nous sommes tous nés sur la même planète et là, ça se voit plus qu’ailleurs. L’aéroport de Juba au Sud-Soudan n’échappe pas à la règle. De là, nous devons reprendre un vol dans un Fokker 50 à hélices, en direction de la capitale du Haut Bangui, Cotavu. Nous y attend une piste comme on ne les voit plus que dans les films sur les années 50, balisée par des fanions. Je n’ai évidemment pas pris les mêmes vols que Malaïka. Elle est rentrée bien avant moi. Il est peu probable qu’on se voit au-delà de la réunion officielle avec les membres fondateurs du parti.
Jean, mon cadreur, et Phil, mon preneur de son, ont emmené un minimum de matos. J’impose, quand je le peux, un ingénieur du son. J’aime le travail à l’ancienne. Nous sommes attendus par un chauffeur et sa Peugeot 504. Il en est fier et partage son bonheur. Nous installons tant bien que mal nos bagages encombrés du matériel de reportage dans un coffre qui restera ouvert, ficelé avec une corde nouée. Une fois à l’intérieur, assis sur des sièges qui ont dû servir à autre chose, je constate que le manche du changement de vitesses a été remplacé par un bout de bois. Le frein à main est un câble enroulé sur un moulinet à pêche au gros et le tableau de bord sert de cuisine intérieure. Fruits blets, pain rassis, morceaux de vieux fromage… Stabilisé par du fil de fer, un mug représentant Élisabeth II.
— Trois montres ! dit notre chauffeur en désignant fièrement les trois cadrans : vitesse, cassé, compteur-tours, remplacé par un petit réveille-matin qui fait tic-tac ou plutôt tactac et les jauges masquées par une photo de la Vierge Marie.
— Belle auto ! fais-je en pouffant.
— Vintage ! ajoute Jean.
— Very collector! approuve le chauffeur.
Nous démarrons dans un concert de klaxons. La sortie du parking implique une série d’engueulades avec nos voisins, des cris, des insultes qui se terminent toujours par un sourire sans dents, sinon une, voire deux, noircies par la nicotine et une sorte de qat qu’il mâche toute la journée. Enfin, nous cahotons sur une route dite nationale, caillassée, cratérisée de nids de poule, trempée, aux ornières boueuses. Seule l’entrée de l’hôtel soulage nos vertèbres grâce à un tarmac neuf. Nous nous laissons porter par l’enthousiasme d’un service disproportionné, mais surveillons nos bagages. Arrivé dans ma chambre, je m’étends sur un Epeda de récupération aux draps amidonnés, sous une climatisation bavant des gouttes d’eau brune sur la moquette, une bouteille d’un litre de bière à la main, la porte du minibar grande ouverte tant il chauffe à l’intérieur. Il ne manque que Shakira chantant :
— Viva Africa ! Zamina mina hé hé… waka waka !
J’ai rendez-vous ce soir avec David et Emmanuel Lisumbu, respectivement Vice-Président et directeur de propagande du parti démocratique « Liberté et Dignité » présidé par Malaïka. Il me faut bien deux heures pour lire leur programme truffé de fautes d’orthographe et de litotes incompréhensibles pour la majorité des gens.
Machinalement, je me saisis d’un stylo et rature.
À ma demande, on m’amène une bière fraîche puis une autre, toujours en bouteille d’un litre, qui sera chaude dans un quart d’heure. Phil frappe à la porte de ma chambre.
— J’ai un filon, dit-il après que le serveur est parti.
— Chouette ! C’est quoi ?
— Un village… enfin, un campement de misérables Banguais10 paraît que ce que nous allons voir est insoutenable. Le guide local ne veut pas en entendre parler. Il dit que c’est une zone interdite.
— Une zone interdite ? Par qui ?
— Par l’ancien régime encore en place. L’armée n’a pas encore choisi son camp. Pour l’instant, elle reste acquise au Général Kolé M’bémé, le dictateur. Elle interdit pratiquement tout déplacement en dehors de la capitale.
— Ben… C’est justement pour ça qu’on est là, nous. Pour visiter les zones interdites.
— OK. Je prépare ça avec Jean. Faudra trouver une parade pour le guide.
— Je m’occupe du guide.
Phil s’en va. Le téléphone sonne. Je décroche. Des voix se croisent. J’entends « Passez-le-moi »…
— Bonjour Monsieur Danver. Je suis Ebonguo Karli, le Ministre de l’Intérieur de la République démocratique du Haut Bangui. Je voulais personnellement vous souhaiter la bienvenue.
— Merci.
— Vous êtes venus dans le cadre d’un reportage ?
Je pense au sketch de Jean-Marie Bigard et ai bien envie de lui dire : « Non, je suis venu faire un tennis, connard ! », mais je me retiens.
— Le Président serait flatté d’une entrevue.
— Je vous remercie. Ce serait effectivement opportun de rencontrer le Général Kolé M’bémé.
— Je ne suis pas sûr de son désir d’interview, vu le déroulement des élections en cours, mais un entretien privé…
Je temporise. Vu les enjeux.
— C’est évident. Donnez-moi la date et l’heure du rendez-vous.
— Demain… Quinze heures au Palais…
— Ah ?… et après-demain ?
— Je ne peux pas vous garantir une autre date que demain, Monsieur Danver.
— D’accord. Je vais m’arranger.
— Vous pouvez me contacter directement sur simple injonction à la réception de votre hôtel. Bon séjour, Monsieur Danver. Si vous avez besoin de quoi que ce soit…
Voilà. Je sais où je suis. Les élections du premier tour, prétendument gagnées par l’opposition, sont toujours en cours de dépouillement. On dirait des élections en Belgique, le pays où les gens retrouvent, dans l’opposition, les partis pour lesquels ils ont voté et, au pouvoir, des minorités qui s’unissent. Pas d’interview enregistrée, la date et l’heure sont inchangeables, l’armée n’a pas choisi son camp… Nous sommes en pleine guerre civile non déclarée. Je forme le numéro que m’a laissé Malaïka.
— Bonjour Mademoiselle Lisumbu. Vous serez des nôtres ce soir ?
— Oui. Si vous le voulez bien, Monsieur Danver.
— Je le souhaite. Vous êtes la présidente du parti élu.
— Je suis en phase de démission, mais je serai là.
— Bien. À tout à l’heure Mademoiselle.
Voilà qui nous change de l’atmosphère de notre première rencontre. Mais nous sommes suffisamment peu naïfs pour savoir que tout est toujours sur écoute en politique, démocratique, théocratique et surtout « hypocratique ». Je m’allonge et me surprends à rêver de son corps. J’ai peu d’autres souvenirs d’elle. La destinée de cette graduée en droit politique, parfaite francophone et meneuse d’un parti au programme démocratique dans une dictature africaine me séduit. Cette femme m’épate et je me sens lentement fondre pour elle.
C’est toujours dangereux de se mettre à aimer.
Surtout lentement…
10 Le Haut Bangui est une république imaginaire entre le Soudan Sud, l’Ethiopie et le Kenya. Chaque pays revendique la zone sous sa bannière mais c’est une zone de non-droit que j’ai choisie pour cela. Donc les habitants sont des Banguais, Banguaises qui parlent le Bangui. Rien à voir avec la capitale de la République centraficaine. Mais ils parlent la même langue.
Chapitre 8
« D’une utilisation imprécise, tous les mots ont perdu leur tranchant. »
Ce qui est plus rapide que l’amour, c’est la fatalité.
Je croise une femme éteinte à l’entrée de la villa délabrée où a lieu notre rencontre avec les leaders du parti « Liberté et Dignité ». Larguées, les phrases élégantes à l’humour subtil et compétitif. Elle sourit timidement et n’a visiblement pas du tout envie que quiconque se doute de notre relation. Tant mieux. Ce n’est pas que je sois lâche, mais on n’annonce pas les bans pour une nuit de sexe.
Son oncle Emmanuel est hors-jeu. Je le sens propulsé dans une aventure dont il redoute les conséquences. Il ne sera probablement qu’un excellent second de David, le frère de Malaïka. Ce dernier a d’emblée le sourire diplomate, les mots de bienvenue convenus, le sens du consensus facile.
Nous installons caméras et microémetteurs, une mandarine d’éclairage presque inutile en cette mi-journée et attendons les verres de limonade qui donneront un air de décontraction au décor. Seul David souhaite répondre à mes questions. Emmanuel ne reste pas loin derrière moi, les yeux braqués sur son neveu, le carnet et le marqueur prêts à lui dicter quelques mots. Malaïka refuse toute interview, sous le prétexte que le protocole de démission est largement entamé, évoquant des raisons familiales.
L’Africain me fascine. Il ment sans scrupule. Bon enfant, simple, il est pourtant plus intelligent que nous. C’est insipide, mais évident. Seule une maladresse pourrait confondre un Africain. Alors que, nous, nos certitudes nous rendent arrogants. Lui reste altier et ne répond que des phrases de Normands. C’est inouï ! Une fois pour toutes, la colonisation l’a expurgé de l’orgueil du prétendu savoir, mais pas de l’intuition, la matière première de l’intelligence. Le comprendre nous éviterait un jour de nous faire dévorer par l’Afrique. Les lois économiques sont plus fragiles que les idéologies et les Africains sont prêts à tout pour se libérer de nous. La Chine l’a tellement bien compris. L’Afrique est disposée à la subir pour créer une indépendance par rapport à l’Europe. Alors, nous coloniser est un défi à l’issue improbable, mais un espoir tellement fou. Si les femmes l’ont compris, au lit, les hommes devront le jouer, en politique et en affaires. Mobutu Sese Seko, Léopold Sédar Senghor, Jean-Bedel Bokassa, Nelson Mandela, tellement différents, oscillant entre dictature absolue et culture étendue, abnégation et fornication, totalitarisme, cruauté et dignité, avaient, lors de mes interviews, manifesté le même désespoir : non pas d’être noirs, mais de rester « négros ». Ce que j’entendis de pire, après avoir cité Brel et sa magnifique phrase « l’élégance d’être nègre », est sorti de la bouche d’une femme, une Noire, congolaise, belge sur son passeport, qui, après un coït orgasmique partagé, regardait mon sexe repu et minable et dit :
— L’inélégance d’être un Blanc !
Comme si la nudité était plus impudique pour un Blanc. Ce n’était pas mon organe ratatiné qui lui inspira cette agression verbale, mais son état de femme réglée. Un peu de sang s’écoulait sur les draps. Elle ne m’avait pas prévenu. Ça la faisait rire et me mettait en colère.
— Quand assumerez-vous, Petits Blancs ?
Je réalise l’éphémère de la situation actuelle. Rien n’est fait. Je vais interroger le leader d’un parti politique qui aurait gagné le premier tour des élections alors que les dépouillements ne seraient pas terminés, s’opposant à un dictateur du siècle dernier que l’armée suit. On ne s’assagit pas dans mon métier. On reste des rêveurs qui croient au destin en espérant y contribuer. David est très vite à l’aise. Je fais tout pour cela. Mais reste dans les clous. Pas question de devenir à mon tour consensuel. Alors qu’il m’énumère les aberrations du système politique actuel, la misère des gens, l’inacceptable richesse de la caste du Général Kolé, je lui demande :
— Qu’allez-vous faire de mieux ?
Alors qu’il m’étale comme un vendeur de casseroles les promesses d’un candidat enthousiaste, je le coupe :
— Comment ?
— Je… je n’en sais rien. On peut couper ?
— C’est peu dire…
— Oui. Je le reconnais. Mais nous y arriverons, sinon…
— Sinon ?
— Nous mourrons tous.
Je fais un signe à Jean. On coupe. C’est magnifique !
Je la tiens mon interview. J’imagine le final du reportage : « Sinon ? Nous mourrons tous… » Aucun homme politique occidental n’oserait parler ainsi. Là, je le sens, il va être élu. C’est magique ! On me sert un Chivas. Tant pis, c’est du whisky de Saoudien, mais je l’avale d’un trait, imprudemment, avec les glaçons fabriqués avec l’eau de la rivière. Non sans souhaiter « bonne chance »