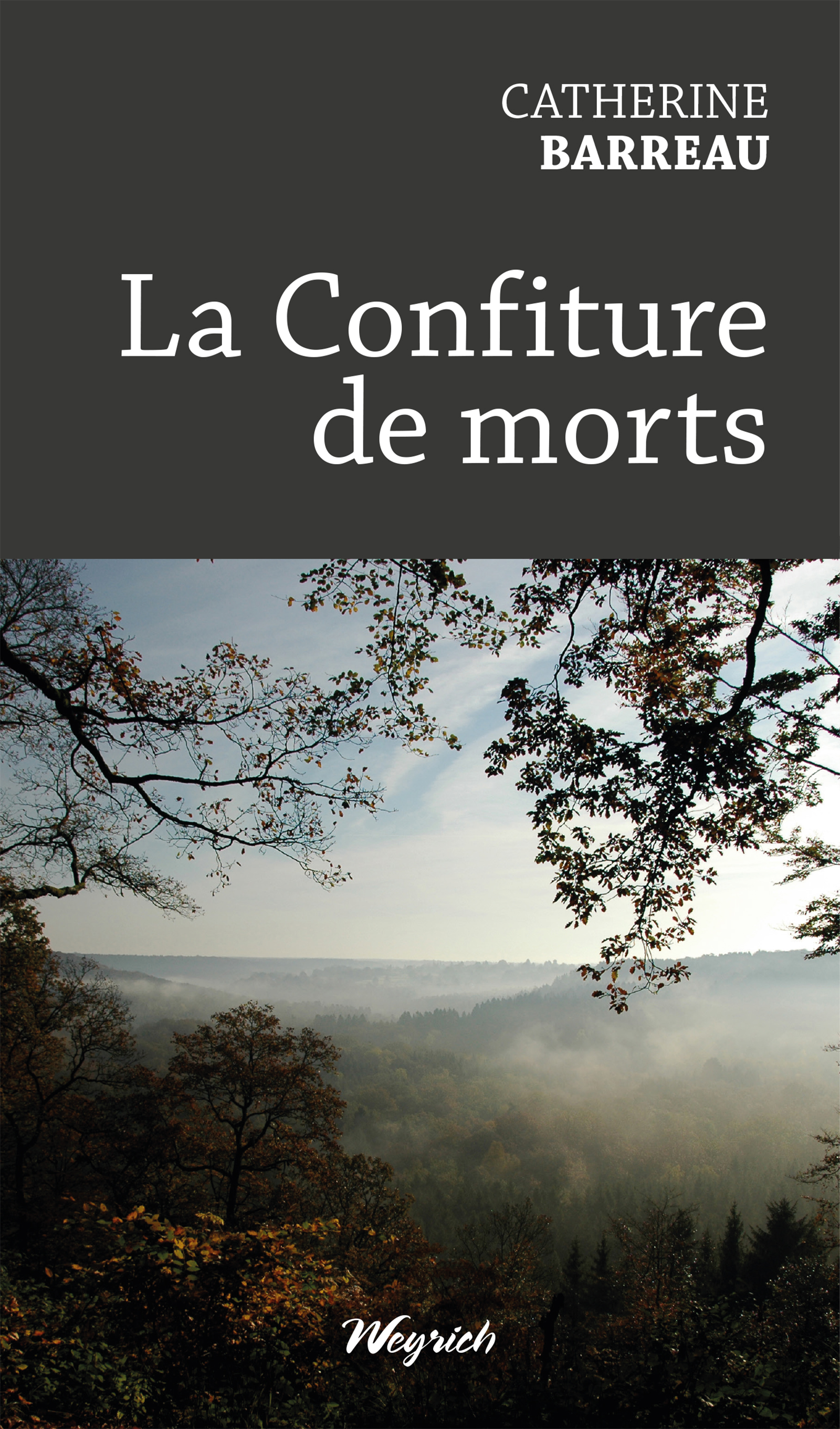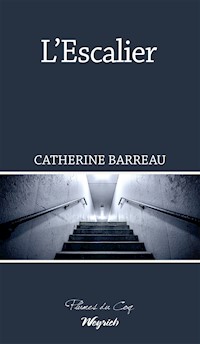
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ils sont trois, Rita, Georges et Jean-Charles. Ils n’ont a priori rien en commun et pourtant ils vont partager pendant de longues heures une expérience inattendue: se retrouver bloqués dans la cage d’escalier d’un bâtiment administratif à Namur. Trois individus pris dans la nasse, et qui ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer au-dehors pour les coincer de la sorte. Il va falloir s’apprivoiser et, surtout, survivre. Trois personnages en quête d’une issue et d’un destin.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Catherine Barreau vit dans la région namuroise. Elle a déjà publié le romans
Quatre attentes chez Academia. Elle pratique la pêche à la mouche et la soudure à l’arc.
La Confiture de morts, un subtil roman d’apprentissage, est le deuxième titre qu’elle publie dans la collection Plumes du Coq, après
L’Escalier en 2016.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’Escalier
Il les a entendus se saluer : au revoir, bon week-end, à lundi. Des déplacements dans le couloir, des blagues, les mêmes chaque vendredi. On a proposé des capotes à qui en voudrait, quelqu’un a conseillé du Viagra. Personne n’a passé la tête dans son bureau, personne n’a attendu sa voix. Deux ans qu’il existe sans vivre, ses collègues se sont adaptés, ils lui foutent la paix. La paix, non, ce n’est pas le bon mot. Son bureau jouxte le cagibi des produits de nettoyage. Un signe.
Il regarde la petite saillie dans le mur extérieur, sous le rebord de sa fenêtre. La pierre de taille est rongée par les fientes de pigeon. Plus bas, une femme claudique sur les pavés disjoints de la rue de Fer, elle tire un caddie rouge ; elle marche, penchée en avant, et son mouvement fait claquer les pans de sa veste sur ses flancs. Elle secoue ses cheveux mauves et lève la tête vers lui. Elle le regarde, il recule. Que voit-elle ? L’ombre d’un fonctionnaire qui sirote du café froid dans un gobelet en plastique. Cette habitude de ne plus se reconnaître, la défaite de soi. Les yeux de cette femme le réveillent. Qui sommes-nous l’un pour l’autre ?
Il sursaute. Une mouche a heurté la vitre, produisant un bruit mat à côté de son oreille ; elle grésille, longtemps, et quand le bruit aigre s’interrompt, elle se pose et explore la surface en segments illogiques. Son petit corps louvoie sur la fenêtre, elle cherche une issue ; elle décolle, se pose et se frotte les pattes sur les yeux. Elle reprend son exploration, s’obstine à sortir en se jetant contre le verre et elle vrombit, s’écarte, revient se cogner. Elle s’éloigne et va tournoyer au centre de la pièce, au centre de rien, où elle décrit des spirales elliptiques sous le néon ; une peau de banane brunie dans la poubelle l’occupe un moment.
Georges ne reconnaît pas la main molle et gonflée, il se demande ce qu’il devient et à quoi il s’accroche ; il jette le gobelet dans la poubelle, il cherche la mouche. Elle est posée sur le bureau, elle y suçote une trace visqueuse ; il ne se souvient pas avoir eu les doigts gras ni les avoir posés là. La mouche précipite son vol vers la fenêtre, bute sur la vitre, rebondit sur le verre ; elle vibre et gigote ; elle retourne à son vol rond et creux au milieu du vide.
Il ferme la porte de son bureau, avance dans le couloir. Il quitte toujours le bureau le dernier. Il ne sait pas que c’est la dernière fois.
Il insère sa fiche dans la pointeuse, passe devant le distributeur de snacks et sort du couloir de l’administration communale pour descendre au parking. L’ascenseur est en panne, une fois de plus. La mouche verte suce une tache sur son veston, il ne l’a pas vue sortir avec lui ; il l’écarte. Ses cuisses frottent l’une contre l’autre, son ventre pèse devant lui, son cou gonflé l’oppresse.
Il pousse la porte coupe-feu en se disant qu’il lui en aurait fallu, des portes coupe-feu, pour le protéger de ses incendies. Le claquement est suivi d’un déclic inhabituel, puis l’écho résonne dans la cage d’escalier qui sent la poussière humide et l’urine. Qui peut bien pisser ici, se demande-t-il en posant le pied sur les marches trop courtes. Des chewing-gums noircis, écrasés, sans relief, tachent le carrelage jaune du sol. Plusieurs nez de marche sont ébréchés, ils ressemblent à un bord de falaise. Et à sa vie. Il pensait avoir le temps, jusqu’au moment où il a compris qu’il était trop tard. Alors il a fait de son existence une vallée de larmes ; le sel croûte sa terre, rien n’y pousse. Une vallée si profonde, si sombre et si lointaine qu’aucun animal n’y descend, qu’aucun humain ne la connaît. La pluie elle-même ne s’y risque pas.
Il descend une volée de marches en soufflant. Au palier suivant, la femme aux cheveux mauves entre, elle porte une veste pied-de-poule. Elle tire le caddie rouge qui se coince contre le chambranle de la porte, elle le dégage par saccades, elle le soulève et s’enfonce dans l’escalier, devant Georges. Elle s’accroche à la rampe de formica noir en retenant, de l’autre main, le caddie qui cogne ses jambes et tinte à chaque secousse. Elle s’arrête sur le petit palier intermédiaire avant de reprendre sa descente vers le parking ; il la suit, quelques marches plus haut.
La porte coupe-feu du niveau rue se referme derrière lui avec le déclic qu’il a entendu à l’étage des bureaux. Georges se retourne. Le grand type qui vient d’entrer dans la cage d’escalier s’arrête ; il consulte son iPhone. Comme si c’était lui qui choisissait, comme si cet arrêt ne dépendait pas de moi qui bouche son passage mais d’une tâche plus noble, pense Georges en regardant l’homme en contre-plongée. Ce costume doit coûter un mois de son salaire de fonctionnaire. Son fils Jean pourrait développer ce style, pour le bonheur de son grand-père et de Jacques : beau, athlétique et distingué. Il y a les gagnants et les loosers, les battants et les capitulards, il a choisi son camp. Il reprend la descente, son imper informe plié sur le bras comme une dépouille. Il pense à saint Barthélemy, portant sa propre peau après son martyre.
Des bruits montent du niveau inférieur. Des cliquetis et quelques jurons. Du palier de repos, il voit la femme aux cheveux violets agiter la poignée de la porte qui mène au parking. Elle se tourne vers Georges : « Nom di Dju ! C’est coincé ! » Il la regarde se trémousser, lui dit de pousser ; « Ben oui, je fais que ça ! Qu’est-ce que vous croyez ? » Elle essaie encore, elle s’appuie des deux mains à la tige métallique et donne un coup de l’épaule. « C’est coincé », reprend-elle en le regardant. Le grand type en costume qui attendait derrière eux soupire : « C’est pas vrai ! »
Georges rejoint la femme, il doit déplacer le caddie contre le mur pour glisser son corps bouffi près d’elle et essayer d’ouvrir la porte. Il donne des coups saccadés sur le panneau orange en baissant la poignée. Il regarde l’avertissement collé sur la porte : Cette porte coupe-feu doit rester fermée. Ça l’amuse, il sourit à la femme, elle fronce les sourcils : « Quoi ? », il lui montre la phrase en lui disant qu’au moins ils respectent le règlement. Elle fixe l’écriteau, ses lèvres articulent en silence, lentement, dans une grande concentration la succession des syllabes, comme un enfant qui apprend à lire. Elle répète la fin de la phrase à mi-voix : « doit-rester-fermée », puis se tourne vers lui : « C’est malin ! », s’esclaffe-t-elle, dévoilant une pagaille de petites dents jaunes et grises. Elle baisse les yeux et se couvre la bouche d’une main noueuse, trop abîmée pour son âge, pense Georges.
Il secoue encore la poignée sans succès, ses joues tremblent comme des bouillottes. Le mécanisme est trop lâche, sans résistance, on dirait qu’il n’est plus relié à la serrure. Elle pouffe encore. Ils rient.
« C’est pas vrai ! J’ai autre chose à faire, crie le grand type. Mais ouvrez donc cette porte. » Il descend les six marches : « Bougez-vous. » Ils se plaquent contre le caddie, l’autre semble convaincu de réussir où ils ont échoué. Georges doit remonter trois marches pour le laisser passer, son ventre frôle la cuisse musclée. Ça a dû lui arriver souvent, à cet homme, de se révéler plus rapide, plus intelligent, plus efficace que les abrutis ordinaires. Ce mépris captive et fascine Georges ; il a pitié d’eux trois. Le grand type tente d’ouvrir la porte d’un geste net et ne leur parle pas quand il constate : « Cette porte est bloquée. Je ne peux pas le croire ! Qu’est-ce que c’est ce foutoir ? Services publics ! Incroyable. » Il se retourne, monte au niveau rue.
Ses pas résonnent dans la cage d’escalier : il agite la poignée, puis se rue plus haut, à l’étage des bureaux. Même son, même échec. Georges crie : « En haut, c’est normal, les bureaux ne sont plus accessibles après dix-sept heures », et à la femme, debout en contrebas, il ajoute qu’ils doivent attendre. Quelqu’un finira bien par rejoindre le parking. « Va avoir du mal à attendre, l’autre excité ! », dit-elle en montrant du pouce les étages supérieurs. Elle demande à Georges s’il connaît le bâtiment. Il lui explique qu’il y travaille.
« Il me semblait bien. Je vous ai vu à la fenêtre tantôt, en passant dans la rue, je vous reconnais. C’est quel service ?
— Les actes de décès.
— Ah », fait-elle.
Il hoche la tête, ils lèvent les yeux sur le vide, entouré par la rampe, qui s’arrête au plafond du deuxième étage ; ils clignotent un peu sous la lumière du néon. Il n’ose pas remonter les marches, il a peur de sembler la fuir, il l’observe ; un parfum bon marché lui pique le nez, des petites croûtes blanches pèlent au coin de ses yeux, elle a des repousses grises à la racine des cheveux. Cette peau sèche, cartonneuse et ravinée lui rappelle le papier ingrain, ce cache-misère qui couvrait les murs chez sa grand-mère.
Il s’assied sur la quatrième marche, vierge de chewing-gums écrasés, il pose l’imper sur ses genoux ; la femme reste debout, elle s’appuie à la porte du parking, la main sur son caddie. Elle désigne le carrelage.
« Ça, c’est du travail de cochon ! Matériaux de mauvaise qualité. Mal ragréé, mal taloché, mal équerré ! Mal foutu, vite fait, vite payé, vite abîmé, dit-elle, et elle pointe l’escalier du doigt. Mettre un carrelage pourri comme nez de marche, c’est une connerie de débutant !
— Vous vous y connaissez en carrelages ?
— Mon mari est carreleur », dit-elle et il la voit rougir.
Georges hésite, il ne sait pas ce qu’il doit faire, il la félicite. Elle passe du rouge à l’écarlate et son sourire s’agrandit ; elle cache sa bouche avec la main, remonte le col de sa veste sur sa gorge. « Bon sang, j’espère que ça ne va pas traîner, mon homme va se demander quoi, je devais lui ramener un outil et j’ai mon souper à faire, moi. Les gosses sont rentrés à la maison, il va râler ; les devoirs, c’est pas une partie de plaisir quand ils s’y mettent, dit-elle en fronçant les sourcils. Je me demande si l’autre excité nous trouve un truc en haut. »
La voix puissante du grand type leur parvient : il appelle quelqu’un, il laisse un message sur un répondeur, il semble qu’un certain Marty soit sommé de trouver rapidement une solution à son problème. La femme soupire, elle hoche la tête, « Moi, c’est Rita », et elle demande à Georges comment il s’appelle. Elle trouve que, s’il faut rester coincés, c’est mieux de se connaître un peu. Georges la rassure : il serait étonné de devoir rester là des heures, il y a pas mal de passage, d’habitude.
« Avec mon bol dans la vie, vous allez voir, on va pas y couper, et j’imagine même pas la tête de Freddy quand je vais lui expliquer pourquoi je rentre en retard avec la voiture et qu’il aura dû s’occuper des gosses tout seul, ça va pas lui plaire… Encore bien si on ne doit pas payer un supplément au parking. Et qu’en plus j’étais coincée avec deux hommes, je sais pas comment il va le prendre, mais je ne vais pas lui mentir parce que dès que je ne dis plus la vérité, il le sent, il a le nez fin pour ça. Je verrai bien, et vous, y a quelqu’un qui vous attend ? »
Georges répond que non, personne ne l’attend. Nulle part. Jamais plus. Le dire tout haut lui paraît étrange.
« Comment ? Désolée, je n’entends pas bien.
— Non, on ne m’attend pas, dit Georges plus fort.
— Ah. Pour l’occasion, c’est une chance. C’est quand même la première fois de ma vie que je suis coincée dans un escalier. Dans un ascenseur, ça, oui, d’ailleurs y a toujours des alarmes ou des téléphones. Ici, rien, je m’étais jamais rendu compte que c’était vide à ce point-là, un escalier. Même pas un tuyau quelque part ; faut dire que c’est moins stressant que d’être coincés dans un ascenseur, pas de chute et il y a de la lumière… Et on est à l’abri de la pluie. Bon ben, on va attendre encore un peu, mais ça devient long, dit-elle en plongeant la main dans sa poche pour en sortir un GSM. Pas de réseau ! Moi, en tout cas, je ne paierai pas de supplément de parking ! »
Il observe son Nokia. Le numéro de téléphone du concierge est dans le répertoire, ils devraient peut-être aller au rez-de-chaussée pour essayer de capter du réseau. Ils montent un étage, elle emmène avec elle le caddie qui lui martèle la cheville. Ils regardent leurs écrans : toujours rien. Elle crie dans la cage d’escalier : « Vous avez du réseau en haut ? »
Après quelques secondes, l’autre répond : « Faible. Intermittent. » Georges conseille à Rita de redescendre près de la porte du parking, quelqu’un pourrait arriver, il s’étonne qu’il n’y ait personne. Il va monter pour essayer de joindre le concierge.
Chaque marche l’épuise, il sent la sueur qui coule le long de sa nuque, ses cuisses qui frottent l’une contre l’autre et son ventre qui dodine par-dessus la ceinture. Un peu de liquide tiède s’écoule sur son sein. Du lait. Un des effets secondaires des médicaments : hyperprolactinémie iatrogène a dit le docteur Luth. Il n’en peut plus des noms barbares, des symptômes, de la camisole chimique.
Arrivé au dernier palier, il n’a plus de souffle ; le grand type est appuyé contre le mur, il pianote sur son iPhone, le rapproche de son oreille, reprend sa manœuvre. Au quatrième essai, il sourit et laisse un message : c’est Jean-Charles et Marty a intérêt à se magner vite fait pour le sortir de ce merdier. La communication semble interrompue. Le GSM de Georges ne capte toujours rien, il demande à l’autre s’il a du réseau. « Un peu », dit-il en continuant à fixer son écran et Georges lui propose d’appeler le concierge. Il consent. Georges lit le numéro sur son répertoire. « Ça sonne, dit Jean-Charles. Tenez. » Quand Georges prend l’appareil, la sonnerie s’interrompt, il murmure qu’il faut recommencer, que la liaison a été coupée.
— Qu’est-ce que vous avez foutu ? demande Jean-Charles.
— Rien, dit-il. Et c’est probablement la réponse la plus juste qu’il ait prononcée depuis des années. Alors il la répète : Rien, je ne fais rien, je n’ai rien fait, c’est la meilleure façon de ne causer de tort à personne. D’être indemne d’échecs, immunisé des réussites aussi.
L’autre le fixe et la neutralité de son regard estompe l’humanité de Georges, alors il en rajoute, il ne sait réagir que comme ça : tenir, amplifier son inconséquence : « Je n’ai rien fait et je me demande même si j’ai vécu. » Jean-Charles lui adresse un sourire ironique, urbain et bref. Faux. Orthodonté, se dit Georges, en se rappelant le chaos dans la bouche de Rita. Aujourd’hui, on distingue les pauvres des riches à leurs dents.
Jean-Charles essaie de joindre le concierge avec la touche rappel, il compose le numéro quelques fois. Pas de connexion. Soudain, l’iPhone vibre, et il décroche.
« Quoi ? Quelle catastrophe ?… Quoi ? Écoute, Marty, si je ne suis pas à Nassau demain, si on foire la mission, je te jure que tu vas savoir ce que c’est une catastrophe ! Allô ? Allô ? Putain ! C’est quoi ce bordel, crie-t-il en agitant le téléphone.
— Un problème ?
— Il n’y a plus aucun réseau, répond-il, et il semble déconnecté, lui aussi. Merde ! C’est quoi ce cirque ? Je dois être à Luxembourg ce soir. Nassau demain. »
Georges ferme les yeux. Un léger vertige l’étourdit, ce n’est pas désagréable, il est habitué, et où mieux que dans cette cage d’escalier serait-il à sa place ? Cet enfermement le réconforte ; rien d’autre qu’attendre, sans désir, sans espoir et sans échéance, aucun blâme à sa passivité. Enfin. Il redescend auprès de Rita.
Mon obésité. Ce gros ventre me précède et me guide. Comme ça, mon flanc glisse contre le formica de la rampe. La graisse qui m’entoure et me confit. Elle balance, ensachée dans ma peau, je suis l’enveloppe et le squelette et la victime et le bourreau. Pas cet obèse qui descend les marches. Trop de violence, j’ai un airbag permanent, aucun choc ne peut me briser les os. Je est un autre. Caché au centre, bien à l’abri, un noyau vital. J’aimerais tellement épingler mon propre acte de décès au revers de mon veston. Je le rédigerais avec soin. Je pourrais joindre le certificat médical de ma dernière hospitalisation. Une existence qui se terminerait dans l’absurdité choisie. Résoudre le problème. Définitivement. Être à la hauteur de leurs attentes, rude, cruel et cynique, confondre l’intelligence et la férocité. Cette mouche qui s’obstinait à vouloir traverser la vitre, elle est plus courageuse que moi. Ma reddition. Je pourrais écrire avant, raconter. Ou trouver une signification, donner un dessein à ma vie calamiteuse et à son terme. Non. Et castré, et maté, et subordonné, je m’applique encore. À quoi, Georges, tu t’appliques à quoi ? À vivre ; à espérer écrire ces phrases qui m’obstruent les veines. Castré, maté, subordonné et coincé. Pourquoi ne pas lâcher ? Rita. L’humanité sans fard. Une intention.