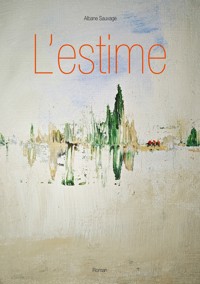
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Célia ne sait plus très bien où elle en est. Son métier au sein d'un grand journal, qu'elle aimait par-dessus tout, pour lequel elle s'est investie jusqu'à en oublier sa vie personnelle, a muté en un autre, désincarné et froid, dans lequel elle ne se reconnaît plus. Elle décide d'évaluer ses compétences, sans trop savoir à quoi s'attendre. Le résultat de l'un des nombreux tests auxquels elle se plie va tout remettre en question, au delà de ses aptitudes professionnelles ; élément déclencheur d'une véritable révolution intérieure bien plus profonde qu'elle ne l'aurait imaginée. Sa joie de vivre et sa spontanéité auraient elles masqué une part plus sombre d'elle-même? Soutenue dans ses choix par ses amis de toujours, une vie heureuse qui renoue avec l'essentiel lui est promise. Mais est-elle prête?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESTIME (n.f)
1. Sentiment favorable né de la bonne opinion qu’on
a du mérite, de la valeur (de quelqu’un)
2. [MARINE] : Calcul approximatif de la position
d’un navire en estimant le chemin parcouru.
Le Petit Robert
NJUT \njut\
Impératif du verbe suédois njuta
Traduction française : Profitez, savourez,
amusez-vous, appréciez, jouissez…
« Il n’y a rien de plus profond
dans l’existence humaine que l’estime de soi. »
Sándor Márai
« La vie est bien trop courte pour la perdre à paraître,
s’effacer, se plier dépasser, trop forcer.
Quand il nous suffit d’être, et de lâcher tout combat
que l’on mène bien souvent qu’avec soi,
pour enfin faire la paix, être en paix.
Et vivre. En faisant ce qu’on aime,
auprès de qui nous aime, dans un endroit qu’on aime,
en étant qui nous sommes. Vraiment. »
Alexandre Jollien
Sommaire
Prologue
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Remerciements
Prologue
1% artistique, c’est l’obligation de décoration d’une construction publique. 1% de céramide, de rétinol, de peptide de cuivre ou de ciclopirox olamine, c’est ce qu’on nous vend dans une multitude de crèmes pour une jeunesse retrouvée, une peau élastique et moins sèche. 1% for the Planet, c’est la part du chiffre d’affaires annuel que certaines entreprises s’engagent à verser à des associations de lutte pour l’environnement.1% logement ou 1% patronal, c’est la participation des employeurs à l’effort de construction. 1% c’est un jeu vidéo dans lequel les joueurs interprètent les membres d’un club de motards en marge de la société. 1% c’est le reste de batterie qui anime mon smartphone après une journée. 1% c’est l’arôme de truffe blanche dans les chips que je pioche directement dans le sachet, calée au fond de mon canapé en regardant un film idiot à la télé – je me suis bien fait avoir sur ce coup-là.
1%. C’est le résultat que j’obtiens à l’un des nombreux tests que je viens de passer.
Gestion des émotions : 1%
1
Le chiffre est écrit sous un baromètre qui montre clairement, à renfort de couleurs vives, que la moyenne de la population mondiale se situe entre 33% et 61%
- Nous reviendrons plus tard sur cet item, Célia, si vous voulez bien…
Mes yeux restent fixés sur l’écran. Une microscopique barre horizontale bleu ciel quasi transparente, inexistante, essaie de se la jouer à côté de colonnes qui paraissent démesurées, vantant les qualités de gestion d’autres candidats que moi. À droite, il y a mon prénom, Célia, c’est bien moi, inscrit en gras, qui rappelle le chiffre 1% en gras lui aussi, et un texte que je n’ai pas le temps de lire. L’homme scrolle pour passer à la suite.
La deuxième page est plus flatteuse, la voix de l’autre côté de l’écran se veut rassurante, mais mon esprit reste bloqué. Je pense à un défaut de fonctionnement de l’étude ou de l’analyse des résultats ; mais pas la voix, car elle continue, sourire dans les cordes vocales, à m’enduire de bienveillance en lisant les indications concernant ma mémoire, mon implication dans le travail, mes systèmes d’organisation, de pensée, mes liens avec les autres, l’ambiance professionnelle dans laquelle j’aime m’épanouir.
J’acquiesce, je souris, je réponds par des phrases courtes aux questions qui me sont posées.
À cet instant, je trouve étrange de parler à un écran alors même qu’il est question de gestion des émotions. Ou plutôt de l’absence de gestion, me concernant visiblement. Le néant. Comme si je ne savais pas quoi faire d’elles, où les ranger, comment réagir.
Je ne sais plus vraiment où j’en suis. Plus très envie de me lever chaque matin pour ce boulot. Manque d’énergie, de mordant, d’excitation… J’ai avalé du zinc, du magnésium, de la vitamine B, de la C, de la D, la pharmacienne m’a même vendu un flacon de gélules, avec indiqué sur l’étiquette Bon état d’esprit, mais je n’ai vu aucun effet. Je suis devenue triste, sans énergie, presque sans vie.
La pandémie a tout bouleversé. Tout s’est modifié en quelques mois et nous nous sommes adaptés. Prendre un café avec un client semble appartenir à un temps révolu. Je ne suis plus très sûre d’être à ma place. Je ne suis plus certaine de trouver un quelconque attrait à vendre de l’espace, planquée derrière un écran.
Je ne sauve la vie de personne et me mets pourtant dans un état de stress permanent, alors que je devrais être au nirvana. Mon équipe est sympa, je travaille avec des gens passionnés, je gagne plutôt bien ma vie, mon chiffre d’affaires est en hausse malgré le climat économique, j’obtiendrai des intéressements plus importants encore cette année et l’essentiel, j’en suis consciente, je vais bien, enfin il me semble car je me sens à bout de souffle.
Je me suis inscrite sur cette plateforme pour un examen de conscience, une remise en question de mes capacités professionnelles.
Revenir à l’essentiel. Envie d’autre chose ou d’ailleurs, pourquoi pas ? Créer du lien, accompagner mes semblables, leur apporter un bout de mieux dans leur vie, plutôt que les inciter à acheter encore et encore en leur infligeant publicité, réclame et promotions sur papier glacé ou sur écran lisse.
Plus qu’un besoin, une nécessité ; j’ai décidé de réaliser un bilan de compétences pour voir où m’amènent mes aptitudes, mes qualités, faire table rase des années d’expérience engrangées méticuleusement, conduites dans le seul but d’être meilleure, plus performante, valorisée, compétitive, m’assurer une vie confortable.
L’homme est dans une toute petite fenêtre en bas à droite, impalpable… Je ne sens pas son odeur. Est-ce qu’il se parfume ? Je n’ai pas de contact avec lui. A-t-il les mains rugueuses ou bien douces ? Mon esprit part à la dérive furtivement…
« Vous êtes comme un voilier qui cherche le vent… », avait-t-il prononcé au téléphone lors de notre premier entretien.
C’est exactement ça ! Une image de barque à la voile faseillant au milieu de l’océan m’est apparue, gilet de sauvetage trop serré qui engonce mon corps et me serre, ce dériveur que nous possédions à Noirmoutier et que mes parents avaient vendu lorsque j’étais adolescente, un Vaurien. Tiens !?
J’ai signé pour deux mois de téléconsultations, ponctuées de plusieurs tests appelant la neuroscience, la logique et une véritable aventure intérieure.
Résultat au milieu d’une foule de qualités plus ou moins reconnues : « Gestion des émotions : 1% ».
Comment est-ce qu’on acquiert une bonne gestion de ses émotions ou celles des autres même ? En apprenant ? Aucune des matières que j’ai pu suivre, aucun cours, aucun professeur n’a jamais mentionné un tel apprentissage. D’ailleurs, avant même d’entamer l’exercice de répondre à un nombre incalculable de questions, plus ou moins farfelues, certaines d’entre elles posées en situation de stress, juste après la vision d’une image ignoble de cadavre, je pensais que c’était inné. Mais qui peut répondre correctement, ne pas se tromper de bouton, dans un état de stupeur ? Le visage gris de la morte, comme en état de décomposition, ses cheveux fins collés les uns aux autres dans un liquide saumâtre qui coule sur ses joues, me reviennent tandis que j’ai oublié quelle était la question qui a suivi.
Ce même questionnaire a été soumis à plusieurs milliers de personnes, comme moi, sans doute dans le même état de reconquête de soi, et qui ont, eux, obtenu des scores moyens voire excellents à cette partie de l’étude.
- Vous êtes un cas d’école ! a annoncé l’homme lorsqu’il a finalement consenti à revenir au diagramme.
Je n’ai rien entendu du reste de l’analyse des qualités qui constituaient mon profil, sauf le mot atypique qui a résonné quelques instants, comme touchée par les piquants du hérisson dans ma tête, à la place de mon cerveau. L’image du dessin de ce petit animal, réalisé en classe de maternelle m’est apparue. Une bestiole d’un brun dégradé, aux abords malicieux et doux sur un fond de peinture vert.
- C’est grave docteur ? je tente avec un sursaut d’humour.
- Grave, non… mais cela doit vous handicaper dans votre quotidien, non ? Vous devriez consulter un spécialiste. Moi, je ne vais rien pouvoir faire à ce stade.
Mon cas semble désespéré.
Oui, je suis à fleur de peau et les larmes montent dès que des paroles me touchent, une situation inconfortable, un enfant dans la rue dont on prend le bras violemment plutôt que la main, un sourire tendre d’une maman à sa progéniture, des amoureux qui se bécotent... Certaines publicités me font même pleurer… Pas vous ?
Est-ce que cela a toujours été en moi ? Oui, je le crois, mais le phénomène s’amplifie depuis plusieurs années. Je ne supporte pas l’injustice, la moindre démonstration d’amour me touche, manquer d’être à la hauteur m’effraie, risquer de décevoir m’horrifie, manquer, tout simplement, me terrorise. Le vide, le manque d’amour, d’amitié, de travail, de sensations, d’émotions, le risque de passer à côté de chaque chose qui remplit un être m’angoissent.
Le regard que pose l’homme sur moi, à travers l’écran de mon ordinateur, me rassure. Il me sourit et sa gentillesse est sincèrement emplie d’empathie. Ce n’est pas une façade, je peux le ressentir. Ses mots prononcés avec une voix suave me font du bien. Ils comblent quelque chose en moi. Comme si mon corps à l’intérieur était parsemé de trous dans lesquels ses phrases venaient se lover et diffuser une chaleur agréable jusqu’à la surface de ma peau.
Il se tient en face de moi, il prend toute la place de l’écran à présent. Les courbes, les diagrammes, les histogrammes ont disparu. Ses cheveux sont tirés en arrière, il est blond. Je devine la couleur de ses yeux, bleus, peut-être verts, je ne suis pas certaine. Son regard est serein et se pose sur moi délicatement. Sa voix m’accompagne encore. Je n’entends plus vraiment ce qu’il me dit. Il termine par : « Pas d’inquiétude, Célia, vous possédez de très bonnes capacités par ailleurs, dont certaines sont hors normes, mais vos émotions doivent vous empoisonner la vie… Je vous envoie l’adresse d’une personne qui pourra vous accompagner pour améliorer tout cela. On se revoit à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances. »
Il lève la main droite et fait un signe amical dans ma direction comme on dit au revoir à une amie que l’on va retrouver bientôt.
L’écran est noir maintenant. Je reste là, plusieurs secondes, hébétée avant de reprendre mes esprits. Je fais un rapide bilan mental et m’aperçois que je n’ai retenu que cinq indications : je suis nulle pour gérer mes émotions - bleu ciel - j’ai d’autres atouts, mais lesquels ? - blond et doux – hors normes.
Le tintement de mon mobile a pris le relai de l’ordinateur que je viens de refermer et indique que j’ai reçu un nouveau mail.
De : PA
à Célia :
Voici les coordonnées d’une amie psychologue, spécialisée dans la gestion des émotions. Elle devrait pouvoir vous aider. Appelez-la de ma part.
Sophie Gaymard : 01 42 22 32 70
Vos émotions sont un cadeau précieux.
Profitez de l’été.
PA
2
Paris, 25 août, le soleil diffuse une lumière brillante à cette heure matinale. Le début du mois était caniculaire partout en France cette année, mais ce matin l’air est plus frais.
Je suis en avance, j’ai le temps de m’installer à la terrasse de ce café qui fait l’angle avec la rue de Paradis… Paradis, soleil… l’été qui s’étire… Je souris en pensant que la journée s’annonce sous les meilleurs auspices. Le garçon m’apporte un café crème et je craque pour un croissant en supplément. Les kilomètres de nage dans l’océan ont un peu affiné mon corps cet été et ma peau a légèrement bruni. Machinalement, j’ouvre mon ordinateur et commence à lire les mails d’information qui sont arrivés dans ma boîte pendant mes vacances. Rien de bien intéressant. Mon regard flâne sur la place et s’accroche à deux hommes en vert qui balaient nonchalamment le trottoir un peu plus loin. Leur rythme est si lent qu’un décalage se produit avec le bouillonnement et la vie intérieure qui m’animent aujourd’hui. Il est l’heure, je range rapidement mon PC dans mon sac à dos, me lève pour régler l’addition : neuf euros. Je crois tomber à la renverse ; pas de monnaie, l’établissement ne prend pas la carte bleue. Misère, je fusille le serveur du regard lorsqu’il m’indique l’emplacement d’une banque à plusieurs centaines de mètres. Je vais finalement être en retard, je presse le pas, dépasse les balayeurs qui se sont arrêtés faire une pause pour fumer. Lorsque je reviens, ils sont en pleine conversation et rient. Je me demande s’ils se moquent de moi avec mon café et mon croissant qui m’ont coûté une fortune.
Je pense à quitter Paris et m’enfonce dans l’ombre de la rue de Paradis jusqu’au 25. J’ai noté toutes les indications que m’a adressées la psychologue par SMS : code A68B puis prendre le deuxième escalier sous le porche. Au 1er étage, longer le couloir qui contourne la cour et prendre l’escalier de service pour un étage supplémentaire. Le bois des marches craque, la peinture est récente, je n’aurais pas choisi ce vert pomme pour des parties communes. Les marches en bois massif sont usées à certains endroits, presque creusées, comme si quelqu’un les avait rabotées, si lisses... J’imagine les innombrables hommes et femmes qui ont gravi ces marches. Probablement des gens de maison… Désormais, les chambres de bonne ont été réunies pour créer des appartements. Il fait sombre, je manque de trébucher, je me rattrape à la rampe.
Je suis devant la porte, une petite plaque en laiton au-dessus de la sonnette annonce que je suis au bon endroit. Mon index appuie d’un coup sec sur le bouton.
Une jeune femme brune ouvre la porte et m’accueille avec un large sourire. Elle porte des lunettes en écailles qui mangent une partie de son visage. La gentillesse que je perçois d’elle évacue immédiatement toutes les tensions qui entortillaient mon estomac…
L’unique pièce qui constitue son cabinet est minuscule. Les murs blancs agrandissent toutefois l’espace décoré d’un bureau sur tréteaux design, de deux sièges colorés chaleureux et de quelques cadres aux représentations neutres.
Nous sommes assises maintenant l’une en face de l’autre, à plusieurs pas de distance. Je la trouve un peu éloignée de moi et cela m’incommode mais cela doit faire partie de la mise en condition. Après tout, je ne suis pas venue prendre un café avec elle, ce n’est pas mon amie, je ne la connais pas et pourtant elle me questionne intimement, sans détour. Elle veut tout connaître de moi, comme si je me connaissais suffisamment moi-même. Les larmes ne tardent pas à déborder sans que je ne réussisse à endiguer leur flot. Je pleure maintenant devant cette femme que j’ai rencontrée il y a moins d’un quart d’heure et qui connaît déjà une partie de ma vie. Je me mets à fouiller dans mon sac, plongeant tête la première à l’intérieur, à la recherche d’un paquet de Kleenex. Une façon de gagner du temps, de me cacher. Comment puis-je manquer de dignité à ce point et me livrer ainsi ? Je n’en reviens pas. Elle a posé les bonnes questions, immédiatement, elle m’a percée à jour au bout de trois. Peu à peu, en douceur, elle a tiré le fil de la pelote qui se nichait au creux de mon ventre. Les larmes ne cessent de rouler. L’impression d’être un personnage de dessin animé japonais. Je ne trouve pas ce paquet que j’étais certaine d’avoir glissé dans mon sac. Elle me montre une petite table à ma droite sur laquelle une boîte de mouchoirs en papier est opportunément à ma disposition.
Une heure pile plus tard, les yeux gonflés, un morceau de papier doux en boule dans ma main gauche, que je continue de triturer comme un doudou rassurant, je quitte cet endroit dans lequel j’ai l’impression d’avoir déposé les armes.
Je me retrouve dans le corridor sombre. Refaire le chemin inverse, rembobiner l’histoire, tâcher de laisser les paquets lourds dont je viens de me défaire ici, ne plus les porter. Repartir d’un nouveau pied. Les escaliers, dévaler les marches cirées, ne pas glisser, je suis en retard pour rejoindre mon bureau à l’autre bout de Paris, tourner à droite, deuxième escalier, contourner la cour, première porte vitrée, deux marches en pierre, je suis sous le porche et déjà j’ai la sensation de reprendre une bouffée d’oxygène, j’ouvre la lourde porte cochère, je suis de nouveau dans la rue de Paradis. Je ne sais plus quoi penser du nom de cette rue. Le soleil a tourné et s’invite sur le côté droit de la chaussée. Je traverse et rejoins la lumière jusqu’au métro Poissonnière. Le chemin inverse m’avait semblé plus long ce matin.
3
Direction Saint-Cloud. Quarante-neuf minutes et deux changements pour rassembler mes idées ou me perdre dans mes songes. L’application de mon téléphone me propose le trajet le plus rapide : RER A jusqu’à la Défense puis le tramway, mais j’ai besoin de souffler, de reprendre mes esprits. Je préfère le métro et choisis la ligne 7, puis la 8 direction Balard et enfin la ligne 10 jusqu’à Boulogne-Billancourt. L’ambiance dans le métro diffère de celle du RER. Les stations révèlent la vie en surface. On devine les quartiers traversés grâce aux voyageurs qui entrent dans la rame. Poissonnière, populaire avec quelques bobos en prime qui se sont installés dans le quartier depuis quelques années. À Opéra, c’est un mélange d’actifs en cols blancs pressés et de touristes nonchalants, étrangers pour la plupart, qui cherchent leur chemin dans ce dédale de galeries souterraines. Invalides, nouveau changement, les hommes sont guindés, les complets gris anthracite et veste de tweed sont de mise, les enfants sont vêtus de bleu marine, bien coiffés, accompagnés souvent par une nounou.
Les odeurs souterraines de Paris sont différentes de celles des trains de banlieue. Celles du métro me rappellent mes innombrables visites de musées avec Coco. Elle habitait le petit appartement que j’occupe aujourd’hui. Après l’accident, elle m’avait fait de la place chez elle pour m’accueillir. Elle n’avait pas d’enfant et m’a élevée comme sa fille. Coco nous a quittés peu après l’anniversaire de mes vingt ans, me laissant le peu qui lui appartenait et nos souvenirs. Elle me manque.
Je suis assise dans un carré et mes yeux fixent le noir des fenêtres. J’y vois mon reflet et celui des gens autour de moi. Certains écoutent de la musique ou regardent des vidéos sur leur smartphone, d’autres, très peu, sont absorbés par la lecture d’un bouquin. Depuis la sortie du confinement, il y a moins de musiciens dans les rames, moins de pauvres ères qui font la manche. Où sont-ils passés ? Est-ce que le virus les a effacés ? Coco s’invite à nouveau dans mes pensées, mes souvenirs vagabondent, l’expo de Vieira da Silva au Grand Palais, le noir intense de Pierre Soulages, le théâtre du Rond-Point, un dîner avec Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud et toute la troupe de Les Strauss dont Coco était l’amie… Coco me manque vraiment. Les larmes remontent. Je fixe le noir des tunnels sans fin et contiens tant bien que mal les larmes qui cherchent à jaillir une nouvelle fois. Les passagers qui m’entourent ne me regardent pas, du moins je l’espère. J’espère que personne ne furète comme je le fais souvent, cherchant à capter l’atmosphère du lieu, d’une foule anonyme, et au passage, pourquoi pas croiser le regard d’un ou d’une inconnue. Cette sorte de sensation de soudain être rencontrée, reconnue. Aujourd’hui, j’aimerais être transparente.
Je retrouve le Kleenex en boule dans la poche de ma veste et le pose au bord du coin extérieur de mes yeux, délicatement, de sorte qu’il absorbe les larmes qui menacent de déborder, comme le papier buvard qui aspirait les gouttes d’encre bleue de mon stylo plume lorsque j’étais enfant.
Durant une heure, j’ai fait un saut dans mon enfance, j’ai raconté ma famille. L’amour, la joie, le manque et la solitude. La psychologue a fixé un nouveau rendez-vous. Plusieurs seront à prévoir pour reprogrammer mon cerveau et la perception erronée de situations pourtant vécues.
Je refais surface en arrivant à la station Pont de Saint-Cloud. Terminus, tout le monde descend, ce train ne prend plus de voyageurs.
Quel voyage ce matin ! Il est à peine 10 heures, la plupart des gens qui rejoignent leur bureau viennent de se lever, ont pris une douche rapide, pas tous, attaquent cette journée comme toutes les autres. Moi, je suis à la moitié de la matinée que j’ai débutée il y a plusieurs heures déjà, avec le sentiment de renaître, de m’engager dans une nouvelle vie intérieure, plus claire, plus sereine. Je suis emplie d’une force insoupçonnée. Je presse le pas, traverse le pont en m’émerveillant du paysage qu’offre la Seine jusqu’à la Défense. Le soleil est déjà haut dans le ciel, les péniches glissent silencieuses sur l’eau. J’aimerais me trouver à la place de ces mariniers. Naviguer sans attache et profiter de cette vue somptueuse chaque jour. Je rejoins les immeubles bruns, dont l’architecture cubique les a scellés en 1972. Sur la petite esplanade de l’entrée principale, des hommes et des femmes fument déjà, debout, agglutinés autour de cendriers. Je traverse l’odeur âcre de mégots mal éteints, la double porte vitrée s’ouvre automatiquement et je m’engouffre à l’intérieur, comme avalée.
Pour rejoindre le bureau, il faut descendre jusqu’à l’entre sol. Un étage nous sépare du rez-de-chaussée. Je choisis d’appeler l’ascenseur, non pas que je rechigne à prendre les escaliers mais le chemin ressemble à celui qui nous conduirait vers une cave avec l’odeur des gaz d’échappement du parking souterrain juste en dessous en prime ! Les miroirs à l’intérieur de la cage d’acier me rassurent. Les pleurs ininterrompus ce matin n’ont pas laissé de traces sur mon visage. Mes yeux brillent plus que d’habitude. Rien de plus.
Les portes s’ouvrent, le bip de mon badge m’autorise à entrer. J’endosse mon rôle de professionnelle. Je passe devant le bureau de Marie dont le vert de la chemise en lin s’accorde à la couleur de ses yeux. Ils semblent changer de teinte en fonction de l’ensoleillement, tirant sur le gris lorsque le ciel est plus sombre qu’aujourd’hui. L’open-space est encore vide. Les commerciaux de mon équipe sont en rendez-vous. Je pose mon sac à dos rempli, sur mon bureau, comme on se déleste d’un fardeau. J’en sors mon ordinateur qui désormais ne me quitte plus, mon cahier dans lequel je note ce que je ne dois pas oublier, tout en fait, le moindre mot clé, les comptes-rendus de mes rendez-vous, de nos réunions, les noms de mes contacts, les numéros de téléphone, tout est inscrit dans une série de carnets à spirales, gardés précieusement dans le tiroir de mon bureau.
Le rédacteur en chef passe devant moi et me salue. Je lève les yeux vers lui, en souriant, je n’ai pas le temps de répondre, il a déjà disparu au bout du couloir. J’ai envie d’un café. Tant pis, je n’attends pas Guillaume et Jules qui arriveront plus tard. Ils ont pris l’habitude de m’inclure avec eux lorsqu’ils sortent fumer leur cigarette. Je les accompagne volontiers avec une tasse fumante dehors sur l’esplanade, refaire des bouts d’histoires ensemble, professionnelles ou pas.
Ce matin, en les attendant, je prendrai mon café seule à mon bureau. Un rapide aller-retour jusqu’à la machine à café. La boisson tient plus de l’eau chaude légèrement aromatisée que d’un plein de caféine. C’est devenu une sorte de tic. Lorsque ma tasse est vide, j’éprouve le besoin de la remplir. Incessants allers-retours nécessaires qui m’extraient de tâches laborieuses sur mon ordinateur. Une contenance. L’occasion d’y croiser les journalistes de la rédaction qui s’amusent à apostropher le service publicité que je représente : « Alors, la réclame ? Les pages de pub rentrent un peu ? On valide le chemin de fer à la fin de la semaine. Il y a encore des espaces sans annonceurs ! Faudrait savoir si on doit écrire plus pour combler ou si vous allez finir par rapporter de l’argent ! ». C’est le jeu depuis la nuit des temps au sein d’un journal. Cette gentille guerre entre la publicité, nécessaire aux ressources économiques et la rédaction, moelle nourricière des lecteurs.
L’une apporte à l’autre et inversement, mais au quotidien, chacune pense être l’essence incontournable sans laquelle l’autre n’existe pas.
Cette année est plus compliquée que la précédente, qui l’était plus que celle d’avant encore. Chaque année le marché s’écroule un peu plus, le papier a de moins en moins la cote auprès des annonceurs face au digital, et pourtant, les objectifs de chacun augmentent encore dans un environnement proche du chaos. Les budgets de communication ont été réduits à peau de chagrin par les marques, les chargés de marketing sont désabusés, les acheteurs média, désengagés. L’ambiance délétère embourbe l’économie, l’enthousiasme a fui pour laisser la place à l’inquiétude et au pessimisme.
Est-ce cette ambiance morose qui m’a poussée à me poser la question de ma place dans ce milieu ? Jusque-là, je ne m’étais jamais imaginée mieux ailleurs.
Bien sûr, l’organisation avait changé, imperceptiblement. La transition de nos métiers avait été nécessaire vers un média digital dont il me fallait tout apprendre. Au début de l’année, il s’agissait d’élargir le champ de mes compétences. Repartir d’une page blanche comme une débutante nourrissait ma curiosité, au moment où j’avais enfin construit un réseau professionnel solide sur lequel m’appuyer pour avancer dans mon métier. Je maîtrisais les sujets de l’édition dans leur globalité et je prenais le pari de repartir de zéro, réapprendre, tout. La technologie d’abord, une nouvelle façon même de m’adresser à des professionnels dont les codes relationnels avaient, eux aussi, évolué. J’avais adhéré à un surcroît de travail. Mois après mois, j’avais compris qu’une modification majeure de mon périmètre s’opérait, au détriment du magazine, qui ne constituerait plus qu’une part infime de mon travail désormais. La pression s’était insinuée, forte, pesante, oppressante.
Le rédacteur en chef regagne son bureau, une pile de dossiers sous le bras, empreint de l’air soucieux qui le mine à chaque bouclage. Les dernières pages doivent trouver leur place dans le chemin de fer, affiché au mur du bureau de la rédaction, pour que chacun puisse envisager la construction du magazine tel qu’il sera imprimé. Il est le seul à pouvoir modifier l’emplacement des sujets, les intervertir, les rallonger ou les raccourcir. Les pages de publicité ont, elles aussi, chacune une place à respecter. C’est un véritable casse-tête que d’imbriquer les cent quarante-huit pages qui feront de ce mille deux cent onzième numéro un nouveau petit miracle que les lecteurs apprécieront.
Nos deux métiers se conjuguent et j’aime cette collaboration étroite que nous entretenons, lui et moi, et qui n’existe pas avec les éditeurs des sites internet que je commercialise. Un nouvel avantage pour ce support papier que j’affectionne tant et que je m’efforce de choyer autant que possible. Je profite de l’absence d’Antoine pour m’y consacrer entièrement. Je sais qu’il préfère me voir développer les annonceurs du web.
Mon regard revient à la liste des prospects que j’ai notée sur mon cahier. Convaincre de nouveaux clients d’annoncer chez nous plutôt que chez nos confrères relève du défi. Il faut réitérer chaque mois, se mettre à la place du lecteur et imaginer les publicités qui pourraient représenter un intérêt pour lui et argumenter. Je décroche mon téléphone et compose le premier numéro de la liste.
À mon quatrième appel, alors que j’ai déjà amassé une foule d’informations à propos d’un constructeur automobile, d’une maison de champagne, d’un courtier en assurance, c’est un fabricant d’équipements de sport en bois haut de gamme qui me demande une proposition. Plusieurs journalistes sont arrivés. Lorsqu’ils passent devant moi pour rejoindre leur bureau, je les salue successivement par un bref signe de la main, tout en notant les mots importants de mon interlocuteur, le combiné de mon téléphone coincé entre mon épaule gauche et mon menton. Eux s’installent et s’enferment intérieurement ; certains, des bouchons enfoncés dans les oreilles pour se couper du monde, les autres, je ne sais pas comment ils parviennent à se concentrer, mais nous n’existons plus pour eux le temps de l’écriture d’un article.
J’enchaîne, la journée est prometteuse, et je compose un nouveau numéro lorsqu’arrive Jules, harnaché de son attirail de motard. Il se débarrasse de ses gants, casque, blouson de cuir, en maugréant. Il me fait un signe, auquel je réponds par un sourire, tout en déroulant mon argumentaire auprès de cet horloger que j’ai réussi à joindre. Puis Guillaume apparaît, casque sur les oreilles, lunettes de soleil de marque sur le nez ; il fredonne un air comme tous les matins, imprimant soudain une ambiance légère dans tout le bureau ; le temps pour lui d’éteindre sa musique et de comprendre que je suis en ligne. Je lève les yeux vers lui en signe de bonjour. «… oui, une véritable appétence de nos lecteurs à hauts revenus pour les belles mécaniques horlogères…. Une rubrique leur est consacrée… Citer votre marque ? Pour cela, je peux vous mettre en relation avec notre rédacteur en chef qui signe cette rubrique… Quel prix pour l’emplacement proposé ?... » ; j’attrape ma calculatrice et compose plusieurs opérations ; « … je vous adresse un bon de commande… par email, oui, merci pour votre confiance… ». Politesses d’usage, je raccroche.
- Un nouveau contrat nous propulse à l’objectif ce mois-ci ! je lance fièrement.
Jules sonne la corne de brume comme il le fait à chaque bouclage lorsque l’objectif est atteint, mais alors qu’au-trefois la rédaction hurlait de joie de l’autre côté du couloir, aucun son ne filtre aujourd’hui.
- Viens Célia, je t’offre un café digne de ce nom pour fêter cette petite victoire ! laisse tomber Guillaume.





























