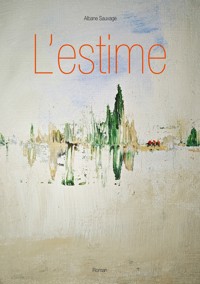5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Albane est une petite fille espiègle. Elle nous invite à la suivre et grandir avec elle, entre sa Bourgogne natale, la Côte d'Azur, Noirmoutier, son île magique, Paris, puis Chateau-Thierry où elle s'installera. Elle partage avec le lecteur son regard sur les adultes, sur ses parents, sa famille, les drames, les déchirements et la maladie qui ont jalonné son apprentissage de la vie... Mais aussi l'extraordinaire liberté, l'art, la joie et l'humour qui l'ont façonnée. Respire... est un récit tout en émotions, qui questionne sur l'importance des mots, des gestes, de la transmission et de l'amour. Un tiers des droits d'auteur sera reversé à une association de lutte contre le cancer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
A Jacqueline,
Pour Marine et Virgile,
« Respirer proche d’un être cher,
Être attentif à un inspir hésitant ou profond,
Être à l’écoute d’un expir fluide ou retenu
Autant de partages possibles, pour dépasser
la violence de certains silences ou l’errance des non-dits »
Jacques Salomé (La vie à chaque instant – 2012)
Sommaire
Prologue
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Epilogue
Prologue
C’était facile pour moi de porter un jugement aussi dur fut-il. Poser un regard intransigeant sur ce qu’elle était devenue. J’étais là, face à ce qui ne ressemblait plus qu’à un corps décharné, enrubanné de tuyaux. Je contemplais le désastre et souhaitais plus que jamais que tout s’arrête vite. Qu’un dernier souffle l’emporte. Vite. Son corps me dégoutait. L’odeur du tabac l’enrobait encore malgré le masque à oxygène qui devait interdire tout mégot incandescent à proximité de l’énorme bonbonne d’aluminium qui la suivait partout pour la maintenir en vie.
J’avais le sentiment d’avoir perdu ma mère depuis longtemps.
Il fallait que la réalité rejoigne ce qui était devenu pour moi une évidence depuis des mois.
Peut-être même des années.
1
C’est le départ. Il fait nuit et mes parents embrassent les amis qu’ils quittent pour toujours. On a embarqué mon poney Grisbee dans un camion qui vient de partir pour je-ne-sais-où. Je crois bien que je vais le retrouver même si on m’a dit qu’on ne pouvait pas l’emmener dans notre nouvelle maison. Loin. Ils n’ont jamais aimé cette bête qui le leur rendait bien. Il mordait. « Une véritable carne », répétaient-ils. Moi, je l’aimais bien Grisbee. Il me portait docilement et faisait attention à moi. Je le retrouverai, c’est sûr !
Olivier et moi sommes en pyjama dans les jambes de ces adultes en effusions de sentiments, d’aurevoirs, de bises qui claquent sur les joues, juste devant chez François. Nous levons la tête pour saisir ce qu’il se passe. François ne nous suivra pas, il garde son restaurant où nous n’irons plus. Je comprends que nous disons aussi adieu à ces soirées où les adultes riaient fort, où Maman nous permettait, assis sur ses genoux à la table des grands, de plonger une cuillère dans la boule glacée à la vanille de sa Dame Blanche, nappée de chantilly, d’amandes grillées et de chocolat, avant de nous écrouler sur les bancs moelleux du restaurant de François, dans un sommeil heureux.
Bientôt, Maman nous installa sur la banquette arrière de la voiture pour un long voyage.
Nous quittons Génelard, nos amis, mon école, Popote, la grosse dame dont je n’ai jamais connu le véritable prénom, joviale et pleine d’amour, qui me gardait après l’école, toujours vêtue d’une blouse à fleurs et dont les cheveux roux hirsutes aéraient un visage disgracieux. Nous quittons pour toujours le village où nous avons commencé à grandir. Nous quittons surtout mes grands-parents Poton et Toum qui ne sont pas là, avec les amis de mes parents, qui n’en finissent plus de nous embrasser.
Mon père avait décidé de rejoindre sa sœur jumelle sur la Côte d’Azur. Il ne reprendrait pas la pharmacie de mes grands-parents comme ces derniers l’avaient imaginé. Une longue lignée de pharmaciens, un héritage familial sur plusieurs générations, s’éteignait avec cette décision.
Être pharmacien de village élevait mes grands-parents au rang de notables. Au milieu du siècle dernier, dans un village perdu de Saône-et-Loire, leurs attributions dépassaient souvent celles d’apothicaires. Mais mon père était hermétique au statut qu’aurait pu lui conférer ce diplôme. Il n’était d’ailleurs même pas allé au bout de ses études. Il avait rencontré ma mère et très vite un léger contre-temps avait entravé leur poursuite. Moi.
Reprendre les affaires familiales l’aurait cloué dans ce village, à vie ou presque. Il rêvait d’autres horizons. Traverser le monde en bateau dans ses jeunes années rebelles, lui avait donné le goût d’ailleurs.
C’est pourtant ici, que j’avais passé une partie de mes mercredis, dans l’arrière-boutique de la pharmacie de mes grands-parents, où étaient confectionnés pilules, cachets et crèmes. La pharmacie était alors encore un art. L’art de mélanger herbes et plantes, poudres et onguents. Un artisanat, avec sur des étagères, toutes sortes d’ustensiles à pilules, et des bocaux de verre jaune ou bleu remplis de produits toxiques
Mes grands-parents étaient considérés avec bienveillance par les habitants, et chacun de nous, enfants, petits-enfants, étions salués dans la rue, identifiés grâce à une génétique physique reconnaissable, comme une marque de fabrique : des yeux noirs et des sourcils droits qui barraient le haut de notre visage.
De nature heureuse, Poton était un homme doux, d’une bonté, d’une intelligence et d’une humilité rares. Il avait donc construit ici, avec Toum, le berceau d’une grande famille.
Une spacieuse maison blanche aux hautes fenêtres cintrées, à la lisière du parc du château, avait alors vu naître et grandir quasiment chacun d’entre nous. A l’intérieur, un long couloir de carreaux de ciment aux motifs colorés contournait le salon parqueté et desservait plusieurs chambres aux plafonds très hauts. Le salon accueillait le cœur de la maison, cosy, meublé de douillets canapés. Son immense porte-fenêtre ouvrait sur le perron devant la maison, et laissait entrer la lumière baignant la pièce de chaleur l’hiver. A l’arrière, une salle à manger faisait le lien entre le couloir et la cuisine, où Toum passait des heures.
Cette maison était devenue mon terrain de jeu préféré.
Je suivais Toum partout lorsqu’elle s’occupait de ses poules, préparait pour elles des mixtures de son et d’eau qu’elle réchauffait et qui écœuraient tout le monde au petit déjeuner. Moi, j’aimais l’odeur âcre du son, parce que je voyais l’amour qui débordait de ma grand-mère dans la préparation de ces tambouilles.
Ce que je préférais par-dessus tout, était de l’assister à la cuisine lorsqu’elle confectionnait de fabuleuses tartes en chantonnant, toujours d’une voix haute et juste, pendant que Poton s’échappait pour une heure à la messe chaque samedi soir. Toum disait qu’il priait pour elle et toute la famille, lui évitant ainsi habilement de l’accompagner.
Perchée sur un tabouret à vis que ma grand-mère ajustait pour moi, je ne perdais pas une miette de la préparation de sa pâte à tarte. Tout d’abord, elle pesait chaque ingrédient sur sa petite balance à plateaux, m’invitant à choisir et disposer les poids adéquats sur le plateau opposé. La pâte était ensuite roulée en boule et placée sur une coupelle pour la laisser reposer à l’office, dont il fallait bien veiller à refermer la porte. Cette minuscule pièce sombre conservait tous les parfums d’un foyer heureux et offrait une odeur douce et réconfortante.
Ensuite nous placions ensemble chaque quartier de pomme en une rosace savamment organisée, avant d’enfourner le moule puis de savourer un dessert merveilleux.
Il me semblait que notre famille était un peu à part dans ce village. Mes grands-parents apparaissaient un peu comme des aventuriers, imposant le respect à tous par le goût qu’ils avaient pour la montagne. L’hiver était pour eux, synonyme de nouvelles escapades alpines. Dès les premières neiges, ils partaient à l’assaut des cimes, équipés de skis et de peaux de phoque. Des photos noir et blanc, jaunies par le temps, les montraient posant debout, heureux, fiers et naturels, au sommet de l’aiguille du midi, vêtus de larges pantalons de laine, de hautes chaussettes claires jusqu’au genou, un manteau ceint à la taille et d’épaisses chaussures de cuir nouées de lacets crochetés. La montagne était une passion encore plus forte pour Toum qui laissait parfois mon grand-père pour rejoindre des cordées, sur les pas de Pierre Gaspard, et grimper, intrépide, de nouvelles hauteurs.
Ma grand-mère plaçait la barre haut. Pas seulement pour la montagne où mes grands-parents avaient entrainé leurs cinq enfants jusqu’à en dégouter mon père. Elle, qui comptait parmi les premières femmes à avoir suivi des études poussées en mathématiques, ne souffrait pas que ses enfants s’abandonnent d’une manière ou d’une autre à l’oisiveté ou la facilité…
Pour avoir grâce à ses yeux, seule une voie scientifique était envisageable. Alors que trois de ses filles avaient poursuivi des études d’infirmières plus ou moins avec envie, Nicole, la deuxième, la rebelle, et sans doute la plus proche de mes grands-parents, avait embrassé les Beaux-Arts, une première dans la famille…
Mon père, seul garçon au milieu de quatre sœurs, était très nettement l’enfant chéri de Toum, son protégé. Pourtant, il allait partir du village natal et construire sa vie loin d’elle.
2
Nous avions roulé toute la nuit à bord de la R16 familiale vert bouteille. Sept cents kilomètres nous séparaient désormais définitivement de la Bourgogne. Mes parents avaient décidé de nous installer dans le Sud, à Grasse, capitale des parfums, où une nouvelle vie nous attendait.
Mon frère Olivier avait deux ans, et dormait encore sur la banquette arrière, alors que je m’éveillais. Le soleil pointait tout juste à l’horizon. L’air frais qui entrait dans la voiture, effleurait le dessus de mes bras et accompagnait les odeurs mêlées de parfums et de nature fraîche. La voiture était garée à l’ombre d’un arbre penché, dont les larges feuilles caressaient la tôle. J’entendais au loin des voix. Je tendis le cou pour mieux voir l’extérieur. De longues plates-bandes d’herbes hautes se succédaient en escalier jusqu’à une petite maison ocre-jaune. Mes parents devisaient joyeusement avec les amis qui avaient accompagné notre déménagement. Un camion avec nos meubles et toute notre vie nous avait suivis et stationnait dans la pente goudronnée juste devant la maison.
Je réveillai Olivier pour lui présenter notre nouveau chez nous, bien différent de l’appartement au-dessus de la boucherie Lavigne que nous habitions à Génelard. Ici, tout était plus vaste, plus clair, plus beau.
Olivier, quand il s’éveillait, avait dans les cheveux, un épi comme du foin, qui le rendait craquant. Ses joues rondes étaient encore rouges de sommeil. Ses yeux plissés s’écarquillèrent en découvrant l’immense jardin qui nous entourait. Certaines plantes extraordinaires, que nous n’avions jamais vues auparavant, nous semblaient un peu effrayantes, avec leurs multiples bras vert et jaune, et leurs piquants acérés comme des griffes.
Sans un mot, nous sommes sortis de la R16, laissant les lourdes portes ouvertes derrière nous, pour courir pieds-nus jusqu’à nos parents.
Nous avions visité chaque recoin du jardin, chaque pièce de la maison. Un papier peint terne tapissait les murs. Le carrelage frais sous nos pieds nus, était composé de petits cailloux agglomérés, comme des pépites, tout lisse. Un grand tapis le recouvrirait dans le salon. La salle de bains se réduisait à un minuscule lavabo et un bac de douche. La machine à laver le linge et une armoire étroite remplissaient déjà le reste de l’espace.
Très vite, chaque meuble avait trouvé sa place. Nous avions ôté nos t-shirts sous la chaleur écrasante et croquions les tomates juteuses pour un pique-nique entre les cartons encore amoncelés. Les adultes sirotaient un pastis et piochaient des tranches de Rosette de chez nous, à l’ombre de la terrasse nord, tandis que nous courions partout à l’aventure du vaste jardin qui deviendrait notre terrain de jeu.
Nous avions tout quitté pour vivre au milieu des parfums entre collines et mer Méditerranée. Nous découvrions un nouvel accent qui parfois, nous empêchait de comprendre tout à fait ce que voulaient nous dire nos voisins.
Je passais d’une école publique de village, dont la plupart des bâtiments étaient en réalité préfabriqués et les jeux extérieurs, faits de briques et de broc, aux allées paysagées, bordées d’iris et de hauts palmiers de l’école primaire Sainte-Marthe à Grasse. Ici, pas de structures de jeu dans la cour ; seuls les marronniers qui l’entouraient, devenaient les accessoires privilégiés de nos jeux créatifs d’écoliers.
Des règles strictes étaient en place parmi les élèves. Avant toute poursuite, chacun mettait un pied en avant, collé à celui des copains de part et d’autre. Tous entonnaient alors une comptine pendant que l’un d’entre eux promenait son doigt tendu sur chaque soulier en une ronde rythmée. Puis, les paroles s’arrêtaient, immobilisant le doigt sur le pied de celui qui, de fait, était désigné pour être le chat. Certains aimaient courir après les autres. David, un garçon frêle et maniéré, maugréait lorsque le hasard le choisissait, puis souvent finissait par abandonner sa place à Dominique ou Marina pour aller jouer à la princesse avec les filles.
A l’intérieur des bâtiments austères, un couloir en alcôve minuscule, comme un passage secret, sorti tout droit d’un conte, et lieu de tous les fantasmes pour des enfants de sept ou huit ans, suivant, deux par deux, ses habitantes voilées en aube blanche. Des nonnes qui me semblaient avoir l’âge de mon arrière-grand-mère, qui, elle, atteindrait bientôt cent ans, dirigeaient l’établissement, accompagnées de civiles pour l’enseignement. La prière quotidienne rythmait la matinée, et la messe du vendredi dans la chapelle de l’école, lavait nos pêchés de la semaine.
Les années se succédaient, heureuses, dans ce petit paradis ouaté de religion bienveillante jusqu’au jour de cette veille de vacances de Noël.
Mademoiselle Houblon était professeur de notre classe de CM1. Vieille fille notoire elle vivait encore chez sa maman, Place aux Aires, juste en face de la pharmacie dans laquelle Maman avait trouvé une place de préparatrice. Elle prit un air solennel après la prière du matin, après que la bougie qui symbolisait Jésus, fut éteinte et que l’odeur de cire se répandit dans la salle de classe.
Elle avait attendu que chacun regagne son pupitre, avait réclamé le silence, avant de nous annoncer qu’elle avait quelque chose de très important à nous dire.
Elle quitta sa place. L’espace au sol était mince sur l’estrade sur laquelle elle évoluait. Sa main droite agrippa légèrement son bureau, longeant le plat du rebord, comme quelqu’un qui ne verrait plus bien et suivrait un chemin risqué, pour venir se poster juste devant nous. Elle prit une pause bien stable sur ses deux épaisses jambes gainées de bas gris opaque, les pieds joints dans ses souliers noirs, bras tendus en avant et doigts croisés vers le bas. Ses cheveux noirs ramenés en arrière en chignon sévère apportaient encore plus d’intensité à l’instant.
Le silence se fit. Totalement.
Nous étions excités à la veille des vacances et l’ensemble de la classe était maintenant figé.
Mademoiselle Houblon attendit encore un moment, ses petits yeux rivés derrière les épais verres de ses lunettes.
« Le père Noël n’existe pas ! » avait-elle lancé soudain.
Consternation de l’assemblée d’élèves de huit ans. Elle nous aurait annoncé que nos parents étaient des extra-terrestres, cela n’eût pas été pire, puis elle continua sans se démonter. Il lui fallait nous révéler La Vérité pour ne pas compromettre notre foi en Dieu, Jésus, Sainte-Marie, Joseph….
Nouvelle consternation….
Alors que certains gamins s’étaient mis à pleurer, je n’entendais plus les paroles de la maîtresse qui déboulaient à flot. Mes yeux ne quittaient plus l’énorme poireau posé sur sa lèvre supérieure, juste en dessous de son nez, d’où s’agitaient plusieurs poils drus et noirs au fur et à mesure que sa bouche articulait des mots.
Mademoiselle Houblon était une sorcière !
Elle leva bientôt ses deux mains, les doigts écartés, et fit des signes pour apaiser la classe.
Noël cette année-là fut différent et le premier d’une série assez pourrie.
Noël était une fête que Maman mettait un point d’honneur à entourer les jours qui la précédaient, d’allégresse et de mystère, pour la rendre chaque année unique. Mère, sœur, frères, nièces et neveux venaient participer à son bonheur, nous inculquant au passage une certaine idée de la famille.
Cette année-là, partagée entre l’accès au sérail de ceux qui savent, et être une dernière fois émerveillée lors du rituel réveil des enfants en pleine nuit, que l’on menait dans le noir, guidés par la seule lueur de chandelles jusqu’au sapin illuminé de véritables bougies, au pied duquel le sol était jonché de cadeaux, j’avais finalement préféré me retrouver, comme les années précédentes, couchée avec les plus petits de mes cousins.
Cependant, je ne m’étais pas endormie comme eux. J’étais restée à l’affût des phrases suspectes, des bruits de fausses clochettes de rennes (ahaha, des rennes dans le Midi, la blague !). J’avais entendu pour la première fois des passe-moi-le-scotch ! et des quelqu’un-aurait-encore-du-papier-cadeau ? et le fameux il-est-l’heure-on-va-réveiller-les-petits.
Mademoiselle Houblon n’avait pas menti.
Noël ne revêtait plus la magie que je préférais aux cadeaux, celle des surprises, des petits secrets suspendus autour de nous, comme des guirlandes festives.
Resteraient désormais les repas gourmands, les bocaux de cerises à l’eau de vie, les fonds de tasse de café dans lesquels nous avions le droit ce soir-là, de tremper un morceau de sucre, les cercles de fumée de cigarettes, l’odeur vanillée de l’Amsterdamer que mon oncle enfonçait dans sa pipe, cette ambiance chaleureuse et les clameurs joyeuses d’une famille réunie.
Les enfants veillaient tard cette nuit-là, découvraient et partageaient jouets et jeux au milieu du salon, tandis que les parents se remémoraient autrefois, racontaient les souvenirs de vacances, de fêtes, d’anniversaires, de réunions de famille déjantées dans la maison de ma grand-mère maternelle, ouverte à tous, toujours. Ces jours d’étés où mes oncles, adolescents, alignaient leur 420 face au Vaurien des voisins, dans de longues régates sur le Lac des Settons qui ponctuaient les vacances d’antan. J’imaginais ma mère au même âge que moi, les cheveux longs jusqu’au fesses, en maillot de bain comme sur les photos, à bord de l’un de ces dériveurs au côté de son frère Pierre qu’elle vénérait…
Le plus fascinant pour nous était, comme s’amusait à le raconter encore et encore Mamie, cette fois où l’un de mes oncles avait dressé le couvert dans le jardin en réceptionnant comme des frisbees, les assiettes lancées par son frère depuis la fenêtre de la cuisine grande ouverte, et les disposait tranquillement sur la table, ou cet autre jour où la vaisselle avait été étendue pour la faire sécher sur le fil à linge. Ma grand-mère en était encore ébahie et n’a jamais dit combien d’assiettes avaient été cassées.
Notre imaginaire alors s’envolait. Il nous semblait que tout était possible.
Si Autrefois semblait toujours plus heureux, plus simple, plus libre, nous étions aujourd’hui bien ensemble, et c’était énorme. Nous écoutions et entendions tout cela. Nous prenions part à ce tout qu’étaient notre famille et nos racines.
La famille de Maman était une branche hétéroclite d’artistes, de joyeux drilles et de bons vivants, dans laquelle l’art sous toutes ses formes avait sa place, et où l’on riait fort jusqu’à en pleurer.
Elle semblait aux antipodes de la famille de Papa, calme, sereine, sportive, saine, mesurée. Chez Toum et Poton, la voix était comme murmurée, les rires contenus, les fous rires réprimés, indécents presque.
Une autre façon de bien vivre aussi. Une autre idée de la vie et de la famille.
Olivier et moi héritions de ces deux univers tellement différents…
3
Mamie avait eu une vie incroyable. Fille d’un industriel du nord de la France, elle avait rencontré mon grand-père, fabricant de parapluies dans le Morvan. Elle s’était mariée et avait profité d’une vie heureuse et facile avec ses deux premiers enfants Nicole (Coco) et Pierre. « Une vie de château » comme elle disait.
Les choses s’étaient gâtées lorsque mon grand-père s’était adonné aux jeux et avait dilapidé petit à petit la fortune que son père avait constituée. Philippe son troisième enfant et Françoise, ma mère, qu’on avait surnommée La Puce dès sa naissance, prématurée, le 30 mars 1947, ne vécurent pas très longtemps l’enfance rêvée de leurs aînés.
Mes grands-parents finirent par quitter leur maison en ville pour se replier dans leur résidence de vacances, qui avait connu tant de jours fastes au bord du lac.
Puis, un soir glacial de l’hiver 1958, ma grand-mère finit par s’enfuir de la maison des Settons avec sa dernière comme seul bagage. La Puce fut placée chez sa grand-mère à Autun puis plus tard dans une famille d’accueil bienveillante, le temps que ma grand-mère qui n’avait jamais vraiment travaillé, trouve une solution viable. C’en fut terminé de la belle vie et des rires qui peuplaient la maison des Settons, mais ce fut toujours plus raisonnable que d’attendre un drame qui n’aurait pas manqué d’arriver.
Après cela, la maison près du lac resta longtemps à l’abandon jusqu’à ce qu’elle soit vendue pour une poignée de cerises. Mon grand-père fut placé sous la tutelle de Pierre qu’il qualifia du même coup de fils ingrat, alors que lui seul s’occupait encore de lui.
Ma mère resta fâchée avec mon grand-père jusqu’au règlement de ses comptes avec lui. Un jour terrible d’affrontement, où tout ce qu’elle lui reprochait, tout ce qu’il avait fait endurer à sa famille, fut enfin verbalisé. Il mourut dans les jours qui suivirent. Ses mots l’avaient tué, elle en était certaine.
Ma grand-mère avait finalement rejoint Coco et Pierre. Elle avait trouvé une place de gouvernante dans une famille de la région parisienne passant ainsi de maîtresse de maison à nounou. Mamie ne s’était jamais laissé faire par le destin et avait toujours su affronter sa situation avec humour et sens critique. Beaucoup auraient baissé les bras, pas elle. Sa force et son caractère l’avaient sortie de toutes les galères. Elle ne s’était d’ailleurs jamais plainte. Et lorsque sa vie fut moins facile, elle sut toujours la conserver heureuse.
Très vite après notre installation dans le Sud, il était devenu évident qu’elle vienne nous rejoindre. Une chambre fut aménagée pour elle dans notre maison, avec les meubles et les affaires de son deux-pièces de la rue Thibaut. Même ses berlingots multicolores et ses bonbons à la violette qui trônaient sur la cheminée de son appartement du quatorzième arrondissement, avaient fait le voyage dans leur bonbonnière en verre.
Mamie partagea notre éducation, gâta la famille entière de repas succulents, avec son art d’accommoder les restes, et instilla chez nous son grain de folie.
A soixante-dix ans, elle soutenait qu’elle était encore capable de faire le poirier. Elle nous le démontra un jour d’été, après quoi elle resta coincée à l’équerre en voulant ramasser, juste après, un abricot dans le jardin.
Mamie avait toujours une cigarette à la main ou au coin des lèvres, qui la plupart du temps se consumait seule et dont la cendre finissait invariablement par terre, sur ses vêtements, ou pire, dans une casserole, ou le plat qu’elle préparait.
Mamie buvait son seul verre d’eau de la journée avec une aspirine, le matin au réveil, avant son thé, puis elle enchainait avec un verre de vin blanc (toujours) vers onze heures, puis au déjeuner, puis vers dix-sept heures jusqu’au dîner et même après.
Mamie était une grand-mère cool, qui quittait rarement ses jeans, ses invraisemblables chemises à motifs et ses baskets blanches à scratchs.
Mamie était devenue la grand-mère rêvée de mes amis et de tout le quartier Saint-Jean à Grasse.
Mamie n’aimait pas les bondieuseries que nous entendions à Sainte-Marthe.
Mamie répétait qu’à sa mort, elle voulait être enterrée sous le laurier du jardin, que nous aurions pris soin d’arroser quotidiennement avec du Muscadet.
4
Les années passaient. Olivier et moi prenions un léger accent du Sud. Certains de nos mots chantaient désormais.
Maman travaillait à la Pharmacie des Aires tout en exécrant son patron, si loin de la déontologie de pharmacien à laquelle l’avait habituée Poton.
Nous la retrouvions parfois avec Mamie, après la fermeture de l’officine. Nous nous installions à la terrasse de l’un des deux cafés de la place aux Aires. Un garçon traversait la rue, un plateau rond posé sur la paume de sa main, pour se poster devant nous. Il passait distraitement un chiffon humide sur la table de bistrot, le regard attiré par une conversation animée plus loin, puis revenait à nous et mémorisait notre commande, composée invariablement de deux verres de blanc sec et de deux sirops de grenadine. Olivier et moi n’avions pas le choix, seulement celui d’ajouter une paille.
Les deux femmes prolongeaient la journée, le dos calé au fond de leur chaise cannelée, fumant cigarette sur cigarette à l’ombre des platanes tandis que nous courions autour de la grande fontaine à quelques mètres d’elles, nous aspergeant d’eau les soirs où la chaleur était plus dense. Maman connaissait maintenant la plupart des commerçants de la vieille ville, qui ne manquaient pas de la saluer d’un petit signe amical. Les garçons bouchers hélaient les fleuristes du marché. Chacun remballant sa marchandise avant de finir ensemble leur journée au comptoir autour d’un pastis.
La place se vidait peu à peu jusqu’à ce que le bruit de l’eau, qui coulait de la fontaine, prenne le dessus sur le brouhaha des seuls habitués des Aires. Le soir s’étirait jusqu’au début de la nuit et nous repartions seulement lorsque les garçons rangeaient les tables et empilaient les chaises de la terrasse.
Papa avait rejoint l’affaire de mon oncle qu’il secondait désormais. Alain et Jacqueline, s’étaient installés sur la Côte d’Azur quelques mois avant nous. Mon oncle avait senti fleurir le marché de la photographie et avait ouvert avec l’aide d’un technicien développeur, une boutique à Cannes, juste derrière La Croisette.
Papa avait pris rapidement la gestion du magasin, tandis qu’Alain investissait déjà dans un entrepôt qui servirait bientôt de laboratoire de développement. En quelques années, Multicolor développa les pellicules de toutes les boutiques de la Côte d’Azur. La vie de milliers d’inconnus défilait dans l’odeur âcre des bains chimiques, sur les bandes de papier brillant ou mat, passant de machine en machine jour et nuit. Des techniciennes scrutaient le moindre défaut de chaque image sans s’attarder sur le sujet qui pouvait aller jusqu’à l’intime.
Des coursiers étaient chargés le soir de collecter auprès des boutiques du bord de mer jusque dans les collines grassoises, les rouleaux de pellicules. D’autres livraient les travaux terminés dès le lendemain matin. La famille avait été mise à contribution. Maman avait créé de grandes pochettes en toile de jute, solides, fermées par un Velcro. Le « M » tout en rondeurs de Multicolor, déclinant les couleurs de l’arc-en-ciel, était apposé sur chacun d’entre eux grâce à un pochoir dont nous remplissions l’intérieur avec d’énormes feutres, sans dépasser les contours.
Chacun avait gagné sa place dans la région. Mon père s’était fait quelques amis dont Pierre, commissaire de courses de rallye. Un autre point commun avec sa sœur jumelle Jacqueline et son mari, qui avaient couru ensemble le Rallye de Cannes. Nous rencontrions alors quelques sommités de la course automobile dont la grassoise Michèle Mouton, sans qu’Olivier et moi ayons conscience que ce petit bout de femme était une championne très connue.
La maison accueillait sans cesse voisins et nouveaux amis autour du barbecue, construit avec des pierres glanées ici et là dans les carrières alentours par un copain flic. Le monument était, à la mesure de cet immense bonhomme, qui avait érigé l’édifice pierre par pierre. Retourner une grille de merguez demandait à mon père, ne dépassant pas le mètre soixante-huit, toutes sortes d’acrobaties.
Un couple d’amis venait plus que les autres, profiter chez nous de ces dimanches à la campagne. Ils habitaient un appartement à Cannes, et Grasse, comme bon nombre d’habitants de la Côte, leur apparaissait comme le début de la montagne. Papa avait sympathisé avec l’homme, le premier collaborateur de mon oncle Alain. Sa femme, une grande brune, était toujours habillée comme si elle allait défiler, perchée sur de hauts talons.
La musique, éclectique, battait son plein chaque week-end, et nous grandissions dans la joie et la liberté, portes grandes ouvertes, vie au plein air dans le jardin… la maison ne désemplissant pas.
Les membres de nos deux familles, paternelle et maternelle de Bourgogne, d’Isère, du Nord ou parisienne nous rendaient visite à tour de rôle et découvraient cette région du Sud, magnifique et pleine de senteurs de pins, d’eucalyptus, de lavandes et de roses qui n’existaient nulle part ailleurs en France.
Coco était sans doute la visiteuse la plus assidue et venait souvent faire une cure de soleil chez nous. Lorsque mon oncle ne l’accompagnait pas pour profiter de la lumière exceptionnelle du sud et peindre une collection de tableaux, elle apportait dans ses valises « des bisous de Jean-Jacques » qui n’étaient rien de moins qu’un assortiment de petites pâtisseries de chez Fauchon, place de la Madeleine. Nous aimions bien notre oncle parce qu’il était artiste, bonhomme, mais nous lui préférions les mignardises sucrées…
Coco ne restait pas en place et nous embarquait aux quatre coins de notre propre région, accompagnée de Mamie. Avec elles, nous passions nos vacances de la plage au lac St Cassien, dans les musées, jusqu’aux endroits les plus reculés de l’arrière-pays, dont les routes sinueuses nous rendaient malades en voiture. Coco s’énervait de nous voir allongés à l’arrière de la 204 orange de ma grand-mère au lieu de profiter de la vue, tandis que nous luttions contre chaque virage, le cœur au bord des lèvres.
Courmes était un petit village à flanc de montagne, perché au milieu de nulle part. Le lieu que nous préférions avec Olivier. Coco garait la voiture dans un pré, en contrebas, assez loin des premières habitations. Une fois que notre estomac avait retrouvé sa place, nous nous asseyions sur le carré de tissu posé sur le sol, qui nous servait de nappe, nous ôtions nos sandales pour laisser l’herbe nous chatouiller les pieds, et nous dévorions les incomparables Pan Bagnats préparés par ma grand-mère. Puis, alors que les deux femmes plongeaient dans une petite sieste, allongées sous un arbre, Olivier et moi nous aventurions dans la rivière glacée qui traversait le champ à quelques mètres. Nous imaginions alors toutes sortes de jeux dans un cadre sublime d’algues multicolores. Nous pouvions rester là des heures entières à inventer nos vies d’aventuriers, au milieu de barrages de fortune, les pieds dans l’eau gelée qui finissait par sembler brûlante, jusqu’à ce que les façades du village se colorent d’une lumière mordorée brillante. Il était l’heure de rentrer à la maison avant que le soleil ne disparaisse derrière la colline.