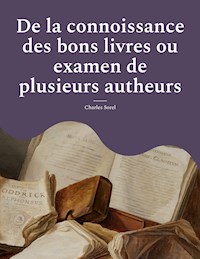Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"L'Histoire comique de Francion, écrit par Charles Sorel, est un livre captivant qui plonge les lecteurs dans un monde d'aventures, de rebondissements et de comédie. Publié pour la première fois en 1623, ce roman picaresque est considéré comme l'un des premiers romans modernes de la littérature française.
L'histoire se déroule au XVIIe siècle et suit les péripéties de Francion, un jeune homme plein de malice et d'esprit vif. Dès le début, Francion se retrouve confronté à des situations rocambolesques et des personnages hauts en couleur. Son voyage à travers la France est ponctué de rencontres surprenantes, de quiproquos hilarants et de situations comiques.
Charles Sorel, l'auteur talentueux derrière cette œuvre, a su créer un univers riche en humour et en satire sociale. À travers les aventures de Francion, il dresse un portrait satirique de la société de l'époque, mettant en lumière les travers et les absurdités de la noblesse, de la justice et de la religion.
L'Histoire comique de Francion est un livre qui ne manque pas de divertir et de faire réfléchir. Les lecteurs seront emportés par le style enlevé de Sorel, sa plume vive et son sens aigu de l'ironie. Ce roman est une véritable ode à la liberté, à l'esprit critique et à la joie de vivre.
Que vous soyez amateur de littérature classique ou simplement à la recherche d'une lecture divertissante, L'Histoire comique de Francion est un livre qui saura vous séduire. Plongez dans les aventures trépidantes de Francion et laissez-vous emporter par ce récit plein d'humour et de fantaisie.
Extrait : ""La nuit était déjà fort avancée, lorsqu'un certain vieillard, qui s'appelait Valentin, sortit d'un château de Bourgogne avec une robe de chambre sur le dos, un bonnet rouge en tête et un gros paquet sous le bras. Que si, contre sa coutume, il n'avait point ses lunettes, qu'il portait toujours à son nez ou à sa ceinture, c'est qu'il allait faire une chose qu'il ne désirait point voir, de même qu'il ne voulait pas que personne la vît."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Sorel, sieur de Souvigny, est né à Paris en 1602. Son père, procureur au Parlement, avait combattu dans les rangs de la Ligue ; sa mère était la sœur de Charles Bernard, lecteur du roi et historiographe de France.
Il fit ses études rue Saint-Étienne-des-Grecs, au collège de Lisieux, dont les élèves passaient pour être « les plus polissons de Paris ». C’est là qu’il rima ses premiers poèmes sur Les Vertus du Roi (1615) et sur L’Heureux Mariage du Roi de France Louis XIIImede ce nom (1616).
Il semble qu’il ait ensuite étudié le droit, mais à contrecœur : les lettres et la cour l’attiraient plus que la chicane. En 1621, il entre comme « domestique » ou secrétaire dans la maison du comte de Cramail, petit-fils du fameux Montluc. C’était un libertin, alors âgé de cinquante-trois ans, et qui se piquait d’écrire. « Toujours galant et propre, dit Tallemand, il dansait bien et se tenait bien à cheval. » Pendant l’année qu’il le servit, Sorel collabora avec le gentilhomme gascon à de petits ouvrages qui devaient paraître sans sa signature, comme Les Thèses ou Conclusions amoureuses du Bachelier Erophile (1621) ou Les Jeux de l’Inconnu.
En 1632, Sorel, qui vient de publier L’Histoire amoureuse de Cléagenor et Doristée, entre au service de Charles de Marcilly, comte de Cypière et écuyer du roi. « Cet homme, dit Bassompierre, trichait au jeu et ne payait pas ses dettes… » Passe encore de signer un roman de son secrétaire (Le Palaisd’Angélie, 1622) ; ne le payer point est chose inadmissible, et Sorel, plein de ressentiment, s’attache à la personne de Barradas, ce gentilhomme champenois que Louis XIII avait enrichi et fait écuyer des Petites-Écuries.
Sorel publie alors chez Pierre Billaine (1623), la première rédaction de son Francion, commencé en 1620 et terminé deux ans plus tard. Il donne à l’impression des Nouvelles françaises (1623) et fabrique des stances pour le Ballet des Bacchanales (1623), auquel avaient collaboré Boisrobert, Saint-Amant et Théophile.
Trois ans plus tard, il publie L’Orphise de Chrysante (1626), long roman à clef, galant et fort ennuyeux ; il compose, sous le titre du Berger extravagant, une curieuse parodie de L’Astrée ; enfin, il remanie son Francion en vue d’une édition nouvelle (1626) qui connaîtra un retentissant succès.
Barradas avait été disgracié au mois de décembre de cette même année parce que, si l’on en croit Ménage, « son cheval, au cours d’une partie de chasse, aurait pissé sur le chapeau du roi ! » Mais bien avant cette aventure, Sorel avait quitté la maison du favori. Dégoûté de la cour et des grands, il n’avait d’autre projet que de poursuivre les travaux de son oncle, l’historiographe, dont en 1635 il devait acheter la charge. Ses parents étant morts, il vint habiter au 16 de la rue Saint-Germain-l’Auxerrois, chez Mlle Parmentier, sa sœur, qui avait épousé un avocat, substitut du procureur général.
De cette maison où il vivait en grave célibataire, au milieu des livres et des chartes, il ne sortait guère que pour visiter quelques bons amis ou des précieuses, ses voisines, dont l’âge avait émoussé la séduction : l’une jouait du luth à ravir, l’autre faisait des vers et se prénommait Angélique. Parfois aussi il se rendait à Soigny, en Champagne, où il possédait quelque bien. L’histoire était alors son occupation quotidienne ; mais il savait interrompre ses doctes travaux pour polir – trop laborieusement – Le Polyandre, autre histoire comique dont seule la première partie a vu le jour (1649), ou bien pour composer des œuvrettes galantes : La Maison des Jeux (1642), Les Lois de la Galanterie (1644) et la Description de l’Île de Portraiture.
Sorel venait de dépasser la cinquantaine. On doit se le représenter alors, selon Gui Patin qui le connaissait depuis trente-cinq ans, comme « un petit homme grasset, avec un grand nez aigu, qui regarde de près, et qui paraît fort mélancolique et ne l’est point… Ce monsieur Charles Sorel, ajoute le spirituel docteur, a fait beaucoup de livres français ; il a encore plus de vingt volumes à faire et voudrait que cela fut fait avant que de mourir, mais il ne peut venir à bout des imprimeurs. Il est fort délicat et je l’ai souvent vu malade. Néanmoins, il vit commodément parce qu’il est fort sobre. Il est homme de fort bon sens et taciturne, point bigot ni mazarin. »
En 1663, comme il venait de publier Le Chemin de Fortune, petit traité où il indiquait à tous le moyen de s’enrichir, l’historiographe de France perdit, par décret de Colbert, la pension de deux mille sept cents livres que lui versait chaque année « pour son office noble homme maître Jacques Kerver, receveur général des finances en la généralité de Paris ». Il fallut vendre la maison de la rue Saint-Germain et peut-être celle des Champs ; et l’on s’en fut habiter rue des Bourdonnais, chez Simon de Riencourt, époux reconnaissant d’une nièce que le bon oncle Charles avait dotée.
Ses vieux amis n’avaient pas abandonné l’écrivain pauvre ; chaque jour, la nouvelle demeure retentissait de la voix chère de Gui Patin, « le hardi, le téméraire, l’inconsidéré, dont le chapeau, le collet, le manteau, le pourpoint, les chausses, les bottines faisaient nargue à la mode et à la vanité. » Et en l’absence du bon doyen, le seul qui fit parler « le taciturne », l’abbé de Marolles, traducteur de tous les latins et de tous les grecs, donnait la réplique au sieur Morin, délicieux amateur d’estampes, de papillons et de tulipes.
Après dix ans d’un labeur acharné, durant lesquels des libraires peu généreux lui firent bâcler des livres d’histoire, de religion, de critique, d’astronomie et de morale, Sorel mourut le 7 mars 1674, dans la maison de la rue des Bourdonnais. On l’enterra le surlendemain à Saint-Germain-l’Auxerrois, cependant que l’abbé de Marolles lui rimait ce tombeau touchant et ridicule :
À l’époque où fut écrit le Francion, on ne lisait que de fades et languissants romans, à la fin desquels une jeune fille sans tache épousait le pur objet de sa flamme, à moins qu’elle ne finît ses jours au couvent. Les pudiques amants traversaient d’injustes épreuves ; mais des lettres tarabiscotées les raffermissaient dans leur mutuelle constance. On devine à quel point ces proses sentimentales des sieurs de Nervèze ou des Escuteaux pouvaient exciter les railleries de « l’élève polisson » du collège de Lisieux.
Sorel avait dix-huit ans. Il courait les traiteurs et les quarante cabarets de Paris, dont il connaissait les meilleurs crus. Il passait des nuits chez les filles du Marais et fréquentait les poissonnières des Halles et les crocheteurs du Port-au-Foin, dont le vert parler faisait ses délices. Il écoutait les plaidoiries du Palais et les boniments des charlatans sur la place Dauphine. Mondor, Tabarin et Bruscambille n’avaient point de spectateur plus assidu que lui. Tous les jours, au sortir du Louvre, il s’arrêtait sur le Pont-Neuf et ne manquait d’y acheter une chanson, un almanach, une gravure ou un pasquil. Il demandait aux bouquinistes leurs livrets populaires, leurs romans picaresques et leurs conteurs gaulois : Bouchet, Noël du Fail, Despériers ou Beroalde. Et il emportait chez lui ses trouvailles pour les dévorer à la lueur de sa chandelle.
Mais qu’il se promenât à Paris ou dans un village, qu’il allât chez les bourgeois ou chez les grands, ce petit homme replet, au gros nez « empourpré comme une éminence » prêtait une vive attention à tous les propos et les soulignait d’un large ris badin qui découvrait des dents fort aiguës. Cependant, il braquait sur les passants des yeux gros et bouffis « qui avaient quelque chose de plus que d’être à fleur de tête ». D’aucuns croyaient, dit-on, que « comme on se met sur des balcons en saillie hors des fenêtres pour découvrir de plus loin, la nature lui avait mis des yeux en dehors pour découvrir ce qui se faisait de mal chez ses voisins ».
À mesure qu’il étudiait les hommes, ce petit bourgeois réaliste et satirique s’était persuadé qu’il fallait continuer les traditions des vieux conteurs qu’il aimait ; au lieu de recourir à la fiction, mieux valait prendre le sujet d’un roman dans la vie même et, pour « faire une histoire entièrement vraisemblable », rapporter les choses « simplement, comme l’on parle, sans user d’aucune afféterie ». La condition des personnages mis en scène n’avait aucune importance pourvu que le héros principal fût un gentilhomme et non pas un coquin comme dans les romans espagnols. C’est ainsi que le Francion fut fait des souvenirs d’enfance, de collège et de débauche, et que tels personnages y sont louangés ou moqués suivant la reconnaissance ou la rancune que Sorel leur avait vouées. Tous les types de la société trouvèrent ainsi leur place dans une autobiographie amusante, depuis le pédant crasseux qui s’enrichissait en faisant jeûner ses pensionnaires, jusqu’à l’épouse vénale d’un débile barbon, cette Laurette que le donjuanesque Francion poursuivait depuis longtemps et qu’il cesse de désirer le jour où elle est à sa merci.
Très lue au XVIIe siècle, dont elle est le roman le plus agréable, L’Histoire comique de Francion est un panorama assez complet de Paris en 1620, une sorte de roman Louis XIII écrit sous Louis XIII. Elle fut imitée par Lannel (Le Roman satirique, 1624) et par Tristan l’Hermite (Le Page disgracié, 1643) ; le sieur d’Ouville y prit des contes sans en changer une lettre ; Cyrano de Bergerac y trouva l’idée de son voyage à la lune, Molière deux scènes de Sganarelle et le caractère de L’Avare ; Diderot, Lesage et Beaumarchais la connurent sans conteste, et Théophile Gautier lui-même, avant d’écrire Le Capitaine Fracasse, consulta cet ancêtre de nos romans réalistes. Et cependant Sorel est resté un écrivain mineur parce qu’il manquait de style.
L’édition originale de Francion, parue en 1623, est intitulée :
L’HISTOIRE || COMIQVE || DE FRANCION.|| EN LAQUELLE SONT || descouvertes les plus subtiles finesseset || trompeuses inventions tant || des hommes que des femmes, de || toutes sortes de conditions || et d’aages. || Non moins profitable pour s’en gar-|| der, que plaisante à la lecture. || [ Marque ] || À PARIS, || Chez PIERRE BILLAINE, ruë || Sainct-Iacques, à la bonne Foy. || M. D.C. XXIII.|| Avec Priuilège du Roy.
Ce volume venait à peine de voir le jour que le poète Théophile était poursuivi comme auteur supposé des « vers sales et profanes » du Parnasse des poètes satiriques. En août 1623, Théophile, jugé par contumace, est brûlé en effigie ; un second procès qui se déroule pendant deux ans se termine par l’exil du poète. Peu soucieux d’exciter l’ire du père Garasse et de subir le sort de l’athéiste Vanini, « pauvre papillon venu d’Italie pour se brûler au feu du Languedoc », Sorel, qui cependant n’avait pas signé son livre, en remanie considérablement le texte en vue d’un nouveau tirage. Il coupe, cela va sans dire, les passages obscènes ou libertins, supprime des anecdotes, en ajoute d’autres pour se venger de Balzac et de Boisrobert ; il affine le trait, corrige les lourdeurs et les négligences, suites inévitables de la rapidité avec laquelle il composa. Enfin, ayant judicieusement expurgé, ajouté trois livres (IX, X et XI) au texte primitif et marié son héros, Sorel donne en 1626 une deuxième édition de son œuvre sous le titre :
L’HISTOIRE || COMIQVE DE || FRANCION.|| OV LES TROMPERIES, LES SUBTILI- || tez, les mauuaises humeurs, les sottises, || et tous les autres vices de quelques || personnes de ce siècle, sont || naïfuement representez. || Seconde édition remue & augmentee de beaucoup. || [ Marque ] || À PARIS, || Chez PIERRE BILLAINE, rue S. Iacques, || à la Bonne Foy, deuant S. Yues. || M. DC. XXVI || AVEC PRIVILÈGE.
Enfin, en 1633, Sorel publie une version définitive où son roman s’augmente d’un douzième livre. Le texte est, à peu de choses près, celui de 1626, sauf que de banales « moralités », introduites pour faire pardonner les grivoiseries, hachent le récit avec une insistance bien inutile. Voici le titre exact de cette troisième édition :
LA VRAYE || HISTOIRE || COMIQVE || DE FRANCION.|| Composée par Nicolas De Moulinet, sieur DV || PARC, Gentilhomme Lorrain. || Amplifiée en plusieurs endroicts, & aug-|| mentée d’un Liure, suiuant les || manuscripts de l’Autheur. || [ Marque ] || À PARIS, || Chez PIERRE BILLAINE, ruë S. Iacques, || à la Bonne Foy, deuant S. Yues. || M. DC. XXXIII.|| Auec Priuilege du Roy..
On aura remarqué l’anonymat des deux premières éditions. Quant à Nicolas le (et non de) Moulinet, sieur du Parc, prétendu gentilhomme lorrain dont le nom figure sur le titre de 1633, c’était un avocat au Parlement de Rouen, né à Séez dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Venu à Paris, il se lia avec des comédiens, joua peut-être à l’hôtel de Bourgogne et mourut certainement avant 1625. Il est l’auteur de contes licencieux (Facétieux Devis, Paris, Jean Millot, 1612) qui ne sont qu’une transcription de ceux que contient La Nouvelle fabrique, de Philippe d’Alcripe. Il écrivit aussi des romans pastoraux ; tels sont les Agréables Diversités d’amour (1613) et les Amours de Floris et de Cléonthe (1613), où le nom de « l’écuyer Francion » se lit à la page 444. Mais ses productions sont tellement insipides qu’il suffit de les avoir feuilletées un instant pour dénier à l’avocat-comédien tout droit à la paternité du Francion. Que venait-il donc faire en cette histoire ?
Ce n’est pas seulement par crainte du bûcher que Sorel n’avait pas signé les premières éditions du Francion : d’abord il répugnait à toute publicité faite autour de son nom, puis il aimait les cachotteries et il comptait sur le mystère pour attirer le public. Que ses œuvres se vendissent, la gloire lui importait peu (d’ailleurs il publiera par la suite, sans les signer, plus d’un livre inattaquable). À des lecteurs qui demandent l’auteur il jette le nom d’un obscur écrivain mort depuis huit ans ; et le voilà définitivement couvert, à son avis.
Mais il n’avait pas su penser à tout. On peut lire au livre XI du Francion que le romancier avait dix-huit ans lorsqu’il commença cet ouvrage. Or, c’était bien en 1620 l’âge de Sorel, tandis que Moulinet avait depuis longtemps dépassé la trentaine. La Science des choses corporelles (1634) contient aussi cet aveu : « Je confesserai bien que s’il y a du piquant dans ce livre, c’est moi qui l’y ai inséré… » La bibliothèque française apporte aussi sa part de déclarations voilées de regrets et d’excuses significatives. Et la dernière page de la rédaction de 1626 annonce au lecteur, qui ne demande qu’une suite, les aventures du Berger extravagant que Francion a composées, et ces aventures-là, Sorel les a toujours reconnues.
Qu’on réclame maintenant des témoignages plus décisifs, et des contemporains de Sorel nous en fourniront d’irréfutables : Tallemand, Bouhours, Ménage, l’ennemi Furetière et Guy Patin, l’ami de toujours.
Voici donc une précaution devenue inutile et un auteur passé malgré lui à la postérité.
Le texte de 1633 a été réimprimé une cinquantaine de fois au XVIIe siècle et deux fois au cours du siècle suivant ; c’est celui qu’a publié Colombey (Bibliothèque Gauloise), d’après un tirage de 1721, sans se rendre compte qu’au cours des réimpressions successives les typographes avaient défiguré le texte en y perpétuant d’affreuses coquilles lorsqu’ils n’en ajoutaient point de nouvelles.
Il nous a paru que le texte de 1626, sans les concessions ni le masque qu’il s’imposa plus tard, représentait mieux la pensée de Sorel. Nous l’avons scrupuleusement reproduit, nous bornant, et n’était-ce pas notre plus strict devoir ? à corriger une vingtaine de coquilles évidentes que l’on chercherait en vain dans l’édition originale ou qui furent corrigées dans celle de 1633. Mais, pour faciliter la lecture, nous avons délibérément modernisé la ponctuation et l’orthographe ; car nous avons toujours considéré comme un joujou d’un agrément et d’une utilité discutables la poussière que certains amateurs laissent s’accumuler sur les vieilles peintures.
Les variantes de la fameuse édition de 1623, au sujet desquelles on a beaucoup disserté sans en avoir jamais publié une, ont été rejetées à la fin du volume. Qu’il nous soit permis, en terminant, de remercier le détenteur du précieux exemplaire sans l’obligeance duquel les légendes les plus rocambolesques n’auraient cessé de s’échafauder.
BERTRAND GUÉGAN.
La nuit était déjà fort avancée, lorsqu’un certain vieillard, qui s’appelait Valentin, sortit d’un château de Bourgogne avec une robe de chambre sur le dos, un bonnet rouge en tête et un gros paquet sous le bras. Que si, contre sa coutume, il n’avait point ses lunettes, qu’il portait toujours à son nez ou à sa ceinture, c’est qu’il allait faire une chose qu’il ne désirait point voir, de même qu’il ne voulait pas que personne la vît. S’il eût fait clair, il eût même eu peur de son ombre ; si bien que, ne cherchant que la solitude, il commanda à ceux qui étaient demeurés dedans le château qu’ils haussassent le pont-levis ; en quoi ils lui obéirent, comme en étant le concierge pour un grand seigneur auquel il appartenait.
Après s’être déchargé de ce qu’il portait, il se mit à se promener aux environs, aussi doucement que s’il lui eût fallu marcher dessus des œufs sans les casser ; et comme il lui sembla que tout le monde était en repos, jusqu’aux crapauds et aux grenouilles, il descendit dedans les fossés pour faire en secret quelque chose qu’il avait délibéré. Il y avait fait mettre, le soir de devant, une cuve de la grandeur qu’il la faut à un homme qui se veut baigner. Dès qu’il en fut proche, il se dépouilla de tous ses habits, hormis de son pourpoint, et, ayant retroussé sa chemise, se mit dedans l’eau jusques au nombril. Il en ressortit incontinent et, ayant battu un fusil, alluma une petite bougie, avec laquelle il alla par trois fois autour de la cuve, puis il la jeta dedans, où elle s’éteignit. Il y jeta encore quantité de certaine poudre qu’il tira d’un papier, ayant en la bouche beaucoup de mots barbares et étranges qu’il ne prononçait pas entièrement, parce qu’il marmottait comme un vieux singe fâché, étant déjà tout transi de froid encore que l’été fût prêt à venir. Ensuite de ce mystère, il commença de se baigner et fut soigneux de laver principalement son pauvre outil de génération, qui était plus ridé qu’un sifflet à caille. Après être sorti de la cuve, il s’essuya et se revêtit ; tous ses gestes et toutes ses paroles ne témoignèrent rien que de l’allégresse en remontant sur le bord des fossés.
– Voici déjà le plus fort de cette besogne achevé, dit-il ; plaise à Dieu que je puisse aussi facilement m’acquitter de celle de mon mariage ! Je n’ai plus qu’à faire deux ou trois conjurations à toutes les puissances du monde, et puis tout ce que l’on m’a ordonné sera accompli. Après cela, je verrai si je serai capable de goûter les douceurs dont la plupart des autres hommes jouissent. Ha ! Laurette, dit-il en se retournant vers le château, vraiment tu ne me reprocheras plus les nuits, que je ne suis propre qu’à dormir et à ronfler. Mon corps ne sera plus dedans le lit, auprès de toi, comme une souche ; désormais, il sera si vigoureux, qu’il lassera le tien, et que tu seras contrainte de me dire, en me repoussant doucement avec tes mains : « Ha ! mon cœur, ha ! ma vie, c’est assez pour ce coup ! » Que je serai aise de t’entendre proférer de si douces paroles, au lieu des rudes que tu me tiens ordinairement !
En faisant ce discours, il entra dans un grand clos plein de toutes sortes d’arbres, où il déploya le paquet qu’il avait apporté de son logis. Il y avait une longue soutane noire, qu’il vêtit par-dessus sa robe de chambre ; il y avait aussi un capuchon de campagne, qu’il mit sur sa tête, et il se couvrit tout le visage d’un masque de même étoffe qui y était attaché. En cet équipage aussi grotesque que s’il eût eu envie de jouer une farce, il recommença de se servir de son art magique, croyant que par son moyen il viendrait à bout de ses desseins.
Il traça sur la terre un cercle dedans une figure octogone, avec un bâton dont le bout était ferré, et, comme il était prêt à se mettre au milieu, une sueur et un tremblement lui prirent par tous les membres, tant il était saisi de peur à la pensée qui lui venait que les démons s’apparaîtraient à lui bientôt. Il se fût résout à faire le signe de la croix, n’eût été que celui qui lui avait enseigné la pratique de ces superstitions lui avait défendu d’en user en cette occasion, et lui avait appris à dire quelques paroles pour se défendre de tous les assauts que les mauvais esprits, lui pourraient livrer. Le désir passionné qu’il avait de parachever son entreprise, lui faisant mépriser toute sorte de considérations, le contraignit à la fin de se mettre à genoux dedans le cercle vers l’Occident.
– Vous, démons qui présidez sur la concupiscence, qui nous emplissez de désirs charnels à votre gré, et qui nous donnez les moyens de les accomplir, ce dit-il d’une voix assez haute, je vous conjure, par l’extrême pouvoir de qui vous dépendez, et vous prie de m’assister en tout et partout, et spécialement de me donner la même vigueur pour les embrassements qu’un homme peut avoir à trente-cinq ans ou environ. Si vous le faites, je vous baillerai une telle récompense, que vous vous contenterez de moi.
Ayant dit cela, il appela par plusieurs fois Asmodée, et puis il se tut en attendant ce qui arriverait. Un bruit s’éleva en un endroit un peu éloigné ; il ouït des hurlements et des cailloux qui se choquaient l’un contre l’autre et un tintamarre qui se faisait comme si l’on eût frappé contre les branches des arbres. Ce fut alors que l’horreur se glissa tout à fait dedans son âme, et j’ose bien jurer qu’il eût voulu être à sa maison et n’avoir point entrepris de si périlleuse affaire. Son seul recours fut de dire ces paroles ridicules, qu’il avait apprises pour sa défense :
– Ô ! qui que tu sois, grand mâtin qui accours à moi tout ébaudi, la queue levée, pensant avoir trouvé la curée qu’il te faut, retourne-t’en au lieu d’où tu viens et te contente de manger les savates de ta grand-mère.
Il se figurait qu’il y avait là-dessous quelque sens mystique de caché ; et ayant craché dans sa main, mis son petit doigt dans son oreille, et fait beaucoup d’autres choses qui étaient de la cérémonie, il crut que les plus malicieux esprits du monde étaient forcés de se porter plutôt à faire sa volonté de point en point qu’à lui méfaire. Incontinent après, il vit un homme à trente pas de lui, qu’il prit pour le diable d’enfer qu’il avait invoqué.
– Valentin, je suis ton ami, lui dit-il, n’aie aucune crainte ; je ferai en sorte que tu jouiras des plaisirs que tu désires le plus. Mets peine à te bien traiter dorénavant.
La joie que ces propos favorables donnèrent à Valentin modérèrent la peur qu’il avait en l’âme à l’apparition de l’esprit. Enfin, comme il fut disparu, sa frayeur s’évanouit entièrement. Un pèlerin, dont le vrai nom était Francion, lui avait encore ordonné une chose à faire, dont il se souvint, et s’en alla en un endroit désigné pour l’exécuter.
Il lui était avis qu’il embrassait déjà sa belle Laurette ; et parmi l’excès du plaisir qu’il sentait, il ne se pouvait tenir de parler lui tout seul et de dire mille joyeusetés, se chatouillant pour se faire rire. Étant arrivé à un orme, il l’entoura de ses bras, comme le pèlerin lui avait conseillé. En cette action, il dit plusieurs oraisons, et après se retourna pour embrasser l’arbre par derrière, en disant :
– Il me sera aussi facile d’embrasser ma femme, puisque Dieu le veut, comme d’embrasser cet orme de tous côtés.
Mais, comme il était en cette posture, il se sentit soudain prendre les mains, et, quoiqu’il tâchât de toute sa force de les retirer, il ne le put faire : elles furent incontinent liées avec une corde ; et, en allongeant le cou, comme ces marmousets dont la tête ne tient point au corps et qu’on élève tant que l’on veut avec un petit bâton, il regarda tout autour de lui pour voir qui c’était qui lui jouait ce mauvais tour.
Une telle frayeur le surprit, qu’au lieu d’un homme seul qui se glissait vitement entre les arbres après avoir fait son coup, il croyait fermement qu’il y en avait cinquante, et, qui plus est, que c’étaient tous des malins esprits qui s’allaient égayer à lui faire souffrir toutes les persécutions dont ils s’aviseraient. Jamais il n’eut la hardiesse de crier et d’appeler quelqu’un à son secours, parce qu’il s’imaginait que cela lui était inutile et qu’il ne pouvait être délivré de là que par un aide divin, joint qu’il était vraisemblable, à son opinion, que, s’il se plaignait, les diables impitoyables redoubleraient son supplice et lui ôteraient l’usage de la voix, ou le transporteraient en quelque lieu désert. Il ne cessait d’agiter son corps aussi bien que son esprit, et, pour essayer s’il pourrait sortir de captivité, il se tournait perpétuellement à l’entour de l’orme, de sorte qu’il faisait beaucoup de chemin en peu d’espace ; quelquefois il le tirait si fort, qu’il le pensa rompre ou déraciner.
Ce fut alors qu’il se repentit à loisir d’avoir voulu faire le magicien, et qu’il se souvint bien d’avoir ouï dire à son curé qu’il ne faut point exercer ce métier-là, si l’on ne veut aller bouillir éternellement dedans la marmite d’enfer. Ayant cette pensée, sa seule consolation fut de faire par plusieurs fois de belles et dévotes prières aux saints, n’osant en adresser particulièrement à Dieu, qu’il avait trop offensé.
Cependant, la belle Laurette, qui était demeurée au château, ne dormait pas ; car le bon pèlerin Francion la devait venir trouver cette nuit-là par une échelle de corde qu’elle avait attachée à une fenêtre ; et elle se promettait bien qu’il lui ferait sentir des douceurs dont son mari n’avait pas seulement la puissance de lui faire apercevoir l’image.
Il faut savoir que quatre voleurs, ayant un peu auparavant appris qu’il y avait beaucoup de riches meubles dedans ce château dont Valentin était le concierge, s’étaient résolus de le piller, et, pour y parvenir, avaient fait vêtir en fille le plus jeune d’entre eux, qui était assez beau garçon, lui conseillant de chercher le moyen d’y demeurer quelque temps pour remarquer les lieux où tout était enfermé, et pour tâcher d’en avoir les clefs, afin qu’ils pussent ravir ce qu’ils voudraient. Ce voleur, prenant le nom de Catherine, était donc entré il y avait plus de huit jours chez Valentin pour lui demander l’aumône, et lui avait fait accroire qu’il était une pauvre fille dont le père avait été pendu pour des crimes faussement imposés, et qu’elle n’avait pas voulu demeurer en son pays à cause que cela l’avait rendue comme infâme. Valentin, étant touché de pitié au récit des infortunes controuvées de cette Catherine, et voyant qu’elle s’offrait à le servir sans demander des gages, l’avait retirée volontiers dedans sa maison. Ses services complaisants et sa façon modeste, qu’elle savait bien garder en tout temps, lui avaient déjà acquis de telle sorte la bienveillance de sa maîtresse, qu’elle avait eu d’elle la charge du maniement de tout le ménage. On se fiait tant en elle, qu’elle avait beau prendre les clefs de quelque chambre, voire les garder longtemps, sans que l’on craignît qu’elle fît tort de quelque chose et que l’on les lui redemandât.
Le jour précédent, en allant à l’eau à une fontaine hors du village, elle avait rencontré un de ses compagnons qui venait pour savoir de ses nouvelles, pendant que les autres étaient à un bourg prochain, en attendant l’occasion favorable à leur entreprise. Elle lui avait assuré que, s’ils venaient la nuit, ils auraient moyen d’entrer dans le château pour y piller beaucoup de choses qui étaient en sa puissance, et qu’elle leur jetterait l’échelle de corde qu’un d’eux lui avait baillée en secret il n’y avait que deux jours. Les trois voleurs n’avaient donc pas manqué à venir à l’heure proposée ; et, comme ils furent descendus dans les fossés du château, ils virent avaler une échelle de corde par une fenêtre qui était à côté de la grande porte. L’un d’eux siffla un petit coup, et l’on lui répondit de même ; ils regardèrent tous en haut et aperçurent une femme à la fenêtre, qu’ils prirent pour Catherine, encore que ce ne fût pas par ce lieu-là qu’elle leur avait promis de les faire monter.
Il y en avait un entre eux, appelé Olivier, qui, touché de quelque remords de conscience, s’était reconnu depuis peu de jours et avait promis à Dieu en lui-même de quitter la mauvaise vie qu’il menait ; mais ses compagnons, ayant affaire de son aide, parce qu’au reste il était fort courageux, ne l’avaient pas voulu laisser partir de leur compagnie, pour toutes les prières qu’il leur en avait faites, et l’avaient menacé que, s’il s’en allait sans leur congé, auparavant que d’avoir assisté au vol du château, ils n’auraient point de repos qu’ils ne l’eussent mis à mort, quand ce devrait être par trahison. Comme il se vit au fait et au prendre, il dit derechef aux voleurs qu’ainsi qu’il ne voulait pas avoir sa part du butin qu’ils allaient faire, il ne désirait pas avoir sa part de la peine et du péril. Néanmoins, lui ayant été reproché qu’il faisait cela par crainte et par bassesse de courage, il fut contraint de monter tout le premier à l’échelle de corde, craignant que ses compagnons ne lui donnassent la mort.
Quand il fut sauté de la fenêtre dedans une chambre, il fut bien étonné de se voir embrassé amoureusement par une femme qui vint au-devant de lui, et qui ne ressemblait en façon du monde à Catherine. C’était Madame Laurette, qui le prenait pour Francion parmi l’épaisseur des ténèbres de la chambre, ayant éteint la lumière.
Olivier, connaissant la bonne fortune que le destin lui voulait départir, possible pour le récompenser de la bonne intention qu’il avait de n’être plus larron, songea qu’il était besoin d’empêcher que ses compagnons ne vinssent troubler ses délices. Il quitta donc soudain Laurette, pour obéir à la prière qu’elle lui faisait même d’ôter l’échelle ; et, trouvant qu’un de ses compagnons y était attaché déjà, il ne laissa pas de la tirer à soi jusques à la moitié et de la lier à un gond de la fenêtre, par l’endroit où il la tenait. Le voleur jugeait, au commencement, que pour quelque occasion il le voulait ainsi lever jusques au haut, de sorte qu’il ne s’en donnait point de tourment en l’esprit ; mais comme il vit qu’il le laissait là, il commença d’avoir quelque soupçon qu’il lui voulait jouer d’un trait de l’infidélité qu’il avait déjà témoignée. Toutefois il monta dessus l’échelle jusques à la fenêtre de Laurette ; mais Olivier l’avait fermée tout bellement, de manière que n’osant cogner contre, de peur d’être découvert par quelqu’un du château, il lui sembla qu’il lui était nécessaire de descendre. Il se glissa le plus bas qu’il put le long de la corde, qui n’était pas assez longue pour le mener jusques à terre ; et, par hasard, en passant par devant une fenêtre qui était remparée d’un treillis de fer, il y demeura attaché par son haut-de-chausse qui fut traversé d’un barreau pointu, où il s’empêtra si bien, qu’il lui fut impossible de s’en retirer.
Sur ces entrefaites, Francion, ne voulant pas manquer à l’assignation que sa maîtresse lui avait donnée, s’était approché du château, et, ayant vu d’un autre côté Catherine avec une échelle à une fenêtre, il crut que c’était Laurette. Il fut prompt à monter jusques en haut et se mit à baiser cette servante :
– Qui est-ce ? lui dit-elle. Est-ce toi, Olivier, ou un autre ? Es-tu fou de faire tant de sottises en un temps où il nous faut songer diligemment à nos affaires ? Laisse-moi aller aider à monter à tes compagnons. Crois-tu qu’avec l’habit que j’ai, j’aie aussi pris le corps d’une fille ?
Francion, qui avait déjà connu qu’il se méprenait, en fut encore rendu plus assuré par ces paroles, qu’il oyait bien n’être pas proférées par la bouche agréable de Laurette. Il ne s’amusa guère à chercher ce qu’elles voulaient signifier, parce qu’il s’imaginait qu’il n’y avait point d’intérêt. Seulement, il dit à Catherine, qu’il reconnaissait pour la servante, que sa maîtresse lui avait accordé qu’il passerait cette nuit-là avec elle, et qu’il était venu pour jouir d’un si précieux contentement. Catherine, qui avait autant de finesse qu’il en faut à une personne qui exerce le métier dont elle faisait profession, chercha en son esprit des moyens de se défaire de lui, sur l’imagination qu’elle avait qu’il nuirait à son entreprise. De le mener droit à la chambre de sa maîtresse, ainsi qu’il désirait, elle ne le trouva pas fort à propos, d’autant qu’il lui sembla qu’il faudrait, possible, qu’elle fût employée à faire la sentinelle ou quelque autre chose à l’heure que ses compagnons viendraient pour accomplir leur intention. Elle lui fit donc accroire que Laurette était malade, et qu’elle lui avait donné charge de lui faire savoir qu’il ne la pouvait voir pour cette fois-là. Francion, très marri de cette aventure, fut forcé de reprendre alors le chemin de l’échelle. Il était au milieu, lorsque Catherine, qui avait une âme méchante et déloyale, voulant se venger de l’obstacle qu’il lui était avis qu’il mettait à ses desseins, donna à ses bras toutes les forces que sa rage pouvait faire accroître, et se mit à secouer la corde pour le faire tomber. Comme il se vit traité de cette façon, après s’être glissé un peu plus bas, il connut bien qu’il lui fallait faire le saut, de peur que ses membres ne fussent froissés en se choquant contre la muraille. Ses mains quittent donc la prise de l’échelle, et tout d’une secousse il s’élance pour se jeter à terre ; mais il fut si malheureux, qu’il tomba droit dans la cuve où Valentin s’était baigné, contre les bords de laquelle il se fit un grand trou à la tête, dont il sortit tant de sang, qu’en peu de temps l’eau en devint entièrement rouge. L’étonnement et l’étourdissement qu’il eut en cette chute le mirent en tel état, qu’il demeura évanoui et n’eut pas le soin de s’empêcher d’avaler une grande quantité d’eau, dont il pensa être noyé. Catherine, qui entendit le bruit qu’il fit en tombant, se réjouit en elle-même de son infortune et retira soudain son échelle en haut, pensant que ses compagnons ne viendraient pas de cette nuit-là.
Le voleur qui était demeuré en terre, voyant qu’Olivier qui était entré dans le château ne songeait point à lui et que son autre compagnon était attaché en l’air en un lieu dont il ne se pouvait tirer, n’eut point espérance que leurs desseins eussent une bonne issue. Il se figura que l’on trouverait encore ce pendu le lendemain au même lieu, et qu’il n’y avait rien à gagner à demeurer proche de lui, que la mauvaise fortune de se voir pendre, après, d’une autre façon en sa compagnie.
Une certaine curiosité aveugle et conçue sans aucun sujet le convie à se promener par tout le fossé avant que d’en sortir. Étant arrivé à la cuve où était Francion, il voulut voir ce qui était dedans. Ayant connu que c’était un homme, il le tira par le bras et lui mit la tête hors de l’eau ; puis, étant poussé d’un désir de rencontrer de la proie, lequel il ne quittait jamais, il fouilla dedans ses pochettes, où il trouva une bourse à demi pleine de quarts d’écus et d’autre monnaie avec une bague dont la pierre précieuse avait un éclat si vif, que l’on apercevait sa beauté malgré les ténèbres. Cette bonne rencontre lui bailla de la consolation pour tous les ennuis qu’il pouvait avoir, et, sans se soucier si celui qu’il dérobait était mort ou vivant, ni qui l’avait mis en ce lieu-là, il s’en alla où le destin le voulut conduire.
Olivier, qui avait en ses mains un butin bien plus estimable que celui de cet autre voleur, tâcha d’en jouir parfaitement dès qu’il eut fermé les fenêtres de la chambre, par lesquelles il eût pu entrer quelque clarté qui l’eût découvert. Laurette, avec une mignardise affectée, s’était recouchée négligemment sur le lit en attendant son champion, qui dressa son escarmouche sans parler autrement que par les baisers. Après que ce premier assaut fut donné, la belle, à qui l’excès du plaisir avait auparavant interdit la parole, en prit soudainement l’usage, et dit à Olivier en mettant son bras à l’entour de son cou et le baisant à la joue, aux yeux et en toutes les autres parties du visage :
– Cher Francion, que ta conversation est bien plus douce que celle de ce vieillard radoteux à qui j’ai été contrainte de me marier ! que les charmes de ton mérite sont grands ! que je m’estime heureuse d’avoir été si clairvoyante que d’en être éprise ! Aussi jamais ne sortirai-je d’une si précieuse chaîne. Tu ne parles point, mon âme, continua-t-elle avec un baiser plus ardent que les premiers ; est-ce que ma compagnie ne t’est pas aussi agréable que la tienne l’est à moi ? Hélas ! s’il était ainsi, je porterais bien la peine de mes imperfections.
Là-dessus, s’étant tue quelque temps, elle reprit un autre discours :
– Ah ! vraiment, j’ai été bien sotte tantôt d’éteindre la chandelle ; car qu’est-ce que je crains ? Ce vieillard est sorti de céans afin d’aller, je pense, se servir des remèdes que vous lui avez appris pour guérir ses maux incurables. Il faut que je commande à Catherine qu’elle apporte de la lumière : je ne suis pas entièrement de l’opinion de ceux qui affirment que les mystères de l’amour se doivent faire en ténèbres ; je sais bien que la vue de notre objet ranime tous nos désirs. Et puis, je ne le cèle point, ma chère vie, je serais bien aise de voir l’émeraude que tu as promis de m’apporter ; je pense que tu as tant de soin de me complaire, que tu ne l’as pas oubliée. L’as-tu ? dis-moi en vérité.
Rien ne pouvait garantir à Olivier de se découvrir alors, se voyant conjuré par tant de fois de parler, comme s’il eût été Francion. Mais, songeant bien que Laurette pourrait se courroucer excessivement, connaissant qu’elle avait été déçue, il se proposa de chercher tous les moyens de l’apaiser. Il se tira de dessus le lit, et, s’étant mis à genoux devant elle, lui dit :
– Madame, je suis infiniment marri que vous soyez trompée comme vous êtes, me prenant pour votre ami. Véritablement, si vos caresses n’eussent échauffé mon désir, je ne me fusse pas porté si librement à perpétrer le crime que j’ai commis. Prenez de moi telle vengeance qu’il vous plaira ; je sais bien que ma vie et ma mort sont entre vos mains.
La voix d’Olivier, bien différente de celle de Francion, fit connaître à Laurette qu’elle s’était abusée. La honte et le dépit la saisirent tellement, que, si elle n’eût considéré que l’on ne pouvait faire que ce qui avait été fait ne le fût point, elle se fût par aventure portée à d’étranges extrémités. Le plus doux remède qu’elle sut appliquer sur son mal, et celui qui eut de plus remarquables effets, fut de considérer que celui qu’elle avait pris pour Francion lui avait fait goûter des délices qu’elle n’eût pas, possible, goûtées plus savoureuses avec Francion même, et dont elle ne se pouvait repentir d’avoir joui.
Toutefois elle feignit qu’elle n’était guère contente et demanda à Olivier avec une parole rude qui il était. Voyant qu’il ne lui répondait point à ce premier coup, elle lui dit :
– Ô méchant ! N’es-tu point un des valets de Francion ? N’as-tu point tué ton maître pour venir ici au lieu de lui ?
– Madame, dit Olivier, se tenant toujours à terre, je vous assure que je ne connais pas seulement le Francion dont vous me parlez. De vous dire qui je suis, je le ferai librement, moyennant que vous me promettiez que vous ajouterez foi à tout ce que je vous dirai, de même que je vous promets de ne vous conter rien que de véritable.
– Va, je te le promets sur ma foi, dit Laurette.
– Vous avez une servante qui s’appelle Catherine, poursuivit Olivier ; sachez qu’elle est en partie cause de l’aventure qui est arrivée. Je m’en vais vous apprendre comment. Vous croyez que ce soit une fille ; véritablement vous êtes bien déçue, car c’est un garçon qui s’est ainsi déguisé, afin de donner entrée céans à des voleurs. Il avait promis de jeter cette nuit une échelle de corde par une fenêtre pour les faire monter. La débauche de ma jeunesse m’avait fait sortir de la maison de mon père pour me mettre en la compagnie de ces larrons-là ; mais je me délibérai, il y a quelques jours, de quitter leur misérable train de vie. Nonobstant, ayant trouvé l’échelle que vous aviez jetée pour votre Francion, et que je prenais pour celle de Catherine, il m’a fallu y monter, étant en délibération toutefois, non point d’assister au vol, mais de chercher ici quelqu’un à qui je pusse découvrir la mauvaise volonté de mes compagnons, pour les empêcher d’exécuter leur entreprise. Qu’ainsi ne soit, madame, prenez la peine de regarder par quelque fenêtre : vous verrez un des voleurs pendu à l’échelle de corde, que je n’ai qu’à demi tirée. C’est une chose bien claire, que, si j’étais de son complot, je ne l’eusse pas traité de la sorte.
Laurette, étonnée de ce qu’elle venait d’apprendre, s’en alla regarder par une petite fenêtre et vit qu’Olivier ne mentait point. Elle ne lui demanda pas d’autres preuves de son innocence et, voulant savoir ce que faisait alors Catherine, elle l’appela pour lui apporter de la lumière, après avoir fait cacher Olivier à la ruelle de son lit. Catherine, étant venue aussitôt avec de la chandelle allumée et voyant le beau sein de Laurette tout découvert, fut chatouillée de désirs un peu plus ardents que ceux qui eussent pu émouvoir une personne de sa robe. L’absence de son maître et la bonne humeur où il lui était avis qu’était sa maîtresse, lui semblèrent favorables ; car Laurette cachait la haine qu’elle venait de concevoir contre elle sous un bon visage et avec des paroles gaillardes :
– D’où viens-tu ? lui dit-elle. Quoi ! tu n’es pas encore déshabillée, et il est si tard !
– Je vous jure, madame, que je ne saurais dormir, répondit Catherine ; j’ai toujours peur ou des esprits ou des larrons, parce que vous me faites coucher en un lieu trop éloigné de tout le monde ; voilà pourquoi je ne me déshabille guère souvent, afin que, s’il m’arrive quelque chose, je ne sois pas contrainte de m’en venir toute nue demander du secours. Mais vous, madame, est-il possible que vous puissiez être ici toute seule sans aucune crainte ? Mon Dieu, je vous supplie de me permettre que je passe ici la nuit, puisque monsieur n’y est pas. Je dormirai mieux sur cette chaise que sur mon lit, et si je ne vous incommoderai point ; car, au contraire, je vous y servirai beaucoup, en vous donnant incontinent tout ce qui vous sera nécessaire.
– Non, non, dit Laurette, retourne-t’en en ta chambre, je n’ai que faire de toi, et, puisque j’ai de la lumière, je n’aurai plus de crainte. Ce n’est que dans les ténèbres que je m’imagine, en veillant, de voir tantôt un chien, tantôt un homme noir, et tantôt un autre fantôme encore plus effroyable.
– Mais vraiment, interrompit Catherine en faisant la rieuse, vous avez un mari bien dénaturé ! Eh Dieu ! comment est-ce qu’il s’est pu résoudre à vous quitter cette nuit-ci, ainsi qu’il a fait ? Où est-il donc ? Est-il allé prendre des grenouilles à la pipée ? Pour moi, je vous confesse que, toute fille que je suis, je me trouve plus capable de vous aimer que lui.
– Allez, allez, vous êtes une sotte, dit Laurette. Hoy ! les premiers jours que vous avez été céans, vous avez bien fait l’hypocrite ; à qui se fiera-t-on désormais ?
– Trédame, eh ! ce que je dis n’est-il pas vrai ? reprit Catherine. Eh ! que serait-ce donc si je vous avais montré par effet que je suis même fournie de la chose dont vous avez le plus de besoin, et que Valentin ne peut pas mieux que moi vous rendre contente ? Vous auriez bien de l’étonnement.
– Vraiment, voilà de beaux discours pour une fille ! dit Laurette. Allez, ma mie, vous êtes la plus effrontée du monde, ou vous vous êtes enivrée ce soir ; retirez-vous, que je ne vous voie plus ! Que c’est une chose fâcheuse que ces gens-ci ! Autant de serviteurs, autant d’ennemis ; mais quoi, c’est un mal nécessaire.
Catherine qui était entrée en humeur, ne se souciant pas de l’opinion que sa maîtresse pourrait avoir d’elle, s’en approcha pour la baiser et lui faire voir, après, qu’elle ne s’était vantée d’aucune chose qu’elle n’eût moyen d’accomplir. Elle s’imaginait qu’aussitôt qu’elle aurait montré à Laurette ce qu’elle était, elle concevrait de la bienveillance pour elle et ne chercherait que les moyens de la pouvoir souvent tenir entre ses bras. Mais Laurette, sachant bien ce qu’elle savait faire, l’empêcha de parvenir au but de ses desseins et la poussa hors de sa chambre, en lui donnant deux ou trois coups de poing et lui disant force injures.
Tout leur discours avait été entendu d’Olivier, qui sortit de la ruelle et dit à Laurette qu’elle avait bien pu connaître, par les paroles et par les actions de Catherine, qu’elle n’était pas ce qu’elle lui avait toujours semblé. Laurette, reconnaissant cette vérité apparente, lui dit qu’elle voulait mettre ordre à cette affaire-là ; qu’elle voulait empêcher que Catherine ne fît entrer des voleurs dans le château cependant que l’on n’y songerait pas, et qu’elle désirait aussi la punir de ses méchancetés.
– Avisez, madame, ce qu’il est besoin de faire, dit Olivier ; je vous assisterai en tout et partout.
– Je m’en vais trouver Catherine, répliqua Laurette ; suivez-moi, seulement de loin, et venez quand je vous ferai quelque signe, afin de la lier avec ces cordes-ci que vous porterez quant et vous.
Laurette, ayant dit cela, prit la chandelle et s’en alla jusques en la chambre de la servante.
– Là, venez-vous-en avec moi dans cette salle basse, lui dit-elle, portez la lumière.
– Pourquoi faire, madame ? répondit Catherine.
– De quoi te soucies-tu ? répliqua Laurette ; tu le verras mais que tu y sois.
Quand elles furent entrées en la salle, Laurette dit à Catherine :
– Ouvre la fenêtre et monte dessus pour voir ce que c’est qui est attaché au haut de la grille et qui remue à tous moments ; cela m’a mise en peine tout à cette heure en y regardant de là-haut.
Or, c’était le voleur, qui était demeuré là attaché.
Catherine, qui n’en savait rien, après avoir eu la témérité de toucher en bouffonnant les tétons de sa maîtresse, mit le pied sur un placet, et de là sur la fenêtre, où elle ne fut pas plutôt, qu’Olivier qui attendait à la porte s’approcha au signe que lui fit Laurette, qui, ayant pris une grande chaise, monta dessus et empoigna fermement sa servante, tandis que, d’un autre côté, Olivier lui liait les bras par derrière à la croisée.
– Ce n’est pas tout, dit Laurette en riant, lorsqu’elle se vit assurée de sa personne ; il faut voir si elle est ce qu’elle s’est vantée d’être.
En disant ceci, elle lui troussa sa cotte et sa chemise, et lui attacha tout au-dessous du cou avec une aiguillette ; de sorte que l’on pouvait voir sans difficulté ses secrètes parties. Olivier commença alors à s’en gausser, tellement que son compagnon et Catherine le reconnurent à sa parole.
– Ah ! ce dit l’un, je te supplie de m’aider à m’ôter d’ici ; car voilà le jour qui vient, et, si l’on me trouve en cet état, je te laisse à juger ce qui en arrivera.
– Je ne te saurais secourir, répondit Olivier, car il y a une grille de fer entre nous deux. Ma foi, tu fais bien de ne vouloir plus te tenir davantage en l’air ; car c’est un élément qui t’est tout à fait contraire, et tu ne mourras jamais autre part : c’est ta prédestination.
– Tu nous as donc trahis ainsi ? interrompit Catherine ; perfide ! si je tenais ton cœur, je le dévorerais maintenant !
– Ne parle point de tenir, lui répondit Olivier, car tu ne peux plus jouir de tes mains.
– Laissons-les là, dit Laurette ; qu’ils se plaignent tout leur saoul ; personne ne viendra à leur secours que les sergents et le bourreau.
Ayant tenu ce discours, elle convia Olivier de remonter en sa chambre, où ils ne furent pas si tôt, qu’il fut ravi de cette beauté, qu’il ne pensait pas être si merveilleuse qu’elle était, lorsqu’il en avait joui sans lumière. L’ayant considérée attentivement, il prit la hardiesse de cueillir sur sa lèvre quelques baisers, qui ne lui furent point refusés, parce que Laurette, le trouvant de bonne mine, n’était pas fâchée qu’il recommençât le jeu où il avait déjà montré qu’il était des plus savants. Lui, qui lisait ses intentions dedans ses yeux mouvants et lascifs, ne laissa pas échapper la favorable occasion qu’il avait de tâter derechef d’un si friand morceau.
Ils se mirent après à discourir de plusieurs choses. Olivier parla principalement de la bonne fortune qu’il avait eue et fit des serments à Laurette qu’il n’estimait rien au prix, non seulement celles qui lui pouvaient arriver, mais encore celles qui pouvaient venir en son imagination.
– Vous avez beaucoup de sujet de remercier le ciel d’une chose, dit Laurette : c’est de la faveur qu’il vous a départie en faisant que, lorsque je vous ai vu tantôt sur le milieu de l’échelle, vous prenant pour un mien serviteur, je me suis venue mettre sur une chaise en attendant que vous fussiez monté jusques ici ; car, si je me fusse tenue à la fenêtre, j’eusse bien vu que vous n’étiez pas celui que j’attendais et, je ne vous cèle point qu’infailliblement vous eussiez été très mal reçu de moi, au lieu que vous l’avez été si bien, que vous ne vous en sauriez plaindre avec raison.
– Je ne doute point que vous ne m’eussiez maltraité, repartit Olivier, et si je ne m’en offense aucunement ; car quelle bienveillance pourriez-vous avoir pour un homme inconnu qui vous surprend, au lieu de celui que vous aviez dès longtemps pratiqué ? Mais je vous assure que, si je ne suis pareil en mérite ou en beauté de corps à celui à qui vous aviez donné assignation, je lui suis pareil en désir de vous servir, et n’ai pas moins que lui d’affection pour vous.
Ces démonstrations d’amour attirèrent beaucoup d’autres entretiens à leur suite, qui furent souvent interrompus par les embrassements, dont ils goûtaient les délices tout autant de fois qu’il leur était possible.
Quand Laurette vit que le soleil était levé, se figurant que son mari ne tarderait plus guère à revenir, elle pria Olivier de se cacher dedans le foin de l’écurie jusques à tant que, le pont-levis étant abaissé, il eût le moyen de s’en aller. Après qu’il lui eut dit adieu et qu’il lui eut donné une infinité d’assurances de se souvenir toujours d’elle, il s’accorda à se mettre en tel endroit qu’elle voulut et la laissa retourner en sa chambre, où elle s’enferma, en attendant le succès de l’aventure de Catherine.
Il était, ce jour-là, dimanche, et trois jeunes rustres du village s’étaient levés du matin pour aller à la première messe, et de là à un bourg prochain, défier à la longue paume les meilleurs joueurs du lieu. Le curé ne fut pas assez matineux à leur gré. En attendant qu’il fût sorti du presbytère, ils s’en allèrent promener à l’entour du château, où ils aperçurent aussitôt le voleur se tenant d’une main à l’échelle de corde et d’une autre à la grille de fer. Ils virent aussi Catherine toute découverte jusques au-dessus du nombril et la prirent pour un hermaphrodite. Ils s’éclatèrent si fort à rire, que tout le village en retentit ; de sorte que le curé, en boutonnant encore son pourpoint, sortit pour voir ce qui leur était arrivé de plaisant. Leur émotion était si grande, qu’ils ne se pouvaient presque plus soutenir, et ne faisaient autre chose que joindre les mains, se courber le corps en cent postures et se heurter l’un contre l’autre comme s’ils n’eussent pas été bien sages. Leur bon pasteur, ne jetant les yeux que sur eux, ne voyait pas la cause de leurs risées et ne cessait de la leur demander, sans pouvoir tirer de réponse d’eux ; car il leur était impossible de parler, tant ils étaient saisis d’allégresse. Enfin le curé, en tirant un par le bras, lui dit :
– Eh ! viens çà ! eh, Pierrot ! ne veux-tu pas me conter ce que tu as à rire ?
Alors ce compagnon, se tenant les côtés, lui dit à plusieurs fois qu’il regardât à une des fenêtres du château. Le curé, levant la vue vers ce lieu, aperçut ce qui les émouvait à tenir cette sotte contenance, et n’en jeta qu’un éclat de risée fort modéré, pour faire le sérieux et le modeste.
– Vous êtes de vrais badauds, dit-il, de faire les actions que vous faites pour si peu de chose. L’on connaît bien que vous n’avez jamais rien vu, puisque le moindre objet du monde vous incite à rire si démesurément que vous semblez insensés. Je ris, quant à moi, mais c’est de votre sottise : que savez-vous, si ce que vous voyez n’est point un sujet qui vous devrait inciter à jeter des larmes ? Nous saurons tantôt du seigneur Valentin ce que tout ceci veut dire et quels jeux l’on a joués cette nuit en sa maison.
Comme le curé achevait ces paroles, il arriva auprès de lui beaucoup de paysans qui, étonnés du merveilleux spectacle, interrogèrent le voleur et Catherine, qui les avait mis là ; mais ils n’en surent tirer de réponse. Les pauvres gens baissèrent honteusement la tête, et n’y eut que le voleur qui dit à la fin que l’on le tirât du lieu où il était, et qu’il conterait tout de point en point. Le curé dit à ceux qui l’accompagnaient qu’il fallait avoir patience que Valentin eût ouvert le château, et il y en eut qui tournèrent à l’entour, afin de voir s’il n’y avait point quelqu’un aux fenêtres pour l’appeler. Une plaintive voix parvint à leurs oreilles du creux du fossé qu’ils côtoyaient ; ils jetèrent leurs yeux en bas et aperçurent la cuve où était Francion, qui était sorti de son évanouissement et n’avait pas la force de se tirer de ce lieu. Comme ils le virent tout en sang, ils dirent :
– Ha, mon Dieu ! qu’est-ce qui a ainsi accommodé ce pauvre homme-là. Hélas, il a la tête fendue à ce que je pense !
En disant ceci, ils descendirent en bas ; alors l’un d’eux s’écria :
– Miséricorde ! c’est mon bon hôte, ce dévot pèlerin qui demeure en ma maison depuis quelques jours. Mon cher ami, reprit-il en se tournant devers lui, qui ont été les traîtres qui vous ont si mal accoutré ?
– Ôtez-moi d’ici, repartit Francion, secourez-moi, mes amis ; je ne vous puis maintenant rendre satisfaits sur ce que vous me demandez.
Quand il eut dit ces paroles, les villageois le tirèrent hors de la cuve ; et, comme ils le portaient à son hôtellerie, ils rencontrèrent un de ses valets, qui fut bien étonné de le voir en l’équipage où il était. Ce qu’il trouva de plus expédient, fut d’aller querir un barbier, qui arriva comme l’on dépouillait son maître auprès du feu pour le coucher dedans un lit. Il vit sa plaie, qui ne lui sembla pas fort dangereuse, et, ayant mis dessus un premier appareil, il assura qu’elle serait guérie dans peu de temps.
Tandis, tous les habitants du village s’assemblèrent devant le château pour voir le soudain changement d’une fille en garçon. Ceux qui avaient déjà pris leur plaisir de cette drôlerie s’en allaient dire à leurs voisins qu’ils s’en vinssent à la grande place, et qu’ils n’y auraient pas peu de contentement. Le bon fut que les femmes, qui ont bien plus de curiosité que les hommes, et principalement en ce qui est d’une plaisante aventure, voulurent savoir ce que c’était que leurs maris avaient vu. Elles s’en allèrent en troupes jusques au château, où elles ne furent pas sitôt, qu’ayant aperçu Catherine, elles s’en retournèrent plus vite qu’elles n’étaient venues. Celles qui étaient de belle humeur riaient comme des folles, et les autres, qui étaient chagrines, ne faisaient que grommeler, s’imaginant que tout avait été préparé à leur sujet et pour se moquer d’elles.
– Oui, c’est mon, disait l’une, c’est bien en un bon jour de dimanche qu’il faut faire de telles badineries que cela ; encore si l’on attendait après le service ! Cela serait plus à propos à carême-prenant. Ho ! le monde s’en va périr sans doute : tous les hommes sont autant d’Antéchrists.
– Ne vous enfuyez pas, ma commère, dit un bon compagnon ; venez voir la servante de Valentin, elle montre tout ce qu’elle porte.
– Le diable y ait part ! lui répondit-elle.
– Sur mon Dieu, lui répliqua-t-il, vous avez beau faire la dédaigneuse, vous aimeriez mieux y avoir part que le diable.
– Va, va, lui dit une autre bien résolue, nous ne voulons pas avoir seulement part à un morceau ; nous le voulons avoir tout entier.
– Je le sais bien, reprit le rustre ; vous ne vous enfuyez de ce joyau que l’on vous a fait voir, que parce qu’aussi bien est-il trop loin de vous : il y a un fossé et une grille entre deux ; et puis vous aimeriez mieux le manier que le regarder.
– Merci Dieu ! lui dit la femme en se courrouçant ; si tu m’échauffes une fois les oreilles, je manierai le tien de telle façon, que je te l’arracherai et le jetterai aux chiens.
Ainsi les femmes eurent plusieurs brocards ; mais je vous assure qu’elles en rendirent bien le change. Au moins, si elles ne jetèrent des traits aussi piquants, elles dirent tant de paroles et tant d’injures, et se mirent à crier si haut toutes ensemble, qu’ayant étourdi tous les hommes, elles les contraignirent d’abandonner le champ de bataille, comme s’ils se fussent confessés vaincus.
Quelques villageois, s’éloignant du reste de la troupe, s’en allèrent à cette heure-là près du clos où était Valentin, qu’ils ouïrent crier à haute voix. Ils s’approchèrent du lieu où ils l’avaient entendu, ne croyant pas que ce fût lui, et furent infiniment étonnés de voir cet épouvantail couvert d’habillements extraordinaires, attaché à un arbre. En se tempêtant la nuit, son capuchon lui était tombé sur les yeux, de telle sorte qu’il ne voyait goutte et ne savait s’il était déjà jour. Au défaut de ses mains, il avait fort secoué la tête pour le rejeter en arrière ; mais toute la peine qu’il y avait prise avait été inutile. Il ne voyait point les paysans et oyait seulement le bruit qu’ils faisaient en se gaussant de cet objet qui se présentait à leurs yeux, non moins plaisant que celui qu’ils venaient d’avoir en la grande place.