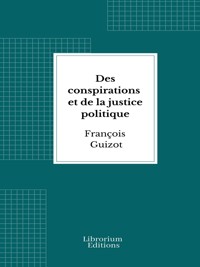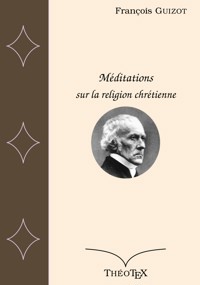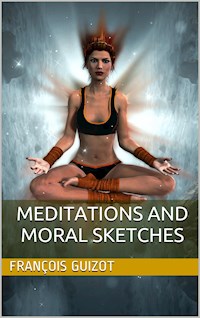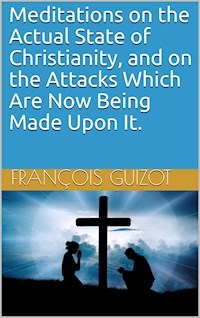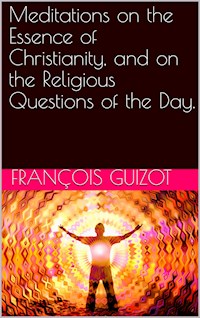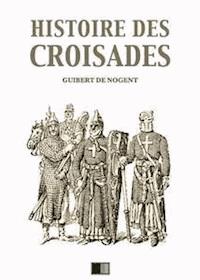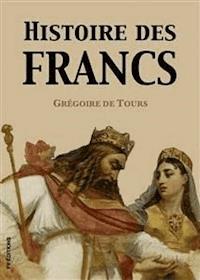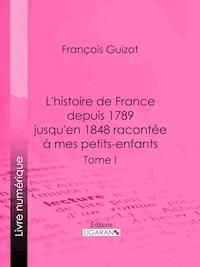L'histoire de France depuis 1789 jusqu'en 1848 racontée à mes petits-enfants E-Book
François Guizot
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Explorez la France de Napoléon : ambitions démesurées, illusions brisées, destins bouleversés. François Guizot raconte la grandeur, les crises et les secrets d’un empire qui a façonné l’Europe.
Au cœur d’une Europe en pleine mutation, suivez la France de Napoléon, de ses triomphes éclatants à ses revers les plus cuisants. Entre réformes intérieures, guerres sanglantes et luttes pour l’indépendance, ce récit dévoile comment l’histoire d’un seul homme est devenue celle d’un continent, bouleversant à jamais le destin des nations.
François Guizot, historien et témoin privilégié du XIXe siècle, offre ici une vision rare et nuancée du Premier Empire. Grâce à une narration vivante et à des sources inédites, il met en lumière les rouages du pouvoir, la censure de la presse, l’opposition libérale, et les illusions qui ont mené la France de la gloire à l’épuisement. Parfait pour les passionnés d’histoire, les lecteurs de Jean Tulard ou Alain Decaux, et tous ceux qui veulent comprendre l’Europe contemporaine à travers ses racines napoléoniennes.
Laissez-vous surprendre par les intrigues diplomatiques, les choix politiques décisifs et les voix oubliées qui ont façonné l’époque. Un livre incontournable pour saisir les enjeux, les passions et les leçons d’une ère où chaque victoire portait en germe sa propre chute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1293
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pendant plus de vingt ans, l’histoire de la France a été l’histoire de l’Europe ; pendant plus de quinze ans, l’histoire de Napoléon a été l’histoire de la France : histoire cruellement sanglante et agitée, parée souvent de tant de gloire et d’éclat, que le pays a pu se bercer et s’est bercé en effet des longues et fatales illusions qui l’ont entraîné à d’amères souffrances. Toute la vie de notre patrie ne s’est pourtant pas éparpillée au loin, à la suite de ses armées victorieuses, ou de ses arrogants négociateurs ; si l’ancienne France s’étonnait parfois de se voir tellement agrandie qu’elle risquait de devenir une des provinces de l’Empire, elle en restait toujours le centre ; son impérieux maître ne l’oubliait pas. Emporté au-delà de son territoire par l’instinct déréglé de l’ambition, il ne renonçait pas au gouvernement intérieur de sa première et plus illustre conquête. Secondé par quelques hommes capables et modestes auxquels il transmettait des ordres péremptoires qu’ils modifiaient quelquefois en les exécutant, Napoléon a fondé tout de nouveau l’administration française, naguère puissante sous Louis XIV entre les mains de ses grands ministres, détruite et bouleversée par les secousses révolutionnaires. Il a établi des institutions, il a élevé des monuments qui sont restés debout lorsque les trophées éblouissants de ses armes ont disparu, que toutes ses conquêtes nous ont été enlevées, après que la France épuisée s’est retrouvée meurtrie et sanglante, plus petite qu’au sortir des mauvais jours de la révolution française.
« À peine revêtu d’une magistrature nouvelle pour la France et pour lui, dit le comte Mollien dans ses mémoires, Napoléon s’était imposé, la tâche de connaître tous les revenus et toutes les dépenses de l’État. Il avait acquis la patience des détails, parce que dans ses campagnes il ne s’était reposé que sur lui seul du soin d’assurer la subsistance, le vêtement, la solde de ses armées. » À la veille d’Austerlitz, à la suite des immenses efforts entrepris, par le gouvernement comme par le public, pour rétablir l’ordre et l’activité dans un pays si longtemps agité et ébranlé par d’incessantes secousses, la mesure des entreprises nouvelles avait été dépassée ; « les embarras s’étendaient de la fortune publique à la fortune privée, tous les symptômes d’une crise grave et prochaine se manifestaient déjà. » Napoléon ne se le dissimulait, pas ; il ne voyait et ne cherchait de remède que dans la victoire. Passant devant M. Mollien pour se rendre au spectacle, il lui avait dit : « Les finances vont mal, la Banque éprouve des embarras, ce n’est pas ici que j’y puis mettre ordre. » Pendant longtemps, la fortune comme le repos de la France devaient dépendre des chances toujours douteuses de la victoire ; longtemps elle la servit avec une constance sans exemple ; le jour vint où la victoire ne suffit plus à notre patrie ; elle n’avait plus la force de supporter le prix de sa gloire. L’empereur Napoléon s’était trompé en cherchant dans la conquête les sources de la prospérité publique ; le sang qui coule des veines d’une nation ne se remplace pas aussitôt lorsqu’une autre nation humiliée et vaincue lui doit à son tour livrer goutte à goutte son sang, ses enfants, ses trésors. La société s’épuise sans que les contributions de guerre et les exactions remplissent, en définitive, les coffres du vainqueur. Les longues hostilités de l’Europe et les alternatives de nos succès et de nos revers nous ont assez appris cette rude leçon. Victorieuse ou vaincue, la France n’a jamais écrasé complètement ses ennemis ; elle n’a jamais été écrasée par eux. Tous ont souffert, tous souffrent encore de cet attentat au bien public des sociétés qu’on appelle la guerre de conquête. Au début de son pouvoir suprême, Napoléon croyait trouver dans la victoire une source inépuisable de richesses. « C’étaient les idées des anciens que Napoléon attachait au droit de conquête, » dit M. Mollien.
Il apprit au lendemain même de la bataille d’Austerlitz que la victoire ne suffit pas au repos et à la prospérité d’un pays ; les dépenses qu’avaient exigées les préparatifs de la guerre, les sommes énormes que le trésor avait dû payer, la crise générale des affaires avaient engagé le ministre du trésor, M. de Barbé-Marbois, à chercher des ressources dans des entreprises hasardeuses confiées à des mains peu sûres. « Vous êtes un très honnête homme, écrivait l’empereur à son ministre, mais je ne puis pas croire que vous ne soyez pas environné de fripons. » Six semaines après la bataille d’Austerlitz, le 26 janvier 1806, Napoléon arrivait à Paris dans la nuit, convoquant pour le lendemain matin un conseil des finances. L’empereur permit à peine qu’on lui adressât, quelques mots sur une campagne si promptement et si glorieusement terminée. « Nous avons, dit-il, à traiter des questions plus sérieuses ; il paraît que les plus grands dangers de l’État n’étaient pas en Autriche ; écoutons le rapport du ministre du trésor. »
« M. de Barbé-Marbois commença ce rapport avec le calme d’une conscience qui ne se reproche rien, » ajoute M. Mollien. Bientôt il exposa comment les recettes constamment inférieures aux dépenses indispensables avaient obligé le trésor à faire des emprunts, d’abord aux receveurs généraux, puis à une compagnie nouvelle de spéculateurs à la tête de laquelle se trouvait M. Ouvrard, homme capable, mais d’une réputation douteuse ; les faiseurs de service, comme on les appelait, avaient à leur suite entraîné l’État dans des affaires périlleuses avec l’Espagne et les délégations sur les receveurs généraux qui leur avaient été concédées dépassaient énormément leurs avances. « L’État est le seul créancier de la compagnie, » dit enfin M. de Marbois.
L’empereur s’emporta. Son esprit prompt et pénétrant, toujours porté à la défiance, découvrait, par instinct et sans pénétrer dans les détails, la fraude qui avait aveuglé son ministre. Il fit appeler les faiseurs de service, les commis principaux du trésor, et confondant les uns et les autres par les éclats de sa colère, il oublia en même temps les égards qu’il devait à l’âge et au caractère de M. de Marbois ; celui-ci fut destitué brusquement, et aussitôt remplacé par M. Mollien. « Je n’ai pas eu besoin d’entendre le rapport entier pour deviner que les faiseurs de service avaient détourné peut-être plus de soixante millions, dit Napoléon à son nouveau ministre ; il faut les retrouver. »
Les dettes des faiseurs de service envers le trésor public étaient plus considérables encore : M. Mollien en devait, trouver la preuve et parer dans une grande mesure aux dangers qui résultaient pour le trésor de cette association funeste avec une compagnie de spéculateurs.
Deux ans plus tard, l’empereur devait placer M. de Barbé-Marbois à la tête de la Cour des Comptes qu’il venait de fonder. Il n’admettait, pas le besoin du repos et le goût de la retraite. Un moment, M. Mollien avait hésité à accepter la charge que lui imposait le maître. Directeur de la caisse d’amortissement, il était satisfait de son poste. « On ne refuse pas un ministère, dit brusquement l’empereur ; ce soir vous prêterez serment. » Le comte Mollien introduisit d’importantes améliorations dans l’administration des finances. La fondation de la caisse de service, en compte courant avec les receveurs généraux, la tenue des livres en partie double, naguère importée en France par Law, mais qui n’avait pas été établie au trésor, la publicité des comptes rendus annuels, tels furent les progrès alors accomplis par le ministre du trésor.
Les travaux publics n’avaient pas été négligés dans ce tourbillon d’affaires qui s’agitaient autour de Napoléon. Il avait ordonné de vastes travaux de routes et de canalisation ; dans les intervalles de repos qu’il consacrait à la France et à son gouvernement intérieur, il conçut la pensée des monuments destinés à immortaliser sa gloire et à fixer dans l’esprit du peuple les souvenirs du passé auquel le maître nouveau de la France attachait quelque prix. Il fit réparer la basilique de Saint-Denis, élever îles chapelles sépulcrales, et institua un chapitre composé d’anciens évêques. Il fit achever le Panthéon, rendu au culte publie sous le nom ancien de Sainte-Geneviève ; il ordonna la construction des arcs de triomphe du Carrousel et de l’Étoile, l’érection de la colonne de la place Vendôme. Deux ponts nouveaux, les pouls d’Austerlitz et d’Iéna, relièrent l’une à l’autre les deux rives de la Seine. L’achèvement du Louvre, la construction de la Bourse, l’érection d’un temple consacré au souvenir des exploits de la grande armée et qui devait devenir l’église de la Madeleine, furent également décrétés. Dans le vaste mouvement de sa pensée qui devançait constamment et le temps et les ressources dont il disposait, Napoléon préparait une lâche énorme pour les gouvernements qui devaient lui succéder. Tous ont laborieusement contribué à l’achèvement de l’œuvre qu’il avait conçue.
En même temps qu’il élevait des monuments et qu’il réorganisait le système de l’administration publique, Napoléon prétendait fonder un nouvel état social. Il avait créé des rois et des princes, il avait élevé autour de lui sa famille et les compagnons de sa gloire à une fortune inouïe, il voulut consolider en l’étendant, cette aristocratie qui lui devait tout son éclat. Il avait magnifiquement doté les grands fonctionnaires de l’Empire, il voulut rétablir au-dessous d’eux et autour d’eux une hiérarchie de serviteurs subalternes, honorés des charges publiques et désormais, par ce seul fait, revêtus pour eux et pour leurs ramilles de titres héréditaires. Dans le discours du trône, par lequel il ouvrit la session du Corps législatif en 1807, Napoléon fit entrevoir à ce sujet ses intentions. « La nation a, dit-il, éprouvé les plus heureux effets de l’établissement de la Légion d’honneur. J’ai créé divers titres impériaux pour donner un nouvel éclat aux principaux de mes sujets, pour honorer d’éclatants services par d’éclatantes récompenses, et aussi pour empêcher le retour de tout titre féodal incompatible avec nos Constitutions. »
C’était donc par un fils de la Révolution, encore imbu de la plupart de ses doctrines, qu’une noblesse devait être créée en France. Le pays ne s’y trompa pas. L’empereur put faire des ducs, des marquis, des comtes, des barons, il ne constitua pas une aristocratie, ce lent produit des siècles dans l’histoire des nations. Les nobles nouveaux demeurèrent des fonctionnaires lorsqu’ils n’étaient pas des soldats, illustres pour leur propre compte comme par l’incomparable éclat de la gloire de leur chef.
L’empereur gagnait des batailles, concluait des traités, élevait ou renversait des trônes, il fondait une noblesse nouvelle et décrétait l’érection de monuments magnifiques, par le seul effort, de sa volonté toute-puissante ; il ne concevait point de limités à cette action impérieuse et se croyait le maître de commander les chefs-d’œuvre de l’esprit comme les mouvements de ses armées. Il n’était pas et ne fut jamais indifférent aux grandes beautés de l’ordre intellectuel, et son goût était choqué lorsqu’on le louait à l’Opéra par de mauvais vers.
Dans sa pensée, l’esprit tenait sa place dans l’état social et devait être partout réglé comme une classe de cet Institut qu’il avait reconstitué et complété. Il jetait déjà les bases du grand corps universitaire qu’il devait bientôt fonder et qui a su, depuis lors, malgré quelques lacunes, rendre à l’éducation et à l’instruction nationales de si importants services. Dans la session de 1800, un projet de loi rédigé par A. Fourcroy, administrateur de l’instruction publique, en avait fait connaître les principes fondamentaux. À côté du corps du clergé, auquel Napoléon ne voulait pas confier l’éducation publique, il avait conçu la pensée d’une corporation laïque, qui ne serait point soumise à des vœux permanents, tout en étant pénétrée de cet esprit de corps qu’il avait appris à regarder comme l’une des grandes forces morales de la société. Sous le nom d’Université impériale, un corps enseignant, nouveau devait être chargé de l’éducation publique dans tout l’Empire ; les membres de ce corps enseignant contracteraient des obligations civiles, spéciales et temporaires. L’éducation professionnelle des hommes destinés à cette carrière, leurs examens, leur incorporation dans l’université, le gouvernement de ce corps confié à un conseil supérieur composé des hommes illustrés par leurs talents, tout ce plan vaste et fécond, dû en grande partie au concours de M. de Fontanes, devait se développer par la suite au sein des orages qui commençaient déjà à s’amonceler sur la France. Napoléon avait dès longtemps conçu le projet, il en remit le détail à d’autres temps ; en attendant qu’il créât la pépinière qui devait fournir à la France des hommes instruits chargés d’élever les générations nouvelles, le tout-puissant conquérant, au milieu de sa campagne de Pologne et dans ses quartiers d’hiver de Finkestein, préparait une note sur rétablissement d’Écouen, récemment fondé pour l’éducation des filles pauvres appartenant aux familles des membres de la Légion d’honneur. Je veux donner ce document presque entier, qui fut l’acte d’un bon sens dédaigneux et rude, afin de montrer comment cet esprit infiniment actif et puissant poursuivait à la fois des entreprises et des pensées diverses, en imprimant à toutes ses œuvres le cachet de son caractère et de sa volonté personnelle.
« Il faut que l’établissement soit beau dans tout ce qui est monument et qu’il soit simple dans tout ce qui est éducation. Gardez-vous de suivre l’exemple de l’ancien établissement de Saint-Cyr, où l’on dépensait des sommes considérables et où l’on élevait mal les demoiselles.
« L’emploi et la distribution du temps sont des objets qui exigent principalement votre attention. Qu’apprendra-t-on aux demoiselles qui seront élevées à Écouen ? Il faut commencer par la religion dans toute sa sévérité. N’admettez à cet égard aucune modification. La religion est une importante affaire dans une institution publique de demoiselles. Elle est, quoi qu’on en puisse dire, le plus sur garant pour les mères et les maris. Élevez-nous des croyantes et non des raisonneuses. La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destination dans l’ordre social, la nécessité d’une constante et perpétuelle résignation et d’une sorte de charité indulgente et facile, tout cela ne peut s’obtenir que par la religion, par une religion charitable et douce. Je n’ai attaché qu’une importance médiocre aux institutions religieuses de (l’école militaire de) Fontainebleau, et je n’ai prescrit que tout juste ce qu’il fallait pour les lycées. C’est tout le contraire pour l’institution d’Écouen. Presque toute la science qui y sera enseignée doit être celle de l’Évangile. Je désire qu’il en sorte non des femmes très agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de mœurs et de cœur, non d’esprit et d’amusement. Il faut donc qu’il y ait à Écouen un directeur, homme d’esprit, d’âge et de bonnes mœurs, que les élèves fassent chaque jour des prières régulières, entendent la messe et reçoivent des leçons sur le catéchisme. Cette partie de l’éducation est celle qui doit être le plus soignée.
« Il faut ensuite apprendre aux élèves à chiffrer, à écrire et les principes de leur langue, afin qu’elles sachent l’orthographe. Il faut leur apprendre un peu de géographie et d’histoire, mais bien se garder de leur montrer le latin ni aucune langue étrangère. On peut enseigner aux plus âgées un peu de botanique et leur faire un léger cours de physique ou d’histoire naturelle, et encore tout cela peut-il avoir des inconvénients. Il faut se borner en physique à ce qui est nécessaire pour prévenir une crasse ignorance et une stupide superstition et s’en tenir aux faits, sans raisonnements qui tiennent directement ou indirectement aux causes premières.
« On examinera s’il conviendrait de donner à celles qui seront parvenues à une certaine classe une masse pour leur habillement. Elles pourraient s’accoutumer à l’économie, à calculer la valeur des choses et à compter avec elles-mêmes.
« Mais, en général, il faut les occuper toutes, pendant les trois quarts de la journée, à des ouvrages manuels ; elles doivent savoir faire des bus, des chemises, des broderies, enfin toute espèce d’ouvrages de femme.
« On doit considérer ces jeunes filles comme si elles appartenaient à des familles qui ont dans nos provinces de quinze à dix-huit mille livres de rente, et ne devant apporter de dot à leurs maris pas plus de douze ou quinze mille francs, et les traiter en conséquence. On conçoit dès lors que le travail manuel dans le ménage ne doit pas être indifférent.
« Je ne sais pas s’il y a possibilité de leur montrer un peu de médecine et de pharmacie, du moins de cette espèce de médecine qui est du ressort d’une garde-malade. Il serait bon aussi qu’elles sussent un peu de cette partie de la cuisine qu’on appelle l’office. Je voudrais qu’une jeune fille, sortant d’Écouen pour se trouver à la tête d’un petit ménage, sût tailler ses robes, raccommoder les vêtements de son mari, faire la layette de ses enfants, procurer des douceurs à sa petite famille au moyen de la partie d’office d’un ménage de province, soigner son mari et ses enfants lorsqu’ils sont malades, et savoir à cet égard, parce qu’on le lui aurait inculqué de bonne heure, ce que les gardes-malades ont appris par l’habitude. Tout cela est si simple et si trivial que cela ne demande pas beaucoup de réflexion.
« Quant à l’habillement, il doit être uniforme. Il faut choisir des matières très communes et leur donner une forme agréable. Je crois que, sous ce rapport, l’habillement actuel des femmes ne laisse rien à désirer. Bien entendu, cependant, qu’on couvrira les bras et qu’on adoptera les modifications qui conviennent à la pudeur et à la santé.
« Quant à la nourriture, elle ne saurait être trop simple ; de la soupe, du bouilli et une petite entrée, il ne faut rien de plus.
« Je n’oserais pas, comme à Fontainebleau, prescrire de faire faire la cuisine aux élèves : j’aurais trop de monde contre moi ; mais on peut leur faire préparer leur dessert et ce qu’on voudrait leur donner, soit pour leur goûter, soit pour les jours de récréation. Je les dispense de la cuisine, mais non pas de faire elles-mêmes leur pain. L’avantage de tout cela est qu’on les exerce à tout ce qu’elles peuvent être appelées à faire et qu’on trouve l’emploi naturel de leur temps en choses solides et utiles.
« Si l’on me dit que l’établissement ne jouira pas d’une grande vogue, je réponds que c’est ce que je désire, parce que mon opinion est que, de toutes les éducations, la meilleure est celle des mères, parce que mon intention est principalement de venir au secours de celles des jeunes filles qui ont perdu leur mère ou dont les parents sont pauvres ; qu’enfin, si les membres de la Légion d’honneur qui sont riches dédaignent de mettre leurs filles à Écouen, si ceux qui sont pauvres désirent qu’elles y soient reçues, et si ces jeunes personnes, retournant dans leurs provinces, y jouissent de la réputation de bonnes femmes, j’ai complètement atteint mon but, et je suis assuré que ; l’établissement arrivera à la plus solide, à la plus haute réputation.
« Il faut dans cette matière aller jusqu’auprès du ridicule. Je n’élève ni des marchandes de modes, ni de femmes de chambre, ni des femmes de charge, mais des femmes pour les ménages modestes et pauvres. La mère, dans un ménage pauvre, est la femme de charge de la maison. »
L’esprit du siècle et les entraînements du luxe dans une époque agitée devaient l’emporter sur la volonté arrêtée et raisonnée du législateur ; les maisons de la Légion d’honneur n’étaient pas destinées à devenir les meilleures écoles pour les mères de famille « dans des ménages modestes et pauvres ». Napoléon avait bien jugé de l’influence supérieure de l’exemple journalier lorsqu’il disait : « Mon opinion est que la meilleure éducation est celle des mères. » La plus sage et la plus prévoyante réglementation ne le saurait jamais remplacer. La religion ne saurait être enseignée par ordre comme la couture ou la cuisine ; la forte leçon des vertus et du dévouement de tous les jours restera éternellement le partage des mères.
La délicate question de l’éducation féminine devait porter la trace du génie organisateur de l’empereur Napoléon ; il avait également cherché à réglementer les encouragements dus au génie par le pouvoir. Dès l’année 1805, il avait institué des prix décennaux destinés à récompenser les auteurs des meilleurs ouvrages dans les sciences physiques, mathématiques, historiques, l’auteur de la meilleure pièce de théâtre, du meilleur opéra, du meilleur poème, les meilleurs peintres et sculpteurs, « afin, disait le préambule du décret, que la France conserve non seulement la supériorité qu’elle a acquise dans les sciences, les lettres et les arts, mais encore que le siècle qui commence remporte sur ceux qui l’ont précédé. »
Ce serait de la part du dix-neuvième siècle une arrogante prétention de revendiquer la supériorité sur ses illustres devanciers du seizième, du dix-septième et du dix-huitième siècle, en ce qui regarde les choses de l’esprit ou l’éclat artistique ; nous avons cependant eu cet honneur et ce bonheur d’être témoins d’une admirable explosion du génie créateur de la France dans toutes les branches de la littérature ou de l’art ; nous avons vu des orateurs, des poètes, des artistes qui pouvaient marcher de pair avec les plus illustres chefs de nos écoles anciennes ; tout cet éclat, toute cette gloire nationale et pacifique n’ont pris naissance qu’au sein de la liberté régulière et de l’ordre constitutionnel. Les agitations de la révolution française, les fortes et continuelles émotions de la guerre, par-dessus tout la domination d’une volonté arbitraire qui ouvrait ou fermait à son gré les lèvres et, les presses, n’avaient pas été propices à l’expansion de l’esprit humain sous le règne de l’empereur Napoléon. Ceux qui possédaient une étincelle de l’admirable don du génie conservaient en même temps dans leurs âmes cette passion de la liberté qui les rangeait nécessairement parmi les ennemis ou les suspects. Au faite de sa suprême puissance, Napoléon ne put jamais souffrir l’indépendance de la pensée ou de la parole. Il avait dès longtemps poursuivi M. Benjamin Constant lorsqu’il avait pris place parmi les membres du Tribunal, il conserva toujours pour Mme de Staël une aversion persécutrice qui témoignait de cette petitesse de caractère souvent cachée sous la grandeur de l’esprit et des vues. Lorsque je feuillette la table des matières de cette immense correspondance de Napoléon qui révèle l’homme tout entier en dépit de la prudence des éditeurs, je retrouve sans cesse le nom de Mme de Staël, accolé à des mesures de rigueur ou à des épithètes malveillantes. « J’écris au ministre de la police d’en finir avec cette folle de Mme de Staël, écrit-il le 20 avril 1807 au comte Regnault Saint-Jean d’Angely, qui s’était excusé de ses relations avec l’illustre proscrite. On ne doit pas souffrir qu’elle sorte de Genève, à moins qu’elle, ne veuille aller à l’étranger faire des libelles. Tous les jours, j’acquiers de nouvelles preuves qu’on ne peut être plus mauvaise que cette femme, ennemie du gouvernement et de cette France dont elle ne peut pas se passer ; » et quelques jours auparavant à Fouché : « Quand je m’occupe de Mme de Staël, c’est que j’ai des laits devant mai. Cette femme est un vrai corbeau, elle croyait la tempête déjà armée, et se repaissait d’intrigues et de folies. Qu’elle s’en aille dans son Léman, les Genevois ne nous ont-ils pas fait assez de mal ? »
Nourri à d’autres sources que Mme de Staël, mais aussi ardent dans son opposition au maître souverain des destinées de la France, M. de Chateaubriand maintenait, comme elle, le drapeau de l’indépendance de l’esprit et du génie contre la volonté arbitraire d’un homme. Il allait le manifester avec éclat ; illustre déjà par la publication du Génie du Christianisme, il écrivait alors dans le Mercure, « Dix-huit mois avant la publication des Martyrs, dit M. Guizot dans ses mémoires, en août 1807, je m’arrêtai quelques jours en Suisse en allant voir ma mère à Nîmes, et dans le confiant empressement de ma jeunesse, aussi curieux des grandes renommées que j’étais inconnu moi-même, j’écrivis à Mme de Staël pour lui demander l’honneur de la voir. Elle m’invita à dîner à Ouchy, près de Lausanne, où elle se trouvait alors. J’étais assis à côté d’elle ; je venais de Paris, elle me questionna sur ce qui s’y passait, ce qu’on y disait, ce qui occupait le public et les salons. Je parlai d’un article de M. de Châteaubriand dans le Mercure qui faisait du bruit au moment de mon départ. Une phrase surtout m’avait frappé, et je la citai textuellement, car elle s’était gravée dans ma mémoire : « Lorsque dans le silence de l’abjection l’on n’entend plus retentir que la chaîne de l’esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu’il est aussi dangereux d’encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l’historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C’est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l’empire, il croît inconnu auprès des cendres de Germanicus, et déjà l’intègre Providence a livré à un enfant obscur la gloire du maître du monde. » Mon accent était sans doute ému et saisissant, comme j’étais ému et saisi moi-même. Mme de Staël me prit vivement par le bras, en me disant : « Je suis sûre que vous « joueriez très bien la tragédie, restez avec nous et prenez place dans « Andromaque. » C’était là chez elle le goût et l’amusement du moment. Je me défendis de sa bienveillante conjecture, et la conversation revint à M. Châteaubriand et à son article qu’on admira beaucoup, en s’en inquiétant un peu. On avait raison d’admirer, car la phrase était vraiment éloquente, et aussi de s’inquiéter, car le Mercure fut supprimé, précisément à cause de cette phrase. Ainsi l’empereur Napoléon, vainqueur de l’Europe et maître absolu de la France, ne croyait pas pouvoir souffrir qu’on dit que son historien futur naîtrait peut-être sous son règne, et se tenait pour obligé de prendre l’honneur de Néron sous sa garde. C’était bien la peine d’être un si grand homme pour avoir de telles craintes à témoigner et de tels clients à protéger. »
Si l’empereur poursuivait avec colère l’esprit d’opposition dans ce monde des salons qu’il travailla sans cesse à rallier autour de lui et s’il en redoutait surtout les glorieux représentants, Mme de Staël et M. de Châteaubriand, il surveillait plus rudement encore les journalistes et les journaux. Son origine révolutionnaire et les premières habitudes de son esprit le rendaient hostile à cette liberté de la presse qui éclata sous l’Assemblée constituante, alla décroissant sous l’Assemblée, législative et vint expirer sous la Terreur dans des flots de sang. Lorsque, dans la Constitution de l’an VIII, M. Daunou voulut inscrire la liberté de la presse, il rencontra une grande opposition de la part des anciens Jacobins. Ils étaient, eux et leurs amis, assurés de dire toujours ce qu’ils voudraient, ils connaissaient les moyens de conserver ce droit, ils l’avaient acquis au prix de bien des massacres ; la liberté que réclamaient leurs adversaires leur paraissait dangereuse et inique. Tel a toujours été le fond de la pensée révolutionnaire, et l’empereur Napoléon n’avait pas oublié cette théorie et cette pratique arbitraires. Cependant il savait aussi quelle peut être l’influence de la presse périodique et il faisait effort pour soumettre à la discipline de sa volonté le petit nombre de journaux qui subsistaient sous son règne. « Remuez-vous donc un peu plus pour soutenir l’opinion, écrivait-il à Fouché le 28 avril 1805 ; faites imprimer quelques articles habilement faits pour démentir la marche des Russes, l’entrevue de l’empereur de Russie avec l’empereur d’Autriche, et ces ridicules bruits, fantômes nés de la brume et du spleen anglais. Dites aux rédacteurs que s’ils continuent sur leur ton actuel, je solderai leur compte, dites-leur que je ne les jugerai point sur le mal qu’ils auront dit, mais sur le peu de bien qu’ils n’auront pas dit. Quand ils représenteront la France vacillante, sur le point, d’être attaquée, j’en jugerai qu’ils ne sont pas Français ni dignes d’écrire sous mon règne. Ils ont beau dire qu’ils ne donnent que leurs bulletins, on leur a dit quels étaient ces bulletins, et puisqu’ils doivent dire de fausses nouvelles, que ne les disent-ils à l’avantage du crédit et de la tranquillité publique ? »
Déjà le Journal des Débats, au premier rang dans la presse périodique, sous l’habile direction de MM. Berlin, avait été doté d’un surveillant spécial chargé de veiller à sa rédaction, et auquel l’administration du journal était tenue de payer douze mille francs par an. Fouché avait menacé les autres journaux de cette mesure disciplinaire en leur ordonnant de mettre « en quarantaine toute nouvelle désagréable et désavantageuse pour la France ». Cette prudence patriotique ne suffit pas longtemps au maître. « Faites connaître à Fiévée que je suis très mécontent de la manière dont il rédige son journal, écrit-il le 6 mars 1808. Il est ridicule que, contre les règles du bon sens, il veuille donner croyance à tout ce que disent les papiers allemands pour faire peur des Russes. Il est ridicule de dire qu’ils mettent cinq cent mille hommes sur pied, tandis que, dans la coalition même, la Russie ne fournissait qu’une centaine de mille hommes, lorsque l’Autriche en fournissait trois cent mille. Mon intention est qu’il ne parle des Russes que pour les humilier, atténuer leurs forces, prouver combien leur fatras de réputation militaire et les éloges de leurs armées sont peu fondés ; » et le même jour à M. de Talleyrand : « Mon intention est que les articles politiques du Moniteur soient faits par les Relations extérieures. Et quand j’aurai vu pendant un mois comment ils sont faits, je défendrai aux autres journaux de parler politique autrement qu’en copiant les articles du Moniteur. »
Nous avons connu les dangers et les redoutables effets d’une liberté illimitée de la presse. Jamais elle ne fut plus effrénée qu’au lendemain d’un système arbitrairement oppressif. Le feu qui paraît alors s’éteindre couve sous la cendre pour éclater bientôt avec une fureur nouvelle. Les trente-trois années du régime constitutionnel dont la France venait de jouir contribuèrent puissamment à la modération des actes et même des paroles au moment de la Révolution de 1848. Le débordement d’injures et de colère qui salua la chute de l’empereur Napoléon s’était lentement accumulé pendant le long silence imposé sous son règne.
La volonté arbitraire et despotique parvient à faire le silence, elle ne réussit pas à le rompre à un jour donné et dans une direction convenue. En vain Napoléon institua des prix décennaux, en vain il demanda, aux diverses classes de l’Institut, des rapports sur la marche de l’esprit humain depuis 1789, le génie littéraire resta sourd à sa voix, et le talent véritable de quelques poètes d’un ordre secondaire, Delille, Esmenard, Millevoye, Chênedollé, ne suffit pas à triompher de l’apathie intellectuelle qui semblait envelopper les gouvernés. « Quand j’entrai dans le monde en 1807, dit M. Guizot, le chaos avait depuis longtemps éclaté, l’enivrement de 1789 avait bien complètement disparu, la société, tout occupée de se rasseoir, ne songeait plus à s’élever en s’amusant ; les spectacles de la force avaient remplacé pour elle les élans vers la liberté. Au milieu de la réaction générale, les fidèles héritiers des salons lettrés du dix-huitième siècle y restaient seuls étrangers. Les mécomptes et les désastres de la Révolution n’avaient point fait abjurer aux survivants de cette brillante génération leurs idées et leurs désirs ; ils restaient sincèrement libéraux, mais sans prétentions pressantes et avec la réserve de gens qui ont peu réussi et beaucoup souffert dans leurs tentatives de réforme et de gouvernement. Ils tenaient à la liberté de la parole, mais n’aspiraient point à la puissance ; ils détestaient et critiquaient vivement le despotisme, mais sans rien faire pour le réprimer ou le renverser. C’était une opposition de spectateurs éclairés et indépendants qui n’avaient aucune chance ni aucune envie d’intervenir comme acteurs. »
C’était ainsi que la lassitude des classes supérieures, décimées et ruinées par la révolution française, et la terreur qu’inspirait le despotisme militaire éclatant et triomphant, contribuaient ensemble à entretenir les esprits dans une mollesse et un assoupissement que le bruit du canon interrompait seul. Je me trompe : les grands savants, mathématiciens ou naturalistes, sortis tout jeunes ou déjà mûrs de l’ère de la révolution française, M. de Laplace, M. de La Grange, M. Cuvier, soutenaient dans l’ordre de leurs études cette supériorité scientifique de la France qui n’a pas toujours marché de pair avec le génie littéraire, mais qui n’a jamais cessé d’illustrer notre patrie. Les goûts personnels de l’empereur servaient et encourageaient les savants, lors même que leurs opinions étaient restées plus indépendantes qu’il ne lui convenait. Il reprochait quelquefois à Monge, son compagnon pendant la campagne d’Égypte, d’être resté au fond du cœur attaché à la république. « Dame ! disait gaiement le grand géomètre, Votre Majesté a tourné si court ! »
Napoléon avait en effet tourné court, et il entendait que la France le suivit dans la rapide évolution de sa pensée. Jaloux de marcher le premier et de tracer à tous la voie, il indiquait aux auteurs dramatiques le canevas de leurs pièces de théâtre, comme aux peintres le sujet de leurs tableaux. « Pourquoi, écrivait-il à Fouché, n’engageriez-vous pas M. Raynouard à faire une tragédie du passage de la première à la seconde race ? Au lieu d’être un tyran, celui qui lui succéderait serait le sauveur de la nation. C’est dans ce genre de pièces que le théâtre est neuf, car sous l’ancien régime ou ne les aurait pas permises ! » En revanche, et par un retour secret de cette crainte de la maison de Bourbon que lui inspira toujours son génie, Napoléon s’opposait à la représentation d’une tragédie d’Henri IV.« Cette époque n’est pas assez éloignée pour ne point réveiller de passions. La scène a besoin de plus d’antiquité. »
Les passions se réveillaient parfois facilement, sur des points qui ne paraissaient pas menaçants ou dangereux. Au lendemain du sacre et du Concordat, quoi de plus naturel et de plus simple que de vouloir rédiger un catéchisme à l’usage de toutes les écoles ? Les articles organiques l’avaient déclaré : « Il n’y aura qu’une liturgie et qu’un catéchisme pour toutes les églises de France. » Au premier abord, la cour de Rome ne fit aucune difficulté. L’abbé Emery, supérieur de Saint-Sulpice, avait donné au ministre des cultes, M. Portalis, un sage conseil : « Si j’étais à la place de l’empereur, avait-il dit, je prendrais purement et simplement le catéchisme de Bossuet. On déclinerait par là une immense responsabilité. » Napoléon avait du goût pour l’esprit et pour la doctrine de Bossuet, l’idée lui plut. Le nouveau catéchisme destiné à former l’esprit et le cœur des générations naissantes fut placé sous le patronage de Bossuet, « de ce prélat fameux dont la science, les talents et le génie ont servi l’Église et honoré la nation, disait le rapport de M. Portalis. La justice que tous les évêques de la chrétienté ont rendue à la mémoire de ce grand homme nous en garantit suffisamment l’exactitude et l’autorité. L’ouvrage des rédacteurs du nouveau catéchisme n’est, à vrai dire, assurait le ministre des cultes, qu’un second exemplaire de l’œuvre de Bossuet. »
Le grand évêque eût, à coup sûr, éprouvé quelque embarras à reconnaître certaines pages du travail si prudemment présenté sous son égide. Rigidement fidèle à l’esprit de l’Évangile quant à la suprême égalité des mortels en présence de Dieu, quelle que pût être parfois sa condescendance pour les volontés du roi Louis XIV, Bossuet développant le quatrième commandement, le respect et la soumission dus par les enfants aux parents, s’était contenté d’ajouter : « Que nous prescrit encore le quatrième commandement ? – De respecter tous supérieurs, pasteurs, rois, magistrats et autres. »
La soumission des sujets de Louis XIV était connue du monarque, et cette exposition lui suffisait. M. Portalis jugea qu’au lendemain de la Révolution française les principes du respect et de l’obéissance avaient besoin d’être plus nettement définis. « Il s’agit d’attacher la conscience des peuples à l’auguste personne de Votre Majesté, dont le gouvernement et les victoires garantissent la sûreté et le bonheur de la France, écrivit-il à Napoléon le 15 février 1800. Recommander en général la soumission des sujets à leur souverain, ce ne serait pas, dans l’hypothèse présente, diriger celle soumission vers son véritable but. J’ai donc cru qu’il était nécessaire de s’expliquer franchement et de rapporter le précepte d’une façon précise à Votre Majesté. Cela ôte toute équivoque en fixant les cœurs et les esprits sur celui qui peut seul et doit réellement fixer les esprits et les cœurs. »
Napoléon avait souscrit sans peine à l’empressement pieux de son ministre des cultes, et il s’était lui-même chargé de rédiger la demande et la réponse du nouveau catéchisme : « La soumission au gouvernement de la France est-elle un dogme de l’Église ? – Oui, l’Écriture enseigne que celui qui résiste aux puissances résiste à l’ordre de Dieu ; oui, l’Église nous impose des devoirs plus spéciaux envers le gouvernement de la France, protecteur de la religion et de l’Église ; elle nous ordonne de l’aimer, de le chérir et d’être prêts à tous les sacrifices pour son service. » Les théologiens, « dont se défiait toujours » M. Portalis, firent remarquer que, l’Église étant universelle, ses dogmes ne pouvaient établir le respect pour un gouvernement particulier ; la rédaction fut donc modifiée et bientôt si fort développée que le commentaire du quatrième commandement devint plus long que l’exposition du principe même. J’en veux donner ici le texte, comme un document curieux de l’esprit du temps.
Leçon VII.Suite du quatrième commandement.
Demande. Quels sont les devoirs des chrétiens à l’égard des princes qui les gouvernent, et quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon Ier, notre empereur ?
Réponse. Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon Ier notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l’empire et de son trône ; nous lui devons encore des prières ferventes pour son salut et pour la prospérité temporelle de l’État.
D. Pourquoi sommes-nous tenus à tous ces devoirs envers notre empereur ?
R. C’est premièrement parce que Dieu qui crée les empires et les distribue selon sa volonté, en comblant notre empereur de dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l’a établi notre souverain, l’a rendu le ministre de sa puissance et son image sur la terre. Honorer et servir notre empereur est donc honorer et servir Dieu lui-même. Secondement, parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ, tant par sa doctrine que par ses exemples, nous a enseigné lui-même ce que nous devons à notre souverain ; il est né en obéissant à l’édit de César-Auguste, il a payé l’impôt prescrit, et, de même qu’il a ordonné de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, il a aussi ordonné de rendre à César ce qui appartient à César.
D. N’y a-t-il pas de motifs particuliers qui doivent plus fortement nous attacher à Napoléon Ier, notre empereur ?
R. Oui, car il est celui que Dieu a suscité, dans les circonstances difficiles, pour rétablir le culte public et la religion sainte de nos pères et pour en être le protecteur. Il a ramené et conservé l’ordre public par sa sagesse profonde et active ; il défend l’État par son bras puissant ; il est devenu l’oint du Seigneur par la consécration qu’il a reçue du Souverain Pontife, chef de l’Église universelle.
D. Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur ?
R. Selon l’apôtre saint Paul, ils résisteraient à l’ordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la damnation éternelle.
D. Les devoirs dont nous sommes tenus envers notre empereur nous lieront-ils également envers ses successeurs légitimes dans l’ordre établi par les constitutions de l’Empire ?
R. Oui, sans doute, car nous lisons dans la Sainte Écriture que Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, par une disposition de sa volonté suprême et par sa providence, donne les empires, non seulement à une personne en particulier, mais aussi à sa famille.
D. Quelles sont nos obligations envers nos magistrats ?
R. Nous devons les honorer, les respecter et leur obéir, parce qu’ils sont les dépositaires de l’autorité de notre empereur. »
Le catéchisme avait été revu et corrigé par la commission des théologiens, par M. Portalis, par l’empereur et par le cardinal légat lui-même, malgré la défense formelle qu’il avait à ce sujet reçue de Rome. « Il n’appartient pas au pouvoir séculier de choisir ou de prescrire aux évêques le catéchisme qu’il aura préféré, avait écrit le cardinal Consalvi le 18 août 1805. Sa Majesté impériale ne pense certainement pas à s’arroger une faculté que Dieu confie exclusivement à l’Église et au vicaire de Jésus-Christ. »
Caprara avait tenu cachée la dépêche du secrétaire d’État. Le texte du catéchisme avait reçu son approbation lorsqu’il parut enfin en 1800. Ce fut par un article du Journal de l’Empire du 5 mai 1800 que la cour de Rome apprit la prochaine publication d’un catéchisme, uniforme et obligatoire pour tous les diocèses de France, avec l’approbation officielle du cardinal légat. Une dépêche du cardinal Consalvi, exprimant à Caprara l’étonnement et le mécontentement du souverain pontife, resta secrète et sans effet. La puissance de la cour de Rome auprès de son envoyé échouait devant la séduction mêlée d’effroi que l’empereur Napoléon avait dès son arrivée à Paris exercée sur le cardinal Caprara. Les évêques français n’étaient pas moins troublés que le pape. « Est-ce à l’empereur de se mêler de ces choses-là ? écrivait à l’un de ses amis M. d’Aviau, archevêque de Bordeaux. Qui lui en a donné la mission ? À lui les choses de la terre, à nous les choses du ciel ; bientôt, si nous le laissons faire, il mettra la main à l’encensoir et peut-être voudra-t-il plus tard monter à l’autel. »
Une seule modification fut concédée aux réclamations des évêques, appuyées par le cardinal Fesch. Au mépris de Bossuet et de ses enseignements, la constante doctrine du catholicisme : « Hors de l’Église, point de salut, » avait été omise dans le nouveau catéchisme. La phrase fut rétablie, et le catéchisme, revêtu de l’approbation du légat, parut dans les premiers jours d’août 1808. Placée dans l’alternative de démentir ou de rappeler Caprara, la cour de Rome garda prudemment le silence. Les différends s’accumulaient entre le pape et l’empereur, entre l’autorité spirituelle, qui conservait encore quelques prétentions à l’indépendance, et la volonté arbitraire du conquérant, résolu à gouverner le monde, Rome comprise. Nous arrivons enfin au moment où l’excès de l’arrogance devait provoquer l’effet des volontés contraires. Nous allons voir le pape captif, le peuple espagnol soulevé, le climat et les déserts de la Russie ligués contre le maître-tyrannique de l’Europe. L’Angleterre n’avait jamais accepté le joug. Partout elle avait secondé la résistance. Désormais, ce n’était plus sur la mer seulement ou par l’appui de ses subsides qu’elle entrait dans la lice, sir Arthur Wellesley allait à son tour engager la lutte.
Un dernier acte de la volonté absolue de l’empereur Napoléon devait signaler la période du gouvernement intérieur de la France qui précéda la guerre d’Espagne et les campagnes d’Allemagne et de Russie : ce fut la suppression pure et simple, par un sénatus-consulte, de ce Tribunat naguère institué avec tant de pompe, et qui était peu à peu tombé dans l’insignifiance à la suite des épurations successives qu’il avait subies et du secret qui avait été imposé à ses délibérations. Le pouvoir absolu ne pouvait supporter ni la contradiction, ni l’apparence même de la discussion, quelque modérée qu’elle put être. Le souvenir importun d’une opposition éloquente et courageuse s’attachait cependant encore au nom du Tribunat. Des noms honorés avaient survécu dans ce grand silence. « L’abolition du Tribunat sera moins un changement qu’une amélioration dans nos institutions, dit M. Boulay de la Meurthe dans son rapport, le Tribunat n’offrant plus, depuis la constitution de l’Empire, que l’aspect d’une pièce inutile, déplacée et discordante. » Le Corps législatif donna asile aux membres du Tribunat encore en exercice ; ils prirent de droit place dans ses rangs ; ils y disparurent, annulés par la servitude qui régnait autour d’eux. Le prix de leur admission dans le Corps législatif avait cependant été décoré d’une apparence libérale : la parole avait été rendue à cette assemblée.
M. de Fontanes prit d’avance le soin de marquer quel esprit devait présider à ses discussions. « Ces enceintes qui s’étonnaient de leur silence, et dont le silence va cesser, n’entendront pas gronder les tempêtes populaires. Que la tribune y soit sans orages et qu’on n’y applaudisse qu’aux triomphes de la raison. Que la vérité surtout s’y montre avec courage, mais avec sagesse, et qu’elle y brille de toute sa lumière. Un grand prince en doit aimer l’éclat. Elle seule est digne de lui, qu’en pourrait-il craindre ? Plus on le regarde, plus il s’élève ; plus on le juge, plus on l’admire. » Par la bouche de M. Carrion-Nisas, le Tribunal remercia l’empereur de l’avoir déchargé de ses fonctions. « Nous croyons moins arriver à l’extrémité de notre carrière qu’atteindre le but de tous nos efforts et la récompense de notre dévouement, » disaient-ils. Assuré de la docilité des grands corps de l’État, tranquillisé sur celle de la magistrature dont il avait ordonné l’épuration, l’empereur Napoléon put tourner ses pensées vers l’extérieur : il s’agissait d’asseoir le roi Joseph sur le trône d’Espagne.
Napoléon n’avait, pas tenu sa promesse aux Bourbons d’Espagne : il n’était pas venu à Madrid pour apaiser les divisions et pour raffermir le pouvoir ébranlé ; il avait attiré l’un après l’autre tous les membres de la famille royale à Rayonne, et là, sur le sol français, il avait facilement consommé leur perte. C’était de même sur le sol français qu’il préparait l’élévation de son frère au trône. Le roi Joseph tardait à arriver : ce fut le 8 juin seulement qu’il fit son entrée à Rayonne ; déjà la volonté impérieuse et les habiles manœuvres de l’empereur avaient amené dans cette ville un certain nombre de grands seigneurs favorables au pouvoir nouveau par intérêt ou par crainte ; déjà Joseph était proclamé roi d’Espagne et des Indes ; à peine ce prince avait-il eu le temps de mettre le pied à terre, qu’il était entouré de députations espagnoles soigneusement préparées par ordre de Napoléon. C’était à regret que le nouveau monarque de l’Espagne avait quitté Naples ; sans prévoir les difficultés qui l’attendaient, il aimait la vie douce et facile de l’Italie, et n’avait pas encore oublié les ennuis d’une prise de possession et les obstacles que rencontre un régime nouveau. L’empereur prit soin de l’étourdir dès le début ; la junte formée à Bayonne préparait une constitution ; Napoléon avait réuni de nombreux renseignements sur le lamentable état de l’administration en Espagne. « Il me faut ces documents pour les mesures que j’ai à ordonner, avait-il écrit à Murat toujours à Madrid, malade et triste ; il me les faut aussi pour apprendre un jour à la postérité dans quel état j’ai trouvé la monarchie espagnole. » Inutile précaution d’un grand esprit qui croyait disposer de l’avenir et du jugement de la postérité comme il avait jusqu’alors ébloui ou terrassé tous les témoins de sa prodigieuse carrière !
Huit jours après l’arrivée du roi Joseph à Bayonne, la nouvelle constitution était adoptée par la junte improvisée. « C’est tout ce que nous pouvons vous offrir, sire, avait dit imprudemment le duc de l’Infantado, naguère le plus ardent complice du prince des Asturies dans ses intrigues contre son père ; nous attendons que la nation se prononce et nous autorise à donner un plus libre cours à nos sentiments. » On fit taire le duc ; la nation espagnole n’avait pas été consultée.
La constitution espagnole avait été généralement inspirée par le modèle de la constitution française ; l’article premier rendait hommage aux passions religieuses de l’Espagne : « La religion de l’État est la religion catholique, aucune autre n’est permise. » Le roi Joseph venait de choisir ses ministres ; plusieurs avaient fait partie du gouvernement de Charles IV. Après avoir prêté serment à son nouveau monarque, le premier soin de la junte fut d’aller remercier et complimenter l’empereur Napoléon à Marac.
Au même moment, et pendant qu’il appelait à Bayonne les renforts de troupes qu’il destinait à accompagner et à soutenir le roi Joseph à l’entrée de son nouveau royaume, Napoléon écrivait à l’empereur Alexandre :
« Monsieur mon frère, j’envoie à Votre Majesté la constitution que la junte espagnole vient d’arrêter. Les désordres de ce pays étaient arrivés à un degré difficile à concevoir. Obligé de me mêler de ses affaires, j’ai été par la pente irrésistible des évènements conduit à un système qui, en assurant le bonheur de l’Espagne, assure la tranquillité de mes États. J’ai lieu d’être très satisfait de toutes les personnes de rang, de fortune et d’éducation. Les moines seuls, qui occupent la moitié du territoire, prévoyant dans le nouvel ordre de choses la destruction des abus, et les nombreux agents de l’inquisition qui entrevoient la fin de leur existence, agitent le pays. Je sens bien que cet évènement ouvrira un des plus vastes champs pour disserter. On ne voudra pas apprécier les circonstances et les évènements, on voudra que tout ait été suscité et prémédité. Cependant, si je n’eusse considéré que l’intérêt de la France, j’aurais eu un moyen plus simple, qui eût été d’étendre mes frontières de ce côté et d’amoindrir l’Espagne. Une province comme la Catalogne ou la Navarre eût été plus pour sa puissance que le changement qui vient d’avoir lieu, qui en réalité n’est utile qu’à l’Espagne. »
Pendant que l’empereur Napoléon annonçait ainsi en Europe ce qu’il lui convenait de faire croire sur les évènements d’Espagne, pendant que le nouveau roi, parti de Bayonne le 9 juillet, mettait le pied sur son territoire, du nord au midi, de l’est à l’ouest, l’Espagne tout entière était en feu.
Depuis le départ des princes de la maison de Bourbon pour Bayonne, l’agitation et l’inquiétude populaire étaient restées grandes à Madrid ; elles s’étaient peu à peu répandues dans les provinces les plus reculées et dans les profondeurs de la vieille race espagnole, honnête et Hère, qui conservait aux champs ses qualités traditionnelles. « Ne fiez ni votre honneur ni votre personne à un grand d’Espagne, disait à M. Guizot une personne qui avait appris à les juger sévèrement au travers des révolutions ; confiez tout ce que vous avez de plus cher à un paysan espagnol. » Malgré les assertions de l’empereur, tous les grands seigneurs espagnols n’étaient pas favorables au roi Joseph. Dans la campagne, les paysans s’étaient soulevés en masse, les bourgeois en faisaient autant dans les villes.
La première, la ville de Carthagène avait donné l’exemple de la révolte ; dès le 22 mai, à la nouvelle de l’abdication des deux rois publiée à Madrid dans les journaux du 20, on avait crié dans les rues « vive Ferdinand VII ! » et l’on avait arrêté l’amiral Salcedo qui se préparait à conduire à Toulon la flotte espagnole. Les armes renfermées dans les arsenaux furent distribuées à la population. Une junte se forma aussitôt. Murcie et Valence suivirent l’exemple de Carthagène. Le peuple, exalté par les prédications d’un moine, le chanoine Calvo, massacra un seigneur de la province, le baron d’Albulat, qui fut en vain défendu par un autre moine, le P. Rico. Les Français habitant Valence s’étaient réfugiés dans la citadelle : ils furent attirés au dehors par un stratagème et bientôt égorgés jusqu’au dernier. À ce premier élan de la fureur populaire succéda l’horreur des honnêtes gens ; le comte de Cerbellon se trouva contre son gré placé à la tête de l’insurrection. Tout le monde prit les armes, on attendait l’arrivée et la vengeance des soldats français.
Toutes les provinces s’insurgeaient les unes après les autres ; les plus apathiques attendirent le jour de la Saint-Ferdinand ; le 30 mai, lorsque le jour se leva sans que le drapeau du saint fût arboré par les rues, dans l’Estramadure, à Grenade, à Malaga, les cris de la populace proclamèrent le roi Ferdinand VII. Partout le sang fut répandu avec un atroce déploiement de cruauté. Les magistrats ou les gentilshommes qui cherchaient à entraver un soulèvement dangereux furent massacrés. Les Asturies avaient tressailli au premier bruit de l’abdication ; la junte d’Oviedo proclama le rétablissement de la paix avec l’Angleterre et envoya des délégués à Londres. Le clergé parvint à protéger l’existence de deux colonels des régiments espagnols qui s’étaient opposés au soulèvement de leurs troupes. En Galice, les honnêtes efforts du capitaine général Filangieri lui coûtèrent la vie ; il avait accepté à regret la présidence de la junte : lorsqu’il tenta de maintenir l’ordre parmi les insurgés, il fut assassiné dans la rue. Valladolid avait obligé le capitaine général, don Gregorio de la Cuesta, à prêter les mains au soulèvement populaire. Au premier signe d’opposition du vieux soldat, on avait dressé une potence sous ses fenêtres, Burgos, occupée par le maréchal Bessières, restait immobile, mais Barcelone tenta un mouvement insurrectionnel ; partout les Catalans étaient armés jusqu’aux dents ; le général Duhesme annonça l’intention de mettre le feu à la ville : les plus turbulents s’enfuirent vers des lieux moins menacés. Saragosse avait placé à la tête de son héroïque population don Joseph Palafox de Melzi, jeune, charmant et bien connu dans son pays natal. Il avait convoqué les Cortès de la province et ordonné la levée en masse de l’Aragon ; sur les confins de la Navarre, et presque sous les yeux de l’armée française, Santander et Logroño se soulevèrent. Les Castilles, avec leurs vastes plaines ouvertes et leur proximité du gouvernement français, s’agitaient sourdement sans oser encore s’insurger. Murat était malade, souvent en proie au délire, mais le général Savary veillait sur Madrid ; la capitale attendait son nouveau maître.
Nulle part l’insurrection n’avait été plus spontanée et plus générale que dans l’Andalousie. Séville avait conçu l’espoir de devenir le centre du mouvement national et de grouper autour d’elle les efforts patriotiques de l’Espagne tout entière. Le gouvernement provisoire se revêtit d’un nom pompeux ; la Junte suprême de l’Espagne et des Indu, envoya des messagers pour soulever les villes de Badajoz, de Cordoue de Jaen. À Cadiz, on entoura l’hôtel du capitaine général Solano, marquis de Socorro. Tous les corps de troupes dispersés dans le midi de l’Espagne obéissaient à son commandement ; on lui arracha avec peine un assentiment forcé aux désirs tumultueux de la populace ; il persista à s’opposer au bombardement de la flotte française commandée par l’amiral Rosily et qui se trouvait depuis trois, ans dans la rade. Il alléguait en vain le danger auquel on allait exposer les navires espagnols confondus parmi les vaisseaux français. La multitude devint furieuse. Le capitaine général parvint à se réfugier chez un de ses amis. Sa retraite fut trahie ; blessé entre les bras de la femme de son hôte qui cherchait à le défendre, il fut entraîné sur les remparts et bientôt massacré. Le général Castaños qui commandait au camp de Saint-Roque, avait plié devant la volonté clairement manifestée de ses troupes. Il connaissait trop l’armée française pour ne pas concevoir de grandes craintes, mais le mouvement populaire était irrésistible : Je général Castaños accepta le commandement supérieur des quinze à dix-huit mille soldats qui se trouvaient réunis entre Séville et Cadiz.
Sans entente préparatoire, dans un pays partout entrecoupé par les fleuves et par les montagnes, jusque sous le feu des canons français, l’Espagne se soulevait ainsi spontanément contre une usurpation arrogante, précédée par une lâche perfidie. Elle portait dans ce premier élan de sa colère patriotique ; le courage, l’ardeur, la passion qui devaient assurer son triomphe ; elle, y déployait en même temps une cruauté et une violence sauvages dont nos malheureux soldats furent trop souvent victimes. L’empereur était encore à Bayonne, tout occupé de régler les affaires de l’Espagne en dehors de l’Espagne ; il apprenait tardivement et imparfaitement les mouvements insurrectionnels qui soulevaient partout le pays. Accoutumé à commander de loin et arbitrairement à ses lieutenants, il ordonna de Bayonne tous les mouvements de ses troupes, affectant d’attacher peu d’importance à la révolte, envoyant à Paris et à Valençay de fausses nouvelles sur les succès de ses armes et cachant de son mieux au roi Joseph l’étendue et l’importance de la résistance qui se préparait contre lui. Sur beaucoup de points, les courriers étaient arrêtés ou assassinés ; l’empereur fit repartir le général Savary pour Madrid.
Cependant toutes les forces de l’armée française étaient en marche pour écraser l’insurrection. Le général Verdier et le général : Frère avaient eu bientôt raison du soulèvement de Logroño et de Ségovie ; le général Lasalle battit, en avant de Valladolid, don Gregorio de la Cuesta qui avait été forcé de quitter la ville, craignant d’y être égorgé, « Vous n’avez que ce que vous méritez, – disait le vieux général espagnol, en se repliant sur Léon, – nous ne sommes qu’une poignée de paysans indisciplinés et vous prétendez vaincre ceux qui ont vaincu toute l’Europe. » Le général Lefebvre-Desnouettes rencontra plus de résistance à Tudela, dont les insurgés avaient rompu le pont sur l’Èbre. Le 15 juin, il se trouva devant Saragosse : don Joseph Palafox s’y était enfermé, la population tout entière couvrait les toits des maisons, d’où pleuvaient une grêle de balles. Le général français comprit qu’il s’agissait d’un siège en règle : il fit demander à Barcelone des renforts et de l’artillerie. Le maréchal Moncey n’avait pas encore pu réussir à gagner Valence. Le général Duhesme était bloqué dans Barcelone par l’insurrection, qui gagnait de jour en jour plus de terrain en Catalogne. Il se vit cependant obligé de détacher le général Chabran, qui devait rejoindre le maréchal Moncey ; les insurgés profitèrent de cette division de nos forces pour se jeter sur la colonne du général Schwartz, chargée de fouiller le couvent du Montserrat. Partout dans les villages des montagnes le tocsin sonnait, les ponts des torrents étaient coupés, il fallait enlever chaque bourg à la baïonnette. Une sortie du général Duhesme délogea les ennemis de leur poste sur la rivière du Llobregat, il s’empara des canons, qu’il ramena dans Barcelone. « Qu’il désarme toute la ville de Barcelone, écrivait l’empereur le 10 juin au maréchal Berthier, de manière à n’y pas laisser un seul fusil, qu’il approvisionne de vivres le château et Montjouy en prenant chez les habitants. Il faut les mener très militairement. La guerre justifie tout. Au moindre évènement, il faut prendre des otages et les envoyer dans le fort. »
Le général Dupont avait été chargé de l’entreprise à la fois la plus difficile et la plus importante. Douze à treize mille hommes marchaient sous ses ordres ; il s’avançait vers l’Andalousie avec la mission de réduire à la soumission cette grande province et de protéger la flotte française de Cadix. L’empereur avait ordonné au général Junot de soutenir le mouvement de Dupont en lui envoyant la division de Kellermann, mais le Portugal imitait l’exemple de l’Espagne et se soulevait tout entier. Dès ses premiers pas en Andalousie, Dupont reconnut l’importance de l’insurrection, et demanda aussitôt du renfort, « Je n’aurai plus alors à faire qu’une promenade conquérante, » écrivit-il au général Savary.
Le 7 juin, après un combat assez vif, les troupes françaises enlevaient le pont d’Alcolea sur le Guadalquivir ; le soir même elles arrivèrent devant Cordoue. Une canonnade enfonça les portes, il fallut enlever à la baïonnette les barricades et les maisons. Les soldats s’irritèrent, et lorsqu’ils furent vainqueurs, ils usèrent cruellement de la victoire. La haine s’en accrut ; derrière nous, en deçà de la Sierra Morena, sur la route de Cordoue à Andujar, les traînards, les malades, les blessés qui avaient été obligés de s’arrêter dans les villages, étaient mis à mort avec des raffinements de barbarie. Le général Dupont attendait les deux divisions Vedel et Frère qu’il avait demandées à Madrid ; à Cadiz, sur la flotte française, on comptait les jours, bientôt les heures.