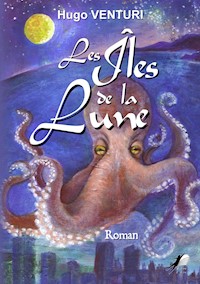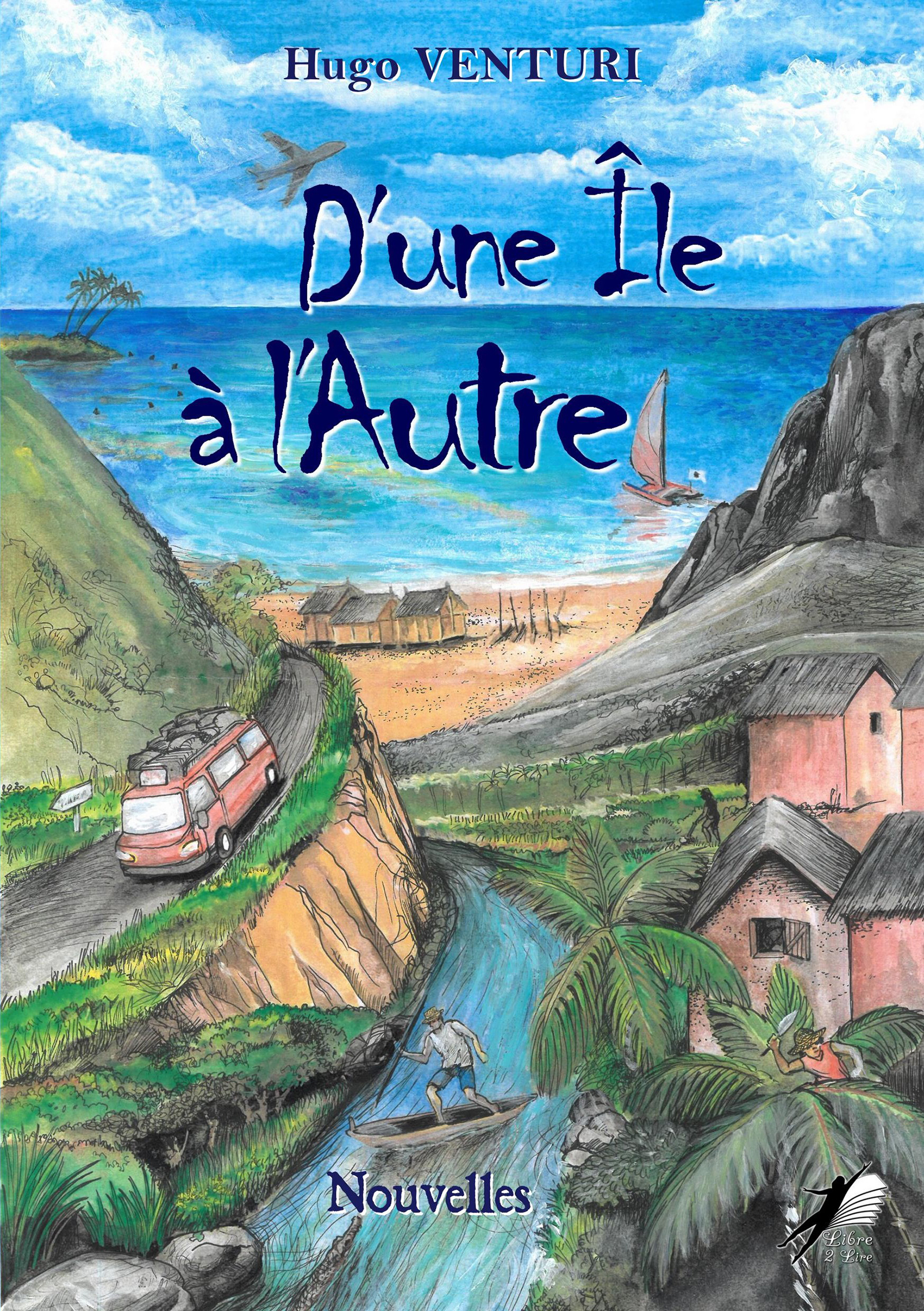Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Qui n’a jamais rêvé de vivre à Madagascar ?
De se baigner dans ses eaux limpides et turquoises bordées de plages sauvages, de marcher dans ses forêts primaires et luxuriantes peuplées d'animaux endémiques et de profiter de son climat tropical toute l’année.
Mais au-delà des clichés de carte postale, l'Île Rouge à des secrets bien plus profonds à révéler.
Depuis une quinzaine d'années, Ugo sillonne la grande Île de long en large et pendant tout ce temps, il aura essayé de la comprendre à travers ses habitants et sa culture. Au gré des opportunités et des rencontres, simple voyageur ou entrepreneur tenace, il tentera à chaque fois de surmonter les nombreuses difficultés qui se dresseront devant lui, en se débattant dans un monde régi par d’autres lois, d’autres codes.
Plus qu'un voyage, un véritable parcours initiatique haut en couleurs vers Madagascar…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Insatiable voyageur depuis l’âge de vingt ans,
Hugo VENTURI n’a jamais cessé de courir derrière ses rêves. Moniteur de plongée, restaurateur ou encore chercheur de pierres, il vit aujourd’hui entre la Corse et Madagascar. Son style d’écriture direct et limpide s’adresse directement au cœur des lecteurs et tente de réveiller en chacun d’eux, l’envie de découvrir son propre eldorado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo VENTURI
L’Île Rouge
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en Francepar Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN papier : 978-2-38157-514-8ISBN Numérique : 978-2-38157-514-8Dépôt légal : Février 2024
© Libre2Lire, 2024
Pour ma fille,le plus beau fruit de mes voyages.
« Nous sommes des pauvres qui dormonssur des lits d’or et de saphirs… »
Citation malgache
-1-L’arrivée à Mahajunga
La première fois que je posais le pied à Madagascar, ce fut après une longue et éprouvante traversée du canal du Mozambique qui séparait Mayotte de la grande île… J’avais embarqué, trente-six heures plus tôt, sur un bateau de fortune enregistré aux affaires maritimes de Dzaoudzi sous le nom de « Andry » et j’avais aussitôt regretté de ne pas avoir pris l’avion pour me rendre à Mahajanga, la ville portuaire la plus proche du département français. Sur la proue du rafiot rouillé s’entassait pêle-mêle des carcasses de voitures, une quantité impressionnante de pneus usés et de pièces mécaniques corrodées à faire pâlir le plus débonnaire des douaniers. J’avais quitté Mayotte avec moins de regrets que lors de mon premier séjour dans les années 90 car j’en avais eu marre de tourner en rond sur ce caillou dont j’avais déjà maintes fois goûté aux saveurs et dont l’ambiance festive et conviviale d’antan s’était effacée petit à petit devant la modernité et l’insécurité. Les voitures se faisaient plus nombreuses et paradoxalement l’auto-stop ne marchait plus. Les téléviseurs avaient remplacé les balades nocturnes des voisins. Le paradis se changeait immuablement en enfer, alimenté par un flot incontrôlé et ininterrompu d’immigrés clandestins venus des îles Comores toutes proches. Mon ancien quartier tranquille, perché sur les hauteurs de Kaweni, était devenu le plus gros bidonville de Mayotte et un coupe-gorge redoutable. La violence s’installait et personne ne savait comment l’endiguer… Sur place, les Français en mal d’aventure comme moi parlaient souvent de Madagascar, la grande île orientale voisine, comme d’un pays fantastique et immense où tout était possible. L’offre était tentante et facilement accessible, alors j’avais voulu tenter ma chance. Et après une journée et demie passée en mer, avec un simple sac à dos comme bagage, j’étais prêt à découvrir cette île enchanteresse qui promettait monts et merveilles à qui osait la fouler.
Mais pour cela, il fallait encore attendre que le matelot amarrât le bateau au quai, et le vent soufflant de puissantes rafales n’aidait en rien la délicate manœuvre. Après plusieurs tentatives infructueuses, son collègue à terre réussit enfin à rattraper l’énorme bout et à l’attacher à la bitte d’amarrage. Mais c’était sans compter sur la fureur des éléments qui, poussant de toutes leurs forces sur la coque du navire, achevèrent de déchirer la grosse corde tressée, déjà usée par le temps et les intempéries. Le pauvre marin, aux premières loges sur le pont avant, n’eut pas le temps de reculer assez vite et l’amarre lui fouetta le tibia dans un claquement sinistre. Heureusement pour moi, je me trouvais sur le bastingage tribord, loin de tout danger. Ce malencontreux incident obligea les passagers à patienter encore quelques heures de plus avant de débarquer, car personne de l’équipage ne voulait se risquer de nouveau à la périlleuse opération. Mais le pire, c’était pour ce pauvre bougre qui hurlait à la mort sans soin véritable pour calmer la douleur de sa fracture ouverte. Lorsque la tempête faiblit, on s’approcha une seconde fois de l’embarcadère et un courageux mousse lança une amarre plus solide qui cette fois, tenu bon. Je passais les formalités douanières en présentant mon passeport au personnel du port puis, mon sac sur le dos, m’engageais le pas nonchalant sur une grande avenue qui remontait vers le centre-ville de Mahajanga. Il faisait aussi chaud qu’à Mayotte, mais je n’en souffrais pas car mon organisme était déjà acclimaté à la moiteur tropicale. Je n’avais aucune idée de l’heure, mais mon horloge biologique m’indiquait clairement que je crevais la dalle. Dans la précipitation du départ, j’avais oublié d’emporter un casse-croûte pour la traversée et n’avais donc rien avalé depuis deux jours. De toute façon, les odeurs de gas-oil mélangées au roulis permanent du bateau m’avaient ôté tout appétit durant le voyage, mais à présent que j’étais arrivé à destination, mon estomac criait famine. Les contours d’une petite terrasse ressemblant à la devanture d’un restaurant se matérialisèrent progressivement devant mes yeux, tel un mirage en plein désert. Je m’installai sur une chaise pour être sûr que je ne rêvais pas et jetai mon sac sur le sol dans un même mouvement. Puis, rassuré, j’attendis un serveur pour prendre ma commande. Mais à Madagascar, et je commençais à peine à le concevoir, il fallait apprendre à cultiver la patience… Donc, une bonne demi-heure plus tard, une jeune fille légèrement vêtue me ramena un menu inscrit sur une feuille de papier A4 plastifiée. Tout était écrit en malgache, j’essayais alors de me renseigner sur les plats.
Elle me répondit dans un mauvais français et d’un ton sec.
Elle repartit comme elle était venue, en traînant la patte. Elle avait juste oublié de me demander si je voulais boire quelque chose en attendant le plat. Après une autre demi-heure de plus, mon palet commençait sérieusement à se dessécher, devenant aussi aride qu’un désert Arabe. Je me levai pour voir ce que devenait ma commande et découvris dans la salle du restaurant, la serveuse affalée sur une table à moitié endormie. Un peu gêné, je lui secouais l’épaule et lui mimais avec un mouvement explicite de mon pouce vers ma bouche que j’avais soif. Elle ouvrit un œil et la tête déformée, reposant dans la paume de sa main, me demanda avec un fort accent qui roulait les « r ».
Je voulais marquer le coup alors j’optai pour la bière, ma première dans la grande île, puis je retournai m’asseoir à ma place, pour ne pas laisser mon sac seul trop longtemps. Je ne possédais pas grand-chose mais suffisamment pour que mes quelques affaires me manquent si elles venaient à disparaître subitement. Au bout d’une nouvelle heure d’agonie, mon plat arriva enfin, accompagné d’une bouteille fraîche de soixante-cinq centilitres de mon breuvage préféré. Je remerciai gracieusement l’employée du restaurant, oubliant même de lui faire une remarque sur la longueur de l’attente. Je ne voulais pas gâcher la fête devant la vision féerique de ce steak juteux à souhait dont les odeurs indescriptibles m’enivraient les narines. Et les frites moelleuses et croustillantes qui l’accompagnaient dans l’assiette promettaient elles aussi une ivresse des sens qui me donnait presque le vertige. Je commençais pourtant par remplir mon verre et m’envoyais aussitôt une cascade de malt et de houblons liquide à travers le tunnel sec et étroit de mon gosier. Je ne pus m’empêcher de pousser un râle qui ressemblait plus à un orgasme qu’à un cri de contentement. Je ne connaissais pas de sensation plus appréciable sur Terre, de plus exquis, de plus intense que la première gorgée d’une bière bien fraîche après un long périple en mer. Et après avoir réhydraté avec bonheur les cellules de mon organisme momifié, je m’attelais à me remplir la panse. Je tranchais dans le filet, tendre comme du beurre, et enfournais un morceau cuit à point dans ma bouche salivante. Entre chaque bouchée, je piochais dans les frites chaudes et grasses, puis mastiquais doucement l’ensemble, arrachant les sucs de cette délicieuse viande rouge, que je devinais être une sorte de bœuf local, à travers l’âpreté terreuse des patates violacées. Le repas terminé et mon corps rassasié, je demandais l’addition à la serveuse qui par miracle circulait à ce moment-là à travers les tables avec sa nonchalance habituelle. Je prenais quand même tout mon temps pour finir ma bière qui commençait à perdre ses bulles et sa fraîcheur. Au moment où elle me ramena la note, je pris conscience que je n’avais pas encore converti mes euros en monnaie locale. Mon estomac avait réagi à un instinct reptilien et prit le contrôle de mon cerveau en m’intimant l’ordre d’aller boire et manger en priorité plutôt que passer à la banque faire le change. Par chance, elle accepta le billet de vingt euros que je lui proposais et qui devait largement dépasser la douloureuse mais je m’autorisais ce généreux pourboire en contre-partie de l’excellent repas dont je m’étais délecté. En jetant un œil distrait sur la facture, l’écriture maladroite et enfantine de la serveuse me sauta au visage. Elle avait inscrit sur le bout de papier en petites lettres disparates et en français : steak de tortue avec pommes frites. Horrifié, je l’interpellai aussitôt.
Elle n’attendit pas la fin de mon plaidoyer en faveur des reptiles marins et s’éclipsa dans la salle du restaurant pour finir sa sieste.
Je trouvais sans peine une chambre bon marché dans un hôtel du centre-ville qui possédait le confort minimum syndical : des draps propres, un ventilateur en état de marche et une douche individuelle. Les toilettes communes sur le palier ne me dérangeaient pas outre mesure, même si l’endroit n’était guère propice à la lecture d’un bon vieux magazine. Bref, j’inaugurais en premier lieu le trône, prenant soin de ne pas toucher l’abattant en pensant à la multitude de culs qui avaient déjà souillé sa faïence. Une fois mon affaire prestement terminée, je retournais dans ma piaule et prenais une longue douche d’eau froide. Puis une irrésistible envie de tester le matelas s’empara de ma volonté et je succombais sans lutter à cette soudaine tentation. Au réveil, j’étais un nouvel homme, prêt à conquérir le monde et ses sujets. Et pour m’aider dans cette tâche laborieuse, je ne lésinais pas sur les moyens. J’enfilai d’abord ma plus belle chemise, celle avec des fleurs d’hibiscus rouge sur fond blanc qui soulignait parfaitement la dualité entre la passion et la candeur. Et pour afficher une certaine décontraction, j’optais pour un jean délavé et usé au niveau des genoux, des baskets Adidas aux pieds et une paire de Rayban plaquant ma chevelure rebelle à la façon d’un serre-tête. Paré de la panoplie parfaite du mec cool, je quittais ma chambre et m’engageais à nouveau dans les rues désertes de Mahajanga.
Il faisait toujours une chaleur à crever et au bout de dix minutes de marche à peine, j’avais déjà taché les aisselles de ma chemisette et baignais littéralement dans un jus de pantalon moite et désagréable. Mes chaussures toutes neuves étaient devenues aussi poussiéreuses qu’un livre de Sartre tandis que de grosses gouttes de sueur perlaient à travers mes lunettes de soleil. J’essayais tout de même de garder une certaine prestance en poussant les portes de la banque. Personne ne faisait la queue, à croire que la ville entière était abandonnée. Je m’approchai sans attendre de la petite guérite réservée au change de devise et sortis de ma poche quelques billets de cinquante euros que le banquier m’échangea contre une épaisse liasse d’Ariarys1. J’étais impressionné par la quantité de papier qu’il me tendait et n’avais aucune idée d’où le cacher. Je n’eus pas d’autres choix que de rentrer à l’hôtel où j’en profitais pour reprendre une douche et me changer. Cette fois, je portais mes habits légers habituels, short, débardeur et claquettes, un pur bonheur… Mon expérience des tropiques m’avait appris une chose essentielle pour survivre dans ces contrées chaudes et lointaines, le meilleur endroit pour attendre la fin de la journée, à l’abri des morsures du soleil, était une terrasse de café. Je me mettais donc en quête de cet idéal et tombais en chemin sur un étrange et majestueux rond-point. Un baobab centenaire se dressait fièrement au carrefour et attirait quelques touristes intrigués par le diamètre impressionnant de son tronc. Certains se laissaient tenter par un cliché, gentiment proposé par les photographes professionnels qui hantaient les lieux, pour immortaliser leur passage sur terre, à la barbe du géant qui se foutait de tout ce cirque. Il avait déjà vécu plus de deux cents ans et ne comptait pas s’arrêter en si beau chemin. Je poursuivais ma balade en remontant le boulevard qui bordait la mer aussi tranquillement que le soleil commençait à décliner. Et plus il plongeait vers l’horizon, plus la ville se repeuplait. Avec l’allègement de la température, la bourgade côtière semblait reprendre vie. Des camionnettes garées le long du trottoir proposaient des glaces aux badauds, ravis de se promener en famille sur la longue digue de ciment. Plusieurs vendeurs de ballons arpentaient le bitume pour offrir du rêve aux yeux des enfants écarquillés. Je me joignis à la foule heureuse et grandissante, comblé par toute cette agitation et trouvais enfin ce que je cherchais. Une vingtaine de gargotes au moins s’alignait bout à bout pour former une unique et immense terrasse couverte d’où s’échappaient des rires et une musique différente à chaque enceinte. Les fumerolles des fatapera2 exhalaient des parfums de viandes et de poissons grillés entremêlés et la bière semblait couler à flots au vu des cadavres qui jonchaient le sol. Je m’assis sur un tabouret libre parmi la multitude et commandais pour commencer une bière fraîche comme la plupart des clients déjà présents. La vue sur le coucher de soleil écarlate était splendide, les brochettes exquises et la boisson enivrante. Je me prélassais quelques heures encore dans ce petit coin de paradis puis j’allais me coucher, éreinté de ma journée et de mon voyage en mer…
-2-Bienvenue à Antananarivo
J’avais quitté Mahajanga de bon matin et il fallut au taxi-brousse une bonne vingtaine d’heures pour franchir les 560 kilomètres qui le séparaient de la capitale malgache. Je ne m’éterniserais pas sur les détails du voyage et me contenterais de le résumer ainsi : Crevaisons et remplacements des plaquettes de frein à répétitions alternées, chaleur étouffante la journée et froid glacial la nuit, le tout enrobé d’une attente interminable. Je notais tout de même deux passages agréables, la traversée du pont de la rivière Betsiboka aux eaux rouges et furieuses et la montée sur les hauts plateaux sur une route escarpée magnifiquement accrochée à la falaise à la lueur du crépuscule. J’arrivai à la gare routière d’Ambodivona sur les coups de minuit et les autres passagers me conseillèrent tous vivement de prendre un taxi pour rejoindre mon hôtel. À les écouter, la marche à pied nocturne dans la capitale rimait plus avec folie suicidaire que ballade contemplative. Je suivais donc les prudentes recommandations des habitants avertis et demandai au taxi qui me harcelait depuis dix minutes déjà s’il connaissait un établissement bon marché acceptant de me recevoir à cette heure avancée de la nuit. Son tarif exorbitant équivalait quasiment à la somme du voyage depuis Mahajanga. On coupa donc la poire en deux et il me déposa au Lambert, dans le quartier touristique d’Ambodrona. Le prix abordable de cet établissement en plein cœur de la capitale s’expliquait par sa singulière situation géographique. En effet, la porte d’entrée se trouvait en plein milieu d’un grand escalier qui dégringolait vers l’avenue d’Analakely, l’artère principale de la ville. Le taxi me déposa en haut des marches et disparut dans la nuit sans perdre une minute, me laissant seul au monde dans ce lieu macabre, avec mon sac sur le dos. J’entrepris sans tarder la descente car les rues mal éclairées du quartier ne présageaient rien de bon à s’éterniser dans le coin. Je frappai sur la porte en métal qui résonna comme une cloche d’église. J’eus aussitôt la dérangeante impression qu’on m’observait et me retournais constamment pour sonder l’obscurité du silence, de peur d’avoir réveillé tous les malfrats de la ville. Les secondes s’égrainaient dans l’air moite sans que personne ne daigne m’ouvrir alors j’insistais lourdement, en proie à une panique grandissante, car plus je frappais, plus le bruit risquai de m’attirer des ennuis dans cet endroit propice aux embuscades. Enfin la porte s’ouvrit en grinçant sur ses gonds et un homme encapuchonné m’accueillit sur le seuil. Il ne dit rien et me laissa entrer. Ça devait être le gardien de nuit car son humeur maussade trahissait un réveil brutal et inhabituel. Un sourire timide aux lèvres, je m’approchai de l’accueil, espérant qu’une chambre soit disponible car je me voyais mal repartir à pied dans cet escalier lugubre. La providence semblait être de mon côté car le réceptionniste me tendit les clefs de ma chambre. Je le remerciai chaleureusement mais son visage resta impassible, n’affichant aucune joie comme si un masque rigide l’avait remplacé. Le taxi ne m’avait pas menti, cet établissement offrait des tarifs imbattables mais le service allait avec. À l’intérieur du petit hall d’entrée, je distinguais la présence d’une silhouette féminine assise sur une chaise en osier, faiblement éclairée par une veilleuse. Elle n’était pas bavarde non plus et je commençais à me demander si je n’avais interrompu leur petite sauterie et du coup plombé l’ambiance par mon intrusion tardive. De toute façon, je n’allais pas tarder à m’allonger sur le matelas que me réclamait mon dos depuis de longues heures et ils seraient bientôt libres de retourner à leurs bacchanales. Au moment où je m’engageais dans le couloir pour rejoindre ma chambre, le gardien me barra le chemin et sortit une arme de poing de derrière son dos pour me la poser brutalement sur le front. Je me tétanisais de stupéfaction, ne comprenant pas tout de suite ce qui se passait. Il hurlait en faisant tournoyer son revolver sous mon nez mais je ne comprenais absolument rien de ce qu’il disait. Quand il tira brutalement sur les bretelles de mon sac avec sa main encore libre, je compris alors ses intentions, il en avait après mes affaires. J’obtempérais sans discuter, de peur qu’une balle ne sorte malencontreusement du canon, et déversais le contenu de mon unique bagage sur le sol carrelé du hall d’entrée. Le réceptionniste ne bronchait pas et je comprenais maintenant pourquoi son accueil avait été si glacial. Le braqueur trouva rapidement la liasse de billets, mais se désintéressa de la carte bancaire et du passeport, qui pour ma part étaient les plus importants. Il me menaça une nouvelle fois avec son arme en m’obligeant à rejoindre le pauvre employé terrorisé de l’hôtel et la fille confortablement installée sur son siège, pour pouvoir me garder à l’œil moi aussi. Une fois encore j’obéissais, mais étrangement je n’avais pas peur. Je savais qu’en exécutant ses instructions à la lettre, avec douceur et prudence, je ne serais pas une menace pour lui et il me laisserait en vie. Derrière le petit bureau de la réception, une autre surprise m’attendait. Sous une grande couverture, trois autres clients étaient recroquevillés, attendant la fin du cauchemar. Un autre homme descendit alors de l’étage, les traits lui aussi dissimulés derrière une capuche et sembla signaler à son complice qu’il avait fini d’écluser les chambres. Ce dernier parla brièvement avec le réceptionniste avant de lui décocher gratuitement un coup de crosse dans le nez qui lui brisa net l’arête. Puis les deux malfaiteurs s’enfuirent en prenant bien soin de refermer la porte derrière eux. Un homme blanc et barbu sortit aussitôt de sous le tissu de laine, le visage rougi par l’étouffement. Il voulait ouvrir la porte pour respirer de l’air frais car il prétendait souffrir de claustrophobie mais l’hôtelier l’en empêcha. Tout en se recouvrant le visage d’une main afin d’empêcher le sang de couler, il expliqua que les voyous avaient piégé la porte avant de partir, en installant une grenade qui menaçait d’exploser si quelques inconscients avaient eu la mauvaise idée de les poursuivre. Je ne croyais pas trop à leur stratagème, mais de toute manière, personne ici présent n’avait envie de courir derrière des hommes armés et dangereux dans la nuit sombre. Tout le monde préférait rester à l’abri des murs en attendant que le jour se lève. Le gérant blessé reprenait doucement ses esprits, son écoulement nasal avait cessé et il brancha un téléphone fixe sur la prise conçue à cet effet, avant de composer le numéro du Commissariat du premier arrondissement. Personne ne se sentait d’aller s’isoler dans sa chambre, encore sous le choc de la récente attaque, alors on s’assit en cercle autour de la table en osier du hall d’entrée, notre hôte prépara du café pour tout le monde et on fit doucement connaissance en attendant l’arrivée de la Police.
Rivo remplissait nos tasses et réchauffait nos cœurs, de bonne corpulence et d’âge indéfini, cet homme transpirait la gentillesse et la compassion. Il était encore troublé par l’intrusion violente dans l’établissement dont il avait la garde et regrettait de s’être fait avoir si bêtement. En effet, les bandits s’étaient simplement fait passer pour des policiers effectuant un contrôle de routine. Il avait alors ouvert la porte sans se méfier, au beau milieu de la nuit et avait compris trop tard, l’odieuse tromperie se refermer sur lui.
Pierre, sexagénaire et ancien professeur à la retraite, venait tout comme moi pour la première fois à Madagascar. Veuf depuis plus d’un an, il était venu se changer les idées dans ce lointain pays qu’il rêvait de visiter depuis longtemps. Il avait emmené son fils dans son sillage, un jeune adulte d’une vingtaine d’années, timide et réservé. Antoine avait sombré dans une profonde dépression à la mort de sa mère et n’arrivait pas à remonter la pente. Enfant unique et tardif, choyé par une maman possessive dont la disparition soudaine avait créé un vide irremplaçable dans le cœur du jeune homme. Son papa avait donc pris la décision de partir en voyage pour leur ouvrir de nouvelles perspectives à tous les deux et tenter ainsi de combler le vide affectif qui les rongeait.
Vincent, lui, était un habitué des lieux, résident depuis plusieurs années sur la grande île, il était constamment à la recherche d’un emploi pour survivre. La quarantaine bien tassée, les valises qui lui gonflaient les paupières trahissaient une consommation excessive d’alcool. Malgré cela, c’était un compagnon drôle et attachant qui détendait l’atmosphère en asticotant sans cesse la jeune malgache. Il n’arrêtait pas de lui lancer des allusions explicites sur comment accélérer la lenteur du temps ou sur les différentes manières les plus efficaces pour se remonter le moral. Elle ne semblait pas être offusquée par ses grasses plaisanteries, bien au contraire. Elle s’appelait Miona, originaire de Diégo-Suarez dans le Nord du pays, elle était venue à la capitale comme beaucoup de filles de la côte chercher de l’argent facile et dans le meilleur des cas trouver un mari aimant et fortuné. Pour atteindre ses rêves, elle traînait de bars sordides en hôtels glauques, espérant un jour trouver l’âme sœur. Elle avait à peine vingt ans, un visage angélique et un corps parfait. J’avais remarqué qu’entre deux assauts de Vincent, elle se tournait souvent vers moi pour jauger ma réaction. Sa bouche formait alors un cul de poule et ses sourcils se levaient exagérément haut comme pour m’inviter à prendre sa défense. Mais j’étais bien trop occupé à rire des loufoqueries du comique de service pour l’aider à se sortir de ce flot d’humour mal placé. Le père et le fils, renfermés sur eux-mêmes depuis l’incident, commençaient à sortir de leurs coquilles en esquissant des sourires timides. Pierre alla même jusqu’à venir en aide à la pauvre victime en intervenant en sa faveur, simulant sa protection tel un Prince qui sauverait sa dulcinée. Bref, l’ambiance bonne enfant de la soirée nous permettait de nous détendre un peu et d’oublier ce qui nous avait réunis autour de cette table.
La police arriva vers trois heures du matin et pas au meilleur de sa forme. Deux agents avaient été envoyés sur l’affaire dont l’un paraissait encore ivre. Il parlait avec difficulté et son haleine fétide ne faisait aucun doute sur son état d’ébriété. Chacun notre tour, nous dûmes raconter ce qu’il s’était passé et aucun des deux ne prenait de note. Ils se contentaient d’écouter d’une oreille distraite, le regard ailleurs et vide. Je trouvais la situation grotesque et je ne comprenais pas l’utilité de cette déposition, qui de toute façon n’intéressait personne. Les deux commissaires en charge de l’enquête paraissaient avoir d’autres projets en tête que d’attraper les coupables, l’un avait envie de retrouver son lit et l’autre sa bouteille. Au bout d’une heure environ à tourner en rond avec leur interrogatoire absurde, ils prirent congé sans apporter ni réponse concrète ni solution tangible à notre problème commun. Nous avions été détroussés et menacés de mort avec une arme à feu et aucune poursuite n’était engagée, vu qu’aucune plainte n’était formellement déposée. Les coupables erraient toujours dans la nature et continueraient leurs larcins. L’affaire aurait dû s’arrêter là mais le destin en décida autrement.
Vincent m’avait invité à passer la soirée avec lui dans un de ses bouges préférés, comptant mettre à profit ce bénéfice de vie, cet instant terrestre si précieux qu’on pouvait nous retirer à tout moment, sans prévenir. La boîte de nuit était située dans le quartier de Tsaralanana, littéralement « Belle rue » en langue malgache, et je me demandais pourquoi les habitants l’avaient appelé ainsi vu l’état de délabrement de la route et la faune qui arpentait ses trottoirs. Mais peut-être qu’à l’époque de l’attribution de son nom, le quartier ressemblait à autre chose… Mon compagnon, habitué à ce genre d’endroit, salua le videur à l’entrée du portique qui lui rendit la pareille. Vincent semblait à l’aise dans cet univers décadent et avança dans le couloir sombre d’un pas sûr et averti. Pas trop rassuré, je le suivis à la trace dans le bruit et l’odeur de sueur qui emplissait l’atmosphère. En sortant du corridor, des chaînes pendaient du plafond comme des lianes métalliques, délimitant ainsi un passage jusqu’à la piste de danse. De part et d’autre du rideau d’acier se trémoussaient des ombres lascives, rendues difformes par le mouvement et l’obscurité. J’avançais dans cette jungle humaine, assourdissante et mystérieuse quand une main, jaillie de nulle part, me saisit par l’entrejambe. Sans avoir le temps de réagir et cherchant désespérément mon compagnon du regard, la fille m’amena, toujours en me tirant par les bijoux de famille jusqu’au bout de la salle. Elle ne les lâcha qu’une fois arrivée au comptoir et après s’être assuré que je lui payerais une bière. Vincent vint alors à ma rescousse, il envoya balader la fille d’un coup d’épaule et me montra du doigt la jeune Miona qui dansait comme une déesse au milieu de la piste. C’était de loin, la plus jolie fille de la boîte, les autres à côté n’étaient qu’un ramassis de vieilles putes desséchées par l’alcool et la haine. Elle était la jeune fronde d’une fougère naissante au milieu d’arbres centenaires écorchés par les années et les tempêtes, la fraîcheur d’une brise marine balayant de son souffle, la chaleur humide d’une nuit d’été caniculaire. Vincent aussi ne la lâchait pas des yeux, il la dévorait tout en buvant avec avidité son verre de rhum. Et après trois verres cul sec, ragaillardi par l’alcool, il alla se dandiner derrière elle en la tenant par les hanches. Comme à son habitude, elle ne s’offusqua pas de l’accostage grossier du chalutier, et intensifia même les ondulations de son ventre qui plongea son partenaire dans une béatitude niaise. J’observais la scène, plus excité que jaloux devant le spectacle de leur débauche, mais rassuré par les regards malicieux que me jetait de temps à autre la belle danseuse. Le comportement désinvolte et jovial de mon camarade de soirée changea subitement après une conversation enflammée entre les deux interlocuteurs. Je pensais que mon nouvel ami avait lancé la phrase de trop, celle qui blesse, trop imprégnée par l’alcool et qu’on regrette aussitôt après l’avoir dite. Mais leur sujet de désaccord était d’une tout autre nature et je n’allais pas tarder à être de la partie. Vincent était revenu au comptoir, l’air grave et songeur. Il commanda une bière pour se remettre de sa danse et de ses contrariétés et m’expliqua enfin ce qu’il se passait. Miona avait reconnu les deux malfaiteurs de la veille qui se vantaient d’avoir commis un larcin et d’avoir les poches pleines d’argent. Ils se comportaient comme de vrais nababs, payant des tournées à toutes les filles invitées à leur table, et avec notre argent bien entendu. Je fus choqué à mon tour par ses révélations inattendues et inquiet de la suite des événements, mais la courageuse Malgache avait déjà pris les devants et alerté la Police qui devait intervenir d’un instant à l’autre. Vincent n’était pas d’accord, le mal était fait et tout le monde s’en était tiré à bon compte et remuer la merde, selon lui ne servait à rien d’autre que de faire remonter de mauvaises odeurs. Personnellement, j’étais plutôt du côté de Miona, un des braqueurs avait quand même pointé son arme chargée contre mon front et avait failli m’ôter la vie pour quelques misérables Euros. Je ne l’avais pas encore digéré et une partie de mon for intérieur réclamait vengeance. Savoir que des individus pareils, dangereux et cupides, circulaient encore librement dans la ville me remplissait d’effroi et je voulais que justice soit faite. Mes vœux ne tardèrent pas à être exaucés et se matérialisèrent en un pugilat terrible qui transforma en un éclair l’ambiance lascive de la boîte en démonstration de force vindicative. Les chaises volaient dans tous les sens, les gens se marchaient les uns sur les autres pour fuir l’interpellation musclée des forces de l’ordre. Ce coup-ci, la Police du quartier faisait preuve d’une efficacité brutale, en envoyant de vrais hommes d’action entraînés et prompts au combat en totale opposition avec les deux agents détachés de la nuit dernière. L’intervention dura quelques minutes et se conclut par le menottage des deux suspects, envoyés directement en cellule afin de répondre de leurs actes. La soirée était loin d’être finie pour les nantis violemment déchus de leur piédestal.
Après l’épisode d’agitation qui avait secoué temporairement le dancing, la langueur festive reprit doucement ses aises, distillant à nouveau les plaisirs interdits que les ombres alcooliques étaient venues chercher au cœur de la nuit. Ma propre âme rescapée se sentit étrangement soulagée et réclama à son tour son lot de ribauderie. Assisté de mon compagnon d’infortune, l’alcool se mit à couler sans retenue, alternant verres de rhum, bières et danses collées serrées avec de multiples partenaires aux genres confondus. À ce régime-là, je ne tardais pas à voir trouble, avec une sacrée envie de vomir collée aux tripes. Il était l’heure d’aller se coucher et Vincent, en bon chaperon, appela un taxi pour rentrer à l’hôtel. Il m’aida à grimper les escaliers de l’hôtel, puis me coucha dans mon lit. Dehors l’aube se levait doucement, les oiseaux citadins gazouillaient, ma tête tournait comme un manège et je finis par sombrer.
Je descendis dans le hall en milieu de matinée, surpris de voir que tous les locataires de l’hôtel étaient déjà sur le pied de guerre, tasses de café fumantes à la main. Je n’apercevais pas Rivo et m’inquiétais de son absence à l’assemblée du petit déjeuner. Pierre m’expliqua que le traumatisme lié à son agression l’avait forcé à se mettre en arrêt maladie, le temps de récupérer. Et contre toute attente, c’est Vincent qui allait s’occuper du Lambert, avec l’autorisation directe du propriétaire des lieux. Il habitait dans la chambre du rez-de-chaussée depuis plus de six mois et il connaissait parfaitement les rouages de l’établissement. Le départ précipité de Rivo n’avait pas donné beaucoup d’alternatives au Patron qui avait trouvé dans cette solution inespérée, le seul homme de confiance à portée de main pouvant continuer à faire tourner son affaire, le temps pour la direction de se retourner. Miona n’était pas là non plus, pourtant, elle résidait à l’hôtel, dans une des chambres du bas, bon marché et réservée aux papillons de nuit… Mais je ne m’inquiétais pas de son absence, elle avait dû trouver un client pour satisfaire ses besoins financiers et avait sûrement passé la nuit dans un endroit plus luxueux. Pierre qui avait préféré rester tranquille dans sa chambre avec son fils me demanda comment s’était passée ma soirée.
Et jetant un œil complice à mon compagnon de virée, je rajoutais :
Le vieil homme ne semblait pas être au courant de nos péripéties de la veille comme sa moue dubitative nous l’indiquait.
Vincent ne put s’empêcher d’intervenir en faisant le clown comme à son habitude.
Pierre ne semblait pas rassuré par nos anecdotes et l’homme sage qui sommeillait en lui devina d’instinct que les ennuis n’étaient pas terminés. Il se renfrogna dans sa chaise et continua de boire son café pour oublier toute cette histoire. Vincent, sentant que sa remarque pertinente avait rendu songeur le sexagénaire, tenta de détendre l’atmosphère en énumérant les nouvelles dispositions qu’il comptait bien instaurer sous son règne hôtelier.
Deuxièmement, je vais baisser le prix des chambres du sous-sol pour attirer une clientèle plus festive et redonner un peu de folie à cet hôtel moribond !
Vous en pensez quoi ?
On le regardait les yeux grands ouverts mais le pire c’est qu’il était sérieux. Et à ma grande surprise, Antoine, le fils de Pierre prit la parole en public pour la première fois.
En entendant ces mots, Vincent rayonna de bonheur, la nouvelle gérance semblait avoir convaincu un premier client. Notre petit conciliabule sur la façon de gérer au mieux « le Lambert » fut interrompu par l’arrivée surprise de trois policiers. Ils cherchaient les témoins du braquage de l’autre soir mais ces derniers n’étaient pas compliqués à trouver, vu qu’on était tous réunis autour de la même table, à part Miona, disparue depuis hier soir et Rivo, en congé longue durée. Les inspecteurs requéraient notre présence au Commissariat afin de déposer une plainte en nous expliquant ce que nous savions tous déjà, les braqueurs étaient enfermés dans leur geôle, en instance de comparaître devant un juge. Pierre et son fils refusèrent de témoigner, prétextant qu’ils n’avaient pas vu les visages des agresseurs, cachés de force sous la couverture dès le début de l’incident. Mais en bon père protecteur, je me doutais bien qu’il ne voulait pas exposer son rejeton à une nouvelle épreuve, qui de toute évidence n’aboutirait à rien de positif. Sur le coup, je n’avais pas été d’accord avec sa position, mais la suite des événements me fit amèrement regretter mon choix. Le voyage s’avérait parfois être long entre la bouche du sage et l’oreille de l’incrédule.
Dans le poste de Police, l’ambiance était morose. Je dus raconter encore une fois la scène en détail afin que les enquêteurs corroborent mon histoire avec celle des autres témoins. Vincent raconta la même version des faits et nous signâmes tous les deux en bas de la feuille du dépôt de plainte. Miona fit alors son apparition, en sortant du bureau du commissaire en chef, elle était radieuse comme d’habitude malgré des paupières lourdes de fatigue qui trahissaient la longue nuit passée au Commissariat. Au début, soupçonnée de complicité, les policiers l’avaient interrogé sans relâche, puis finalement, aux vues de ses déclarations concordantes, elle était devenue témoin principale de l’affaire. C’était la seule qui avait reconnu les visages des agresseurs et son témoignage était vital pour accuser les coupables. Une fois la paperasse administrative remplie, nous nous dirigeâmes de chœur en marchant vers le tribunal de la cour d’assises où nous attendaient déjà le juge et les inculpés. Cette confrontation ne nous faisait pas plaisir mais nous n’avions pas vraiment le choix, maintenant que la Police avait fait son boulot, on ne pouvait plus faire marche arrière. Donc, clopin-clopant, le commissaire en chef en tête de cortège, nous traversâmes la capitale en remontant l’avenue de l’Indépendance, où les pavillons du marché couvert d’Analakely offraient de nombreux achalandages de produits frais venus de toutes les régions de Madagascar. Ainsi les mangues de Diégo-Suarez se mélangeaient avec les litchis de Manakara et les crabes de Mangrove de Morondava côtoyaient la viande de zébu de Tuléar. Plus loin et moins exotiques, des stands de vêtements et de babioles chinoises s’entassaient devant un nombre impressionnant de badauds attirés par les voix criardes des mégaphones des vendeurs. Mais tout autour de cette abondance, des centaines d’habitations faites de cartons et de sachets plastiques s’agglutinaient les unes aux autres dans une insondable pauvreté où leurs tristes locataires survivaient en fouillant les bennes d’ordures alentour. Les plus chanceux d’entre eux trouvaient quelques bouteilles ou des boîtes de conserve usagées à revendre au marché de l’Alomby, une brocante de la misère où s’étalaient sur plus d’un kilomètre, coincé entre deux caniveaux putrides, toute une humanité sans avenir.
Au bout de l’avenue, en tournant sur la droite, on s’engouffra dans le tunnel Garbit où des enfants vautrés sur le bitume, à moitié-mort asphyxiés par la fumée et le bruit des voitures, mendiaient quelques pièces aux passants pressés de sortir de cet enfer. Je zigzaguais entre les gouttes d’eau sales qui dégoulinaient de la voûte, et les crottes humaines sur le sol. Je rampais dans le cul du diable. Soudain une vieille femme me barra le chemin et m’agrippa le bras. Ses loques usées et déchirées par endroit avaient pris les couleurs de la rue gris et ocre. Elle me demanda de l’argent tout en ouvrant son corset pour me dévoiler l’horreur de sa condition. Ses seins flaques pendaient lamentablement et n’offraient déjà pas une vision très reluisante, mais les bubons qui lui parsemaient les flancs dépassaient le soutenable. J’essayais de me dégager de sa poigne de fer mais elle ne me lâchait pas. Elle continuait à vociférer des mots inaudibles tout en étalant au grand jour les ravages de la Peste sur son corps vieillissant. Pour m’en défaire, je fouillai dans mes poches et par chance, trouvai un billet tout fripé que je tendis à la femme. Elle lâcha enfin son étreinte et je sortis au pas cadencé de ce gouffre maudit. Dehors, un paysage plus ensoleillé me fit plisser les yeux, encore habitués à l’obscurité du tunnel. Des Jacarandas en fleur bordaient un lac majestueux et repeignaient en violet une partie du ciel. Ce tableau digne des impressionnistes du 19e siècle nous remit du baume au cœur et nous regonfla le moral, nonobstant les immondices diverses qui jonchaient les berges inondées. Au milieu du grand plan d’eau se dressait fièrement le monument dédié aux morts franco-malgaches de la Première Guerre mondiale. L’imposante statue qui officiellement avait eu pour objectif de rassembler les deux peuples, avait surtout servi de prétexte pour asseoir l’hégémonie de l’empire colonial français en effaçant les traces de l’ancienne royauté Imerina, les premiers et légitimes dirigeants de Madagascar.
En continuant à longer le lac, nous arrivâmes enfin dans le quartier d’Ampefiloha où se trouvait le palais de justice d’Antananarivo. À l’intérieur, c’était la cohue, pire que dans la rue et il fallait jouer des coudes pour avancer sans se perdre de vue dans ce dédale d’escaliers interminables et de coursives exiguës. Mais le policier averti qui connaissait l’endroit comme sa poche, trouva la porte du juge sans perdre une de ses ouailles en chemin et nous fit entrer tous les trois dans la petite pièce mal aérée. Ça sentait le moisi et la poussière, odeurs émanant sûrement des piles de dossiers entassées en désordre sur le bureau et qui devaient traîner là depuis une éternité. Derrière l’impressionnant monticule de papier, une tête fluette de femme semblait chercher un chemin jusqu’à nous. Une paire de lunettes lui surplombait le nez et de longs cheveux noirs, tressés à la manière des habitantes de la capitale, lui donnaient une fière allure tout en imposant son statut. Elle nous fit poliment asseoir sur trois chaises à notre disposition. J’étais installé à l’extrémité gauche, à côté Vincent se rongeait les ongles d’impatience et Miona à l’opposé me lançait des sourires timides et fatigués. Quand la porte s’ouvrit à nouveau, ce fut le choc. Deux lascars menottés avançaient vers nous, accompagnés par le policier. Je remarquais immédiatement leurs démarches chancelantes et leurs visages constellés d’hématomes. Le plus petit, que je soupçonnais d’être mon agresseur, me dardait méchamment du regard. Si ses yeux rouges de haine avaient pu m’assassiner sur le champ, ils l’auraient fait sans hésiter une seconde. Heureusement que le Commissaire l’avait attaché car il vint se poster debout juste à côté de moi, sa main frôlant presque mon visage. Je n’étais pas du tout rassuré car à tout moment, il pouvait péter un plomb et se ruer sur moi comme une bête sauvage. S’il avait réussi à dissimuler une lame sur lui, il m’aurait déjà égorgé sur place, j’en étais persuadé. La juge parlait en malgache quand elle s’adressait aux accusés et en Français lorsque c’était le tour des victimes de s’exprimer. Mais au moment où elle nous demanda chacun notre tour de reconnaître les individus inculpés de tentative de meurtre, j’hésitais… Je n’étais pas sûr à cent pour cent, je n’avais pas vraiment vu leurs visages lors du braquage car ils avaient pris soin de les dissimuler derrière leurs capuches. Le seul indice réel que j’avais à ma disposition était leur corpulence physique. Je me rappelais avec certitude de la disparité de leur taille, le premier étant petit et maigre et l’autre grand et costaud, et effectivement les deux personnes enchaînées devant moi correspondaient parfaitement à ses critères particuliers. De plus, Miona, la seule à visage découvert lors du fameux soir de l’attaque, m’avait certifié les avoir reconnus, sans parler du fait qu’ils s’étaient largement vanté envers les filles de la boîte de leurs larcins crapuleux. Le doute ne pouvait pas s’immiscer dans cette bataille judiciaire et morale, j’avais quand même été menacé de mort, merde ! Je décidais alors de suivre le même élan que mes camarades et reconnus physiquement les coupables devant la juge. Le grand ne broncha pas, son visage tuméfié ne manifestait aucune rancune et semblait accepter son sort. Mais, l’autre énergumène, voyant que j’avais hésité, ne l’entendait pas ainsi. Il déblatérait ce que j’imaginais être un flot d’insultes à mon encontre avec la rage du désespoir. Mais je n’entrais pas dans son jeu, je le laissais exhorter sa haine et sa violence sans dire un mot, pressé que tout cela se termine avant qu’il ne m’étrangle pour de bon. La colère de l’un passée et la résignation de l’autre consumée, ils disparurent derrière le cadre de la porte avec leur chien de garde qui ne les lâchait pas d’une semelle. J’avais cru comprendre qu’ils venaient de Tamatave, la grande ville portuaire de l’Est mais ils n’étaient pas près d’y retourner avant longtemps. Car là où ils allaient, personne n’en revenait jamais vraiment indemne. En effet, la prison centrale d’Antanimora, surpeuplée et insalubre, souffrait d’une triste réputation où seule la corruption généralisée permettait aux prisonniers les plus aisés de survivre décemment durant leurs séjours derrière les barreaux. Si nos deux apprentis braqueurs ne voulaient pas se retrouver à dormir les uns sur les autres, entassés et suffocants dans une pièce sans fenêtre et manger tous les jours la même bouillie infâme de manioc fermenté, il valait mieux pour leurs matricules qu’ils aient gardé une part de leur magot pour soudoyer les gardiens. Mais ce n’était plus mon problème à présent, l’incarcération faisait partie du jeu et ils auraient dû y réfléchir avant de pointer une arme chargée sur mon front. D’ailleurs, si je ne voulais pas constamment raser les murs pour éviter de les rencontrer par une nuit aveugle et silencieuse, il était préférable pour ma propre sécurité qu’ils restent enfermés dans ce cloaque immonde le plus longtemps possible, comme l’avait si joliment souligné le Commissaire. Et pour continuer à me rassurer, il m’avait également conseillé d’aller me mettre au vert à la campagne pour quelques jours le temps que l’affaire se tasse, car il s’inquiétait d’éventuelles représailles de la part de complices, toujours en activités dans la ville.
À peine étions-nous sortis du bâtiment juridique, qu’un petit rassemblement de personnes s’approcha de moi. La plus âgée des femmes pleurait et me suppliait de faire relâcher son fils, accusé à tort selon elle des faits qui lui étaient injustement reprochés. Comment savait-elle qui j’étais ? Et pourquoi m’interpeller dans la rue alors que toutes les preuves accablaient les coupables ? J’étais mal à l’aise, pris en tenaille par la famille des accusés et personne pour venir à ma rescousse. Enfin, le commissaire arriva et dispersa les perturbateurs en m’emmenant à l’écart. Il y avait un problème, la fourgonnette du pénitencier n’était pas disponible et il avait besoin d’argent pour emmener ses prisonniers en taxi à la maison d’arrêt, située à l’extrémité nord de la capitale. Malheureusement pour lui, ni moi ni mes compagnons n’avions emporté la moindre liquidité, et de toute manière ce n’était pas à nous de payer. Les voleurs nous avaient déjà dévalisés, et il fallait en plus leur payer un taxi maintenant, c’était hors de question. Le commissaire n’eut pas d’autre choix que d’escorter ses deux prisonniers à pied, espérant qu’ils arriveraient à bon port, sans rencontrer de problèmes en chemin…
Après la matinée éprouvante que j’avais passé au tribunal à me confronter à mes agresseurs et à leurs familles implorantes, je n’aspirais qu’à me vider le cerveau de toutes ses préoccupations. Vincent ressentait le même malaise que moi alors, bravant la fatigue, il décida de mettre en place le jour même les améliorations novatrices de l’hôtel. Pendant que Pierre et sa progéniture s’occupaient d’acheter diverses bouteilles d’alcools, Vincent et moi commencions à nettoyer la grande terrasse qui surplombait le bâtiment. De là-haut, on apercevait toute la ville et ses mille collines. Sur une des plus élevées, le Rova, l’ancien palais de la reine, dominait toujours l’étendue à ses pieds malgré le récent incendie protestataire qui avait ravagé ses murs. L’inégalité croissante entre les habitants des côtes et ceux de la capitale avait poussé les plus défavorisés à la révolte et comme souvent, la haine et l’injustice latente s’étaient matérialisées brutalement en détruisant une représentation symbolique de la caste dominante. Plus bas, l’avenue de l’Indépendance dessinait une large ligne où trônaient d’autres vestiges d’un passé plus récent. La gare ferroviaire coloniale et sa ligne de chemin de fer, malheureusement inutilisée faute d’argent et d’entretien. Le vieux bâtiment joliment restauré servait aujourd’hui de restaurant luxueux et de galerie marchande de grandes enseignes. Le soleil était haut dans le ciel et il faisait chaud malgré l’altitude de la Capitale qui culminait à plus de mille mètres. L’étage supérieur de l’hôtel n’avait pas été visité depuis longtemps et était devenu un débarras au fil des années. On commença par entasser dans un coin toutes les affaires inutiles qui mourraient doucement sous la rouille et la poussière, sans rentrer dans les détails car faire une liste exhaustive des objets qui traînaient à ciel ouvert depuis une éternité s’avérait être une tâche impossible. Imaginez simplement le grenier mal rangé d’une maison familiale où plusieurs générations atteintes du syndrome de Diogène auraient ajouté leur pierre à l’édifice. Bref, en fin d’après-midi, tout était prêt pour accueillir d’éventuels visiteurs. On avait réussi à bricoler plusieurs tables avec d’énormes rouleaux en bois de câble électrique chinés dans l’