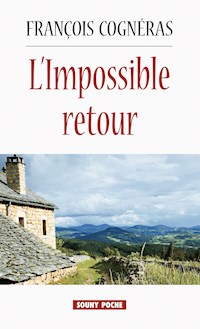
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'histoire d'amour improbable entre une patronne d'exploitation et un prisonnier en Allemagne, réunis par la guerre.
Ils n’auraient jamais dû se rencontrer. La guerre les a réunis. Charles, prisonnier en Allemagne, accepte de travailler dans une ferme plutôt que de végéter dans son camp. L’exploitation est tenue à bout de bras par Kirsten et son fils. Très vite, entre la jeune patronne et son ouvrier, la compréhension fait place à l’estime, la sympathie à l’amour. Derrière les rideaux et les volets clos naît alors une grande passion, bien plus forte que tous les interdits et toutes les lois du Reich. Cette liaison vécue à la fois dans l’espérance et la crainte des lendemains ne peut pas s’éteindre. Mais, la Libération venue, Charles n’osera pas rentrer en France avec sa belle Saxonne et un enfant de l’ennemi. Devront-ils attendre, aussi longtemps qu’il le faudra, l’impossible retour ?
Laissez-vous emporter par le récit d'une passion interdite et dévorante, inspiré par une histoire vraie ! Après la Libération, Charles et Kirsten devront attendre indéfiniment un impossible retour ?
EXTRAIT
Vers Noël, la presse du Reich crut pouvoir claironner une grande nouvelle : les forces allemandes, en Belgique, dans les Ardennes, par une offensive foudroyante, avaient percé le front américain et poursuivaient leur avance vers le sud, bousculant l’ennemi déconcerté et impuissant à réagir. C’était assurément le début d’un retournement de la guerre. À l’ennemi, sur ce front de l’Ouest, d’entendre raison si toutefois il en était capable ! À l’annonce de cette « bonne » nouvelle, la plupart des Allemands restèrent circonspects, avec raison. Les Américains reculèrent en effet pendant quelques jours, perdirent quelques villes, puis reprirent l’offensive et leur progression. Le 2 janvier, il ne restait plus trace de l’offensive foudroyante ! Au contraire, les Alliés et même les Français, depuis la mer du Nord jusqu’à la Suisse, pénétraient en Allemagne.
Car les nouvelles arrivant toujours tant bien que mal, les prisonniers avaient maintenant la confirmation que des troupes de la France libre ralliée au général de Gaulle étaient présentes aux côtés des Anglo-Américains. On s’interrogeait encore sur ce qu’était cette Résistance et ces FFI dont il était question sur Radio-Londres que des malins parvenaient à capter. Les prétendus terroristes dénoncés par les journaux de Vichy, en réalité ces hommes réfugiés dans les bois qui s’organisaient comme ils pouvaient en petites unités clandestines de combattants, c’étaient donc eux ? Il se confirmait aussi que la collaboration de la France de Vichy avec l’Allemagne ne s’était pas contentée de rester administrative. La triste Milice qui avait combattu les Résistants, livré des hommes à la Gestapo, les collaborateurs de tout poil, disait Radio-Londres, rendaient maintenant des comptes à la justice. Décidément, pensaient les prisonniers, ça n’allait pas trop bien dans leur pauvre pays. On n’en aurait pas fini du jour au lendemain avec les malheurs de la guerre. Et ils se sentaient un peu plus impatients de se retrouver chez eux.
A PROPOS DE L'AUTEUR
François Cognéras signe ici un roman poignant, inspiré d’une histoire vraie, terriblement humain, une émouvante aventure psychologique. Et Kirsten et Charles ne quittent plus le lecteur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Michèle et Jean Rougier et à leur fille Evelyne
I
Charles est assis devant sa petite table de travail sur laquelle aucun objet ne révèle une occupation. Il n’écrit pas : cela ne lui arrive que de temps en temps, lorsqu’il a une petite lettre à envoyer ou quelque papier à remplir. Il ne lit pas non plus : c’est le soir seulement qu’il se résout quelquefois à ouvrir un livre apporté par Michèle et, selon l’intérêt qu’il y trouve, y reste plongé, les lunettes sur le nez, rarement plus d’une heure, car ses yeux se fatiguent et le sommeil le prend. Il n’a même pas les mains occupées avec une clé et un tournevis à quelque bricolage, son passe-temps préféré. Il a les jambes croisées l’une sur l’autre et les mains croisées posées sur une cuisse. Il ne fait rien, il a l’air d’attendre, assez bêtement.
Depuis un moment, il pensait et il pensait plus précisément qu’il arrivait à la fin de sa vie. Non sans une bonne raison : cette alerte, il y a tout juste un mois, cette attaque cérébrale. Dont il s’est presque remis pourtant, mais qui reviendra sans doute. Dont il sent les séquelles dans son corps : cette raideur pataude quand il marche, ce bras gauche qui se fait prier pour obéir, ce côté du visage qui est comme gelé quand il se regarde dans la glace pour se raser. Heureusement, on n’est plus au temps des sabres et c’est un rasoir électrique qu’il promène sans trop de difficulté sur sa peau… Bien sûr, Michèle, sa nièce, qui est passée le voir avant-hier encore, lui a cité l’exemple de cette vieille femme bien connue d’eux qui s’est rétablie d’une telle attaque pour vivre treize années encore, sans infirmité sérieuse.
Est-ce qu’on peut réellement savoir qu’on arrive à la fin de sa vie, à moins de faire partie de ceux qui, conscients d’être gravement malades, sentent leurs forces décliner ? Et ceux-là mêmes, peuvent-ils reconnaître qu’ils usent leurs toutes dernières forces, qu’ils sont à leur dernière extrémité ? Comment le devineraient-ils ?
On ne peut pas être complètement sûr que sa vie touche à son terme, soit. Mais lui n’en serait pas surpris. Il plaisante avec lui-même : de l’autre côté, on ne ressent plus de surprise… De l’autre côté ! Il se comprend : de l’autre côté, c’est le néant, c’est le plus vraisemblable. Encore que, au fond, il n’en sache rien. Il ne s’est jamais beaucoup soucié de ce que racontait la religion de son enfance, même en 40 quand il fuyait sous les bombes et les mitraillages des Allemands. Maintenant, il en serait davantage préoccupé. Mais qui pourrait le renseigner ? À qui oserait-il s’adresser ? Ses copains, ses pareils ? Les pauvres ! Il les a entendus affirmer quelquefois avec assurance ou plutôt nier, nier tout au-delà bravement, jouant les esprits forts : « Quand tu es mort, y a plus rien, qu’est-ce que tu veux qu’il y ait ? » Mais ils sont comme lui, ils n’en savent rien, ils n’y connaissent rien.
Soit. Mais à supposer qu’il y ait une deuxième vie et un jugement, son sort ne devrait pas être trop rigoureux. Il s’est efforcé de vivre en homme honnête, serviable, indulgent avec son entourage ; il a évité de faire du tort à autrui et si, comme il est probable, il n’y est pas toujours parvenu parce que c’est le sort commun, cela a dû être, sans qu’il s’en rende compte. Personne n’est irréprochable, mais il veut croire que, vraiment, il ne mérite pas trop de blâmes pour sa conduite… sa conduite, même là-bas ? Il ne sait qu’en penser. Il n’avait pas le sentiment d’agir mal, au contraire, lui qu’on privait depuis tant de mois de liberté, qui avait subi les mauvais traitements, les humiliations des prisonniers. Là-bas, il fallait survivre, se débrouiller, saisir toute occasion d’atténuer son sort, endurer, tenir. On ne savait pas pour combien de temps on était là, dans cette servitude, cette condition de captif. Mais encore, sa conduite, lorsque libre et en réalité, maître de son destin, il pouvait, s’il avait agi avec fermeté, rapidité, lucidité, tenir un engagement important entre tous ? Il ne sait qu’en penser.
Le voilà bien parti à se raconter son histoire ancienne, ses rêves… Mais n’a-t-il pas rêvé une grande partie de sa vie ? Qu’est-ce qui a été solide, réel, dans son existence ? Peut-être sa vie là-bas. Cette aventure inattendue. Mais elle est loin ? Oui, mais il y a repensé si souvent. Il a rêvé si souvent qu’il y était encore, là-bas.
Il n’empêche, les années ont passé. Il est vieux. Et pour la vie qu’il mène, ici, dans cette maison de retraite… L’asile de vieillards, disait-il autrefois, avec presque autant de dédain que de compassion. Eh bien, son tour est venu. Cette condition de pensionnaire, ces vieux qu’on voit toute la journée. Dont il fait partie ! Et ces assistantes, ces infirmières… Eh bien, quoi ! des femmes, et même, pour beaucoup, des femmes encore jeunes ! Il ne s’est jamais caché d’aimer la société féminine, il la trouve agréable. Mais ici, ce sont des femmes en blouse blanche, anonymes, qui font leur travail, c’est tout. Et leur gentillesse, une gentillesse de commande ! Ce ton emprunté, impersonnel…
Quant à ses semblables… Il y a bien ceux qui veulent tenir le coup, prendre la vie comme elle vient, qui blaguent, qui savent s’amuser, qui viennent le chercher, presque trop souvent, pour une belote. « Allons, dis pas que t’as pas le temps. On n’a pas d’autre quatrième. Allez, on t’attend… » Ceux-là, les forts, les sages, assurent ou avouent qu’ils ne sont pas plus mal ici que chez eux. Et il y a tous les autres. Ces pauvres vieilles femmes, avec leur pauvre sourire ; celles qui veulent garder l’apparence, rester des dames, toujours bien mises et bien coiffées. Et les chagrines, à peu près toujours moroses, de mauvaise humeur. Celles et ceux qui souffrent pour de vrai et beaucoup, que la maladie ravage et qu’on voit partir parfois, discrètement, au CHU d’où ils ne reviendront peut-être pas. Celles et ceux qui ne marchent qu’en chancelant, qu’on a envie de soutenir, bien que ce soit inutile. Celles et ceux, complètement gagas, auxquels il ne faut même pas faire attention, pitoyables et bien à plaindre.
Et cette atmosphère trop tranquille, cet aspect, autour de soi, des choses qui vous gardent un air correct mais étranger, cette odeur de cuisine de collectivité, pas toujours si appétissante que ça, qui flotte dès onze heures du matin et cinq heures du soir, autour des bâtiments et dans les allées.
Ces petits soins dont il n’a que faire, ces voix douces, cette amabilité dont il se passerait. « Allez, Papy, dépêchez-vous un peu. Il vous manque quelque chose ? » Mais non, il ne lui manque rien, mais il voudrait prendre son temps, prendre le temps, comme lorsqu’il était chez lui, de rabattre posément du même geste immémorial, avant de se lever de table, la lame de son couteau, ce couteau dont il ne se sépare jamais depuis des décennies. Mais oui, il va débarrasser le plancher, c’est cela qu’on attend de lui, quoiqu’on n’ose pas l’exprimer en ces termes et qu’on affecte la patience. Et puis « Papy » ! Eh bien, il n’est le papy de personne ici et, au fond, ça ne lui plaît pas d’être appelé ainsi. Mais à quoi bon le dire ? Il faut être patient, on l’est bien avec lui. C’est ce que pensent, ici, tous ceux qui sont raisonnables. Et il doit être juste, lui qu’irritent les gens à mauvais caractère, les éternels bougons : le personnel montre tout de même beaucoup de bonne volonté et, empruntées ou pas, la douceur et la patience ne sont-elles pas des vertus ?
Ses vrais petits trésors, ils sont restés chez lui, rangés, pas même cachés ou planqués : des lettres, la photo, quelques photos. Ils n’intéresseraient pas les voleurs et il a craint qu’ici, on aille fouiller dans ses affaires. Mais quand il mourra, ces reliques tomberont entre les mains d’autrui, car enfin, on videra la maison un jour, on déménagera tout. Oui, mais ce sera entre les mains de Jean-Paul et Michèle, ses neveux. Qui se poseront certainement des questions et, peut-être, découvriront-ils une partie de sa vie. Ce ne sera pas trop grave. Ils doivent être capables de comprendre. Brûler ces souvenirs, le jour où il est parti, il n’y a pas songé. Autant se brûler la cervelle, autant en finir sur-le-champ.
Ils comprendront. Jean-Paul est le meilleur des garçons, Michèle, une fille intelligente et bonne, trouvée par son neveu dans une famille ouvrière pauvre, ce que, certes, il n’a pas eu à regretter. Sur cette époque lointaine, les années passant, les idées ont changé : beaucoup ont oublié ; beaucoup, parmi les plus jeunes, ignorent à peu près tout et ne désirent pas savoir ; les autres, du moins, se sont mis à y voir un peu plus clair. La guerre n’apporte pas la vérité aux humains : pour bien combattre, il faut haïr en bloc, sans tenter d’expliquer. Mais lui, depuis un demi-siècle en fait, a découvert une vérité plus sûre : qu’avant tout jugement, il faut savoir distinguer et qu’une nation, voire la majorité de ses membres, n’explique pas chaque habitant de cette nation et qu’il est absurde de dire : un Boche, un Welche… Et qu’un homme libre et lucide se fout des étiquettes qu’on place sur les pays, les peuples ou les races, et tous les groupes qui ne prétendent à rien d’autre qu’au droit légitime d’exister.
Michèle et Jean-Paul ont des idées modernes. Tout n’est pas bon dans ce qui est moderne, mais certaines idées valent mieux que celles qui avaient cours autrefois, qui n’étaient que des préjugés, selon un mot qu’il entend quelquefois prononcer par Michèle.
Alors, qu’ils entrevoient ce que fut son histoire là-bas, qu’ils découvrent qu’il ne fut pas toujours, pas seulement, l’oncle paisible à la vie toute simple, tout cela lui importe peu. Tout cela, au fond, peut-être même le souhaite-t-il. Car il ne parvient pas si facilement à lire en lui. Vraiment, quel souci a-t-il de ce qu’on croira, de ce qu’on pensera de lui, une fois qu’il ne sera plus de ce monde ? La vérité, n’est-ce pas toujours ce qu’il faut préférer ?
Il ferait peut-être mieux, au lieu de perdre son après-midi à méditer le passé, d’aller jeter un coup d’œil au journal dont il n’a rien lu encore, peut-être de s’employer à un petit travail, ou du moins de discuter un peu avec les autres, ou encore, ce qui fait le mieux oublier, pour un moment, le vague à l’âme, de se proposer pour disputer avec Marcel, Philippe et P’tit Louis un mille ou deux et la belle si nécessaire, d’autant plus que, ces jours derniers, la chance a été avec lui.
Mais l’autre tentation est la plus forte : retrouver ces jours sombres et ces jours de lumière, ces jours privilégiés et inattendus, cette embellie imprévisible…
Alors… Alors, pour faire surgir dans sa mémoire ce qu’il a vraiment senti, c’est-à-dire vécu – parce qu’enfin ce qu’on vit, c’est ce qu’on ressent profondément, ce qu’on comprend avec force, ce qui retentit en soi – il lui faut tout d’abord se remettre à l’esprit le contraste des jours, et il faut tout d’abord revenir aux jours noirs. Ce besoin de ne pas faire taire les souvenirs les plus pénibles, ce n’est pas de la cruauté envers soi-même, c’est une volonté de lucidité. Le revoilà donc aux tristes heures de 1940. La guerre est perdue. Ils viennent d’être livrés aux Allemands…
II
Parqués sur une espèce de terrain plat – un pré ? un terrain vague ? sa mémoire a laissé s’enfuir ce détail – et gardés là deux heures peut-être, les mitrailleuses de l’ennemi braquées sur eux, ils avaient ensuite été sommés de marcher. Et ils avaient marché sur des routes inconnues, interminablement, jusqu’à en avoir le dos et les jambes affreusement douloureux. Les coups de crosse, les coups de botte des Allemands… Pourquoi ? Parce qu’ils ne restaient pas serrés ? Parce qu’ils n’avaient pas compris un de ces ordres que ces hommes vociféraient ? Il ne s’agissait pas de résister : Charles gardait trop présente la scène insoutenable de ce soldat tombé de fatigue, incapable de se relever, frappé de plus en plus durement, puis piqué, percé de coups de baïonnettes, expirant, achevé comme un animal blessé. Même si ça faisait mal, tant qu’on avait la volonté et la force de vivre, il fallait marcher. Il fallait aussi soutenir ceux qui trébuchaient.
Ça, c’était dans les dernières heures de cette journée si longue. On ne pensait même plus, on ne se posait plus de questions. La souffrance avait changé, le mal s’était enfoncé dans tous les muscles, jusque dans les vertèbres. Le chagrin, l’angoisse, ç’avait été au début, avec l’étonnement d’être tombé si rapidement aux mains de ces hommes verts assez conformes à la représentation mentale qu’en avait Charles : furieux, cruels, gueulards, mécaniques et obéissants. Mieux vêtus, mieux équipés, sans contestation possible, d’une tenue beaucoup plus stricte que les Français. Ah ! les Français, cette armée qui foutait le camp de tous les côtés comme un tas de bûches mal entassées qui s’écroule tout à coup, comme un échafaudage réputé solide et en réalité mal dressé qui s’effondre brusquement et manque vous écraser ! L’armée des Français, une autre fois, à un autre moment, il y repensera. Les Allemands, enfin, les Boches, comme on disait, étaient bien des hommes-machines, et des hommes-machines bien réglés, des robots obéissant aux cris.
Comment ces hommes avaient-ils pu, en si peu de jours, si complètement gagner la guerre ? Lui et les autres en étaient consternés. Après tous ces mois d’inertie totale ! Et la ligne Maginot pourtant ? Oui, mais ils étaient passé par la Belgique, comme en 14 et comme en 14 avaient avancé très vite, et cette fois rien n’avait pu les arrêter : ils avaient trop de blindés et ils étaient maîtres du ciel. Les mauvaises nouvelles s’étaient accumulées en peu de jours et les gradés avaient simplement dit à Charles et aux autres : « On est cernés, enfermés. On ne peut plus s’en sortir. Il est trop tard pour se replier. » Et ces hommes-mécaniques verts s’étaient bientôt trouvés là et eux, les Français, qui n’avaient même pas eu le loisir de se battre un peu sérieusement, avaient reçu l’ordre de déposer leur Mas 36, leurs munitions, leur ceinturon.
Dépit, colère contre la « Mère Patrie » inconséquente et incompétente. C’était pour ça qu’on les avait mobilisés ? Stupeur et angoisse. Angoisse de ce qu’ils allaient devenir, de ce qu’on allait faire d’eux. Exaspération contre ces incurables optimistes, si nombreux, qui prétendaient qu’après tout ils ne seraient pas tués, qu’on n’allait pas les manger ! Où les conduisait-on, d’abord ? Dans un camp où ils resteraient jusqu’à la fin de la guerre. Où la vie serait dure, ça oui. Mais d’où ils sortiraient un jour, assuraient les optimistes, ayant échappé au pire qui était d’avoir été tué au combat.
Si confuse, si amoindrie qu’ait été sa conscience, Charles avait remarqué l’aspect fleuri des maisons de la petite ville alsacienne où ils finirent par arriver ; un nom en heim qu’il pourrait confondre avec un autre et dont il n’est plus sûr : il y en a tant. Là, ils furent conduits jusqu’à un bâtiment sommaire, un vaste hangar, un entrepôt vide, où une partie des prisonniers, dans laquelle se trouva Charles, fut poussée sans ménagement et serrée pour la nuit. Ils ne reçurent ni à manger ni à boire. Le lendemain matin seulement, fut distribuée à chacun une tranche de pain grisâtre et de l’eau fut versée à tous ceux qui purent présenter leur quart.
Ils croupirent là une journée au moins. Deux peut-être ? Il se l’est parfois demandé sans parvenir à une certitude. Il pensa, comme beaucoup d’autres, à s’évader. C’était risqué : les yeux mauvais des sentinelles vertes les épiaient, les canons de leurs armes toujours braqués sur les captifs. Un homme, proche d’une issue, au moment où on leur apportait ce fameux pain, tenta de prendre la fuite. Halt ! Un seul cri. Un seul coup de feu. L’homme tomba, gravement blessé ; il fut emporté. Mort ? On ne s’interrogea pas beaucoup sur son sort, Charles ne l’a jamais su.
Le transport en Allemagne : quel autre souvenir abominable ! Un train poussif et les wagons à bestiaux… comme dans l’armée française, après tout. Cela n’aurait rien été. Mais eux, les prisonniers, serrés là-dedans… comme dans une boîte de sardines ! La comparaison serait appropriée si elle n’avait pas si souvent servi. Vivre, c’est d’abord respirer, c’est là une évidence, mais on ne le sait plus, on n’y pense pas. Eux s’en apercevaient, particulièrement les plus petits, qui étouffaient. Dans le wagon voisin de celui de Charles, un homme mourut au bout de quelques heures, certains purent voir son corps qu’on descendait, c’était à Stuttgart. Pendant presque deux jours, ils furent ainsi voiturés debout, lentement emportés à travers l’Allemagne, le corps brisé, macéré dans l’entassement de la viande humaine, dans la forte odeur humaine où dominait celle des excréments, la plus irrespirable… enfin, au début.
Sortir de là, fuir à tout prix, il n’était guère sensé d’y penser. Ils ne quittaient pas le wagon et toutes les issues étaient bloquées. Percer le plancher ? Entreprise fort longue et problématique sans instruments et pour autant, n’ouvrant guère de possibilités de fuite, qui ne reçut guère d’approbations et ne fut pas même tentée.
En finirait-on ? Un moment arriverait-il où on sortirait de là ?
Au bout de ces interminables heures, la descente, enfin, l’ultime marche vers le stalag, les barbelés, les miradors… Le crâne tondu, la plaque qu’on leur avait remise avec leur numéro à porter à leur cou. Ces souvenirs se fondent dans le quotidien de la misère morale autant que physique qui commençait pour des mois. Les baraques, dressées par eux, qui remplacèrent bientôt les tentes rudimentaires. La faim, la soupe claire de rutabagas deux fois par jour. La colique et les feuillées rudimentaires. Et les rassemblements ineptes pour le « comptage » des prisonniers laissés en rangs et en colonnes, immobiles et debout, une heure ou deux sous le soleil de l’été dans les premiers temps et, quelques mois plus tard, dans le petit vent aigre et cinglant. Le désir de leurs geôliers de brimer, de tourmenter, l’ennemi détesté et vaincu était trop visible. Et les civils curieux venus voir derrière les barbelés ces fameux kriegsgefangene – ou kriegsgefangener, ou kriegsgefangenen, c’était difficile de bien entendre leur jargon –, se moquant de leur mine de déterrés, de leur aspect piteux, de leur mise et de leurs têtes de vaincus, pensant sûrement qu’ils méritaient bien de souffrir… Et pourtant aussi déjà, ces regards de vieux, impénétrables, peut-être sceptiques mais probablement sans haine, et ces coups d’œil apitoyés chez quelques femmes de tous âges qui disaient, en dépit de tout, que tout n’était pas irrémédiablement mauvais chez ce peuple vainqueur.
Les Allemands assuraient que la guerre était à peu près finie et gagnée par eux : l’Angleterre se trouvait, à les entendre, à bout de forces, ce n’était plus qu’une affaire de jours ; quant à la France, les kriegsgefangenen n’ignoraient pas qu’elle avait depuis longtemps demandé l’armistice. Ils furent d’ailleurs, ces pauvres prisonniers, ces malheureux Franzosen, autorisés à donner signe de vie à leurs familles par l’envoi d’un bout de carton où ils pouvaient écrire quelques lignes. Et puisque la guerre était finie, n’allaient-ils donc pas être libérés et rentrer chez eux ? Ce bruit courut plusieurs fois, voulu, sinon lancé par les Allemands, et autant de fois fut démenti.
Il fallut supporter, il fallait durer, vivre… pour une durée inconnue, sous ce ciel inconnu…
Les lieux, les alentours ? Charles a de tout temps été trop curieux de la nature et des paysages, pour ne pas avoir trouvé le moyen et le loisir d’épier, regarder, dès le lendemain de son arrivée, au-delà des clôtures barbelées du stalag. Un horizon de hauteurs massives, de moutonnements, plutôt que de vraies montagnes, surtout du côté du soleil. Des prairies, des champs qui avaient l’air bien cultivés. Des bois apparemment peu étendus, plutôt aux endroits élevés. Un paysage agricole mixte, après tout assez semblable à sa Combraille où il avait toujours vécu. Mais nulle part ici de puys bien tracés, bien posés, presque alignés, comme ceux qu’il voyait de sa maison ou de ses champs. Il n’avait pas dû y avoir de volcanisme. Pas de lointains prenant un air un peu mystérieux de vraies montagnes comme les monts Dore, lorsqu’il regardait par temps clair du côté de Pontgibaud.
Et quel était donc le nom de cet endroit de cette Allemagne maudite où on les avait « traînés » ? Il y a toujours dans un groupe humain des individus qui trouvent le moyen d’être informés avant les autres ; quelques prisonniers comprenaient l’allemand et bientôt, leurs gardiens acceptèrent de lâcher quelques paroles, une réponse brève et méfiante donnée à regret ou sans façon et par amusement, devant une ignorance trop évidente. Ils surent donc qu’ils se trouvaient en Saxe et des noms de localités proches furent prononcés : Zittau, Koznovitz – ou quelque chose comme ça, tant c’était difficile à dire – Bautzen… Et à peu de kilomètres finissait l’Allemagne et commençait la Tchécoslovaquie, un pays ami des Français sur lequel, à la vérité, Charles ne savait rien, sinon que ledit pays avait eu, parmi les premiers, à souffrir des entreprises de l’Allemagne et de son Hitler. La frontière était au sud, justement vers ces monts qu’on apercevait. Tenter de s’évader, de gagner ce pays, cette pensée lui était venue. Oui, mais la Tchécoslovaquie était sous la botte germanique : là-bas, il ne serait pas plus en sécurité qu’en Allemagne…
Quant à patienter raisonnablement jusqu’à la fin de la guerre… Les Allemands ne semblaient pas pressés d’en finir. Ils venaient d’attaquer l’URSS, un pays démesurément étendu. Ils y étaient entrés, en avaient envahi toute une partie, approchant de Moscou. Les Boches étaient décidément très forts !
À la longue, il s’était pourtant un peu habitué, il avait appris un peu de cette patience si utile. Il devait moins souffrir intérieurement… Et l’animosité des Allemands n’avait-elle pas faibli ? Oui, les Allemands, au cours de ces années d’une guerre qui a fini par mal tourner pour eux, ont changé d’attitude à l’égard des prisonniers français. Mais quand ce changement a-t-il commencé ? En 41 ? Pas encore. Plutôt en 42. Et pour Charles, l’année 1942 a apporté le début d’un changement autrement décisif à sa captivité, la fin d’un boulet au pied traîné en permanence, d’un esclavage insupportable.
III
Le temps de ces kommandos plus ou moins volontaires pour travailler dans les fermes a pu commencer en 41. Mais lui, il a quelque peu tardé à y partir : il ne voulait pas, se disait-il, apporter aux Allemands quelque aide que ce fût. Seulement, il entendait parler les autres. Sortir du stalag, c’était déjà quelque chose ; ensuite, travailler au-dehors, ça valait mieux que croupir éternellement enfermé ou être expédié d’autorité dans une usine ; enfin, dans les fermes, dans certaines fermes tout au moins, on n’y était « pas si mal que ça ». Or, l’agriculture, c’était sa partie, il s’y connaissait autant que quelques autres et plutôt davantage. Et sortir de là, seulement sortir, quel mieux-être ce serait !
Alors il s’était décidé : aide apportée aux ennemis ou pas, son travail représenterait si peu et il ne s’agirait de produire que ce qui permet aux humains de se nourrir, il ne s’agirait pas de les aider à mal faire. Oublier un peu la promiscuité, l’odeur de la baraque, cette odeur forte de chaussette pourrie, de renfermé, de pet, cesser d’entendre les sempiternels gémissements et les sempiternelles plaisanteries, aigres, indigentes et douteuses, de ses frères de captivité, pouvait-il au moins espérer ces petits bonheurs ?
Et ainsi, il avait été envoyé sous escorte armée, très tôt un matin, à quelque huit ou neuf kilomètres du stalag, en compagnie de trois autres prisonniers de son acabit, à la ferme Jung. Une ferme qui n’avait pas cet air ancien de celles des Combrailles, qui ne paraissait pas se trouver là de toute éternité. L’aspect, l’architecture, la nature des matériaux de construction, étaient autres : des murs en pierre moins sombre, tirant sur l’ocre clair plutôt que sur le gris, la tuile des toits d’une forme inconnue de Charles et d’un rouge particulier. Une ferme qui, dans son pays, aurait été classée dans les grandes exploitations et Charles n’avait pas douté qu’elle dût l’être aussi en Allemagne : une superficie qu’il pourrait bientôt évaluer à coup sûr à plus de quarante hectares, presque entièrement mis en valeur, en champs, vergers, prairies ou bons pâturages. Les quatre hommes de son kommando devraient intervenir dans deux autres exploitations dont, comme à la première, une femme avait la charge, le maître et le personnel masculin dans la force de l’âge ayant dû être mobilisés et envoyés quelque part sur le front russe, en Afrique ou dans les Balkans. À moins que, par chance pour eux, ils aient été affectés dans les troupes d’occupation en France, ce pays où la nature était réputée généreuse et la vie facile, où, comme chaque Allemand croyait bien le savoir, ils ne devaient pas se plaindre de leur sort, ils ne pouvaient qu’être bien.
L’arrivée à la ferme Jung… Kirsten… Leur première rencontre… Elle est là, bien présente dans sa mémoire et jamais elle n’en sortira. Il s’attendait à trouver comme maîtresse de maison une grosse Allemande couperosée, blonde (la majorité des Allemands sont blonds), mais renfrognée sans doute et au visage ingrat. Il a pensé avoir devant lui la fille – une des filles, peut-être – de la maison qu’on chargeait de les recevoir en l’absence de la maîtresse. Il a pensé aussi que cette jeune ennemie était gracieuse. Et il a dû se détromper. C’était bien cette femme toute jeune qui était la patronne de cette ferme ! Et après tant de mois subis dans un entourage exclusivement masculin, parmi ses frères de captivité et les vieux militaires allemands chargés de leur surveillance, c’était un réconfort, un réel bienfait que sa seule contemplation. Belle, oui. Pas plus, probablement, que beaucoup d’autres, mais pour lui, à ce moment-là, merveilleusement belle. « Elle a des formes », déclarèrent peu de temps après les autres, et sans être… comment dit-on déjà… vraiment en chair, elle semblait bien faite à Charles, bien « balancée ». Soit, elle avait des formes et cela faisait partie de ce qui la rendait séduisante, mais ce n’était pas ce qui l’avait tout d’abord frappé. Il se rappelle l’intensité de son regard – pour lui c’est la qualité du regard autant que l’harmonie des traits qui donne sa grâce à un visage – et cet air juvénile et cette chevelure châtain clair, presque blonde, coupée court mais abondante.
Leur première rencontre… Les quatre prisonniers sont descendus de la camionnette, on vient d’annoncer leur arrivée. Elle s’avance vers les kriegsgefangenen. Les yeux vifs mais froids, a-t-il cru d’abord, les dévisagent, s’attardent un peu plus longuement sur lui – il en est sûr – que sur les trois autres. Elle demande leur nom et leur prénom, s’efforce de les répéter comme pour les retenir, se tait pendant deux ou trois secondes, puis ajoute seulement : Gut ! La voix est un peu grave, l’accent allemand, dès qu’elle prononce les noms français, bien perceptible ; le ton ne révèle ni dédain, ni hostilité, ni sympathie.
C’était, là-bas comme en France, l’époque des foins. Le travail ne manquait pas et ils ont été invités à s’y mettre aussitôt. Charles connaissait ce travail. Il savait que, pour bien sécher, l’herbe devait être retournée, bien étalée – et il y avait pour cela un râteau faneur tiré par un cheval –, mais aussi que, ici et là, dans les coins, l’intervention d’un râteau manuel n’est pas toujours inutile. Il se servait assez habilement d’une faux. Il savait apprécier la qualité d’un fourrage et si celui-ci était assez sec. Le maniement de tous les outils lui était familier. Dès le deuxième ou troisième jour, l’Allemande parut apprécier la présence de ce Franzose et son regard non seulement perdit toute froideur, mais devint pour lui clair et loyal, empreint de compréhension. Charles sut qu’il faisait bonne impression et s’en réjouit obscurément. Il ne voulait pas décevoir cette femme chez qui toute apparence de méfiance et d’hostilité s’était effacée. Déjà, cette Allemande n’était plus vraiment une ennemie. La grâce féminine confère des privilèges. Il était homme et il était tout jeune ; elle était femme, Allemande ou pas. Déjà, il aurait été ennuyé de lui déplaire.
Mais, à cette époque encore, il ne pensait pas, il ne croyait pas être épris d’elle. Ç’aurait d’ailleurs été particulièrement imbécile de sa part. Elle avait un mari, mobilisé et au front. Elle avait un enfant qui faisait ses premiers pas. On ne va pas tomber amoureux d’une femme mariée, à plus forte raison d’une femme qui, contre votre bon vouloir, vous commande et à plus forte raison d’une femme d’un pays ennemi et détesté. Ils s’étaient côtoyés pendant des mois en bonne entente, se respectant tacitement, s’estimant, méritant ces égards qu’ils avaient l’un pour l’autre, elle, satisfaite de ce bon employé, lui content de cette patronne exceptionnelle et irréprochable. Et vraiment, sans rien de plus ? C’est difficile à retrouver. Des hommes tels qu’eux, en regardant une femme, pour peu qu’elle fût désirable, avaient souvent des réflexions peu gênées, gardées pour soi ou exprimées entre eux un peu plus tard. Ainsi certains soirs, sur le chemin du retour, parlant de cette maîtresse tout de même un peu particulière :
— Celle-là, si on pouvait, on lui ferait bien son affaire.
— C’est jamais qu’une Boche…
— Et alors ? Elle est quand même bien foutue !
— Et elle est correcte avec nous.
— Tu trouves qu’elle nous fait des cadeaux ?
— Des cadeaux, non. Mais elle est correcte. Tout à fait correcte. Et à écouter un peu ceux des autres kommandos, elles sont pas toutes comme ça.
— Peut-être que ça lui ferait plaisir à elle aussi…
— Quoi donc ? Ce qu’on disait ? Ah oui… Ben, je sais pas… Faudrait lui demander !
— Merci du conseil… Seulement, je suis pas sûr encore du succès ! Et j’ai pas envie de me faire envoyer autre part où c’est peut-être pas mieux. Alors…
— Alors, tu vas attendre encore un peu avant de… de tenter ta chance…
— Voilà. Tu es de bon conseil, toi !
— Entre frères de malheur, ça se doit !
C’étaient là, à peu de chose près, les prétentions effrontées qu’ils avaient dû formuler les uns et les autres, et les conseils ironiques de prudence qu’ils s’étaient donnés.
Dans un tel environnement, toutes sortes de pensées avaient pu lui traverser l’esprit et, comme les autres, Charles avait sûrement imaginé, sans y croire… Il avait certainement eu des désirs, repoussés au nom des convenances, de la morale et du bon sens. Mais tout ça, il s’en faut que ça mérite d’être appelé de l’amour.
Il avait certainement regretté que cette femme ne fût pas de son pays et de se trouver, lui, en de telles circonstances, en pareille situation, prisonnier, vaincu, en face d’elle, étrangère et ennemie, placée au-dessus de lui, mariée enfin. Il avait dû regretter qu’ensemble ils n’eussent guère à échanger que quelques mots, quelques signes relatifs aux ordres donnés par elle, reçus par lui, ne se comprenant qu’avec peine, lui s’efforçant cependant de témoigner la plus grande bonne volonté, elle, acceptant de sourire des malentendus, lui jetant parfois un bref regard amusé qui le laissait perplexe et plein d’embarras. Mais telles étaient les choses, se disait-il alors ; la vie, qui n’était pas si bonne et n’avait pas tant à donner, aurait pu faire en sorte qu’il fût tombé sur un maître ou une maîtresse durs et antipathiques dont il aurait tout aussi bien dû s’accommoder. Soit, il avait pu ressentir des regrets, ou plutôt du dépit… oui, du dépit, ce mot convenait mieux… Il avait pu tout aussi bien se donner des motifs de satisfaction…





























