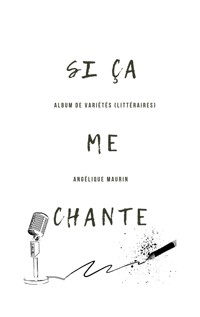Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans la France de 1939, Gus, ouvrier de l'ombre épris de vie et de femmes légères va perdre souffle et raison en découvrant par l'étroitesse d'une ouverture donnant sur la rue, les jambes et la démarche indolente d'une passante vite entraperçue. Elle s'appelle Mado. Elle a seize ans. Elle sera pour Gus et pour tous ceux qui, après lui, croiseront son chemin, cette insaisissable, cette ineffaçable, qui pèsera toujours plus lourdement au centre des existences de chacun. Dans un monde qui s'apprête à subir l'un de ses pires bouleversements, les douleurs intimes et individuelles des êtres qui s'attacheront aux pas de Mado, supplanteront celles, pourtant si prééminentes de la grande Histoire. "Elle n'était qu'illusion. Elle n'était que Mado. Elle n'avait toujours été que cela. Son accidentelle, celle que même le plus cruel des destins n'aurait pas osé admettre lui avoir promis." Des prémices de la Seconde Guerre jusqu'à l'orée des eighties, la trajectoire inconcevable d'une héroïne ambiguë que vous vous ingénierez peut-être à vouloir comprendre. Mais y parviendrez-vous?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
AMÈRE
Création et réalisation de la Couverture : Jonas Bonhomme
Sommaire
1938
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
1939
Chapitre 1
Chapitre 2
1941
Chapitre 1
1944
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
1945
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
1949
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
1950
Chapitre 1
1976
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
1938
« Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur.
Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre.»
(Winston Churchill)
1
Dans sa vie, Gus avait rarement levé les yeux vers le ciel, mais ce matin-là quand il le fit, il eut un premier aperçu de ce qu’il avait toujours supposé être le paradis.
S’il avait été un gars plus fin, un de ces gars qui aiment se pencher sur leurs souvenirs ou parler en société de leurs premiers émois, il aurait peut-être pensé ou dit plus tard – dans ses vieux jours sans doute, ces jours inévitables où la nostalgie de celui qui décline, l’amène à s’appesantir sur les touchantes crédulités d’un passé à jamais perdu – qu’il aurait dû savoir alors que l’enfer se cachait parfois derrière les images idylliques du jardin d’Éden. Mais il n’était pas ce genre de bonhomme Gus et ne le serait jamais.
En cet instant, à demi-nu dans la chaleur torride et moite du fournil, les cils lourds de poussière et le nez saturé par les relents oxydés du charbon brûlant dans le four à pain, il redressa son visage blanchi où des gouttes de sueur traçaient des larmes sales et le tourna vers le soupirail, à quelques mètres au-dessus de sa tête, seule percée de lumière et d’oxygène qui laissait aux geindres1 l’assurance d’être encore des hommes, pareils à ceux d’enhaut, ceux du ras du trottoir, et non des taupes laborieuses, esclaves enterrés aux muscles durs des pâtons exigeants.
La trouée était étroite, coupée de barreaux de fer, la vitre grise et grasse, mais ce qui se dessinait derrière le frappa de plein fouet avec la clarté éblouissante d’une révélation.
Des jambes. Des jambes de femme.
Oh pas des jambes entières, bien sûr, le soupirail était trop petit ! Mais des mollets, la naissance d’une cheville, celle bien plus troublante et plus fugace encore d’un genou.
Gus n’en revint pas. Un choc.
Il n’était pourtant pas homme à s’attendrir si facilement. Il avait presque trente-six ans et des filles il en avait connu bibliquement tout un tas. Oui, vraiment un tas. À quatorze ans déjà le jeune Gus, qui trimait tous les matins au nettoyage des écuries de la ferme Besson pour aider sa pauvre maman à nourrir la famille, s’amusait dans des jetées de paille avec les jumelles de son patron, deux sœurs longues et blondes âgées de bien cinq ans de plus que lui, qui testaient leur étrange et espiègle complicité en se partageant sans gêne aucune les faveurs du petit ouvrier de leur père.
Gus, gamin finaud qui ne laissait passer aucune occasion de profiter de la vie et des bienfaits que les autres pouvaient lui accorder, allait à l’une et l’autre, la bouche à droite, la main à gauche, les yeux pleins d’étoiles et le sourire ébloui, découvrant par l’usage délicieux de ces corps féminins alloués sans complexe à sa curiosité, sa propre capacité à donner plus que ce que l’on attendait de lui et à souscrire avec bien plus d’éclat, d’excellence et de mérite, à un rôle qu’on lui avait octroyé par défaut.
Il avait toujours et dans tous les domaines, mis ce point d’honneur à refuser de n’être qu’une pièce interchangeable, sans consistance et sans fierté, qu’on utilise et qu’on oublie. Gus savait se ruer volontairement vers des rôles minables, mais pour ne s’imposer nul autre choix que celui d’en sortir vainqueur, grandi et de surprendre – en finissant à leur niveau ou même au-delà – tous ceux qui n’avaient voulu voir en lui qu’un simple pion.
Ses employeurs, tout au long de sa vie, les hommes riches qu’il avait pu fréquenter, les lettrés, tous ceux qui snobaient les petites gens de son acabit, avaient été un jour contraints de regarder Gus d’un regard bien moins hautain, plus droit et parfois même plus soumis.
Les femmes n’avaient bien sûr pas dérogé à la règle. Et les sœurs Besson, premières tourmenteuses de l’ego crâne d’un Gus jeune mais bouillant de défi et de reconnaissance, avaient sans doute inconsciemment œuvré aux bases de son opiniâtreté.
Au cœur d’elles, il avait assimilé et compris mieux qu’aucun autre la nécessité de démultiplier ses mouvements, d’amplifier ses gestes, d’offrir doublement la fougue joyeusement acharnée de sa belle volonté.
Gus avait su avoir quatre mains, vingt doigts, quatre bras pour aller bien plus loin que leurs désirs, tout en conservant la fraîcheur et la fébrilité revigorante de ses émois de grand enfant ripailleur et touche-à-tout, leur coupant le souffle avec sa concentration soigneuse, dirigée, efficace, de petit homme déjà terriblement rompu à ces jeux pleins d’enjeux.
Depuis, beaucoup d’autres frangines – mais il avait préféré par la suite ne pas user inconsidérément de ses forces et les consommer une par une – avaient agrandi la brigade de ses maîtresses pâmées par tant d’adroits efforts.
Enfin, l’âge adulte et la fatigue du boulanger venant, Gus avait fini par se lasser des amourachements et des vaines attentes que les jouissances explosives de ces dames semblaient avoir rendus légitimes. Il avait moins de temps pour la bagatelle et aucun à assigner à l’exclusivité. Moins de ressort aussi.
C’est comme ça que Gus avait abandonné bien vite la conquête des demoiselles pour s’intéresser à celles qui ne l’étaient plus. Les bourgeoises des autres c’était du tout cuit pour lui. Pas d’attaches, pas de fausses promesses. Juste quelques bousculades divertissantes et sans lendemain, vite et bien faites, dans une montée d’escalier ou contre une porte cochère. De quoi se détendre simplement après des heures harassantes de pétrissage et de façonnage.
Comme les autres, ses infidèles se laissaient elles aussi griser par cette technicité qu’il ne désirait plus que consacrer à son travail. Quand elles y prenaient trop de goût, Gus décampait en vitesse. Une première extase pouvait passer pour un délicieux accident, une deuxième aurait été pour elles plus difficile à oublier et pour lui plus problématique à gérer. Il visait rarement deux fois la même cible de toute façon. Une épouse amoureuse signifiait plus d’emmerdements encore que la plus éprise des chasseuses de mari, ça il le savait. Aussi, dispersait-il son talent pour éviter leur dépendance.
Il avait la main. Ou plutôt tant de mains. Partout. Sur elles. Tant de mains !
Il les désorientait. Elles étaient perdues et subjuguées. Toutes le lui avaient dit.
« Tu m’étonnes !» leur répondait-il en adjugeant un sourire convaincu au souvenir de ses prouesses tentaculaires sur les peaux affamées des sœurs Besson.
Ces nombreuses déclarations d’ivresse ne rendaient pas l’amant Gus plus présomptueux. Mais l’ouvrier boulanger oui.
Il se disait que la chair des femmes l’avait conduit vers ce qu’il était réellement, vers l’amour sensuel qu’il portait à la pâte à pain, cette matière dans laquelle il baignait le jour, la nuit, en suant sang et eau certes, mais avec une rage, une passion quasi charnelle.
Y plonger, la relever, la retourner, la maîtriser, c’était son truc.
La travailler toujours, encore, demandait autant de force, de doigté, de métier que ce que les corps de ses belles lui avaient enseigné. Et il leur était reconnaissant pour ça. Il les chérissait pour ça.
Son goût pour le sexe faible et les relations désinvoltes lui faisait apprécier sans surprise la fréquentation des filles publiques. Elles étaient son autre option, évidente, pour un batifolage sans conséquences. Il les pratiquait même assidûment, son frère Marius étant une sorte de maquereau.
« Ah non pas maquereau ! le houspillait Marius. Bordelier si tu veux bien !»
Le mot plaisait davantage à ce satané coquin. Il y trouvait plus de gloire. Et Gus se pliait de bonne grâce aux susceptibilités de son cadet. D’autant plus quand le commerce de ce dernier lui apportait presque davantage de satisfaction que ses galipettes adultérines.
De fait, les putains étaient gaies, inventives, pas farouches et prêtes à tout pour un billet et un verre de plus. Des rapports simples et francs. Tout ce qu’affectionnait Gus.
Elles aussi aimaient bien ses mains. Quand elles pressaient, quand elles manipulaient, quand elles…
Mais là, il n’était plus question d’autres femmes.
Il n’était question que de ce bout d’inconnue qu’un ciel pourtant étriqué glorifiait.
La peau devinée derrière l’écran dégueulasse du carreau irradiait. Du moins c’est ce qu’il lui semblait. L’os rond de la malléole lui paraissait plus délicat, plus fragile qu’aucun autre, la cheville plus fine, le mollet – pourtant visiblement un peu fort – plus adorablement galbé. Et sous les mouvements lents de la jupe rouge que la vue ascendante de Gus rendait cruellement éloquents, l’apparition rare du genou prenait un intérêt divin, une fascinante mesure. Il aurait voulu voir plus haut, l’amorce d’une cuisse peut-être, mais il pressentait que son cœur n’y résisterait pas.
Elle avança d’un pas – et Dieu que ce pas lent, presque indolent le séduisait – mais il pouvait voir encore.
La courte station de cet ange devant la boulangerie, devant l’infime ouverture de la trappe, ne durerait pas longtemps. Et Gus s’empêtrait dans l’urgence impérieuse de l’imaginer. Elle, son profil insaisissable, sa main tenant fort ses quelques pièces, ses doigts déliés qui s’ouvriraient bientôt pour se saisir du pain farineux qu’il se reprochait d’avoir modelé sans avoir présagé qu’il serait pour elle et se refermeraient, phalanges douces contre croûte dure, avant de le serrer contre son sein.
Il aurait fait n’importe quoi pour s’arracher à son trou, pour monter à la boutique et le lui remettre lui-même. Pour la regarder partir en déroulant ses pieds, soigneusement du talon à la pointe, ce qu’il avait déjà appris d’elle et qui lui donnait cette démarche alanguie, si aguichante et si spéciale.
Qui était-elle ? Il était ouvrier ici depuis presque trois mois maintenant et connaissait tous les habitants du village. Il était certain que son œil averti n’aurait jamais pu louper pareilles proportions.
Était-elle blonde, brune, rousse ?
En connaisseur, il associait plus volontiers une brune à la carnation de cette peau pourtant étudiée dans de si minables conditions. Une brune oui, il en était sûr.
Un bas de pantalon beige vint s’immiscer dans le rêve éveillé de Gus. L’intrus abhorré se rapprocha du bout d’inconnue. Elle pivota sur elle-même et sa jupe rouge entoura ses genoux – soudain tous deux somptueusement dévoilés – d’un cercle puis de plis, d’un cercle puis de plis encore, écrin mobile aux mouvements hypnotiques de balancier.
Si au sens propre Gus était déjà depuis un moment à ses pieds, au sens figuré, il y tomba raide et radicalement à ce moment-là.
Et les chaussures de l’homme le piétinèrent quand il la vit rester tournée vers lui et laisser les pans du pantalon frôler de beaucoup trop près la stabilité retrouvée de sa jupe écarlate.
Gus sentit se crisper ses mâchoires. Une plainte rauque et involontaire s’échappa d’entre ses lèvres. Mais aucun des camarades qui peinaient près de lui dans le terrier sombre du fournil ne s’en préoccupa. Les douleurs des muscles saillants de leurs bras englués de pâte ou celles de leurs peaux aux poils roussis aux abords du four ardent, composaient à chaque instant une fraternité de cris. Celui de Gus fut différent des leurs sans doute, mais ils ne le remarquèrent pas. Ils étaient tout entiers à la fabrication du pain.
Gus lui, s’apprêtait à fabriquer sa peine.
1 Geindre ou gindre : nom donné aux ouvriers du boulanger qui pétrissaient à la main. Ce mot signifierait « jeune garçon » ou « gendre » (l’ouvrier devenait à une époque très souvent le gendre de son patron), mais pourrait également trouver sa source dans les gémissements poussés par ces apprentis qui « geignaient » en effectuant ce travail physique et éprouvant.
2
De mémoire d’homme, on avait toujours appelé Gus: « le taureau ».
Il y avait de nombreuses raisons à cela.
Et celle, grivoise, qui ragotait sur les ardeurs bestiales du gaillard et – par un approximatif raccourci – sur leurs propensions à faire pousser des cornes sur les têtes de tous les cocus de la terre, n’était pas la dernière. Mais elle n’était bizarrement pas la plus importante.
L’origine de ce surnom venait tout d’abord de son enfance et plus particulièrement d’une sorte de légende, construite et rapportée par la propre mère de Gus, une brave femme qui avait donné vie à quatre beaux bébés et qui ne s’était jamais privée de balancer à qui voulait ou non l’entendre, le calvaire épique qu’avait été la naissance de son premier-né.
Avec moult détails sordides, qu’elle se plaisait à distiller avec un sadisme et une délectation non dissimulés – notamment quand son public était pleinement concerné et qu’il se composait d’émotives toutes nouvelles épouses ou d’inquiètes futures accouchées –, elle contait les déchirures, la peur, les hurlements, les heures interminables, les coups de boutoir de la terrible progression de l’enfant dans son étroit bassin de primoparturiente et la façon violente dont il avait fini par en jaillir, boule fauve ou petit corps tassé et fumant, qui portait sur le crâne deux taches ensanglantées et sur le dos un fin duvet brun ; duvet qui s’était vite transformé, au gré des distorsions du temps et des récits toujours plus excessifs, en une sorte d’épaisse et incroyable toison.
Le motif suivant était évidemment purement physique.
En effet, Gus était râblé et court sur pattes. Son modeste mètre cinquante-six se déplaçait sur des jambes courtes dont l’arc incontestable semblait plier sous le poids d’un torse massif et d’une cage thoracique large. Sa façon de se mouvoir, avec ce poitrail imposant en avant, le faisait paraître redoutablement balèze. Un brin matamore aussi. Et les muscles de ses bras, sculptés au dur travail de la boulange, complétaient l’impression de force brute qui émanait de lui malgré sa petitesse, suffisamment du moins pour faire réfléchir à deux fois les amoureux de la castagne bien plus grands que lui.
Son regard bleu pouvait troubler aussi. Il était froid, pénétrant, acéré derrière des yeux qui regardaient toujours en dessous. On sentait un feu couver en lui. De ces feux dansants qui fascinent et qui décollent la peau plutôt que de la réchauffer.
Gus était donc de ces hommes qui vous captent et vous séduisent.
Pas forcément beau avec son nez fort, ses joues distendues creusées de plis et son menton affirmé, il possédait cependant des traits qui, tout en étant grossiers, recélaient une réelle harmonie. Et chacun s’accordait à dire que « le taureau » était un type attirant. Petit, inquiétant, mais attirant.
Pour couronner anarchiquement mais bellement le tout, une crinière dense et fournie de cheveux clairs déjà parsemés de fils gris, achevait de donner à son visage buriné un air de capitaine pirate ou de flamboyant aventurier ; sans oublier, point cardinal de ce courtaud mais extraordinaire ensemble, une toque, rectangle déconcertant tissé de frisettes drues – en poil de taureau imaginait-on – dont Gus, qui pourtant ne ressentait ni n’admettait aucun complexe, s’affublait pour se rehausser de quelques centimètres et qu’il quittait rarement.
Il aimait bien ce drôle de galurin. Sans le trouver pour autant ni élégant ni flatteur. Il était juste le seul à en avoir un de la sorte et cette petite originalité, plantée comme un phare incongru au sommet d’un monument remarquable, faisait qu’on le distinguait encore un peu plus.
La dernière justification à cette analogie animalière et non la moindre, était sans aucun doute son tempérament.
Gus était une petite frappe.
Oui.
Un bagarreur. Un colérique. Un fonceur.
Il n’avait peur de rien et bataillait dans le tas à la première occasion. Il pouvait être brutal parfois et cogner sans sommation tous ceux qui lui paraissaient mériter une bonne dérouillée. Il courait sur sa rage des anecdotes nombreuses, parfois un peu grossies, qui constituaient la légende violente d’un fou furieux, sortant facilement sa lame ou ses poings. Ça le faisait sourire. D’autant plus lorsqu’il prenait conscience de l’effroi et de la menace latente qu’induisait inévitablement le coin ironique de ce simple sourire.
Cette rage, elle était bel et bien en lui. Il la sentait enfler parfois et déborder jusqu’à ses mains. Mais l’époque était dure et avait fait de lui un homme dur. Il ne parvenait pas à exprimer ça autrement.
Gus faisait partie de la classe des ouvriers, des tâcherons, de ceux que l’on rémunère pour agir et non pour penser. Et il avait travaillé beaucoup depuis ses treize ans. C’était pendant la Grande Guerre et les enfants, ceux surtout dont le père ne reviendrait jamais, devaient se débrouiller pour subsister. La ferme Besson avait été un lieu parmi tant d’autres. Il avait passé des jours entiers dans les champs, le dos courbé, les jambes tétanisées. Il avait chapardé. Il avait volé. Il aurait pu tuer aussi.
Il n’avait peur de rien parce qu’il n’avait jamais eu le temps de songer à la peur.
Il ne voulait que vivre et réussir à vivre encore. Et mieux surtout. Oui. Mieux.
Quand il avait vingt ans, il s’était essayé au cabaret. Ça avait pas mal marché ! Il avait la gouaille qu’il fallait. Les textes paillards ou humoristiques, c’était son truc. Avec sa voix un peu rauque de déjà gros fumeur de Gauloises, il entonnait des chansonnettes légères comme Elle faisait prout prout2 ou encore Cach’ ton piano3, se complaisant à faire rire et à distraire, puis à finir fin saoul au comptoir au bras d’une ou deux mignonnes aux yeux brillants d’amour et d’alcool ou la face écrasée d’un poivrot collée sous son genou.
Il avait trafiqué aussi un peu avec Marius. Quelques larcins sans envergure, de la nourriture, des bêtes, du pognon. Des transactions avec des michetonneuses aussi, déjà. C’est là que Marius avait décidé de faire du sexe son fond de commerce.
Gus lui, se contentait d’essayer les filles. Il voulait bien tremper de temps en temps – sans mauvais jeu de mots – dans les affaires de son frère, mais il se sentait attiré bien davantage par le pignon sur rue que par les lanternes rouges. En bref, malgré ses tendances aux mauvais coups, Gus souhaitait être honnête.
C’est sur le tard qu’il avait rencontré Monsieur Lamothe, un boulanger prospère. Ils avaient sympathisé et le gros Lamothe, qui lui rappelait par bien des aspects son père défunt, l’avait pris comme apprenti pendant trois ans. Gus avait la bougeotte et après son apprentissage il était allé voir ailleurs. C’était préférable pour en connaître plus sur le métier. Tous les ouvriers boulangers faisaient ça.
Il avait roulé sa bosse un peu partout. Cannes, Lyon, Marseille. Dans les grandes villes on s’épuisait à la tâche, mais ça payait bien et on progressait vite.
Il avait donc continué à aller là où le vent, le travail et les francs sonnants et trébuchants le menaient. Car son rêve, c’était d’être patron, d’avoir sa propre boulangerie. Peiner comme un forçat ne l’avait jamais dérangé. Il fallait ce qu’il fallait pour réussir. Gus avait un but à atteindre. Et il y arriverait, il en était certain.
La seule chose aujourd’hui capable de contrecarrer ses plans serait une nouvelle guerre. Il avait de vraies craintes à ce sujet et les articles sidérés et pleins d’appréhension de la presse ne visaient pas à le rassurer. On avait eu beau affirmer haut et fort et pendant des années que 14-18 serait la der des ders, les journaux ne cessaient actuellement de marteler les refrains alarmants d’un regain d’inquiétude.
L’annexion de l’Autriche4 par les troupes nazies trois mois auparavant, et cela sous les atermoiements d’une France et d’une Angleterre incapables de s’opposer aux ambitions du chancelier Adolf Hitler, préoccupait. Ce dernier, aussi bougrement dangereux que charismatique, semblait presque autant dévoré par ses volontés pangermanistes5 que par sa haine viscérale de la France, l’ennemie mortelle du peuple allemand, coupable selon lui des humiliations du Traité de Versailles6.
Gus s’intéressait peu à la politique en règle générale. Mais il savait que les réorganisations de territoires et les soifs de conquêtes des puissants pouvaient initier le pire. Vienne la Douce, offerte au national-socialisme et à son armada de drapeaux à croix gammée, venait d’en être le plus ou moins résigné témoin. Et ce Führer, avec ses gesticulations, ses harangues incantatoires et son regard exalté, affichait tout l’attirail du barjo idéaliste prêt à projeter bien d’autres prises.
Dans ce siècle imparfait et aux incompréhensibles enjeux, les gens simples se devaient de devenir les combattants de leur propre destin. C’était ainsi. Gus acceptait. Une guerre avait déjà traversé sa vie. Si une autre se profilait, eh bien il n’aurait d’autre choix que de faire avec. Les restrictions, le manque, les pertes, il les avait déjà expérimentés, il y était habitué.
Son quotidien, même sans que les soucis du monde s’en mêlent, n’avait jamais été de tout repos de toute façon. Il travaillait plus de onze heures par jour et six jours par semaine dans la saleté, la promiscuité et la chaleur, à secouer de lourds sacs de farine, à besogner dans la douleur. Mais ça, il l’avait choisi. Par contre il était logé et nourri, c’était un avantage. Et son salaire, il pouvait le mettre de côté pour son projet.
Bientôt, quoi qu’il se produise ici ou ailleurs, il aurait en poche la totalité de la somme qu’il s’était fixée pour pouvoir retourner chez lui à Tarascon7 et y ouvrir un magasin bien propre. Bientôt, quoi qu’il advienne par et pour les hommes, il regagnerait les bords du Rhône et le Château du Roi René8 sous l’ombre duquel il avait grandi. Pour l’heure, il fallait espérer. Profiter. Gagner encore un peu plus. Boire du vin après le labeur. Glisser sa main dans le corsage des filles.
Ou encore mieux, sous la jupe rouge affriolante de la propriétaire de cette belle paire de jambes qui l’obsédait depuis deux jours.
Les motivations comme ça, ça incite forcément les hommes à avancer.
Et les couleurs vives et piquantes, ça pousse toujours les taureaux à foncer.
2 Chanson paillarde de 1910 interprétée par Charlus.
3 Chanson de 1920 interprétée par Dréan.
4 L’Anschluss ou annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie survenue le 12 mars 1938.
5 Le pangermanisme visait à créer une grande Allemagne en unissant tous les peuples germanophones.
6 Traité de paix entre les Allemands et les Alliés, signé en 1919, après la 1re guerre mondiale, qui a sanctionné fortement l’Allemagne vaincue, jugée responsable du conflit, et lui a imposé des pertes territoriales, économiques et militaires profondes vécues comme un « Diktat ». Les clauses écrasantes de ce traité ont favorisé les idées revanchardes de la cause nazie.
7 Tarascon-sur-Rhône : petite ville du Sud-Est de la France située dans le département des Bouches-du-Rhône et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
8 Ancien château-fort situé à Tarascon, reconstruit au XVe siècle dans un style gothique et renaissance, il est célèbre pour avoir été la résidence de René d’Anjou dit le « bon roi René ».
3
« Allez, remue-toi Mado ! Il faut s’occuper des bêtes. Rejoins-moi dehors ! Maintenant ! »
Francis regarda l’étroite silhouette de sa femme s’éloigner et traverser la cour de la ferme. Les larges et volontaires enjambées de Marthe et la nervosité des mouvements de ses longs membres maigres ou de sa frêle tête grise traduisaient ce matin, non seulement son hyper activité habituelle mais aussi et surtout son humeur excédée. La matinée s’annonçait orageuse et le ciel n’y était évidemment pour rien.
Mado, leur fille, courbée sur une des chaises de la cuisine, enfilait ses souliers sans envie, apparemment totalement sourde aux premiers grondements des bourrasques maternelles. L’opération, pourtant simple, lui prenait un temps que Francis trouvait infini et les coups d’œil inquiets qu’il jetait à l’extérieur lui indiquaient que Marthe avait déjà, et avec une colère non dissimulée, commencé à remplir les abreuvoirs seule.
C’était ainsi, elle ne savait pas attendre. L’inarrêtable Marthe Brun était un vrai cheval de remonte qui ne supportait ni les pas perdus ni les épaules basses. Elle était donc droite et en marche. Toujours. Et ses déplacements ne s’épuisaient jamais en étapes inutiles. Où elle allait, il y avait à faire et par où elle passait, elle découvrait encore et encore à œuvrer.
Francis entendit sa voix tonner au loin – prévalence cinglante dans son tympan droit – et surplomber tout le barouf de son ouvrage.
En réponse à ce cri, les doigts de Mado, lents, volontairement traînants, formèrent la première boucle du lacet.
Ses yeux la jaugèrent. Négativement sans doute, car elle laissa l’ébauche du nœud lui échapper. Recommença.
La grande pouvait bien se déchirer la gorge là-bas ! Ce serait en vain. La Cendrillon du jour n’avait à l’évidence aucune envie de se presser à chausser ses jolis pieds.
Les vaches meuglèrent en franchissant le lourd portail de l’étable et Marthe les accompagna d’un nouveau « Mado ! » tonitruant tout en faisant claquer le plat de ses longues mains sèches contre les croupes solides, là où elle aurait aimé sans aucun doute, voir et cingler la face morne de sa fille. Cette dernière ne s’activa pas davantage et entreprit de serrer mieux, de serrer plus, avant de s’atteler à l’attache de la seconde chaussure.
La tête de Francis dansant la gigue, alternait courbures et torsions. Courbures d’une supplique muette vers l’indocile assise près de lui et torsions inquiètes vers l’exigeante, dehors, dont les notes basses se heurtaient à l’alarme autrement plus grave de ce qui devenait des aigus.
Il savait que quand Marthe haussait le ton il valait mieux écouter. Tout le monde s’accordait à le dire. Pas seulement lui. Ça impressionnait. Elle était ce genre d’énergumène chiche en paroles dont la résonance des éclats ne pouvait qu’ébranler, que laisser penaud et fragile.
Pas pétochard pour un sou, Francis s’avouait pourtant bien volontiers n’être pas très à l’aise avec les emportements de son épouse.
Ils le plongeaient, sans qu’il puisse s’en prémunir tout à fait, dans de piquantes réminiscences de ses fragilités enfantines, quand il blêmissait, garçonnet, de l’humiliation d’avoir été pris en défaut ou d’avoir le nez coincé dans l’angle triste réservé aux cancres, son bonnet d’âne glissant sur son crâne tondu et butant sur ses oreilles en feuille de chou, accentuant ce décollement dont ses copains de classe se moquaient gentiment.
Mado, elle, ne s’émouvait jamais de ça, de ces gueulantes. Et Francis éprouvait pour cette faculté une sorte d’admiration mêlée d’effroi.
Il aurait aimé lui aussi n’opposer toujours qu’un visage indifférent à celui courroucé de sa femme et laisser courir, laisser passer l’averse. Mais malgré l’envie et l’excitation du réel défi que cela représentait, il n’aurait pour rien au monde pris le risque de s’offrir à elle en adversaire. Il n’était qu’un mari. Un peu faible, un peu lâche. Il n’était, également et pour son plus grand drame, qu’un père, construit peu ou prou des mêmes pusillanimités. Une chiffe douce essuyant les plâtres des humeurs et de l’antagonisme constant de ses deux diablesses.
Bien évidemment il comprenait ce qu’elles avaient à se reprocher l’une à l’autre. Il gémissait intérieurement des mêmes complaintes. Mais lui préférait se camoufler derrière sa neutralité.
La façon d’être de Marthe, cette attitude sans nuances qui consistait toujours à soit aboyer soit se museler, n’avait pas grand-chose de surprenant pour qui en faisait journellement les frais. Mais si chez Francis l’habitude n’arrivait jamais à rimer avec je-m’en-fichisme, chez la jeune demoiselle arrogante qui partageait avec lui ce parfois barbant quotidien, c’était tout le contraire. Plus rien ne pouvait la bouleverser.
Mado faisait donc fi autant de la langue acerbe de sa mère que de ses lèvres cousues ; autant de son air revêche que de son hostilité ; autant de ses phrases sévères que de ce rempart de froideur dont elle était précédée en toute occasion et qui la dispensait d’être approchée de trop près par ses congénères ou dérangée par tout ce qui l’insupportait chez eux : leur bêtise, leur futilité, leur vulgarité et tant d’autres choses encore.
Quand Marthe se claquemurait dans la dureté de ses silences, ces silences qui pouvaient être sans fin, abyssaux, Mado exultait. Car cette carte du mutisme jouée si bien et avec tant de réussite, elle était capable d’y recourir aussi.
Et son incroyable talent à l’exercice du « je me tais », ce mimétisme-camouflet intentionnellement utilisé pour attiser et pour singer, poussait une Marthe, désormais arroseuse arrosée, dans des retranchements froissés dont elle ne savait plus trop comment se dépêtrer avec dignité.
Dans ce contexte, les calmes affrontements, sans mots mais presque atrocement hurlants, de la souveraine instigatrice et de sa séditieuse émule glaçaient irrémédiablement l’une et rendaient l’autre plus insolente encore.
Quelques fois, pour ces provocations feutrées mais néanmoins flagrantes, Mado avait reçu des gifles. Quelques fois, elle en avait gardé les traces. Peu lui importait. L’ancienne et sa main si leste vieillissaient chaque jour un peu plus et leurs attaques s’étiolaient un brin.
La môme rétive avait de la finesse et le sens de l’analyse. Elle avait développé ça au cours des heures et des heures qu’elle passait dans cet ennui ou ce désœuvrement que lui reprochait vertement Marthe et qui inquiétaient Francis. Un infime bien dans son grand mal pensait-il. Elle graduait.
C’était une occupation absurde qui insupportait ses parents. Mais elle lui permettait de combler un peu de ce temps interminable dont elle ne savait que faire et qu’elle regardait s’écouler, de longues gouttes en gouttes étirées, dans des monotonies neurasthéniques et des folles lassitudes.
Ce qui était certain, c’est que ce temps passé à penser, à observer, à juger, lui avait permis de comprendre que son aînée, toute rigoriste qu’elle fut, finirait un jour par plier, par capituler et que son incompréhension, après n’avoir été longtemps que colère, se transformerait inéluctablement en fatalité.
« Allez marmousette, va aider maman ! S’il te plaît ! Tu seras tranquille après ! Va vite ! Elle te criera pas après si tu y vas vite ! »
Francis suppliait là où il aurait dû bousculer. Avec ce sourire affectueux, ces phrases cataplasmes qu’il confrontait sans cesse aux dards irrités de ses femelles braquées. C’en était presque risible. Il en était conscient.
Le regard à la fois étonné et plein de pitié que sa fille portait sur son imperturbabilité, sur sa capacité à entrevoir toujours le meilleur en tous et en tout le blessait un peu mais il s’en accommodait. Peut-être l’enviait-elle, elle qui était incapable d’apposer un tel philtre étoilé sur les êtres et les choses, mais il sentait qu’elle ne l’admirait pas pour autant. Et le peu de douceur qu’elle accordait à sa mère n’était pas redistribué plus favorablement au compteur de son père.
Comme Mado, Francis était un excellent observateur. Il décodait vite ce qui pouvait se dissimuler derrière un comportement. Il comprenait donc sans peine les capacités qu’avait Mado à disséquer les outrances de Marthe ou ses propres faiblesses. S’il regrettait de ne pas lui avoir légué sa propension au bonheur, il se félicitait au moins de lui avoir transmis son discernement. Il savait que ce don, car c’en était bel et bien un, pouvait se révéler utile et ce, dans un grand nombre de situations. À lui, personnellement, il avait même sauvé la vie !
C’était, s’en souvenait-il, dans les fosses excavées des tranchées de la Grande Guerre, c’était dans des coulées de boue et de tirs ennemis, là où il avait su lire l’effroi et l’abandon dans la bête sale créée par la communion des corps ou la fierté de se battre jusqu’à la mort dans l’affût du dernier soldat debout.
Il avait toujours déchiffré pour sa survivance tout ce qu’un regard pouvait détenir de peurs, de questions et de requêtes. Tout ce que la position d’un homme, la courbure de sa nuque ou le clignement de son œil pouvaient exprimer quand les mots n’avaient plus de place, quand leurs sons pouvaient vous condamner, vous transpercer, ou qu’ils s’évanouissaient dans le tumulte des combats.
Il avait appris des heures sans bruits qui précèdent l’aurore et le branle-bas des nouvelles offensives, du bruissement, des murmures, que le vent rapportait des terriers adverses et qui disaient la vigueur ou la fatigue de ces étrangers contre lesquels se battre.
Il avait appris des animaux. Des rats. De leur ruse et de leur assurance, de leur immonde appétit pour la chair morte mais encore tiède des humains sacrifiés. Mais cette leçon-là, ignominieusement ancrée dans ses pires cauchemars, il avait fait le choix de refuser d’y penser trop.
Il préférait se souvenir des chiens mascottes, pareils aux braves patauds de son enfance, de leurs yeux doux et de leurs truffes humides, des mulets et de l’odeur de leur pelage qui le transbordait immanquablement dans les pattes consolatrices de ses propres troupeaux.
Il s’était toujours senti proche des bêtes. Comme lui, elles sentaient, pressentaient. Et elles l’exprimaient si bien pour peu que l’on soit assez instinctif soi-même pour interpréter leurs signes et leurs alertes.
Alors même si les deux bourriques qui vivaient sous son toit étaient des taiseuses, il savait bien mieux lire en elles que si elles avaient aligné tous les discours du monde. Qu’elles ne s’entendent pas l’attristait vraiment, mais il n’était pas du genre à longuement s’arrêter sur ses chagrins, quels qu’ils soient. Le monde au dehors était dur et il catalysait les grands inévitables tourments. La vie, il en avait tant de fois soupesé l’importance. Elle ne méritait vraiment pas qu’on se la gâche avec des broutilles.
Il se contentait donc de les distraire l’une ou l’autre de leurs querelles, sacrifiant parfois sa tranquillité pour s’offrir sciemment en cible détournée au courroux de Marthe ou aux bouderies de Mado.
Certes sa tendre moitié l’était peu (tendre), et se montrait souvent incommode, mais en contrepartie elle avait toujours été si forte et si courageuse. Mado refusait de voir ça. En était-elle capable d’ailleurs ? Ou alors était-elle trop ingrate pour accepter de le faire ? Mais lui savait. Sa bonne Marthe avait tout déroulé pour lui. Tout tracé. Tout égalisé. Qu’aurait-il fait sans son indéfectible soutien?
Quand jeune marié déjà âgé de vingt-huit belles années, il avait été appelé au front et en était revenu lourd de traumatismes et plus léger d’un œil, Marthe l’avait attendu, s’était occupée de toutes ses blessures et les avait pansées avec, sans doute aux yeux des autres, peu de chaleur apparente, mais avec une poigne rassurante mais affectueuse au fond et une fermeté de maîtresse-femme imposant au héros éreinté et cassé qu’il était, le repos mérité du guerrier.
Malgré le cache-œil sur son œil désormais lactescent et figé, Francis était clairvoyant. Sa compagne était une vraie partenaire, stable, rassurante et ils s’aimaient profondément mais à leur façon, elle encellulée dans la raideur habituelle, mais férocement protectrice de son rôle d’épouse, lui ouvert à tous les vents frais qui s’offraient aux hommes libres.
Car oui, il se sentait libre. Sa ferme était le seul endroit où il avait envie de vivre. Il y avait les champs, le ciel, les bêtes. Un homme heureux n’avait pas besoin de plus. Il avait l’immensité face à lui, verte, bleue, mouvante. Il n’avait qu’un œil pour en profiter. Mais un œil, c’était mieux que pas du tout. Et sa liberté était toute là. Posséder, profiter de ce qui était à lui et pouvoir le voir encore.
Il aurait aimé avoir un garçon à qui transmettre ses terres et l’amour qu’il leur portait. Mais le destin en avait décidé autrement.
Mado était leur seule enfant. La seule en tous cas qui ait réussi à s’accrocher jusqu’à terme à l’utérus aussi hautement sollicité que défaillant de Marthe.
Elle était arrivée comme en retard pour eux, quatre ans après la fin de la guerre, quatre ans après le premier d’une longue liste de bébés avortés ou mort-nés, quatre ans après que les premiers grignotis du temps aient commencé à mordre les traits d’une Marthe qui ne s’était jamais vraiment sentie jeune et que l’accablant constat de cette nouvelle disgrâce confortait dans l’instauration d’un assombrissement précoce.
Et s’ils avaient vécu la venue au monde de leur poupée menue aux grands yeux noirs comme une réelle victoire, sa naissance avait été aussi entachée des douleurs d’un lourd passif de renoncements et de défaites.
Il n’en avait jamais parlé à Marthe – elle aurait balayé ses inquiétudes d’une moue et d’un revers de main méprisants, elle la rationnelle douée d’une volonté d’avancer tête baissée quoi qu’il advienne sans jamais s’appesantir sur le cruel bourrèlement des réflexions stériles – mais il s’était persuadé en son for intérieur que, malheureusement, ce nourrisson résistant mais tardif avait dû ressentir la tiède et ambivalente joie de leur accueil.
Francis aimait sincèrement et tendrement sa petiote et il essayait de la comprendre, même si cela ne l’empêchait pas d’être lucide sur les défauts qu’il refusait de concéder aux critiques permanentes de Marthe.
Il voyait bien que Mado était depuis toujours renfrognée, molle, languissante, sans volonté, fainéante, inintéressée et, il s’en rendait compte, inintéressante. Mais n’était-ce pas en réaction aux bouleversements ambigus de sa naissance ?
Ne leur reprochait-elle pas de n’avoir pas assez donné d’importance à cette réussite qu’elle représentait ?
De n’avoir pas assez fêté sa vie, éclatante et nue, surgie sous les cendres d’aînés inaboutis ?
À seize ans, l’âge où l’enfance vibre encore dans un corps de femme faite, elle souriait peu, parlait peu, s’occupait peu.
Elle ne s’intéressait pas au travail agricole. Elle trouvait les animaux sales ou effrayants.
Elle ne s’émerveillait jamais aux beaux paysages, ni aux couleurs que le jour radieux ou la nuit tombante faisaient couler en seaux le long des vallées et des plaines.
Elle n’aimait rien.
Faisant peu et toujours sans envie.
Un jour, Francis l’espérait pour la ferme, il l’espérait aussi pour Mado, un jeune homme plein de nobles ambitions viendrait lui demander la main de sa fille. Il la lui accorderait et lui apprendrait à gérer le domaine afin de le lui laisser plus tard, quand Marthe et lui seraient allongés en paix au petit cimetière du village, sous cette stèle où les noms de son père et de son grand-père étaient gravés et près de laquelle s’épanouissaient les parfums sucrés des grappes mauves d’une glycine centenaire.
Il espérait surtout que le garçon serait assez épris pour ne pas trop compter sur le courage de sa future et assez acharné pour trimer pour deux. Ou alors qu’il aurait assez de poigne et de virilité pour lui dessiner une conduite et peut-être, si Dieu le voulait, l’ébauche d’un sourire.
Francis le déplorait, la seule chose qui semblait égayer Mado et allumer un peu de lumière et d’éclat dans ses ténébreuses prunelles c’était des bêtises de magazines féminins. Et ces futilités-là ne poussaient guère au labeur.
Elle pouvait passer des heures plongée dans son satané Midinette9 et ses romans-feuilletons. Une activité de paresseuse sermonnait Marthe. Et non sans raison !
Francis qui avait grandi et toujours vécu avec des dures à la peine trouvait l’inaction de sa drôlesse étrange et irrespectueuse, mais sa douceur et ses âcres remords de père sans doute imparfait, l’incitaient à la compréhension et à la résignation. Lui le guerrier, le brave à trois poils10, n’était pas homme de conflits domestiques. Sa femme bataillait suffisamment pour deux.
Francis se souvenait encore de ce jour où Marthe était rentrée du village sans le fameux journal. Du panier vidé, fouillé, retourné cent fois par une Mado éperdue. De son air terrible. De son regard halluciné. De sa main blanche à force d’être restée crispée sur les un franc vingt-cinq retrouvés inutilisés. Cette main contractée à l’extrême qu’ils avaient dû ouvrir, Marthe et lui, doigt par doigt, millimètre par millimètre, pour en extraire les pauvres pièces qui commençaient à bouillir sur la chair fine de la paume, là où les ongles pourtant courts de Mado avaient creusé de petits arcs rouge sang.
Il n’y avait pas de Midinette au kiosque ce matin-là. Tout avait été vendu. Rien de si grave en l’occurrence.
Pourtant Mado avait mis longtemps à revenir à elle, à se départir de ce voile somnambulique et de ces sanglots lourds qui les avait tant effrayés. À comprendre où elle était et avec qui. À expliquer son trouble. Une gifle nécessaire l’y avait aidée.
« Tout ce cirque pour du papier, lui avait crié une Marthe plus inquiète qu’irritée, en lui collant une seconde fois sa main ferme et rude sur la joue. Oh Bonne Mère, tu es complètement folle ma pauvre! »
Oui, ils s’étaient vraiment posé la question ce jour-là. Sur sa déraison. Marthe et lui. Sans s’en parler. Mais les regards rivés et les silences choisis des vieux partenaires savent communiquer, souvent, mieux que des mots.
Et Francis n’avait pu que constater, les jours suivants, que sa femme avait prié plus que de coutume, elle qui ne fréquentait plus l’église par aversion pour ses fidèles mais qui vouait une passion sans bornes à la Vierge, sainte idole de tous les croyants.
Depuis lors, Mado, qui avait toujours rechigné à aller aux commissions, réclamait à corps et à cris de s’y rendre. Les vendredis particulièrement, jour de parution de son Midinette et aux aurores. Mais les autres matins également, par précaution, par méfiance envers l’inconséquence de ses parents, envers la légèreté des imprimeurs, des livreurs ou celle du marchand de journaux.
Elle prenait aussi plus grand soin de tous les anciens exemplaires qu’elle possédait. Les caressant du bout des doigts après les avoir déployés face à elle comme les lames d’un éventail. Les regardant comme les trésors qu’ils étaient devenus, plus que jamais.
Lorsque Francis l’observait dans cette étrange cérémonie, il avait la sensation qu’il lui était impossible de continuer sans eux, qu’elle se remplissait les poumons, qu’elle se remplissait le cœur, qu’elle pompait la vie, figée et parfaite, qui irradiait de ces pages glacées. La vraie vie. Celle que Mado appelait de tous ses vœux. Pas celle, insipide de leur pauvre réalité.
La vraie vie oui ! Un rêve pourtant, puisé dans les visages si beaux, si apprêtés et si gracieux des couvertures.
Dorothy Lamour, Paulette Dubost…
Simone Simon11 surtout.
Un gars du village voisin qui était venu un jour acheter un lapin et quelques légumes pour son repas du dimanche avait eu la bêtise de leur dire, après avoir vu Simone Simon au cinéma, que Mado ressemblait à la jeune première.
Et depuis, Francis surprenait sa morveuse postée devant les miroirs, le magazine près de son visage, comparant ses traits à ceux de l’actrice.
C’était sans doute un joli brin de fille que la sienne. Il ne s’était jamais appesanti sur ces considérations auparavant.
Lui qui ne jugeait le physique des représentantes de l’autre sexe qu’à l’aune de leurs capacités à traire ou à biner, n’avait toujours vu que la robustesse de Mado, celle qu’elle tirait de sa génitrice malgré une carcasse moins fine et plus harmonieusement bâtie. Aujourd’hui, qu’il réalisait que robuste ne rimait pas avec laborieuse, il ouvrait les yeux sur Mado telle qu’elle voulait qu’on la voie : une Simone Simon à la moue boudeuse, aux pommettes hautes, aux paupières lourdes. Et après ?
Quand le bras de Mado laissait retomber le magazine et que le décor familier réapparaissait dans le miroir à la place du beau visage si parfait de la comédienne, le chagrin, l’abattement, l’ennui revenaient immanquablement et l’insatisfaite retournait errer dans la maison sans but, laissant passer à travers elle le bon sourire de son père ou l’air pincé de sa mère.
Marthe savait l’envoyer curer le lisier des cochons dans ces moments-là, pour lui remettre les idées en place disait-elle. Elle lui serinait aussi, non sans un certain discernement, qu’ici on pouvait être beaucoup de choses : vendangeuse, cueilleuse, bergère, vachère, cuisinière, ravaudeuse, rempailleuse et tant d’autres choses encore, mais que l’on ne pouvait pas devenir ce que personne d’autre avant nous n’était devenu.
Pourtant Marthe se trompait. Et Francis n’osait pas le lui dire. Elle, plus que tout autre, aurait dû se rappeler que leur fille était déjà ce qu’aucun avant elle n’avait réussi à être !
Leur enfant ! La seule concrétisation de tant de fécondations infructueuses. Leur unique ! Celle que le cruel sablier du temps avait menacé de ne plus pouvoir leur promettre.
Mado aspirait à être différente d’eux, différente de tous, mais elle l’était peut-être après tout ! Pourquoi se sentait-elle ainsi prise au piège dans ce coin qu’elle jugeait paumé et qu’elle n’avait jamais aimé, entourée de ces gens qu’elle estimait tous identiques, avec les mêmes discussions, les mêmes habitudes, les mêmes limites ? Pourquoi, si elle n’était pas un peu à part ?
Sur les bancs de l’école communale déjà, elle rejetait les fondements de ce qu’elle entrevoyait comme une ennuyeuse unité et les autres gamins se tenaient à distance d’elle. Francis aurait dû s’inquiéter de sa solitude à ce moment-là. Mais il avait choisi de se voiler la face en arguant que cela n’avait pas d’importance, que leur ferme était trop éloignée pour que les enfants aient pu prendre l’habitude de jouer ensemble, que les amitiés se créaient bien plus facilement entre ceux qui partageaient non seulement la même cour de récréation, mais aussi les mêmes jeux sur la place ou dans les rues. Et puis simplement, Mado était la fille de sa mère. Les chattes dominantes et austères donnaient rarement naissance à des chiots sociables et folâtres non ?
Il n’y avait cependant pas que de la réserve de Marthe en Mado. Il y avait plus que cela.