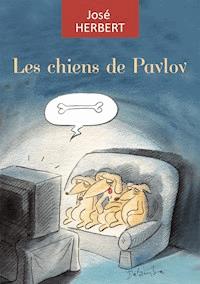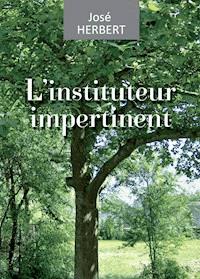
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: José Herbert
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L’auteur partage avec nous des récits de vie emplis d’émotions à la fois tendres et piquants
Instituteur et secrétaire de mairie pendant presque 30 ans, José Herbert nous livre ses souvenirs sur un ton à la fois drôle et tendre, toujours sincère, souvent impertinent...
Vivez avec lui au rythme de Wambaix, un petit village du Cambrésis... Allez à la rencontre de personnages pittoresques, sympathiques, attachants... Éprouvez les joies et les peines des enfants à l'école, ses « petiots » comme il les appelle... Fâchez-vous comme l'homme et l'instituteur libre et volontaire qu'il a été...
Au fil des pages, retrouvez finalement un peu de vos propres souvenirs d'enfant...
EXTRAIT
Presque cinq ans après le dernier jour de classe en juin 2001, l’école et son environnement hantent encore de façon récurrente certaines phases de ma vie nocturne.
Instit je fus, instit je resterai jusqu’à mon dernier souffle. Si dans la journée je suis à peu près tranquille de ce côté-là, les souvenirs s’emparent de mes nuits, qui devraient pourtant être paisibles étant donné ma situation de retraité coulant des jours heureux après une vie bien remplie. Au contraire, au milieu des brumes et du silence nocturne, je me revois souvent dans les situations qui furent les miennes pendant presque quarante ans : la classe, les élèves, les difficultés à se faire entendre et pire encore, à se faire comprendre... Curieusement les scènes qui peuplent mes nuits ne sont pas celles qui furent les plus faciles. Mesdames et Messieurs, les psys pourraient assurément expliquer tout cela… Moi pas !
À PROPOS DE L'AUTEUR
José Herbert a suivi une carrière d'instituteur primaire, après laquelle il s'est officiellement lancé dans l'écriture. Il compte plusieurs ouvrages à son actif, notamment
La messe bleue et
Le dernier jour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Vanité des vanités, et tout est vanité.
L’Ecclésiaste.
De l’utilité d’avoir un nom !
Presque cinq ans après le dernier jour de classe en juin 2001, l’école et son environnement hantent encore de façon récurrente certaines phases de ma vie nocturne.
Instit je fus, instit je resterai jusqu’à mon dernier souffle. Si dans la journée je suis à peu près tranquille de ce côté-là, les souvenirs s’emparent de mes nuits, qui devraient pourtant être paisibles étant donné ma situation de retraité coulant des jours heureux après une vie bien remplie. Au contraire, au milieu des brumes et du silence nocturnes, je me revois souvent dans les situations qui furent les miennes pendant presque quarante ans : la classe, les élèves, les difficultés à se faire entendre et pire encore, à se faire comprendre… Curieusement les scènes qui peuplent mes nuits ne sont pas celles qui furent les plus faciles. Mesdames et Messieurs, les psys pourraient assurément expliquer tout cela… Moi pas !
Pourquoi ce désir soudain de retour en arrière ? Pour faire comme tout le monde : raconter ma vie ? C’est tellement tendance, selon l’expression consacrée ! L’inconvénient est que ma vie est très ordinaire : pas de problèmes familiaux, pas de déviations sexuelles, à ma connaissance, pas d’aventures loufoques, pas de mariages multiples, rien qui puisse intéresser notre sphère… disons… médiatique. Le mot est lâché : médiatique. On constate que chaque feuille du calendrier, outre le saint patron du jour, révèle en effet son lot de nouveaux écrivains. Ecrire est donc si facile ! Il suffit, me semble-t-il, d’avoir un nom. Le secret est là. Ensuite, si l’on ne peut espérer avoir le génie d’un Victor Hugo ou d’un Balzac, qu’à cela ne tienne ! Certains individus se sont fait une spécialité de ce nouveau métier consistant à écrire à la demande de celui qui aura son nom écrit en majuscules sur la couverture. Le bébé ainsi conçu se vend bien en général. Ecrire est donc devenu un moyen comme un autre de se faire une petite fortune, sans trop de difficultés, à condition bien sûr d’avoir…un nom, ce que je n’ai point, hélas, sorti d’un petit village de 350 habitants où j’ai exercé mon métier pendant plusieurs dizaines d’années.
Je me suis aperçu de la supercherie médiatique, une fois de plus, quand, ne sachant que faire un dimanche de mauvais temps, j’attaquai à belles dents une œuvre littéraire signée par l’un de nos grands comiques, connu comme le loup blanc. J’espérais ainsi passer deux ou trois heures de façon agréable, oubliant la grisaille qui sévit parfois de longs jours et de façon pesante sous nos latitudes.
Dès que j’eus parcouru les premières pages du torchon, avalé finalement en une heure, la déception fut au rendezvous. Verdict : nul à pleurer ! Très peu de pages, mal écrites, sans intérêt, sans histoire, sans trame, sans rapport avec le titre accrocheur, évidemment !
Des tranches de vie ordinaires mises bout à bout sans cohérence aucune ! Je me suis dit que l’escroquerie n’était pas loin. Heureusement, et cela me rassura, je n’avais point dépensé un centime pour acquérir ce chef d’œuvre, tandis que d’autres- des dizaines de milliers de personnes sans doute – alléchés par le nom très connu de ce monsieur et la publicité style bourrage de crâne faite autour du livre dans tous les médias du pays, ont voulu se repaître de ce que racontait le grand homme, par ailleurs excellent humoriste à mon humble avis.
À la sortie de l’ouvrage événement en question, l’écrivain (est-ce le mot qui convient ?) dont il s’agit était bien évidemment omniprésent sur nos chaînes de télévision, quotidiennement invité par des présentateurs mielleux et hypocrites dont on se demande s’ils n’ont pas un intérêt financier à la chose, percepteurs qu’ils seraient de quelques sous sur chaque exemplaire vendu.
Non, ce n’est pas l’appât du gain qui me pousse à malmener le clavier de mon ordinateur. Cherchons plutôt du côté de la peur, la terrible peur de vieillir qui assaille tout être normalement constitué. La vieillesse dans laquelle je viens à l’instant d’entrer de plein pied, est responsable de cette boulimie.
Qui ne craint la misérable est un inconscient ! Je le crie haut et fort ! Chaque jour qui passe m’informe des désastres irréversibles causés par la traîtresse. La peur de perdre la mémoire qui l’accompagne, est présente à mon esprit. Je ne veux oublier pour rien au monde les multiples pièces qui, posées avec soin, ont constitué le puzzle de ma vie professionnelle. Les écrire, c’est les fixer à tout jamais dans la mémoire. Le véritable ciment qui rassemble mes souvenirs, ce sont les portraits de personnages typiques et les situations cocasses ayant souvent accompagnées les méandres de mon parcours. Celles-ci ou ceux-là provoqueront de la sympathie, ou une aversion légitime : il faut de tout pour faire un monde !
Une collection de plusieurs tomes me sera sûrement nécessaire pour coucher sur papier les pensées que je traîne depuis si longtemps, à travers le filtre de mes soixante et un balais et de ma carrière d’instituteur secrétaire de mairie dans un petit village du Cambrésis.
Ce fut le déclic. Le soir même je pris le stylo ou plutôt le clavier de l’ordinateur et m’attelai à la tâche. « À cheval ! » me dis-je en cherchant le premier mot de mon récit. J’ai utilisé cette expression à maintes reprises pour signifier à mes élèves, attentifs devant leur maître d’école, qu’il était temps de commencer le travail que je leur avais proposé. Je la destinais maintenant naturellement à moi-même.
Premier contact
J’exerçais, de septembre 1964 à juin 2001, un métier que j’ai qualifié à une certaine époque de métier de fou ! D’abord instituteur dans le Douaisis, Vred puis Auberchicourt, je fus contraint, en 1975, de participer au « mouvement » des enseignants du département du Nord. En effet, l’administration supprimait l’une des dix-huit classes de l’école primaire publique où je pratiquais mes talents d’instit de cours préparatoire. En vertu du principe qui veut que « le dernier arrivé dans un établissement soit le premier à partir », je sollicitai et obtins une place de directeur d’école primaire dans le Cambrésis à partir de septembre 1975. C’est ainsi que, de la condition de citadin, je passai à celle de citoyen rural ou villageois, à Wambaix, 350 habitants, canton de Carnières et arrondissement de Cambrai. Dès mon installation au village, le greffier de la mairie, ancien directeur d’école, désireux de faire valoir ses droits à la retraite, me proposa sa place au greffe de la commune. J’acceptai et pris de cette façon racine, à la rentrée scolaire de 1976, dans ce coin non dénué de charme de la campagne française.
L’école dont j’avais la responsabilité n’avait que deux classes, celle des petits et celle des grands et n’acceptait les enfants qu’à partir de cinq ans. Puis ce fut quatre ans, trois ans et même deux ans, pour conserver un effectif raisonnable de trente à trente-cinq élèves bon an mal an.
Le logement de fonction qui me fut attribué, était délabré, froid et humide. Pas même les toilettes à l’intérieur lorsque nous avons emménagé. Les canalisations d’eau gelaient pendant l’hiver. De la glace ornait les vitres des chambres à coucher. Situation que beaucoup de collègues ont connu, car les logements de fonction ne sont, la plupart du temps, hélas guère entretenus. Manque de moyen de la part des communes ? Non. Manque de volonté de la part des édiles ? Oui, sans aucun doute.
J’ai quitté ce palais en 1983 pour habiter un pavillon que nous avions fait construire, ma femme et moi, dans… le même village où nous sommes toujours installés. Autrement dit, je fus à l’école en tant que directeur de l’établissement scolaire, au bureau de la mairie comme secrétaire et chez moi, à Wambaix, troisième facette du personnage, le civil, le privé, l’homme de la rue, monsieur tout le monde. Privé certes, mais surveillé. Comment peut-il en être autrement ? Le people rural ou villageois n’est pas un vain mot. Il donne matière à commentaires derrière les rideaux des chaumières, au sortir de la messe ou au comptoir de l’unique estaminet, Chez Agnès. La conséquence principale est que je devais prendre garde d’avoir une vie publique wambaisienne exemplaire, m’interdisant les excès et les écarts de conduite, surtout visibles. C’est normal ! Au dix-neuvième siècle, l’instituteur n’avait pas le droit de fréquenter les cabarets, déclarés lieux de perdition. Je n’en étais pas là, quoique…
Le jour de mon arrivée à Wambaix en août 1975, la porte du préau de l’école nous fut ouverte par le garde-champêtre, Guislain, afin que nous puissions débarrasser le coffre de la voiture des premiers objets que nous déménagions. Monsieur Guislain assista à notre déballage jusqu’à son terme, d’un œil bizarre, me semblait-il, soupçonneux, méfiant, interrogateur, sévère peut-être, vu sa fonction. Il ferma ensuite lui-même l’accès au préau. Ce premier contact nous parut glacial. Nous venions de la ville et ignorions totalement qu’à ses portes, certains individus avaient la fonction, comme au temps passé, de garder les champs de la France profonde. Le Douaisis, où nous avions passé la presque totalité de notre vie jusque là était beaucoup plus convivial que cette terre agricole et cléricale du Cambrésis, pourtant limitrophe. Nous avons constaté, dès ce premier contact qu’il n’est pas facile de se faire adopter dans un si petit village. Longtemps, ma femme et moi, sommes restés les étrangers. Cela n’était pas dit ouvertement, mais clairement ressenti !
Quelque temps plus tard, comme le veut l’usage, il me revint de rendre visite au maire de la commune. Visite de politesse et de courtoisie. Monsieur Banse m’accueillit chaleureusement dans la salle à manger du bâtiment principal de son exploitation agricole. La conversation fut dès le départ très difficile car Monsieur le Maire parlait un patois qui m’était totalement inconnu, le patois de Wambaix. Cambrésis et Douaisis sont proches et pourtant si différents. D’autre part, Monsieur le Maire mangeait à belles dents la moitié des mots qu’il prononçait. Par la suite je me suis habitué au dialecte, mais sur le coup, j’ai cru comprendre qu’il me demandait si je pouvais diriger la construction d’une salle des fêtes, le milleclub, que la commune avait reçu il y a longtemps déjà et qui pourrissait en pièces détachées dans la grange d’un agriculteur conseiller municipal. Monsieur le Maire pensait qu’il fallait quelqu’un d’intelligent pour comprendre les multiples plans qui accompagnaient le puzzle de la salle des fêtes. Et qui pouvait être plus intelligent que ce jeune instituteur venu de la ville, avec l’air sympathique et compétent au premier abord ? J’ai donc donné mon accord, bien que sachant à peine tenir un tournevis. On ne peut rien refuser à Monsieur le Maire !
La construction du zénith villageois débuta en juin 1976, année de la terrible canicule. Effectivement, je dus lire des plans et diriger toute une équipe de bénévoles qui s’affairaient sur le site, chaque soir de ce mois au climat tropical. L’ambiance conviviale fut ponctuée de visites des mêmes bénévoles au café d’Agnès la cabaretière car il faisait très chaud et comme chacun sait, chaleur rime avec soiffeur. Je n’étais point habitué à ce comportement et refusais les verres que l’on me proposait, méprisant la bière de luxe et autre pastis dont l’odeur empestait l’haleine de nos ouvriers bénévoles.
Fier comme Artaban, je pris donc la direction de la petite école à deux classes dès la rentrée de septembre 1975. Le premier élève qui se présenta, avec sa maman, pour s’inscrire dans la classe des petits avait cinq ans et se prénommait Laurent. La mère et l’enfant prirent place devant le bureau sur les chaises que je leur présentais. Tout le monde était évidemment intimidé. A l’époque, l’instituteur du village inspirait encore le respect. L’instituteur en question était lui aussi intimidé, c’est normal, mais bien sûr, il ne laissait rien paraître. Je m’aperçus rapidement que le pauvre gamin, affublé par ailleurs d’une timidité maladive, ne voyait presque rien. J’informai la famille qui prit les dispositions nécessaires auprès de l’oculiste. Actuellement, Laurent est presque aveugle. Le papa que je rencontre souvent, m’informe de son état.
Quelques semaines après la première rentrée de septembre, je dus subir une remarque désobligeante de la part de Monsieur le Maire : « Quelqu’un m’a dit que c’était dommage de chauffer les classes alors que vous laissez une fenêtre ouverte dans la journée. » Je dus expliquer à Monsieur le Maire que nous respirions toute la journée un air confiné et pollué par la présence d’une vingtaine de personnes vivant dans un lieu fermé et que par hygiène, il convenait d’aérer le local afin de faire fuir les miasmes porteurs de germes en tous genres. Monsieur le Maire sembla convaincu par mes explications mais à partir de ce jour, je fermai la fenêtre visible de la rue et… j’ouvris la porte qui donnait sur la petite cour intérieure.
Plantons le décor
En 1975, à Wambaix, nous n’avions pas encore quitté le 19ème siècle. Imaginons un village traversé par une chaussée grossièrement pavée, pourtant route départementale, véritable cloaque pendant l’hiver, océan de poussière sous les chaleurs de la belle saison. Les bordures de la chaussée sont inégales et les trottoirs boueux ou poussiéreux, selon la météo. Les maisons sont comme dans tout le Cambrésis, perpendiculaires à la chaussée. Ce sont d’anciennes petites fermes, sans étage, en briques rouges, d’allure médiocre pour un certain nombre d’entre elles. Jadis, deux pièces composaient le logement de part et d’autre d’une petite entrée menant à la cave et au grenier. Depuis, les propriétaires ont agrandi les maisons avec plus ou moins de bonheur et enduit de crépis qui enlaidit souvent l’ensemble en lui ôtant à jamais le caractère historique attaché aux vieilles pierres.
Les bâtiments communaux, école et logement de l’instituteur datent aussi du siècle précédent. Ils ont été mal entretenus. Les boiseries pourrissent. Le mortier qui devait à l’origine tenir les briques part en poussière. Les toitures du presbytère et de l’église laissent passer la pluie. Il pleut sur les fidèles le dimanche matin mais ceux-ci ne se plaignent guère, se bousculant même pour se placer sous les gouttelettes qu’ils savent tombées tout droit du giron divin. Le bâtiment cultuel, bâti à la fin du 18ème, menace de tomber en ruine. Une fissure inquiétante zèbre la construction derrière le chœur. L’oculus situé juste au-dessus du portail d’entrée s’incline dangereusement vers l’avant et attend sa proie pour l’assommer le moment venu. Avouons cependant que mourir sur le porche d’une église serait une fin souhaitée par beaucoup de monde. Passer directement de la vie sur terre au paradis céleste, sans même s’arrêter sur la case souffrances, est un sort enviable de nos jours.
Le château d’eau, lui aussi, est fissuré et l’humidité suinte en permanence de cette longue et fine plaie qui ne veut pas cicatriser. Le bâtiment nous distribue une eau souvent impropre à la consommation car porteuse de colonies importantes de streptocoques fécaux, faute de javellisation efficace.
Le réseau d’éclairage public laisse persister des trous noirs dans toutes les rues, causant la colère des riverains qui, même s’ils ne sortent plus après six heures le soir, exigent que leur portail soit sous les feux de la fée électricité.
Les fils d’eau sont sordides car l’assainissement est un concept inconnu au village. Chacun envoie au caniveau des eaux sales qui véhiculent quelquefois les cheveux des fonds de baignoire, les pâtes et les restes des repas, nourrissant de cette façon la faune sauvage des rues et se transformant en plaque de verglas l’hiver à la grande joie des petiots qui découvrent alors les joies du patinage artistique.
Il n’y a pas de collecte régulière des ordures ménagères. Ce sont les conseillers municipaux, aidés de Guislain, le garde-champêtre, qui prennent en charge ce service. Environ une fois par mois, à condition que la météo soit clémente, c’est-à-dire qu’une pluie continuelle n’ait point rendu les chemins boueux, les élus, avec tracteur et remorque, investissent les rues du village, ramassent les sacs puants contenant les ordures et vont porter le tout à la décharge municipale située hors des murs du village, comme le cimetière, dans le chemin qui fut jadis, paraît-il, emprunté par la carriole du grand Fénelon, archevêque de Cambrai en 1695, prélat, orateur et grand écrivain français.
La décharge municipale, où s’accumulaient depuis des décennies les ordures de la civilisation, est évidemment illégale et donc interdite. Un jour, la commune, mise à l’index, fit venir de la ville un savant hydrogéologue. Celui-ci, après avoir sondé le site pollué, déclara que tout allait bien et qu’il convenait maintenant de planter sur les lieux des arbres à feuillage persistant. Ce qui fut fait. Depuis ce temps, les habitués du parcours du cœur, dans leur randonnée annuelle, ainsi que les enfants de l’école que le maître fait marcher, ne se doutent point que les arbres qu’ils frôlent de leur pelisse puisent leur force dans les détritus, les plastiques et les carcasses de voitures rouillées. Ainsi va la nature, ainsi vont les choses.
Voilà donc à quoi ressemblait la vie quotidienne dans un village quelconque du Cambrésis il y a une trentaine d’année.
Rassurez-vous, de nos jours, aux premières heures du vingt et unième siècle, ce même village, sous l’action des municipalités successives et de « l’air du temps », est devenu heureusement, comme la plupart des villages, un endroit où il fait bon vivre, comme il est dit dans les discours, paisible, propre et offrant à sa population tout le confort moderne : collecte hebdomadaire des ordures avec tri sélectif, gaz naturel, eau potable, assainissement, lampe au sodium dans les lampadaires, voirie correcte, internet haut débit, bâtiment scolaire rénové. Que demander de plus ?
La cour d’école est la place du village
Revenons en 1975. En août, nous installons nos meubles dans l’immense logement de l’école, dont les plafonds culminent à trois mètres cinquante, glacial en hiver, frais en été. Les toilettes sont à l’extérieur. Des glaçons, au plus fort de la saison froide, garnissent la salle de bain. Il me faut purger les canalisations le soir pendant les temps de très grand froid. Des fleurs de gel décorent les vitres de la chambre à coucher et dégoulinent après quelques heures de fonctionnement du radiateur électrique. D’énormes araignées sont à l’affût derrière les rideaux et sous le canapé, surtout en septembre. Ces horribles bestioles, les tégénaires, courent sur la moquette le soir quand nous regardons la télévision et font hurler de peur notre fille Sylvie.
Quelques mètres derrière le logement se trouve l’école à deux classes : la classe des petits et la classe des grands. Les urinoirs des petiots sont à l’extérieur aussi. L’odeur qui s’en dégage au printemps ne gêne personne, semble-t-il. Un petit préau censé protéger des intempéries est tellement bien conçu qu’en temps de pluie une énorme flaque persiste sur le sol. Ce défaut et son exiguïté font que nous ne sortons en récréation que s’il ne pleut pas. Les classes, sales et poussiéreuses, ne sont nettoyées que lors des vacances : Toussaint, Noël, février, Pâques et été. Chaque soir, la femme de service vient donner en vitesse un coup de balai et remuer la poussière. J’ai appris plus tard qu’elle était payée une misère par la commune.
Il m’a fallu des années pour parvenir à changer les choses. De nos jours, les classes sont lavées chaque soir et époussetées de temps en temps. Des sanitaires jouxtant la classe des petits ont été construits et, luxe suprême, les petiots peuvent se laver les mains avec de l’eau chaude. On n’arrête pas le progrès !
La mairie est à quelques mètres de distance, devant le logement de l’école. Des fenêtres du bureau du secrétariat, j’aperçois mon habitation. Difficile également d’avoir un local propre ! La poussière et l’humidité sont omniprésentes. Malheureusement, cette atmosphère polluée ne convient guère à l’ordinateur. Celui-ci, de temps en temps, tombe en léthargie. Il me faut alors pousser le radiateur électrique à fond afin d’assécher les neurones de l’animal qui finalement consent à repartir.
Situation unique en France : la cour d’école est aussi la place du village, devant le logement. Vingt-cinq mètres sur quinze. Pas de clôture ! Les véhicules de la civilisation circulent de chaque côté. Evidemment ma collègue et moi étions en permanence sur le qui vive lors des récréations, car il fallait surveiller les enfants tentés de circuler autour des arbres qui bordaient ce lieu. Quelquefois nous sortions des classes et nous trouvions dans cette cour ouverte des voitures garées, notamment les jours d’enterrement car l’église était toute proche. Cette cérémonie attire au village beaucoup de monde car c’est le lieu par excellence où l’on doit se montrer. Les gens se garaient là sans savoir qu’ils étaient aussi dans la cour de récréation. Certains retrouvaient, à la fin de l’office, leur véhicule entouré d’une kyrielle d’enfants et d’un maître d’école qui les obligeait à s’écarter pour que le conducteur, ébahi, puisse quitter cet endroit probablement hors normes.
D’autre part, combien de fois ai-je du poursuivre un chien qui traînait dans la cour, à moitié fou quand il apercevait les enfants autour de lui, impatient de jouer et de batifoler ! L’employé communal était chargé de ramener le gentil toutou à ses maîtres en leur demandant de veiller à ce qu’il n’aille pas, à l’avenir, divaguer dans les lieux publics !
En septembre, nous devions subir, après la fête communale, la présence du manège sur la place publique. Les petiots étaient heureux de faire la récré sous l’œil indifférent des forains qui démontaient leur métier. Celui-ci, désossé, perdait la magie qu’il possédait encore la veille en tournant immuablement sous les yeux enfantins émerveillés.
De chaque côté de l’ensemble école-place, des voitures, des camions, des autocars et des tracteurs circulaient. La municipalité a installé à proximité des panneaux attention école, mais ceux-ci étaient sans effet et les fous du volant continuaient à rouler à grande vitesse de part et d’autre de notre école. La place servait aussi de terrain de sport. Quelquefois un ballon quittait notre espace et se retrouvait sur la route départementale. Nous allions le rechercher avec mille précautions. Aucun accident ne fut à déplorer pendant toute la durée de mon séjour à l’école. Après mon départ et sous la pression parentale, la commune a du clôturer cette place sur trois côtés, se laissant la possibilité de la transformer en parc de stationnement si la nécessité s’en faisait sentir.
De chaque côté de la place, il y avait des tilleuls, qui pleuraient au printemps en nous arrosant de leurs effluves apaisants. Au fond, une vingtaine de marronniers lâchaient comme des bombes leurs bogues piquantes sur la tête des enfants. Ceux-ci nous apportaient en cadeau des dizaines de marrons bien lustrés dont nous ne savions que faire. En novembre, c’était la chute des feuilles. Le sol se recouvrait petit à petit d’un épais tapis multicolore qui faisait la joie des enfants jusqu’à ce qu’un coup de vent violent n’envoie le tout dans une rue adjacente.
Un cadre enchanteur me direz-vous ? Peut-être. On peut dire aussi bucolique, rural, familial, apaisant. Ajoutons…dangereux ! Très dangereux ! Un jour de forte tempête, un vieux tilleul, énorme mais qui pourrissait sur pied, s’écroula sur la maison de l’école et en détruisit la toiture. L’émotion fut grande car nous venions de rentrer en salle de classe quelques minutes auparavant et nous aurions pu avoir la totalité du centenaire sur nos têtes. La commune se dit alors qu’il fallait réagir et prendre des décisions. L’assureur prit en charge une grosse partie de la dépense de reconstruction de la toiture. L’ouvrier communal eut ensuite la dangereuse mission d’étêter tous les arbres de la place publique, après une séance houleuse au Conseil Municipal : fallait-il les couper complètement ou simplement les raccourcir ? Les arbres de la place publique sont comme une institution dans notre village. Les toucher est très impopulaire et dangereux en période électorale. Ils furent toutefois étêtés par le dit cantonnier, qui dut emprunter une échelle car la commune n’en possédait pas, sans sécurité d’aucune sorte et nous nous demandions chaque jour, en récréation, si cet ouvrier zélé n’allait pas, à un moment ou à un autre, s’écraser sur le plancher des vaches, sous les yeux des petiots amusés par ce spectacle de cirque.
Le bois de ces centenaires fut vendu à qui voulut bien l’acheter et finit en cendres dans les cheminées des chaumières. J’ai constaté à cette occasion que le bois de tilleul ne vaut rien comme bois de chauffage. En séchant, il finit par ressembler à du papier buvard avec un pouvoir calorique hélas très faible.
Classe à plusieurs cours…
…Comment faire ?
Comment faire classe à des élèves tous si différents, comment faire classe à quatre tranches d’âges en même temps ? Exercice de jonglage qui demande une longue expérience pour être correctement réalisé. Malheureusement, beaucoup de collègues ne sont pas attirés par ces classes de campagne et les quittent rapidement si par hasard ils y sont nommés. L’école rurale demande un énorme investissement personnel, une santé de fer, une très grande disponibilité. En retour, l’instit qui reste dans ces lieux peut bénéficier d’une atmosphère de travail quasi familiale, d’enfants moins turbulents qu’en ville, d’un relatif respect de la part des familles, d’une très grande liberté dans la conduite de la classe. Il n’est point vrai de dire que l’instit rural est isolé dans le fin fond de son désert campagnard. On peut très bien être seul au milieu d’une école à dix classes et rester seul aussi, si on le désire, au village. Par contre, si on est ouvert au monde qui nous entoure, habiter et travailler au village n’est pas un obstacle.
Bien sûr, les six heures quotidiennes de cours sont bien remplies. L’instit doit faire en sorte que tous les élèves soient occupés en même temps, autrement dit qu’il n’y ait pas de temps mort, propice aux bavardages et énervements. Pour cela la préparation de la journée doit être minutieuse et réfléchie, de façon à ce que le maître soit à l’aise dans l’exercice de sa pratique quotidienne et n’ait pas à se demander à tout instant ce qu’il convient d’entreprendre.
Les enfants, dans de telles classes, deviennent autonomes par nécessité. Ils savent qu’il ne faut pas déranger le maître quand il est avec un groupe. Ils doivent donc se débrouiller seuls. Les élèves écrivent beaucoup sur les différents cahiers et ce n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Il me semble en effet que de nos jours, on n’écrit plus assez dans les écoles. On voit parfois de magnifiques cahiers, avec des photocopies collées à toutes les pages, bien coloriées, sur lesquelles l’enfant n’a que quelques mots à écrire ou des cases à cocher. Il ne faut pas oublier que l’écriture d’un texte est source irremplaçable de profit : il faut lire et comprendre, bien calligraphier, bien présenter son travail, penser aux majuscules, aux accents, à la ponctuation. C’est en quelque sorte une petite œuvre d’art. L’enfant doit en être fier. La belle écriture et la copie doivent être réhabilitées. Cela n’est en aucune façon du temps perdu que calligraphier un paragraphe. De plus, c’est une activité calme, qui permet, pendant qu’une partie de la classe copie, de travailler avec un autre groupe. À ce propos, méfions-nous de l’utilisation trop fréquente des photocopies. La photocopieuse est devenue un meuble incontournable des fonds de classe. C’est pratique quand on veut rapidement vérifier qu’une notion a été acquise, mais c’est tout. Un exercice doit être écrit, sa consigne soulignée. La photocopieuse est utile également quand il s’agit de présenter aux enfants des documents ou des textes à trier. Elle ne doit cependant pas remplacer le manuel. Un livre est un objet physique irremplaçable qu’il convient de pouvoir toucher, prendre en main, feuilleter, etc.
L’instit qui a plusieurs cours à sa charge s’arrange pour organiser des séquences communes. C’est difficile, surtout à la rentrée scolaire de septembre.
À cette époque, les petits du CE1 réclament toute l’attention du maître. Ils ne savent pas encore bien lire. Ils ne sont pas autonomes. Ils n’ont pas senti le rythme de la classe, sorte de pulsation inconsciente faite de règles et d’habitudes ancrées depuis des lustres. Ils sont en tous points de vue tellement différents des grands du CM2. À sept ans, on est encore bébé. Par contre, au CM2, nos petiots possèdent déjà un étonnant bon sens assorti d’un esprit critique avancé. La façon de leur parler est différente, les besoins pédagogiques sont différents.
J’ai 16 ans et je ne sais pas lire !
Aujourd’hui, 29 novembre, je me suis rendu au lycée professionnel Blériot à Cambrai. Je suis devenu tuteur bénévole de trois jeunes en difficulté de lecture. Un article dans le journal local m’informe que le rectorat a mis en place une structure destinée à venir en aide aux jeunes privés de la capacité de savoir lire. Ils sont repérés par l’armée lors de la journée d’appel à la défense qui a remplacé feu le service militaire. À seize ans, ces jeunes ne savent pas lire. Je veux être utile et rester dans la sphère éducative. Je me suis donc inscrit avec joie et enthousiasme auprès du rectorat, heureux de pouvoir continuer à enseigner. Certains collègues, aussitôt mis à la retraite, ferment la porte de leur classe et disent : « bon débarras, allons maintenant cultiver notre jardin ! » Ce n’est pas ma façon de faire. Je pense que quarante années de bons et loyaux services ne peuvent se terminer comme ça. L’expérience et les compétences accumulées doivent encore servir. Il y a tant à faire !
Les trois élèves du lycée professionnel, Stéphane, Vincent et Christophe connaissent leurs lacunes et veulent s’en sortir. Ils sont parmi les dix à quinze pour cent d’enfants qui ont de grosses difficultés de lecture. Comment la chose est-elle possible ? Comment peut-on ne pas savoir lire à seize ans quand on est d’intelligence normale ? C’est le cas assurément des trois jeunes précités. J’essaie de comprendre cette aberration et pour cela j’interroge les jeunes lors de notre première rencontre. Tous manifestent le sentiment d’avoir été abandonnés dans leurs classes. « On ne s’est pas occupé de moi. » Vrai ou faux ?
Que vaut un système scolaire qui laisse de côté dix pour cent de ses élèves ? À qui la faute ? Comment faire pour remédier à cela ? À seize ans, n’est-il pas trop tard pour s’y mettre ?
Stéphane a des idées de suicide. Je comprends que c’est un appel au secours, une façon de dire « occupe-toi de moi. » Il a des ennuis avec les gendarmes. Il les provoque. Il brave des interdits. Il a une passion pourtant : les pigeons. Il ne peut pas venir à tous les cours de rattrapage que je peux lui proposer car il doit nourrir ses pigeons. Il me montre ses cicatrices au poignet, traces de coups de couteau, vestiges d’un passé suicidaire. Il est souriant pourtant. Il parle beaucoup et fait le fanfaron en face de ses copains.
Vincent est petit, marrant, grand bavard aussi. Il prétend avoir toujours raison. Son élocution est catastrophique. Au début, je ne le comprenais pas. Il aurait donc besoin d’un bon orthophoniste mais il ne veut pas en entendre parler. Il a déjà donné, dit-il, sans résultat. Sa passion : les chats. Curieusement, il n’en possède aucun chez lui. C’est une énigme à résoudre. Aujourd’hui, je lui ai fait cadeau de quelques pages arrachées à un magazine féminin, sur lesquelles on pouvait voir différentes races de chat. « Je vais les mettre au mur de ma chambre » a-t-il dit.
Christophe est beaucoup plus secret. Il n’est pas allé à l’école primaire, prétend-il. Il est gentil, fait ce qu’on lui demande, ne se livre qu’avec parcimonie. Sa passion : le football et l’équipe de Marseille en particulier. Il ne sait pas situer Marseille sur une carte de France, mais peu importe !
Tous les trois lisent en butant sur la plupart des mots, et ne comprennent évidemment pas ce qu’ils déchiffrent péniblement. Mon rôle : les aider à progresser en lecture et écriture, les écouter, car ils n’ont probablement aucune écoute, ou très peu, à la maison. Les mettre en confiance. Eviter de les culpabiliser.
Comment faire ? Je possède une batterie d’exercices et je choisis parmi des dizaines de fiches celles qui sont susceptibles d’être utiles, mais il y a tant à faire, les lacunes sont tellement graves et profondes ! Le vocabulaire est tellement pauvre !
Je me trouve devant une grande misère intellectuelle ! Et je me dis, en regardant autour de moi, que ces trois jeunes ne sont pas une exception, beaucoup de gens que je connais sont dans la même galère, ne possédant de culture qu’au travers des trois ou quatre heures de télévision quotidienne. Et quelle télévision ! Des émissions affligeantes de médiocrité, de la violence en permanence, des publicités parfaitement débiles, des gogols racontant leur vie, des pleurs en gros plan -ça fait grimper l’audimat- la misère du monde, les enfants qui meurent de faim, les extrémismes, les multiples conflits qui couvrent la planète, les gens dehors, sans domicile. Quelle triste énumération !
L’un des exercices que je leur ai proposé aujourd’hui consiste en la lecture d’une série de mots qui ont tous un point commun, sauf un : l’intrus. Par exemple, Mozart, Beethoven, Camion, Vivaldi, Strauss, Ravel. L’intrus est évidemment le mot ‘camion’. La difficulté réside dans le fait que ces mots sont inconnus de nos jeunes, et qu’il faut pourtant les lire pour essayer de les comprendre. Je ne perds pas de vue l’objectif que je me suis fixé, à savoir lire pour comprendre. La lecture est avant tout la compréhension de signes. Je néglige pour l’instant l’orthographe, la grammaire et la conjugaison. Il faut parer au plus pressé.
À un certain moment, je demande aux jeunes :
— Connaissez-vous au moins l’un de ces personnages ?
— Oui monsieur, Beethoven !
— Qui est Beethoven ?
Et Stéphane de me répondre :
— Un chien, monsieur !
Ce jeune faisait allusion bien sûr au chien, vedette du film du même nom ! Eclat de rire de ma part !
Dans le même ordre d’idée, je pense que Notre-Dame de Paris est, pour beaucoup de gens, la comédie musicale à succès d’il y a quelques années. Victor Hugo, connais pas !
Il y a deux ans, quand j’ai décidé d’exercer cette activité bénévole, je fus mis en contact avec un élève, dont j’ai oublié le prénom, et la première fois que je lui ai demandé de lire, pour le tester, il resta figé sur le premier mot de la ligne du premier exercice : Irène. Le i majuscule lui posait un sérieux problème l’empêchant d’aller plus loin. « Où suis-je ? » Je fus, l’espace d’une seconde, désemparé. J’ai bien respiré et j’ai continué.
À la fin de l’année scolaire, le jeune en question était en photo dans le quotidien régional, à l’appui d’un article élogieux qui prétendait qu’il savait maintenant lire grâce à des papys retraités et qu’il avait trouvé un travail grâce à leur action. Les journalistes, comme d’habitude, ont des raccourcis saisissants.
En ce qui concerne les jeunes du lycée professionnel, je suis pessimiste et je doute que l’on puisse grandement améliorer les choses. Les lacunes sont trop importantes. Je crois plutôt au côté tuteur de cette fonction bénévole. Je suis à l’écoute, j’aide éventuellement, je fais de la morale, du civisme, je parle beaucoup avec ces jeunes. Si, avec ça, le goût de la lecture est au rendez-vous, alors, c’est gagné !
Christophe m’a dit l’autre jour :
— Monsieur, j’ai pris un livre à la bibliothèque et j’ai commencé à le lire !
Je ne l’ai pas encore revu pour lui demander où il en était de sa lecture. Je n’oublierai pas de le lui demander la prochaine fois. S’il a abandonné son roman, je lui dirai :
— Tu as bien fait car lire doit être un plaisir, si l’histoire ne te plaît pas, rends le livre à la bibliothécaire et si tu veux, tu en prends un autre !
Il y a, me semble-t-il, deux types de lecture : la lecture plaisir qui affectionne, tant qu’à faire, les endroits confortables : le lit, la plage, le fauteuil et la lecture nécessité, celle de la recette, de la notice de la boîte de médicament, du mode d’emploi, du relevé bancaire, du magazine de télévision, etc.
Plusieurs fois dans la journée, je disais à mes élèves, comme si la répétition pouvait avoir une incidence sur leur comportement : « lire, ça rend intelligent ! Ne pas lire, ça rend…bête ! » Les enfants connaissaient cette phrase par cœur et s’amusaient à la répéter ensemble, les garnements !
La semaine de la lecture
En France, on a l’habitude de saucissonner l’année civile en de multiples évènements. C’est ainsi que sont instituées la journée sans tabac, la journée sans voiture, la journée contre la violence, la journée de l’eau, la journée contre le sida, la journée contre l’obésité, la journée des femmes, la journée des enfants, la fête des mères, des pères, des mamies, la semaine du goût, la semaine de la science, de la lecture, etc. J’en passe et des meilleures. C’est une façon comme une autre, efficace ou non, de rappeler certaines évidences. La méthode Coué a encore de beaux jours devant elle.
Chaque année, à l’occasion de la semaine de la lecture, en mars, il nous fut donné la possibilité d’obtenir gratuitement des magazines de toute nature, politique, chasse, nature, voyages, people, actualités, sports, sciences, tout ce qui peut exister à l’étal du marchand de journaux ainsi que des idées de travaux autour de la lecture, le concours de journalistes… J’étais partant, comme d’habitude, désireux d’éviter le train-train quotidien en proposant à mes élèves des activités qui sortaient de l’ordinaire. Je m’inscrivis donc, via le minitel, internet n’étant à l’époque qu’un concept assez vague. Les grandes maisons de presse jouaient le jeu et nous attribuaient gratuitement des exemplaires de leurs productions. Il suffisait de demander. Je demandais donc par le biais du minitel le plus possible de publications. Celles-ci étaient prêtes quelques semaines après et il fallait aller les chercher chez le grossiste à Cambrai. Tous les journaux étaient ensuite étalés dans le salon chez moi et la toute première tâche consistait alors à vérifier page par page le contenu des publications pour s’assurer qu’elles pouvaient être mises sans danger entre les mains des enfants. Je suis tombé un jour sur le plus célèbre tableau de Gustave Courbet, l’origine du monde, tellement réaliste que j’ai cru voir une photo. Pour qui ne connaît pas, il s’agit d’un sexe féminin en gros plan. Il en faut beaucoup plus pour troubler ces chères têtes blondes. Toutefois, le magazine fut écarté. Je contrôlais également les bandes dessinées.
Muni du précieux colis et de ses dizaines de titres connus et moins connus de la presse française, il était possible de préparer de merveilleuses leçons de lecture, dont voici un aperçu :
Les journaux et magazines sont à disposition sur les tables de la classe. Le but de la séance est de prendre un ouvrage et d’étudier sa couverture en signalant dans un tableau son prix, sa fréquence de parution, son titre évidemment, son numéro, etc.
Un travail a été effectué aussi sur la publicité. Quels arguments utilisent les publicistes pour vendre un produit ? Les mots qui font vendre, les slogans, la place de la publicité…
La séance qui m’a laissé le meilleur souvenir pourrait s’intituler : la première page de différents quotidiens. J’avais décidé pour cette séquence de bloquer toute une matinée. L’emploi du temps habituel fut donc bouleversé, cela ne fait d’ailleurs pas de mal de bousculer parfois les habitudes. Les élèves sont entrés en classe à 9h et ont trouvé, collées au tableau noir, cinq Unes de différents quotidiens, datées du même jour.
J’aimais offrir à mes élèves une surprise à leur entrée dans la classe le matin. Cela pouvait être un dessin sur le tableau noir, ou un collage, un texte, une phrase. Cette façon de faire aiguise leur curiosité et les met en forme pour bien démarrer la journée. Ce jour-là, c’était donc cinq feuilles de journal. L’affaire du moment, qui préoccupait grandement les médias, était la cagnotte de Jospin. Le Premier Ministre avait donc fait des économies et la grande question était de savoir ce qu’il allait en faire ! Entre nous, j’ai souvent l’impression que les journalistes nous prennent pour des imbéciles. Sur cinq quotidiens, quatre titraient en grand sur cette cagnotte, le cinquième, Le Monde, reportait les prouesses du ministre en page intérieure. Cherchons donc à expliquer cette différence.
Ensuite, nous avons étudié l’architecture de chaque Une : l’article principal, les oreilles, les pieds de page, le contenu des colonnes, etc.
Pour finir, j’ai demandé à mes élèves d’inventer, au moyen de dessins, de textes et de couleurs, la Une d’un journal imaginaire. Chacun s’est alors précipité sur sa page de dessin, soucieux d’atteindre l’objectif que l’on s’était fixé. Les résultats furent admirables. L’un des groupes avait décidé de produire un journal humoristique et mis en scène le Pape dans l’un des articles.
Les enfants ont travaillé par groupes de niveau. La classe bourdonnait et s’affairait. Les quatre cours, du CE1 au CM2, travaillaient en même temps, ce qui est rare dans ce genre de communauté scolaire. Les réalisations furent affichées et présentées aux familles lors d’une exposition organisée à la salle des fêtes. Je ne sais plus si nous avions eu le temps d’aller en récréation ce matin-là ! Et peu importe ! ! !
Visite au supermarché
Cet après-midi, comme un bon scout, j’ai accompli une bonne action. À la caisse du supermarché, où je faisais patiemment la queue, j’ai proposé à un vieux monsieur derrière moi, avec sa canne dans le caddy, entre la salade et la bière de luxe de passer devant moi. Pourtant, réflexion faite, je n’étais pas obligé d’agir de la sorte car je ne faisais pas la queue à cette fameuse caisse où est affichée, en grand au-dessus de nos têtes, comme l’épée de Damoclès, la mention suivante : SI VOUS ATTENDEZ À CETTE CAISSE, VOUS VOUS ENGAGEZ À LAISSER PASSER UNE DAME ENCEINTE OU UNE PERSONNE HANDICAPEE. Autrement dit, à l’endroit où j’étais, je pouvais tranquillement laisser gémir derrière moi la personne handicapée, âgée ou la future maman fatiguée par une longue et douloureuse attente maternelle.
Les haut-parleurs à ce moment précis de l’affaire déversaient dans nos oreilles un superbe Ave Maria, style guimauve, à faire pleurer le cœur de pierre que je suis censé être. Je suppose que l’Ave Maria est une gentille œuvre musicale susceptible de créer chez le gentil consommateur que je suis le réflexe : il manque des choses dans mon caddy.
On imagine donc facilement la scène : moi à la caisse, le vieux monsieur et sa canne derrière, et l’ave maria dégoulinant sur nos têtes. Surréaliste !
Sans doute voulait-on nous aider à patienter et en même temps nous inciter à retourner dans les rayons de proximité pour y saisir la dernière chose oubliée ou profiter des promotions, des soldes, des produits gratuits ou des cadeaux qu’il faut absolument saisir, car nous en avons besoin !
On se demande d’ailleurs souvent comment il se fait que, malgré toutes les largesses prodiguées par le magasin et ci-dessus énumérées, la note au bas du ticket de caisse reste salée, et même souvent très salée ! Si salée que l’on s’empresse immédiatement de la vérifier avant de sortir du magasin, mais rien n’y fait ! De toute façon, c’est trop tard, c’est payé ! Ils nous ont eus encore une fois !
C’est compliqué de nos jours d’aller au supermarché. Suivant le jour de la semaine, on a des ristournes sur certains produits, des points multipliés, des cadeaux, ou encore 10%, 15%, 20% sur certains articles ! D’autres produits nous donnent des euros qui s’accumulent dans une tirelire virtuelle. Enfin, si l’on veut, on peut payer son caddy en plusieurs fois et même faire ce choix à l’abri des regards indiscrets, en tapant ce qu’il faut sur le clavier. Bien sûr, il faut être muni pour profiter de ces largesses, de la carte du magasin, gratuite et qui, outre tous les avantages cités plus haut, vous permet aussi d’emprunter une belle somme d’argent, à un taux qu’on a bien du mal à cerner mais qui doit probablement atteindre des sommets.
Quand vous avez la carte en question, vous êtes FIDÉLISÉS, et à partir de ce moment-là, on peut vous faire avaler des couleuvres et vous plumer à toutes les occasions.
Connaissez-vous un grand magasin qui n’a pas sa carte de fidélité à proposer ? Certains, dont je suis, ont une collection de cartes au porte-clefs de la voiture ! Ce qui permet de faire à l’occasion des… infidélités.
Un jour, il y a bien longtemps, notre grand magasin, curiosité touristique des samedis après-midi, proposait à sa clientèle la portion de moules frites, avec son demi, pour 15Frs. Ce plat est chez nous comme la choucroute pour l’Alsacien ou la bouillabaisse pour les gens de la Cannebière. Exceptionnel ! Bien manger sans se ruiner ! Le but était évidemment d’attirer les gens en leur proposant de manger pour rien, et en supposant (bonne supposition d’ailleurs) qu’ensuite, ils feraient un tour dans le magasin pour acheter les choses habituelles indispensables. Les responsables avaient installé des parasols colorés dans la galerie marchande, avec des franges, comme sur les plages corses, et avaient invité les heureux consommateurs à prendre place sur des bancs, c’est plus rustique, le long de grandes tables en bois, sous ces fameux parasols qui ne protégeaient que de la chaleur des lampes de la galerie marchande. Ambiance conviviale qui sied parfaitement à la moule frite. Je me suis pointé dans ce magasin après l’orgie, alors que la population, repue, quittait les lieux à petits pas, le ventre lourd. Les mentons brillaient sous les lumières artificielles, les faces rougeaudes étaient satisfaites. Cela sentait la frite et la moule. L’horreur !
La cafétéria du supermarché est un endroit mythique ! Quel papy ou mamie n’a pas éprouvé le besoin, puis l’envie irrésistible d’y emmener le petit-fils le mercredi !
Nous sommes mercredi, à l’entrée de ce temple de la gastronomie française, il faut déjà faire un choix cornélien, n’ayons pas peur des mots, poussés que nous sommes dans la file des papys et mamies, les bras encombrés des plateaux et des couverts encore chauds du lave-vaisselle, dans l’ordre des prix : mini miam, miam, ou méga miam ? Le choix est vite fait, car rien n’est trop beau pour le petit chéri, et d’autre part, c’est papy qui paye, même s’il sait pertinemment que gaspillage il y aura, il paye et il est content de payer !
Que veut-il le mignon avec son méga miam ? Des crousti-bats ? Des nuggets ? Et comme boisson ? Ce fameux soda hyper sucré, célèbre sur toute la planète, même aux fins fonds de la brousse, où les petits noirs de tribus dites sauvages utilisent la boîte en guise de ballon de football (et j’ose dire que je ne suis pas influencé par la pub !).
Les frites trempées dans la mayo et le ketchup dégoulinent sur le menton du cher petiot. Et puis, comme le dit petiot est dégourdi pour son âge, il court lui-même au micro-onde quand le contenu de l’assiette devient froid et nécessite que mamie, très au courant de ce qui est bon ou mauvais pour la santé des enfants, invite celui-ci à réchauffer le plat car les frites froides, c’est pas bon pour la santé ! Ensuite c’est l’inévitable « Mamie, j’ai pus faim », car c’est à mamie qu’il s’adresse, sachant que mamie dira : « Laisse », tandis que papy se fendra d’un : « T’as pas honte, y a des enfants qui meurent de faim sur la planète ! »
Combat des chefs ensuite pour essayer de faire avaler à notre chère tête blonde le dessert, car papy et mamie savent que le meilleur et de loin dans tout ça, c’est le lait. Le lait est synonyme de croissance équilibrée et de bonne vache bien nourrie paissant paisiblement, le mufle humide et les sabots enfouis dans de gras pâturages.
Finalement, le petit avalera une cuillère du précieux dessert lacté, une seule cuillère pour faire plaisir (qu’il est mignon !). Le reste, papy et mamie le reprennent pour la maison car il ne faut pas gaspiller, avec aussi le fond de soda