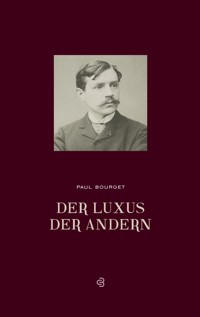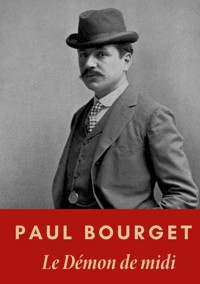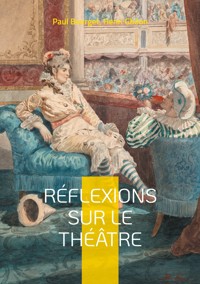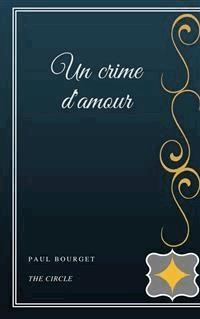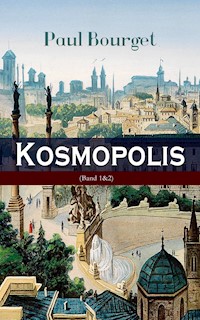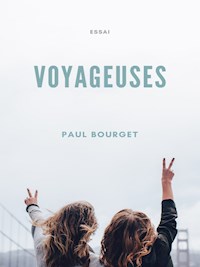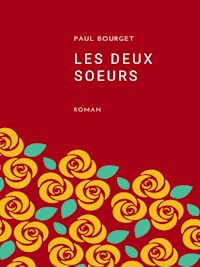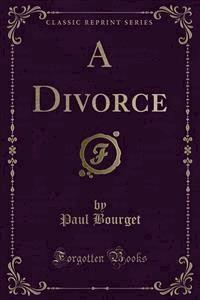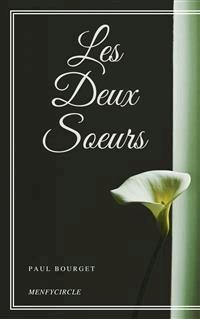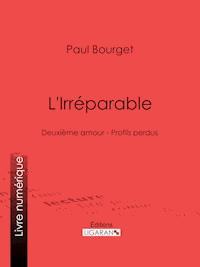
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est en 1877, au mois de mai, que Mlle Hurtrel devint, d'un jour à l'autre, célèbre pour sa beauté dans ce que les journaux plus particulièrement Parisiens appellent le Monde. Entendez par là cette société à demi européenne, à demi française, qui peuple la plus grande partie des hôtels situés autour du parc Monceau et de l'Arc de Triomphe, ainsi qu'un petit nombre de vieux hôtels de la rive gauche."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
… « 13 février 1883. – Bonne journée, de celles à marquer avec un caillou blanc, comme dit le poète ancien. Travail at home jusqu’à trois heures. Puis visite à M. R***. Conversation philosophique sur la complexité de la personne humaine. Le soir, chez Mme V ***. Appris le détail de l’histoire de Mlle Hurtrel. Transcription presque exacte de la même idée dans la vie réelle. Plaisir aigu d’intelligence à ces deux visions successives, l’une abstraite, l’autre concrète, d’un fait unique… » Feuilletant le memorandum de mes heures mortes, dans la solitude d’un hôtel gothique d’Oxford, j’y retrouve ces lignes mystérieuses et je me souviens du moindre détail de cet après-midi. J’entends encore la voix de M. R***. Je revois son beau regard errant de métaphysicien, le cabinet encombré de livres, et, par la fenêtre, les squelettes des arbres du jardin des Plantes, dans le voisinage duquel habite le célèbre professeur. Autour de lui gisaient sur le tapis mal raccommodé les épreuves de son grand ouvrage : De la dissociation des Idées, où il a étudié les maladies de la volonté consécutives à celles de l’Intelligence. Trois gravures, accrochées à la partie de la muraille que les rayons noirs de la bibliothèque n’ont pas envahie, représentent Aristote, Léonard de Vinci et Spinoza… « Non, disait le savant, ses deux mains croisées sur sa large poitrine, ses deux pieds allongés contre le feu et sa tête énorme secouée par un tic qui lui est habituel, – non, la personne humaine, la personne morale, celle dont nous disons moi, n’est pas plus simple que le corps lui-même. Par-dessous l’existence intellectuelle et sentimentale dont nous avons conscience, et dont nous endossons la responsabilité, probablement illusoire, tout un domaine s’étend, obscur et changeant, qui est celui de notre vie inconsciente. Il se cache en nous une créature que nous ne connaissons pas, et dont nous ne savons jamais si elle n’est pas précisément le contraire de la créature que nous croyons être. De là dérivent ces volte-face singulières de conduite qui ont fourni prétexte à tant de déclamations des moralistes… Nous dépensons toute notre activité à poursuivre un but dont nous imaginons que dépend notre bonheur, et, ce but atteint, nous nous apercevons que nous avons méconnu les véritables, les secrètes exigences de notre sensibilité. Que d’exemples de ces erreurs intimes fournirait l’histoire des conversions religieuses, si elle était étudiée par un psychologue !… Eh ! Pourquoi remonter à ces témoignages de l’ordre mystique, lorsque l’expérience quotidienne nous permet d’observer sur place la qualité de notre être ? Cette demi-métamorphose de caractère, provoquée chez la plupart des femmes par la révélation des réalités physiologiques dont s’accompagne la première possession, qu’est-elle donc, sinon la mise en lumière, soudaine et parfois si douloureuse, d’un être inconnu à lui-même et qui sommeillait dans la vierge ? Nous tenons ici la formule de presque tous les drames secrets du mariage. La jeune fille se croit douée d’un certain caractère ; elle organise à l’avance sa félicité d’après ce caractère. Elle se marie ou elle se laisse marier. Puis, cinq fois sur six, dans l’année qui suit, parfois dans la semaine, parfois dans les vingt-quatre heures, elle découvre qu’elle s’est trompée sur sa propre personne. Elle s’imaginait qu’elle aimerait son mari, elle le hait ; qu’elle le haïrait, elle l’adore ; – et ainsi du reste. Elle s’est réveillée comme d’un songe et transformée. Ou plutôt non, aucune magie n’a opéré sur elle. Tout simplement elle a découvert un moi mystérieux jusqu’alors, qui pensait et qui sentait en elle, – à son insu… Ah ! mon cher enfant, quelle artiste en mystification que cette nature, si plaisamment qualifiée de bonne par l’ironique Montaigne !… » Quelques heures plus tard, – il n’y a que Paris pour fournir à de pareils contrastes, – je regardais Mme V*** s’accouder sur les innombrables petits coussins brodés qui s’amoncellent dans le coin de son divan familier. Tout en blanc et si fine, elle jouait, en me parlant, avec un éventail garni de plumes d’autruches blanches et frisées, et ses pieds, chaussés de bas de soie et de mules de couleur noire, faisaient une charmante opposition à la blancheur vaporeuse du reste de sa toilette. Avec sa voix musicale elle me racontait la tragique aventure d’une de ses amies de jeunesse, bien cruellement punie de la faute de n’avoir pas vu clair dans son cœur, – commentaire mondain et mélancolique de la doctrine de mon Maître en psychologie sur la multiplicité du moi. C’est le détail de cette aventure que je m’amuse à transcrire, d’après mes notes d’alors, en complétant ces notes par quelques inductions personnelles, – mais à peine, – et sans dramatiser une histoire dont les grands évènements furent des pensées : « Nous sommes faits, a dit Shakespeare, de la même étoffe que nos rêves… »
C’est en 1877, au mois de mai, que Mlle Hurtrel devint, d’un jour à l’autre, célèbre pour sa beauté dans ce que les journaux plus particulièrement Parisiens appellent le Monde. Entendez par là cette société à demi européenne, à demi française, qui peuple la plus grande partie des hôtels situés autour du parc Monceau et de l’Arc de Triomphe, ainsi qu’un petit nombre des vieux hôtels de la rive gauche. Cette société a ses revenus bien établis, son étiquette stricte, ses galeries de tableaux authentiques, ses équipages soigneusement tenus, ses loges à l’Opéra, ses réceptions retentissantes, bref, tout un opulent décor de haute vie, – et c’est bien le Monde, mais plus du tout au sens où les chroniqueurs de l’élégance auraient pris ce mot voici cinquante ans. Ce Monde moderne ressemble à l’époque dont il forme l’aristocratie luxueuse. Il est, comme cette époque, mouvant et improvisé, tout contradictoire et dépourvu de tradition. La grande fortune, pourvu qu’elle ait été acquise sans trop de scandale, en force la porte, comme le talent, pourvu qu’il ne se montre pas dans son natif égoïsme. La ruine, en revanche, met à cette porte une barrière qui ne se lève guère. Mais, précisément parce qu’il est ainsi, tout incertain et momentané, ce Monde nouveau ne saurait pratiquer dans ses mœurs la logique de l’ancienne Société. Il a ses exclusions cruelles et inexplicables, comme il a ses surprenantes indulgences. La mère de Noémie bénéficia d’une de ces indulgences. Elle arrivait de Bruxelles où son mari, le comte Hurtrel, homme de finance et de politique, avait plus que décuplé par des spéculations habiles une fortune déjà considérable, et elle parut d’abord dans le salon de la princesse Wierschownia, une très grande dame russe et très à la mode. Les deux femmes s’étaient connues aux eaux avant leurs mariages. Ç’avait été entre elles une de ces amitiés de la dix-huitième année qui précipitent deux jeunes filles aux bras l’une de l’autre, et les font se tutoyer dès le premier jour, quitte à s’oublier dès la première absence. Mais il reste convenu, de part et d’autre, qu’on est demeuré amies intimes, et, lorsqu’on se retrouve après de longs intervalles, on s’accable des preuves de cette amitié, plus sincère peut-être que bien des liaisons d’une intimité apparente ; car deux amis, ou deux amies, qui ne vivent jamais ensemble, n’ont à se reprocher aucun des cruels abus de la familiarité, cette rançon trop fréquente de tant d’affections menteuses. Et puis, ceux qui nous ont été chers tout jeunes et que nous avons perdus de vue, c’est le moment idéal de notre jeunesse que nous continuons de chérir en eux ! La princesse Wierschownia fit donc pour sa chère Sylvie, – comme elle avait continué d’appeler cette amie de passage, – tout ce qu’elle aurait fait pour une sœur, quand la comtesse Hurtrel manifesta le désir de s’établir à Paris, sous le prétexte de mieux marier Noémie. Elle donna en son honneur une fête choisie, et qui révéla du même coup, à tous et à toutes, le magnifique coucher de soleil de la beauté de la mère et la délicieuse aurore de celle de la fille. Mais à qui cette dernière avait-elle pris cette beauté-là ? Car le comte Hurtrel était épais et court avec un visage d’homme de proie, tout en nez et en menton, et la comtesse avait une splendeur un peu massive, un visage pâle et mat, des cheveux presque trop noirs, des sourcils qui faisaient barre sous un front bas, et une ombre de duvet dans le coin des lèvres. – Oui, de qui donc Noémie tenait-elle cet or fluide de sa chevelure, cet ovale si finement allongé, cette transparence de son teint, cet éclat si clair de deux yeux bleus qui, dans la même minute, pétillaient d’esprit, ou se noyaient de rêve et s’alanguissaient, cette souveraine aristocratie de ses gestes et de ses sourires ? Beaucoup de femmes, qui ne connaissaient la physiologie que par leur expérience d’alcôve, – mais cette expérience possède ses terribles certitudes, – durent penser, en considérant la grâce aisée des attitudes de Noémie, le je ne sais quoi de merveilleusement souple répandu sur toute sa personne, les attaches menues de ses mains un peu longues et de ses jolis pieds, qu’il y avait derrière ce charme suprême quelque mystère d’amour clandestin. Et plusieurs hommes, de ceux auxquels les médisances de cet ordre sont si habituelles qu’ils n’en sentent plus la férocité, – et qui peut aller beaucoup dans le Monde sans risquer d’y devenir à la fois féroce et insouciant ? – racontèrent qu’en effet un jeune lord anglais, – et ils le nommèrent, – mort depuis des années, – et ils dirent la date et comment, – avait été l’ami très intime de Mme Hurtrel aux environs de la naissance de Noémie. Et c’était vrai. Seulement, quoique personne ne mît en doute une minute la vérité de cette anecdote, personne non plus n’y crut tout à fait, la prodigalité des médisances et des calomnies qui se débitent à Paris ayant du moins ce bon résultat d’établir à leur endroit une sorte de scepticisme fondamental qui se résume dans la formule banale : « on dit tant de choses !… » Et nul ne se soucia de vérifier plus exactement l’origine de l’adorable figure de Mlle Hurtrel qui apparaissait plus adorable encore dans le cadre que lui faisaient les salons de la princesse, – si joliment disposés et qui mélangent avec un goût si habile le large luxe des grands seigneurs d’autrefois à la minutieuse opulence de notre mode contemporaine.
Dès le premier soir où elle fit cette entrée triomphale dans l’admiration des hommes et des femmes qui composaient le cercle de l’hôtel Wierschownia, Mlle Hurtrel fut jugée d’une façon sévère par l’opinion, – invisible arbitre aux arrêts duquel nous nous soumettons d’autant plus volontiers, lorsqu’ils frappent sur autrui, que nous y trouvons d’ordinaire de quoi satisfaire nos secrètes rancunes, et cela sans responsabilité. Ce fut, de la part des femmes, la revanche de l’envie que leur inspira aussitôt l’indiscutable supériorité de cette créature, parée, comme d’un triple collier de perles sans prix, de jeunesse, de richesse et de séduction. Ce fut, de la part des hommes, l’effet de la malveillance innée qui les porte à flétrir les femmes dont ils admirent le plus la beauté, comme si, en avilissant d’abord par la pensée une créature charmante, ils se vengeaient d’avance de celui qu’elle aimera et qui ne sera pas eux. « Cette fille-là est née adultère… », avait dit d’elle l’affreux vicomte de Teyde, qui a sur sa conscience de vieux Beau de cinquante ans tous les crimes privés qui peuvent impunément se commettre dans les ténèbres des intrigues galantes. Et, de fait, Noémie adopta tout de suite vis-à-vis des hommes un ton hardi et libre, et qui le parut davantage, tant il contrastait avec l’aspect romanesque de sa personne physique. Très décolletée, et montrant de ses jeunes épaules délicatement modelées dans leur maigreur tout ce que la coutume, alors déjà si complaisante, permettait d’en montrer, elle avait une manière de regarder les gens bien en face qui ressemblait à de la provocation. Mais son rire surtout pouvait, au jugement des observateurs vicieux qui l’entouraient, corroborer le mot méchant du vicomte, pronostiquer et autoriser le plus dangereux avenir. C’était, aux minutes où elle se laissait aller à sa gaieté, un de ces rires très hauts et très éclatants que connaissent bien les hommes qui ont beaucoup fréquenté les filles, – rire énervé comme il en retentit dans les cabinets particuliers, – rire de femme insolente, qu’elle lançait en montrant ses jeunes dents blanches. Et tout cela faisait un ensemble qui n’était pas loin d’être de mauvais goût, d’autant qu’aussitôt installée dans le monde, elle affecta les longs tête-à-tête dans les coins de canapé, les appels adressés à un homme de l’un à l’autre bout d’un salon et d’une voix claire ; bref, toutes les habitudes de la flirtation la plus abandonnée. Mais, si c’était là de quoi la distinguer un peu des autres jeunes filles de sa société, ce n’était pas de quoi la distinguer beaucoup de la plupart des jeunes femmes ; et puis, la princesse et sa très puissante coterie avaient adopté les dames Hurtrel ; leurs millions étaient bien et dûment avérés, l’hôtel qu’elles avaient loué dans l’avenue du Bois-de-Boulogne parfaitement situé ; leurs réceptions, quand elles en donnèrent, furent d’une élégance irréprochable. Le comte, qui avait continué d’habiter Bruxelles à cause de ses affaires, se montrait à Paris assez souvent pour que la mère et la fille ne pussent prendre une vilaine et douteuse tournure d’aventurières. D’ailleurs, elles s’acquittèrent de leurs devoirs sociaux avec une ponctualité scrupuleuse. On ne connaissait pas d’amant actuel à la comtesse, et quant à Noémie, si son allure demeurait à peine dans les limites des bienséances convenues, du moins cette hardiesse avait-elle, au regard de tous les hommes, l’avantage de rompre l’affreuse monotonie de certaines réunions mondaines : grands dîners, grands bals et jours de visite officiels. Une fois de plus on excusa l’excentrique attitude de Noémie, en prononçant à propos d’elle une de ces formules qui sont des pensées à l’usage de ceux qui ne pensent pas. On répéta : « Ces étrangères… » Et on s’amusa de l’esprit et de l’audace de la jeune fille, – en attendant qu’on s’en servît pour la déshonorer.
Les observateurs de salon, n’étant jamais désintéressés, ne remontent guère des faits, qu’ils savent si utilement et si justement constater, aux natures qu’ils n’auraient aucun profit à connaître. Aussi pas un d’eux ne reconnut-il qu’il y avait un mystère dans cette jeune fille. Mais n’y en a-t-il pas un dans toutes les jeunes filles qu’on mène dans le monde, – pourvu qu’elles pensent ? Et si cela est moins fréquent que ne le feraient croire leurs beaux yeux profonds, c’est aussi moins rare qu’on ne l’imaginerait à entendre leurs conversations. Trop intelligentes pour ne pas pressentir que le décor de la société dissimule des coulisses où elles ne peuvent pas entrer, obligées de se former des idées sur ces arrière-plans de la vie avec les éléments incomplets que leur fournit une phrase ambiguë, un regard échangé, un silence, leur imagination est toujours en travail. Il en résulte parfois un curieux mélange de réelle innocence et de dépravation factice, de virginité ignorante et de coupable divination. Cela fait des têtes singulières, dans l’intimité desquelles personne ne pénètre. Leur mère qui vit chaque jour avec elles, ne s’aperçoit pas de leurs insensibles évolutions d’esprit. Avec leurs amies, même les plus ingénues pratiquent toujours un peu le précepte du prudent proverbe, elles les traitent d’instinct sinon comme des ennemies, au moins comme des rivales du lendemain. Et leurs fiancés, dans leur égoïsme naïf d’amoureux, s’efforcent de les voir, non pas telles qu’elles sont, mais telles qu’ils les désirent. Aussi l’existence intime d’une jeune fille riche est-elle, le plus souvent, quelque chose d’étrangement solitaire, et celle de Noémie Hurtrel plus qu’aucune autre, à cause de sa situation de famille. Elle était réellement, comme le racontait la chronique, la fille d’un lord d’Angleterre, pour qui la comtesse Hurtrel avait éprouvé une des dix passions éternelles de sa vie. Semblable sur ce point à beaucoup de femmes qui valent mieux que leurs actes, la comtesse, qui avait été très galante, pouvait se croire très romanesque, car elle s’était donnée à chaque amant nouveau avec l’idée qu’elle n’avait jamais aimé auparavant et qu’elle n’aimerait plus jamais dans la suite, – et, chaque fois, elle avait été sincère. Mais son sentiment pour ce malheureux marquis de Banbury, – lequel fut plus tard assassiné au coin d’une des routes du comté de Clare, en Irlande, et d’une façon si atroce, – avait duré plus que tous les autres. C’était le seul qui l’eût rendue mère, et, par un de ces miracles de ressemblance transfigurée, comme les fortes passions en produisent quelquefois, tous les traits déjà charmants du jeune lord se retrouvaient dans ceux de son enfant, mais plus charmants encore, et comme auréolés du souvenir de l’extase où s’était accompli ce prodige d’une incarnation presque idéale. Personne n’avait pu savoir si le comte Hurtrel, fort détaché de la comtesse dès les premières années de son mariage, avait soupçonné ou non le secret de la naissance de Noémie. C’était un homme positif jusqu’au cynisme, qui avait épousé sa femme pour sa fortune et ses relations de famille, avec des habitudes d’un libertinage méthodique, et trop réfléchi pour se mettre en colère contre un fait accompli, quel qu’il fût, surtout lorsque ce fait le gênait aussi peu que l’existence de cette fille. Il la voyait une fois par jour, lorsque la comtesse habitait Bruxelles et que lui-même déjeunait ou dînait à la maison, juste le temps de recevoir d’elle, dans le coin de ses favoris grisonnants et coupés très courts, un baiser qu’il ne lui rendait pas. L’absolue indifférence avec laquelle il avait traité cette enfant, l’unique enfant de son ménage cependant, provenait-elle d’une conviction raisonnée sur sa naissance, ou bien d’une insensibilité naturelle pour tout ce qui n’était point succès de vanité ou satisfaction des sens ? Il est probable qu’il y entrait un peu d’une de ces causes et un peu de l’autre, et que le comte ne s’était jamais donné la peine de résoudre une énigme qui lui était indifférente. L’instinct de la paternité n’existait pas chez cet homme. Existe-t-il chez beaucoup de ses contemporains ? Il est permis d’en douter, à voir la multiplication des enfants naturels non reconnus, et la prospérité de ces usines à éducation, aménagées pour l’abandon légal des fils et des filles, qu’on appelle les internats : collèges et couvents. Noémie Hurtrel n’avait donc, à la lettre, pas eu de père. D’autre part la comtesse, en avançant en âge, n’avait fait que s’abîmer davantage dans le gouffre de frivolité que la vie mondaine couvre de ses fleurs. Elle avait trompé de son mieux, et à force d’étourdissement, le morne, le tragique ennui qui est, aux environs de la quarantième année, l’expiation des galanteries de la trentième. Elle ne pouvait plus s’intéresser qu’aux choses de l’amour, et elle sentait l’amour lui échapper. C’est ainsi qu’entre ces deux abandons, l’un presque systématique, l’autre involontaire, Noémie avait grandi seule, – abandonnée, jusqu’à l’âge où elle devint la compagne forcée des sorties de sa mère, à des gouvernantes qui se succédaient hâtivement. La comtesse, comme toutes les maîtresses de maison qui ne suivent pas le détail de la conduite des personnes qu’elles emploient, faisait, aux minutes de ses surveillances subites, des découvertes qui la mettaient hors d’elle-même, et corrigeait sa négligence par des colères et des ruptures. Et ce désordre s’accompagnait de déplacements continuels. Pendant son enfance et sa jeunesse, Noémie avait erré à travers toutes les villes d’eaux et toutes les villes de plaisir, à la suite de sa mère qui, sous un prétexte ou bien sous un autre, était toujours loin de sa maison et de son mari. Elle menait cette vie spirituellement surnommée « de table d’hôte » par un humoriste de ce temps. C’est aussi la vie de tout un clan de personnes très riches, en Europe, lesquelles, s’en trop s’en douter, révèlent ainsi par leur besoin continuel de mouvement, l’inoccupation foncière de leur esprit et de leur cœur. Ç’avait donc été des hivers passés tout entiers en Italie, de longs séjours d’été installés dans les stations les plus différentes, de Trouville à Saint-Maurice, et de l’île de Wight à Biarritz. Tantôt ces dames occupaient un appartement dans un hôtel, tantôt elles louaient une villa ou un chalet. Parfois elles emmenaient avec elles une partie de leurs chevaux et de leurs gens. D’autres fois elles se contentaient du personnel strictement nécessaire et s’improvisaient, pour un séjour de quelques semaines, une écurie et une domesticité de rencontre. Le comte donnait sans discussion, avec l’indifférence d’un homme entre les mains duquel le roulement des plus grandes affaires industrielles et politiques d’un pays fait passer des sommes considérables, les cent cinquante mille francs par année qui soldaient les dépenses de ce cosmopolitisme luxueux, – cosmopolitisme très moderne, dont les Américains, les Anglais et les Russes sont plus coutumiers que les Français ; vagabondage presque contre nature, à moins qu’il ne faille y voir un cas d’atavisme inconscient, et qui aboutit, d’une façon presque fatale, ou bien à la singularité psychologique la plus inattendue, ou bien à l’effacement complet de l’âme et de la physionomie.
Noémie Hurtrel avait échappé à cet effacement, mais pour devenir une créature d’exception, – ce qu’il est si dangereux d’être, surtout lorsque la grande fortune, en vous exemptant des menues attaches, vous permet de pousser jusqu’au bout l’originalité de votre personne. Toute différence trop marquée avec ceux qui vivent auprès de nous n’a-t-elle pas pour résultat certain de nous en faire des ennemis naturels ?… Le premier effet de cette existence de voyages et de luxe effréné avait été d’atrophier dans cette âme la puissance de l’attachement aux choses réelles. Elle s’était trouvée si comblée que rien ne lui était devenu précieux. Et puis, elle n’avait pas grandi, comme il faut peut-être grandir pour que le cœur se développe tout entier, parmi les mêmes objets et les mêmes êtres, que nous aimons alors, pour peu que nous soyons capables d’aimer, parce que nos moindres souvenirs se rattachent à eux, et qu’une partie de nous y demeure unie nécessairement. Les appartements somptueux, les décors des villes, les lignes des paysages, les figures des personnes avaient défilé devant ses yeux calmes d’enfant trop riche, à la manière d’une figuration d’opéra. Aucune impression directe et concrète n’avait donc été assez forte pour s’opposer en elle au développement de la faculté d’imaginer, et cette faculté avait surtout grandi par l’influence des livres. Comme elle connaissait très bien plusieurs langues et plusieurs pays, les occasions de connaître plusieurs littératures s’étaient offertes à elle, et elle les avait saisies avec l’avidité de lecture propre à la jeunesse, lorsqu’il n’y a pas un complet rapport entre les aliments d’émotion fournis par l’expérience quotidienne et les appétits de la sensibilité grandissante. Noémie s’était donc habituée peu à peu à substituer les excitations de la vie rêvée aux excitations de la vie vécue. C’est ainsi qu’elle avait tour à tour été l’héroïne de tous les romans qui tombaient dans ses mains spirituelles et à demi masculines. Et quels romans ! Accoudée sur l’oreiller de son lit de jeune fille et ses beaux cheveux blonds tressés en une grosse natte, elle avait feuilleté tour à tour les œuvres de Balzac et de Spielhagen, Monsieur de Camors et Cometh up as a flower, confusément, sans jamais se placer au point de vue impersonnel qui seul établit la perspective des œuvres de cette sorte et permet de s’affranchir de leur ivresse en les comprenant. Elle avait agi de même avec les poètes, et, comme elle avait eu tout un printemps pour gouvernante la fille d’un professeur de Bonn, avec quelques philosophes. Elle avait souligné, de la pointe du crayon d’or qu’elle portait à l’extrémité d’une chaîne qui faisait bracelet autour de son poignet, un certain nombre de phrases de Shopenhauer et de Darwin, d’Herbert Spencer et de Hartmann. Il lui était arrivé d’aller chez sa couturière avec une Éthique dans sa voiture, et d’ouvrir au retour du bal l’Autobiographie de Stuart Mill, sans trop se douter qu’elle faisait là une action prodigieusement excentrique, tant l’habitude d’une vie arbitraire et improvisée l’emprisonnait dans l’étrangeté de ses caprices. Grâce à cette improvisation et à cette incohérence, il s’était accompli en elle un phénomène plus commun qu’on ne pense chez les personnes que les hasards de l’éducation conduisent trop tôt à un éveil cérébral qui n’est pas proportionné à l’éveil sentimental. Elle cessa peu à peu de distinguer entre la créature qu’elle était réellement et la créature qu’elle s’imaginait ou qu’elle voulait être. Ajoutez à cela qu’elle avait fréquenté beaucoup d’hommes de plaisir. Ils affluaient chez la comtesse et dans toutes ses installations, attirés, un peu par la grâce de son accueil, un peu par ses facilités de maîtresse de maison. Cette femme avait trop aimé l’amour depuis sa jeunesse, pour ne pas fermer les yeux sur les intrigues qui se nouaient autour d’elle. C’est à l’école de ces hommes, qui s’amusaient de son parler d’enfant spirituelle, que Noémie avait achevé de se former ses idées sur elle-même. Quand elle parut chez la princesse Wierschownia, ces idées étaient définitives. Elle se considérait comme blasée et croyait tout connaître du monde, alors qu’elle était d’une innocence physique aussi entière que celle de la vierge élevée dans le couvent le plus fermé. Les libertins qu’elle avait vus chez sa mère avaient causé avec elle sans l’instruire : les uns parce que, la croyant déniaisée, ils lui disaient des phrases trop fortes et dont elle ne saisissait pas bien le sens, les autres, parce qu’ils professaient le respect des jeunes filles, dernier scrupule de beaucoup de viveurs. Enfant unique, elle n’avait jamais eu, à défaut d’une sœur ou d’un frère, quelque amie intime de son âge avec laquelle entretenir de ces conversations dangereuses où deux demi-naïvetés s’éclairent l’une l’autre. Dès l’âge de quinze ans elle avait obtenu de sa mère, qui, en sa qualité de femme sentimentale, s’était d’abord insurgée là contre, puis avait cédé par faiblesse, de ne plus pratiquer ses devoirs religieux, sous le prétexte, sincère d’ailleurs, de doutes philosophiques ; de manière que les imprudentes questions du confessionnal n’avaient pu la faire réfléchir sur toutes sortes de sujets. Elle se croyait insensible, parce que ses coquetteries avec un écrivain célèbre rencontré aux eaux et qui s’était marié richement six mois après cette flirtation de hasard, l’avaient laissée froide ; et cependant, sa physionomie d’enfant de l’amour ne mentait pas. Si elle s’était intéressée jusqu’à la passion aux sentiments de ses lectures, c’est qu’elle était tendre et romanesque au plus haut point. Elle se croyait misanthrope, parce qu’elle avait pris l’habitude, par affectation de supériorité, de toujours mêler une ironie moqueuse à ses jugements sur les caractères et sur les actions, et il n’y avait pas de plus généreuse nature, ni de plus étrangère à l’utile et déshonorante habitude de la défiance. Elle s’était persuadée qu’elle aimait le luxe et les succès de vanité, bien qu’avec le sang paternel elle eût hérité ce profond pouvoir de bonheur ou de malheur solitaire qui est le propre de la race anglaise. Mais c’était la vie, cette vie qui nous révèle à tous ce que nous aurions pu être, alors qu’il n’est plus temps de le redevenir, qui devait lui apprendre combien elle se trompait sur son propre cœur, et non pas cette société de femmes à demi hostiles et d’hommes à demi méprisants, qu’elle côtoyait sans la voir, dans la grâce de sa beauté blonde, – toute pareille à une somnambule que la sécurité de son ignorance fait marcher, légère et droite, sur le bord d’un abîme…
Au mois d’octobre de cette même année 1877, la comtesse et sa fille quittèrent Paris afin de passer trois semaines au château des Oseraies, chez leurs amis les Taraval. Ces dames disaient « leurs amis » attendu qu’elles avaient le même cercle de relations que Mme Taraval, et que, dans la saison, elles l’avaient rencontrée deux ou trois fois la semaine aux visites et aux dîners, aux soirées et à l’Opéra. Et puis, on était si vite des amies de Mme Taraval… Pour peu que l’on fût à la mode sous un titre quelconque, il fallait un bien adroit effort pour esquiver cette amitié, qui se présentait d’une façon si sincère et si confortable. Le confortable ! C’était la manie et c’était l’art de cette femme qui, à trente-deux ans, aurait été délicieuse comme à vingt, sans un embonpoint commençant, et qui possédait précisément l’intelligence nécessaire pour organiser d’une manière accomplie les menus détails de la vie matérielle. Son hôtel de la rue Murillo était tenu avec une entente incomparable de luxe le plus utilitaire. Tout y était parfaitement aménagé en vue du plus grand bien-être possible, depuis les chaises de la salle à manger jusqu’aux fauteuils du boudoir, et depuis l’écurie jusqu’à la table. Ce qui achevait de donner un air d’installation plus définitif encore à ce luxe habile, c’était la physionomie de la maîtresse de maison, si heureusement installée elle-même dans sa taille un peu courte, avec ses grands yeux bruns et calmes, avec son visage d’une fraîcheur inaltérée, avec cette sorte d’atmosphère de sécurité où elle se mouvait, – sécurité fondée sur la réunion de toutes les chances. Elle avait une santé qui ne soupçonnait même pas la migraine, une grosse fortune, deux enfants dont la joliesse faisait se retourner les passants lorsque leur gouvernante anglaise les promenait dans les allées du parc Monceau, un mari qu’elle aimait, et une absence entière d’Idéal d’aucune espèce : « Elle pense objets… », disait Noémie, et, pour une fois, cette jeune fille sans observation voyait très juste.
Quant au mari de cette belle personne, c’était assurément, de tous les hommes que Mlle Hurtrel avait rencontrés dans son séjour de six mois à Paris, celui qu’elle avait remarqué avec le plus de complaisance. Hugues Taraval avait alors trente-six ans. C’était un homme d’une taille moyenne, demeuré mince grâce à un entraînement de vie physique bien compris et ininterrompu. Tous ses mouvements disaient la force. Il avait un visage un peu long, d’une pâleur ambrée, comme pris dans un casque de cheveux très noirs. Une moustache blonde et fine éclairait joliment ce profil que son nez busqué achevait de rendre hardi et presque militaire. Tout dans ses manières révélait la certitude que donne le succès des entreprises, et cette certitude était si profonde chez lui, qu’elle s’imposait même à ses ennemis. Il semblait impossible qu’on le surprît jamais en faute, et il devait évidemment réaliser chacune de ses prétentions. Il avait hérité de son père, un des plus solides agents de change de Paris, une richesse loyalement acquise, que la dot de sa femme avait doublée, – et il ne vivait, en apparence du moins, que pour les choses du sport, dans lesquelles il excellait. Montant à cheval comme un homme qui a été mis en selle à six ans, tirant le pistolet chez Gastine avec une supériorité qui lui avait épargné toute affaire, capable d’enlever comme un cocher de la Grande-Bretagne les quatre postiers de son mail de promenade, et de diriger sans une erreur le détail compliqué d’un cotillon, il avait passé à bon droit, depuis des années, pour un des maîtres de la haute vie. Les jeunes gens de ses deux clubs prenaient son tailleur, copiaient ses toilettes, citaient ses jugements. Et sa correction morale valait sa correction extérieure. Il avait la réputation d’être un gentleman dans la pleine force de ce terme par lequel la société élégante, qui emprunte tout à l’Angleterre, – depuis des coupes d’habit jusqu’à des valets de chambre, et depuis son argot de courses jusqu’à ses formules de convenance, – résume nettement les strictes exigences de sa morale particulière. Taraval s’était, dès sa première jeunesse, conformé avec le soin le plus scrupuleux aux préceptes de ce code, et ceux que le contraste de couleur entre ses cheveux et sa moustache, souvent significatif d’une nature double, ainsi que la nuance de ses yeux d’un jaune brouillé, autre indice d’une race ambiguë, auraient rendus défiants pour sa bonne foi, n’auraient su articuler un seul fait précis contre lui. Des esprits chagrins pouvaient remarquer qu’une telle perfection d’attitude ne va pas sans calcul, et aussi que la surveillance trop soutenue de soi-même procède d’un amour-propre poussé à son dernier excès. Ce sont là des subtilités de raisonnement bonnes pour des moralistes en chambre, et si Taraval vivait dans un impénétrable quant à soi, personne parmi ses amis ne songeait à lui en demander compte. Car, précisément, cette surveillance infaillible qu’il exerçait sur sa personne et qui faisait de lui l’esclave des convenances, constituait une flatterie constante pour toutes les idées reçues dans la Société. Une tenue minutieuse et quotidienne n’est-elle pas un implicite aveu qu’on a pour but de plaire au Monde ? N’est-ce pas là aussi une sorte d’hommage muet envers tous ceux qui composent ce Monde ? Cette infaillibilité souveraine de tenue, jointe à une auréole de royauté d’élégance, avait séduit Noémie par-dessus toutes choses, et quoiqu’elle se piquât d’une prématurée connaissance du cœur humain, elle était bien incapable de déchiffrer un personnage de cette profondeur de perversion et de deviner ce qu’il y avait – derrière cette tenue !…