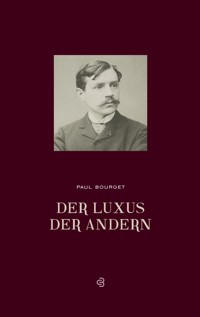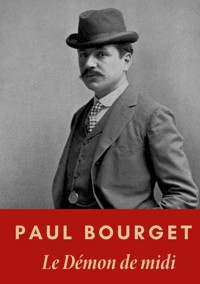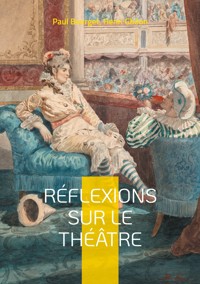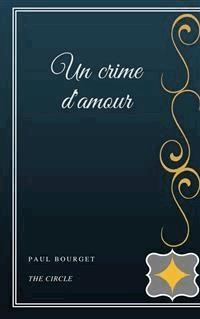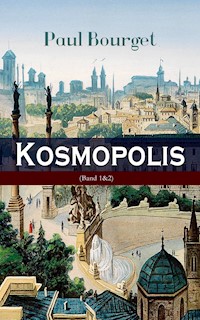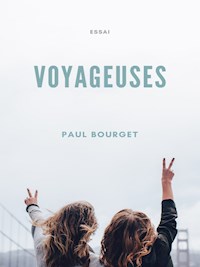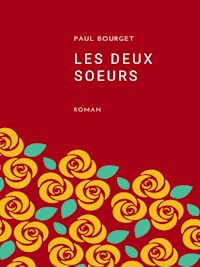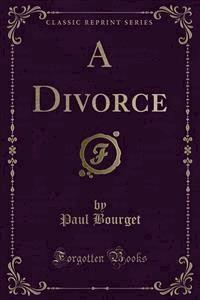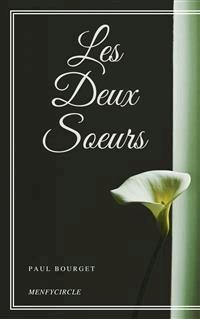1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’Étape est un des romans majeurs de Paul Bourget, rédigé d'octobre 1901 à mai 1902 et qui inaugure dans l’œuvre de l'auteur du Disciple un genre nouveau : le roman à thèse, que Paul Bourget préfère nommer « le roman d’idées »
Présentation
Roman traditionaliste, L'Étape relate l'ascension sociale et les valeurs de la famille en décomposition surtout, celle du professeur Joseph Monneron. Alors que son fils, Antoine, se dissipe dans les jeux et le plaisir, sa fille Julie se dissout auprès d'un jeune homme qui finit par la laisser seule et enceinte. Seul Jean, son dernier enfant, est vertueux mais porté vers des idées religieuses que son père hait. On retrouve dans L'Étape quelques-uns des thèmes récurrents de l'œuvre de Paul Bourget, comme le déracinement et le « déclassement social ». Paul Bourget y célèbre les mérites du patrimoine, de la durée, de « cette maturation antérieure de la race sans laquelle le transfert de classe est trop dangereux ». Il y affirme que « le problème de la vie humaine est uniquement le problème de la famille ».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
I un amoureux
II L’obstacle
III les monneron
IV inquiétude d’esprit et de cœur
V l’union tolstoï
VI le chemin du crime
VII les frères et la sœur
VIII un cœur de jeune fille
IX un cœur de jeune fille (suite)
X et ne nos inducas…
XI la catastrophe
XII le père et le fils
XIII brigitte ferrand
L'ÉTAPE
PAUL BOURGET
L'ÉTAPE
roman
Librairie Plon, 1902 (p. 1-27)
Raanan Editeur
Livre 680 | édition 1
À
EUGÈNE-MELCHIOR DE VOGÜÉ
Son admirateur et son ami P. B.
I un amoureux
L’allée du jardin du Luxembourg où Jean Monneron se tenait aux aguets, était située dans la partie de ce vaste enclos qui a le plus changé depuis ces dernières années, à l’angle de la rue d’Assas et de la rue Auguste-Comte. Le groupe des constructions toutes récentes où sont installés le lycée Montaigne, l’École coloniale et celle de pharmacie a complètement modifié et banalisé le pittoresque aspect de ce coin de Paris, que la disparition de la Pépinière avait bien altéré, dès la fin de l’Empire. Mais, tout rétréci qu’il puisse être, et malgré la vulgarité des bâtiments neufs dont nos architectes l’enserrent, le vieux jardin primitivement dessiné par De Brosse n’en garde pas moins, même dans ses morceaux les plus défigurés, je ne sais quel charme italien. On dirait que la nostalgie de la Toscane, qui décida Marie de Médicis à sa création, flotte autour de ces bassins, de ces terrasses et de ces marbres. C’est l’endroit de Paris où vous aurez encore quelque chance, par cet âge de téléphones et d’automobiles, quand personne n’a plus le temps de rien, de rencontrer un amoureux en train de rêver indéfiniment, et cette occupation peu moderne semble naturelle sous ces larges platanes, à quelques pas de cette façade en bossages où l’exilée de Florence voulut retrouver un souvenir du palais Pitti. Les bustes blancs des poètes, qu’une gracieuse fantaisie édilitaire a placés de-ci de-là dans les massifs, protègent d’un sourire indulgent les paresses sentimentales des promeneurs, étudiants pour la plupart, qui perdent ainsi en folles songeries les heures promises à un pressant et trop aride travail. Que Jean Monneron remplît l’une et l’autre condition du légendaire jeune premier de cet antique Quartier Latin, c’est-à-dire qu’il fût un amoureux et un étudiant, tout dans son attitude et dans sa physionomie le dénonçait jusqu’à l’évidence. Quoiqu’il fit une matinée très fraîche d’automne, — on était exactement au 1er novembre, qui, dans cette année 1900, tombait un jeudi, — Jean restait immobile sur le banc de bois où il s’était laissé choir plutôt qu’il ne s’y était assis, sans prendre garde à l’humidité pénétrante de l’atmosphère. La fièvre de l’attente qui mettait une flamme dans ses prunelles brunes suffisait à réchauffer ses membres, dont la structure se devinait un peu grêle sous le drap mince d’un de ces pardessus de demi-saison que l’argot faubourien appelle expressivement des « vinaigres ». Ce vêtement très défraîchi, avait dû être acheté, comme les autres pièces du costume, au rabais et dans une maison de confection. Mais si le jeune homme était aussi mal habillé que peut l’être un garçon, pauvre déjà, prédisposé à l’oubli du monde extérieur par l’absorption cérébrale, un air de supériorité, comme répandu sur sa personne, enlevait à son apparence tout caractère commun. Ses grosses bottines n’arrivaient pas à dissimuler l’élégance de ses pieds fins. Ses mains maigres et nerveuses sortaient de manchettes presque élimées, mais elles montraient de beaux doigts déliés d’intellectuel. Ajoutons qu’il avait tous les droits à ce nom, qu’il faut continuer d’employer, malgré l’abus qui a pu en être fait. — Il est le seul qui convienne à une certaine espèce d’hommes tels que celui-là qui sont les victimes, parfois admirables par leur noblesse, d’autres fois détestables par leur arrogance, d’un constant abus de la pensée. — Jean était le fils d’un professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, et lui-même boursier d’agrégation de philosophie à la Sorbonne. Le feutre de son chapeau de forme ronde s’était flétri à courir de la Faculté aux bibliothèques sous le soleil et sous les averses, mais il coiffait un front large et comme éclairé de pensées. Le visage creusé trahissait de précoces souffrances, supportées par un tempérament énergique, à la veille pourtant d’être trop éprouvé. Le teint appauvri révélait une existence étroite, une table médiocrement servie, un excès d’effort mental sans une suffisante réparation physique, de grands soucis peut-être et des douleurs morales inavouées. Néanmoins l’humide radical des yeux bruns, la fraîcheur saine des lèvres, la rangée intacte des dents blanches, l’épaisseur bouclée des cheveux châtains disaient des réserves de vitalité profonde. Un peu de détente dans la joie et le bien-être, et ce jeune homme s’épanouirait.
Cette détente lui serait-elle jamais accordée ? Le sort lui donnerait-il ce rayon de bonheur dont il avait le besoin presque animal ? La mélancolie de ce doute sur sa destinée se lisait dans le pli de sa bouche, où il y avait de l’enthousiasme et de l’amertume, de la volonté et du découragement. Jean Monneron allait avoir vingt-cinq ans. C’est la période où ces états contradictoires coexistent tout naturellement. L’âme du jeune homme s’est déjà meurtrie à la réalité, assez pour comprendre que ce monde est, comme la dit un sage, « une affaire brutale, » pas assez pour y flétrir la fleur de sa délicatesse native. La conscience de sa force frémit en lui, et il a peur, devant l’irréparable des décisions à prendre. Il se sait, pour employer une métaphore toute contemporaine, à une tête de ligne, et que son avenir de bonheur ou de malheur dépend d’un aiguillage sur tels on tels rails. Si des incertitudes de carrière ou même de convictions peuvent revêtir, à ce moment de la vie, un caractère de violence presque tragique, qu’est-ce alors qu’il s’agit à la fois pour le jeune homme d’un problème de conscience et d’un problème de cœur ? Le simple énoncé de la situation où se trouvait Jean fera comprendre quelle tempête intérieure le remuait, tandis qu’il surveillait d’un regard follement anxieux la porte du jardin en face de lui. Il aimait une jeune fille. Il s’en croyait aimé. Son unique, son passionné désir, depuis des mois, était de l’épouser, et il se préparait à mettre entre elle et lui quelque chose d’irrémédiable. Il l’avait demandée en mariage. Le père avait apposé à son consentement une certaine condition, et ce 1er novembre avait été fixé, d’un commun accord, comme la date où Jean donnerait une réponse sur cette condition. Que ce fût « oui », et les jeunes gens étaient fiancés. Au lieu de cela, l’étudiant s’était résolu à répondre un « non » qui lui déchirait à l’avance le cœur. S’étant rangé à un parti dont la conséquence était le renoncement volontaire à sa plus douce espérance, que disait la raison ? Qu’il était prudent d’avoir cet entretien de rupture avec M. Ferrand — c’était le nom du père de la jeune fille — sans revoir Brigitte, — c’était son nom à elle. — Par une inconséquence où tous ceux qui ont aimé reconnaîtront le goût, inné aux amants, de se faire du mal à la place la plus blessée du cœur, comme si souffrir, par ce qu’on aime, c’était encore du bonheur, Jean était venu se poster dans ce coin d’allée où il était à peu près sûr de rencontrer cette enfant. Il avait calculé que le 1er novembre était la veille des Morts. Le père et la fille avaient dû, ce matin-là, comme chaque année, aller au cimetière du Montparnasse, sur le tombeau de la mère de Brigitte. M. Ferrand avait une autre fille, mariée à un officier et qui demeurait dans le haut de la rue Notre-Dame-des-Champs. Cette fille s’était, sans doute, rendue au cimetière avec son père et sa sœur. Il était bien probable que ceux-ci la reconduiraient. Pour entrer à la rue de Tournon où ils habitaient, ils passeraient certainement par le Luxembourg, et leur chemin naturel serait par cette porte d’angle. Voilà pourquoi Jean Monneron était là depuis plus d’une heure, — à se torturer d’impatience et de désespoir, à se répéter qu’il était insensé d’épier ainsi l’apparition de celle qu’il lui était interdit d’épouser, à se démontrer qu’il ne pouvait pas, qu’il ne devait pas l’épouser en effet sous la clause imposée par le père, à souhaiter que la jeune fille ne fût pas allée au cimetière, ou qu’elle rentrât par une autre route, et à se dire, devant chaque silhouette de femme apparue au détour de la rue Bara : « C’est elle, » ou « ce n’est pas elle », avec un battement de cœur. Les choses autour de lui s’harmonisaient à la mélancolie passionnée dont il se sentait de plus en plus envahi, au fur et à mesure que les minutes avançaient. Le ciel était voilé, comme tendu de neige, avec de grands nuages plus noirs qui couraient sur ce fond grisâtre, chassés par une bise rude. Cette bise arrachait aux platanes de larges volées de feuilles jaunes qu’elle dispersait sur le gazon, brûlé par l’été d’abord, puis par la précoce gelée. Les géraniums qui bordaient les plates-bandes agitaient leurs dernières fleurs, encore rouges, mais recroquevillées et fanées. Des moineaux piailleurs dont ce vent retroussait les plumes frileuses se disputaient, à quelques pas du jeune homme, un morceau de pain, jeté par un enfant joueur. Jean ne voyait que des passants qui marchaient vite, à cause du froid, et dont la plupart étaient vêtus d’étoffes sombres. Ils allaient, eux aussi, au cimetière, ou ils en revenaient. Tout, dans ce décor funèbre de l’automne commençante, achevait d’accabler l’amoureux. Comment se fût-il retenu de comparer sa détresse présente à la félicité dont il eût débordé, même sous ces arbres aux feuilles jaunies et devant cet âpre ciel, — s’il l’eût voulu, — s’il le voulait, puisqu’il n’avait pas prononcé le « non » fatal ? Et, à de certains moments, il appuyait son front sur sa main avec un geste de révolte, il secouait sa tête accablée et il lui arrivait de répéter à voix haute une simple phrase, toujours la même, celle d’un homme qui raidit l’énergie de sa volonté contre une obsédante tentation :
— « Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas… »
Pour éviter toute équivoque, et caractériser aussitôt le drame intime dont la réponse négative de Jean au père de Brigitte risquait d’être un épisode décisif, il faut expliquer dès maintenant la nature très particulière de cette clause édictée par M. Ferrand et contre laquelle le jeune homme se débattait. L’insistance de l’un et la rébellion de l’autre portaient sur un point qui n’eût pas fait question, voici quelques années, entre des personnes aussi voisines de conditions, et, par suite, appelées, semblerait-il, à penser de même sur les actes essentiels de la vie familiale. Victor Ferrand en effet, appartenait, comme M. Monneron, au monde universitaire. Il avait été le camarade du père de Jean à l’École normale. Il était son collègue à Paris, occupant l’une des deux chaires de philosophie du lycée Henri-IV. Mais pour des Français d’aujourd’hui, — une récente et lamentable crise l’a trop montré, — vivre côte à côte, exercer le même métier, participer aux mêmes devoirs, aux mêmes plaisirs, ce n’est plus avoir la même âme. Le mal d’anarchie dont notre pays souffre depuis 1789, et dont il menace de mourir, c’est plus seulement dans les institutions, il a pénétré jusqu’au tréfonds des sensibilités. Nous n’avons plus de mœurs, au sens civique de ce beau mot. Des mœurs n’impliquent pas seulement un système d’habitudes communes. Elles veulent une conformité des cœurs entre eux et des intelligences. Les deux professeurs étaient partis des deux points les plus opposés du monde social, pour aboutir, sous une étiquette officiellement identique, aux plus radicales oppositions de sentiments et de pensées. L’un, Joseph Monneron, fils d’un cultivateur de Quintenas, en Ardèche, avait fait ses études, comme boursier, d’abord au lycée de Tournon, puis à celui de Lyon. De là, il s’était fait recevoir à la rue d’Ulm. Arrivé, grâce aux concours, à se déclasser par en haut, sa carrière offrait le type accompli du développement que préconisent les doctrinaires de notre démocratie. L’ancien boursier, devenu, à la force du poignet, un fonctionnaire important, ne devait rien qu’à lui-même et à l’État. Il avait d’ailleurs la fierté de son origine et une reconnaissance fanatique pour l’ordre de choses qui avait fait de lui un bourgeois, en quelques années d’obstiné labeur. C’était un exemplaire absolu du Jacobin, à la date de cette année 1900, — autant dire du Jacobin tout court. Pour quiconque, en effet, n’est pas la dupe de la différence des phraséologies, l’identité des formes d’esprit est surprenante entre les sophistes sanglants de 93 et leurs successeurs plus bénins, et plus dangereux peut-être, d’aujourd’hui. La suite de ce récit montrera plus en détail la nature des théories révolutionnaires de Monneron, leur rapport avec l’histoire de sa vie et leur retentissement dans sa famille. Notons seulement, pour l’intelligence immédiate de la crise traversée par son fils, que l’universitaire radical et libre-penseur avait élevé ses enfants hors de toute espèce de religion. « Je ne me reconnais pas le droit, » disait-il, « d’enseigner à des êtres, sans défense contre leurs premières impressions, des hypothèses invérifiées. » Le logicien avait poussé ce parti pris jusqu’au bout : aucun de ses enfants n’avait été baptisé. M. Victor Ferrand est trop connu par son remarquable livre : La Tradition et la Science, pour qu’il soit nécessaire d’exposer ici les principes de ce disciple de Bonald et de Le Play, qui reste, depuis la mort de ses aînés, MM. Ollé-Laprune et Charpentier, un des chefs les plus en vue de la philosophie catholique dans l’Université. Issu d’une famille de propriétaires angevins, et suffisamment riche pour ne pas dépendre de son traitement, ce chrétien avoué n’a jamais dissimulé l’intégrité de ses convictions. Il n’est que juste de reconnaître que la République les a jusqu’ici respectées. Comment et pourquoi un pareil homme s’était-il trouvé admettre un Jean Monneron dans son intimité ? Cette inconséquence apparente sera comprise par tous ceux qui ont approché un vrai professeur tel que celui-là, un de ces accoucheurs d’esprits, possédés par le goût, par la passion du talent jeune. Les éducateurs de grande race éprouvent, à discerner dans un écolier de dix-sept ans les premiers linéaments de la supériorité future, des émotions d’inventeurs et d’artistes. Préciser, hâter l’achèvement de cette ébauche, conspirer à l’éclosion de cette noble fleur humaine, s’associer à ce miracle : la formation d’une belle intelligence, telles sont les délices de ces maîtres, qui demeurent le plus souvent anonymes. Que représentent aujourd’hui, sauf pour de bien rares piétés, les noms d’un Rinn et d’un abbé Noirot, et, plus près de nous, d’un Aubert-Hix, d’un Merlet, d’un Charles ? M. Victor Ferrand appartenait à cette élite, et de là son amitié pour Jean ; Avant d’être nommé à Henri-IV, il avait été suppléant à Louis-le-Grand, où le jeune homme achevait ses études. Il l’avait eu comme élève. Il s’était intéressé à cette nature distinguée et que certaines circonstances de désaccord intime avec son milieu rendaient pathétique. C’était l’époque où la femme du professeur de philosophie venait de mourir. Vivant seul avec sa fille cadette, il n’avait peut-être pas eu, sur les rapports possibles entre ce disciple favori et cette fille, les prudentes appréhensions qu’aurait eues une mère. Peut-être aussi son affection pour Jean lavait-elle induit à fermer les yeux sur un sentiment naissant qu’il avait vu Brigitte partager, avec la joie profonde d’un père qui, dans ses rêves, s’est souhaité pour gendre celui même que sa fille a choisi. Un autre motif, et justement celui qui semblait devoir faire obstacle à cette union, la lui rendait, au contraire, plus désirable. On a compris qu’il s’agit de la religion. Quoique le strict respect du devoir professionnel eût toujours empêché M, Ferrand de transformer son cours de philosophie en un instrument de propagande, ses convictions catholiques étaient trop connues, elles tenaient par des liens trop serrés à l’ensemble de ses idées pour que certains de ses élèves ne fussent pas tentés de l’interroger. Même aujourd’hui, le préjugé, perfidement mis à la mode au dix-huitième siècle, demeure si vivace, l’antinomie entre la croyance et la raison est si généralement admise, que la coexistence, dans un grand esprit, de la haute culture et de la foi, déconcerte comme une anomalie paradoxale. Jean Monneron, en particulier, avait dû être plus étonné qu’un autre d’une attitude intellectuelle qui contredisait si violemment les théories acceptées, respirées plutôt dans l’atmosphère paternelle. Notez que M. Ferrand n’est pas seulement traditionnaliste en religion. Il l’est aussi en politique et ne parle de la Révolution qu’en employant la formule de Le Play sur les « faux dogmes de 89 ». La curiosité passionnée, excitée chez Jean par la rencontre d’idées si différentes des siennes, ses hardies questions, son ardeur à forcer la réponse, toute cette fièvre communicative d’une jeune conscience qui se cherche, avaient entraîné Ferrand à des discussions dont il s’était d’abord fait scrupule. Puis, ces débats l’avaient intéressé autant et plus que son élève. Il s’était créé entre ces deux pensées une de ces relations presque impossibles à définir, car elles n’ont guère d’analogue. L’intelligence de chacun était devenue pour l’autre un champ d’action presque nécessaire. Les allées et venues du souple esprit du jeune homme, ses abandons et ses reprises, ses concessions et ses dérobements avaient fini par donner à leurs entretiens, en apparence si abstraits, — ils ne parlaient jamais que d’idées, — une chaleur et presque une âpreté de combat. La funeste guerre civile à laquelle une retentissante affaire judiciaire servit de prétexte plus que de cause, les avait, un moment, séparés jusqu’à la brouille. Il n’est pas besoin de dire dans quel camp le lucide et sage génie de M. Ferrand l’avait rangé. Après une année entière d’absence et de silence, Jean était, un beau jour, revenu chez son maître, qui l’avait accueilli les bras ouverts. Mais, d’un commun accord, les deux hommes s’étaient, depuis cette époque, interdit précisément les sujets qui les enflammaient le plus jadis. Ferrand, toutefois, n’avait pas cessé d’observer son ancien élève de son perspicace regard. Des signes de tous ordres lui avaient montré que cette conscience continuait d’être très inquiète, très troublée. Il se faisait en elle un travail. C’est durant cette période qu’il avait constaté un romanesque éveil d’amour dans le cœur de Jean et dans celui de sa fille. Il n’eût pas été le croyant qu’il était, tout pénétré d’une foi à la Joseph de Maistre dans la constante action de la Providence sur nos destinées privées, s’il n’avait pas vu, dans ce réciproque attrait, une grâce d’en haut, un moyen dont Dieu se servait pour ramener une âme. Aussi, lorsque Jean s’était décidé à se déclarer enfin et à lui parler de son sentiment pour Brigitte, le père avait été persuadé que cette démarche supposait chez le jeune homme une évolution définitive. Demander la main de Mlle Ferrand, c’était s’obliger à un mariage religieux, et un tel mariage supposait que Jean Monneron se fît catholique. Puis, en pressant le jeune homme, M. Ferrand avait reconnu avec stupeur que celui-ci, trompé sans doute par le profond respect que son maître montrait toujours pour la sincérité des convictions contraires aux siennes, avait nourri l’illusion d’une union célébrée à l’église, mais, comme il arrive dans les mariages mixtes, sans qu’il fût obligé lui-même d’adopter la religion de sa fiancée. Le philosophe n’était pas homme à se contenter d’un semblable compromis, d’ailleurs plus difficile qu’aucun autre à faire accepter par Rome, sans des motifs impérieux qu’il n’avait pas assez nettement aperçus dans le cas présent. Il n’avait vu là qu’une preuve d’un défaut qu’il avait le plus souvent observé dans son élève, et essayé de corriger : l’incertitude. Il avait donc répondu à l’amoureux de Brigitte qu’il ne donnerait sa fille qu’à un catholique déclaré et pratiquant. Sa surprise avait été plus grande encore à constater, chez Jean Monneron, un réel saisissement d’épouvante à la seule pensée d’un acte aussi grave, aussi mêlé aux profondeurs de la conscience. Il l’avait cru si préparé, si voisin d’une adhésion définitive à ce qu’il croyait, lui, être la vérité, et il le trouvait si vacillant, si hésitant encore ! Le jeune homme avait demandé huit jours pour réfléchir. Le père les avait accordés. Ce 1er novembre marquait la fin du délai.
On connaît maintenant le secret de la profonde détresse dont Jean était atterré par cette froide matinée, sur ce banc solitaire du jardin du Luxembourg. Quoi qu’il fût, depuis quelque temps, bien attiré vers les idées de son ancien maître, par suite de toute une évolution intérieure, plus attiré peut-être que celui-ci ne le supposait, le pas lui semblait si définitif, si solennel ! Ce baptême à vingt-quatre ans, c’était une telle rupture avec tout son passé, avec tout son milieu ! Il entrevoyait de tels conflits, et un surtout de telle nature ! D’autre part, les raisons qui le rapprochaient des convictions de M. Ferrand laissaient en lui une telle place au doute !… Bref, il lui avait été impossible de se décider dans le sens où le poussait son cœur. Son amour même avait été un obstacle de plus. Il s’était demandé si l’attraction qu’exerçaient sur lui les doctrines du père de Brigitte ne dérivait pas, sans qu’il s’en rendît compte, du sentiment qu’il portait à la jeune fille. La probité intellectuelle a ses maladies de scrupule comme l’autre. Bien résolu à retirer sa demande, pour ne pas accepter une clause à laquelle il ne pouvait se soumettre en toute conscience, sa violente douleur augmentait encore l’énergie de cette résolution. L’idée de l’effort s’associe trop aisément dans les âmes délicates à l’idée de mérite : elles sont toujours tentées de se mésestimer de ce qui leur plait et de s’estimer de ce qui leur coûte. Et qu’il en coûtait à Jean de renoncer pour toujours à l’amie dont la grâce blonde allait rayonner tout à l’heure dans ce décor d’automne et de tristesse, si ses calculs s’étaient trouvés justes !
Ils l’étaient. Les amoureux ont à leur service un don de divination presque infaillible, qui ressemble aux visions du génie. Le principe n’en est-il pas identique : des facultés de logique portées à un degré supérieur sous l’influence de l’observation aiguë et de l’idée fixe ? Brigitte Ferrand s’approchait, en effet, à ce moment même, de ce coin du jardin où Jean Monneron l’attendait. Si la magie d’intuition qui avait décidé le jeune homme à se poster près de cette porte d’angle se fût exaltée jusqu’à la double vue, et s’il avait pu, des yeux de sa chair, percer le massif des maisons dressées devant lui, il eut aperçu celle qu’il aimait en train de suivre le trottoir de la rue Notre-Dame-des-Champs auprès de son père. Ils venaient, l’un et l’autre, de reconduire chez elle Mme Portier, la sœur mariée de Brigitte, et ils se préparaient à tourner par la rue Bara, qui débouche précisément en face de cette entrée du vieux jardin choisie par Jean. Et peut-être son énergie n’eût-elle pas tenu bon une minute, s’il eût pu non seulement la voir, mais l’entendre qui causait en tête à tête avec son père et parlait de lui. Il savait bien, quoique ne s’étant jamais permis de lui dire ses sentiments, qu’elle les avait devinés. Il croyait savoir aussi, malgré sa réserve, qu’il ne lui déplaisait pas. Il n’avait pas osé imaginer la vérité : qu’elle l’aimait autant qu’il l’aimait. Surtout, il ignorait que M. Ferrand fût le confident de cet amour et qu’il n’eût caché à Brigitte ni la demande de Jean, ni sa propre réponse. Cette entière sincérité du père vis-à-vis de sa fille avait ses dangers trop évidents. Elle tenait à la nature un peu exceptionnelle des rapports qui les unissait. Brigitte Ferrand était de la lignée d’Antigone, de cette « enfant du vieillard aveugle », la plus pure création du génie antique, qui joint à la féminilité du dévouement le plus attentif une vigueur d’intelligence presque masculine, — si tendre, pour asseoir sous les oliviers de Colone l’infortuné qu’elle guide, — si hardie, pour affirmer, devant un juge inique, l’existence de « ces lois non écrites, immuables, dont nul ne sait quand elles ont pris naissance ». Chargée, à quinze ans, de remplacer sa mère morte au foyer d’un père qu’elle admirait autant qu’elle l’aimait, Brigitte avait voulu devenir, pour cet homme supérieur, mieux qu’une ménagère, une compagne de pensée, bien humble, bien modeste, et qui l’aidât cependant à supporter la solitude du veuvage. Cela avait commencé par de tout petits services, comme de recopier les manuscrits du philosophe, comme de transcrire pour lui des extraits, comme de lui lire, le soir, à haute voix, et dans des revues spéciales, des articles dont le titre seul prenait, sur ces lèvres de jeune fille, de touchantes allures de paradoxe. L’hérédité aidant l’affection, elle était arrivée à comprendre, à partager les idées du professeur. C’était aussi ce goût profond et cette entente des choses de l’intelligence qui l’avaient intéressée à Jean. Quoique son instinct de femme lui fit éviter soigneusement tout air de savante, et qu’elle eût même, par réaction, un rien de coquetterie dans sa toilette, sa physionomie trahissait cet excès, cette anomalie plutôt, de culture. L’expression du visage était plus âgée que les traits. Avec des lignes d’une régularité presque classique, elle était moins jolie que belle. Un je ne sais quoi de trop grave flottait autour de sa bouche, pourtant si jeune, et dans le regard de ses prunelles pourtant si bleues. Elle était assez grande, avec une tête plutôt petite, de forme ovale, que couronnaient d’admirables cheveux blonds. Son teint très clair, presque transparent, pâlissait et rougissait à la moindre émotion, d’une manière qui révélait, chez cette enfant, précocement initiée aux plus abstruses théories de la psychologie et de la métaphysique, la plus vive, la plus spontanée sensibilité. Ces deux côtés de sa nature, trop réfléchie et trop émotive tout ensemble, se retrouvaient dans l’entretien qu’elle avait avec son père, ce matin-là, et qui avait commencé dès le seuil de la maison de sa sœur aînée. À peine avaient-ils pris congé de celle-ci, laissée jusqu’ici absolument en dehors de leurs projets, Brigitte avait demandé :
— « Vous devez être content de moi, mon père ?… » Comme on le voit, le traditionnaliste partageait, sur le chapitre du tutoiement, l’opinion de son maître Bonald, lequel a écrit avec son austère ironie : « On ne tutoie plus que son père et sa mère. Cet usage met toute la maison à l’aise. Il dispense les parents d’autorité et les enfants de respect… » Ce petit détail donnera la nuance du caractère et des manières de M. Ferrand, chez qui la bonhomie se relève d’une courtoise, mais souveraine dignité : « Oui, » avait insisté la jeune fille, « je vous avais promis, il y a huit jours, de ne plus vous parler de M, Monneron, et d’être calme. C’est la première fois de cette semaine que je vous aurai prononcé son nom, et j’ai été calme, très calme. Je la suis plus encore ce matin. Je viens de demander à ma mère d’intercéder là-haut pour que les choses soient telles que je les désire… C’est comme si j’avais reçu une promesse… Ah ! mon père, que je plains ceux qui n’ont pas la foi ! Comment vivent-ils avec leurs morts ? Et ne pas vivre avec ses morts, c’est ne pas avoir de famille. Quand je pense qu’il n’a pas connu, jusqu’ici, ces joies profondes que donnent les pratiques religieuses, que je suis tentée de le plaindre !… »
À mesure qu’elle parlait, montrant à nu, dans leur ingénuité, ses espérances et son amour, elle pouvait voir un pli soucieux contracter le front et la bouche de son père. M. Ferrand était un homme de cinquante-trois ans, taillé en force, avec un visage dont la pâleur naturelle s’était accrue par une existence trop sédentaire. Ce teint mat était d’autant plus saisissant qu’il contrastait fortement avec la noirceur des cheveux et de la barbe, où des fils d’argent commençaient à peine de courir. Il y avait, dans ce masque un peu lourd, aux traits fins, presque ténus, de la puissance et de la subtilité. L’ensemble rappelait vaguement le célèbre portrait des Offices qui passe pour représenter Léonard. L’expression était si noble qu’elle faisait oublier une infirmité qui eût défiguré un autre visage : une convulsion enfantine avait fortement dévié l’œil droit. Ce regard bigle s’accordait avec cette physionomie, comme abstraite du monde extérieur et tournée en dedans, qu’éclairait la sérénité ardente des certitudes profondes. L’accent de sa fille, plus encore que ses mots, venait de lui prouver, une fois de plus, qu’il n’avait pas été assez prudent, et qu’il eût mieux valu ne pas lui annoncer la démarche de Jean Monneron, avant d’avoir la réponse du jeune homme sur le point encore en suspens. Pour Brigitte, évidemment, cette réponse ne faisait pas doute. M. Ferrand, lui, en revanche, se rendait trop compte que, si l’amoureux n’avait pas raccourci de lui-même ce délai des huit jours, la raison en était dans une hésitation de plus en plus grande. Il pressentait maintenant la résolution définitive de Jean, dont lui non plus d’abord n’avait pas douté, et il en redoutait le contre-coup sur sa fille :
— « Ma pauvre Brigitte, » reprit-il donc, « tu me dis que tu es calme et tu viens de me parler avec une exaltation dont j’aurais peur, si je ne te savais pas si courageuse, quand il le faut. À t’entendre, la réponse que nous attendons aujourd hui sera certainement ce que nous souhaitons qu’elle soit. Si elle était le contraire cependant ? Si, au dernier moment, les idées qui ont empêché Jean d’accepter aussitôt la condition que nous avons mise, toi et moi, à notre consentement, étaient les plus fortes ?.. Moi aussi, » continua-t-il, « je crois à une mystérieuse influence des morts sur les vivants, et qu’ils peuvent obtenir pour nous, comme nous pouvons obtenir pour eux. C’est tout le sens de la fête d’aujourd’hui et de la communion des saints. Mais je crois aussi que la décision suprême d’une volonté dépend d’elle seule. Je ne t’ai pas caché que, dans les circonstances qui ont amené les choses où elles en sont, j’ai cru voir un dessein caché, une invite de Dieu à cette âme. Cette âme s’y rendra-t-elle ? C’est ce que ni toi ni moi nous ne pouvons savoir, mon enfant. »
— « Vous craignez mon chagrin, si j’étais déçue, mon bon père, » dit Brigitte, en secouant la tête, avec un sourire ému et confiant. « Je ne peux pas l’être. Vous m’avez raconté vous-même que l’incrédulité de M. Monneron n’était que de l’ignorance. Vous lui avez si souvent appliqué devant moi cette belle phrase du cardinal Newman : Je n’ai jamais péché contre la lumière. Il sait, maintenant que vous avez tant discuté avec lui. Toutes ses objections, vous les avez dissipées. Toutes vos réflexions, vous les lui avez communiquées. Vous lui avez prouvé la religion. Comment ne croirait-il pas ?
— « On ne prouve pas la religion, » repartit le philosophe. « Je t’ai dit cela aussi, bien souvent. On donne des raisons de croire, ce qui n’est pas la même chose. Une conversion n’est pas une œuvre purement intellectuelle. Sans cela, tout le monde croirait, ou bien personne. On croit avec tout son être, avec son intelligence, certes, mais aussi avec son cœur et avec sa volonté. Il y a des gens qui n’aiment pas à croire, qui ne veulent pas croire, et ils en arrivent à obscurcir pour eux jusqu’aux ténèbres, ce qui, pour toi, pour moi, fait évidence et lumière. Quand Jean Monneron était mon élève, plus d’une fois j’ai vu son intelligence s’ouvrir, se donner, venir à la foi, et sa volonté l’arrêter net dans cet élan. Qui sait s’il n’en est pas de même aujourd’hui ?… »
— « Mais, » dit Brigitte, « sa démarche auprès de vous était sincère, et, s’il veut m’épouser, » — elle souligna le mot en le prononçant, — « il doit vouloir tout ce qui peut l’y aider, excepté une démarche contre la conscience… »
— « Et s’il pense que c’est le cas ? » reprit M. Ferrand, et, sur un geste étonné de sa fille : « Tu oublies qu’entre lui et nous, il y a son père… » — Et, comme Brigitte esquissait de nouveau son geste : « Comprends-moi bien.» continua-t-il, « je sais parfaitement que le père ne refusera pas son consentement. S’il avait dû le refuser, je n’aurais même pas laissé Jean formuler sa demande. Je connais mon ancien camarade. Il met son point d’honneur à laisser ses enfants absolument libres. C’est la raison pour laquelle il ne les a pas fait baptiser. Il a voulu qu’ils choisissent, une fois majeurs, en pleine indépendance. Il est sincère dans cette persuasion qu’il ne les a jamais influencés. Cela n’empêche pas que, le jour où Jean viendra lui dire : « Je me marie à l’église et je suis catholique, » ce sera pour lui un déchirement, une faillite, la banqueroute de l’éducation morale qu’il a donnée à son fils. Il n’y a pas de neutralité vraie sur certains points. Monneron se croit tolérant. Il est un fanatique à rebours. La religion, pour lui, c’est le poids mort du passé, le legs de superstition d’une humanité inférieure. Il la hait de tout l’amour qu’il porte à ce qu’il croit le progrès et la raison. De voir Jean retourner à cette erreur, il en souffrira cruellement, et Jean le sait. Tu parles de conscience. Voilà le scrupule qui peut troubler la sienne »
— « Vous m’aviez bien dit, » reprit la jeune fille, après un silence, « que M. Monneron le père n’était pas religieux. Mais il ne s’agit donc pas d’une indifférence ? Il s’agirait d’une haine ? Vous venez de prononcer ce mot… Est-ce possible ?… Lui, un si honnête homme !… »
— « Il est un très honnête homme, en effet, » répondit M. Ferrand, « par tant de côtés. Et pourtant, tu as raison, ce n’est point par les portions hautes de son être qu'il sent ainsi. Son excuse, c’est qu’il ne se rend pas compte des mobiles auxquels il obéit dans cette haine. C’est un des points où sa famille est malade en lui, — hélas ! où la France est malade dans sa famille. Suis la filière, et, toi qui connais si bien mes idées sur le principe de continuité, ce que l’Église appelle la réversibilité, tu en trouveras ici une confirmation bien significative. Cette famille Monneron a commis une première faute, dans le grand-père, qui était un simple cultivateur. Il avait un fils très intelligent. Il a voulu en faire un bourgeois. Pourquoi ? Par orgueil. Il a méprisé sa caste, ce jour-là, et il a trouvé un complice dans l’État, tel que la Révolution nous l’a fait. Toutes ces lois sur lesquelles nous vivons depuis cent ans, et dont l’esprit est de niveler les classes, d’égaliser pour tous le point de départ, de faciliter à l’individu les ascensions immédiates, en dehors de la famille, ce ne sont pas davantage des lois saines et généreuses. Ce sont des lois d’orgueil. À quel sentiment s’est-on adressé chez Monneron, au collège ? À l’orgueil. Dans ses examens ? À l’orgueil. Quand je l’ai rencontré à l’École normale, tout son développement n’était qu’un développement d’orgueil. Voilà pourquoi il n’a pas cru. Il a pensé à l’encontre de notre tradition religieuse. Ce faisant, il a estimé qu’il obéissait à sa raison. En réalité, il s’est fourni des prétextes pour justifier une attitude qui n’était que l’instinct déposé en lui par toutes ces données. Il est un vrai représentant d’une époque dont l’aberration consiste à vouloir que chaque génération recommence la société ! Son irréligion est comme son radicalisme, la preuve qu’il ne vit pas avec ses morts, lui, pour prendre ton mot de tout à l’heure. On l’en a séparé et il s’en est séparé. Sa pensée et sa volonté vont contre sa race, au lieu d’en être la continuation, le prolongement. Mais il est écrit qu’il ne sera demandé à chacun de nous que ce qu’il aura reçu. Voilà pourquoi, je te le répète, Monneron est un honnête homme avec les idées d’un sectaire, et voilà pourquoi la conversion de son fils, si elle a lieu, le bouleversera comme un reniement… »
— « Vous admettez pourtant, » interrogea Brigitte, « que cette conversion est un besoin de cette âme ? Comment expliquez-vous alors que l’enfant d’un tel père ait, au contraire, cette nostalgie de Dieu ? C’est votre mot, vous l’avez employé, il y a huit jours encore, dans notre grande conversation… »
— « Tu touches là, mon amie, à un grand mystère, » dit le philosophe. « Qu’il y ait un atavisme moral, comme il y a un atavisme physique, une hérédité en retour des idées et des sentiments de nos aïeux, c’est un fait indiscutable. Pourquoi cette hérédité se manifeste-t-elle dans un individu plutôt que dans un autre ? Le problème n’est pas plus soluble que celui de l’inégalité des talents ou tout simplement des santés, entre frères et sœurs, nés des mêmes parents, dans des conditions identiques. Ce qu’il y a de certain, c’est que Jean Monneron est travaillé, depuis des années, par cet atavisme qui n’a jamais tourmenté son père. La bonne race des cultivateurs Vivarais, dont il est issu, se révolte en lui, malgré lui, contre l’erreur paternelle. Ce fils d’un Jacobin a de continuels retours vers la vieille France. Il voudrait aimer la France nouvelle, et tout l’en écarte. Cet enfant d’un incrédule étouffe dans la négation. Il est né d’un fonctionnaire et d’un déraciné ; et il ne rêve, quand il s’abandonne à ses goûts, que d’une famille établie, de mœurs locales et traditionnelles, d’un milieu terrien. Cette lutte secrète dure depuis que je le connais. C’est la cause qui m’a tant intéressé à lui, durant son année de philosophie. Je n’ai jamais connu un jeune homme dont le malaise démontrât plus complètement combien les sophismes du monde révolutionnaire sont meurtriers à un esprit juste et à un cœur droit… Et puis, il t’a aimée. J’ai vu grandir ce sentiment. J’ai vu que tu le voyais aussi, qu’il t’attendrissait. Il m’a semblé que le bonheur pouvait être là, pour vous deux. Aujourd’hui, je me demande si je ne me suis pas trompé, puisque la lutte intérieure dont il était déjà victime, à dix-huit ans, continue à vingt-cinq, à travers et malgré cet amour… »
— « Non, mon père, » reprit Brigitte, en touchant de sa main le bras de M. Ferrand, « la lutte ne continue pas et le bonheur est là… » Et, en indiquant à son compagnon d’un gracieux hochement de sa tête fine, elle ajouta : « lui aussi, il est là… » Elle venait d’apercevoir Jean Monneron, qui, de son côté, l’avait reconnue. Il s’était levé de son banc, avec la gêne, toujours si touchante pour une femme qui aime, de quelqu’un qui attend depuis des heures et qui veut avoir l’air de s’être trouvé là par hasard. Quoique les préoccupations de M. Ferrand fussent bien grandes et qu’il considérât comme très important l’entretien dont cette présence de son ancien élève annonçait l’imminence, il ne put, lui non plus, s’empêcher d’être attendri et amusé par cette gaucherie de l’amoureux. Dans l’atmosphère de tension intellectuelle où il vivait, et où il faisait, par contagion, vivre sa fille, c’était une bouffée de jeunesse, un souffle de nature et de spontanéité que cet enfantillage de Jean, surpris dans son aguet, confus et s’excusant d’être là par des phrases maladroites. Ses explications balbutiées, en abordant M. et Mlle Ferrand, trahissaient un si naïf embarras que le père en sourit, et ce fut avec la plus indulgente moquerie qu’il y coupa court :
— « Vous n’alliez nulle part ? » lui dit-il. « Hé bien ! tant mieux ! Vous nous accompagnez jusqu’à la maison. »
II L’obstacle
Les trois promeneurs commencèrent donc à marcher ensemble dans la direction du Palais, le père séparant les deux jeunes gens. La première impression d’amusement et d’attendrissement avait cessé tout de suite, et ils n’échangeaient les uns avec les autres que des phrases indifférentes qui tombaient, presque sans réponse, dans un silence chargé de trop de pensées. Tous les trois étaient en effet dominés par des idées qui leur tenaient de trop près au cœur pour qu’ils pussent les dire, et elles leur enlevaient la force de soutenir une autre conversation. M. Ferrand avait aussitôt compris, devant le visage sombre et fermé de Jean Monneron, que sa venue au-devant d’eux ne signifiait pas le facile acquiescement dont s’était flattée Brigitte. Le tendre optimisme de celle-ci n’avait pas tenu non plus contre cette physionomie tourmentée, ni surtout contre le regard d’angoisse dont le jeune homme l’enveloppait de temps à autre. C’est qu’à la voir marcher ainsi, près de lui, avec sa taille svelte, avec la ligne si douce et si réfléchie de son profil, avec ses beaux yeux bleus, remplis d’âme, elle lui apparaissait comme plus charmante encore, comme plus digne d’être aimée pour toujours et uniquement. L’homme supérieur dont elle était la fille ne s’était jamais révélé plus affable, plus attirant, rien que par sa manière de respecter les émotions devinées chez les deux amoureux. Il était vraiment le père d’élection que Jean se serait choisi, le grand aîné auquel pouvoir dire tout ce qu’il devait taire à son vrai père, tant d’incertitudes et de troubles ensevelis au fond de son cœur !… Le vent continuait à chasser les feuilles des platanes le long des allées, la lourde pesée du ciel d’automne à envelopper de mélancolie les statues lavées de pluie, les massifs glacés, le bassin frissonnant, le palais décoloré. L’étudiant pouvait reconnaître une image de son sort actuel dans cette vision de félicité qui passait, passait, et, quand elle ne serait plus là, il ne resterait qu’un sinistre et solitaire décor d’hiver. Et de nouveau la tentation le ressaisissait de ne pas la laisser passer, cette félicité, de ne pas l’accepter, cette solitude. Un mot suffisait… Il ne devait pas le prononcer. Il ne le pouvait pas. Tous les motifs qu’il s’était donnés pour renoncer à son rêve, durant ces huit jours d’un si passionné, d’un si scrupuleux examen de conscience, se levaient du fond de son âme à chaque geste de la jeune fille. Plus elle l’enchantait par sa grâce intelligente et délicate, plus il apercevait de bonheur assuré devant lui, s’il le voulait, et plus la voix intérieure lui commandait de résister, de ne pas sacrifier des raisonnements à une émotion, un principe obligatoire à une joie, si ravissante fût-elle. Et cet orage intime se déchaînait en lui, tandis qu’il prononçait, comme M. Ferrand lui-même, et comme Brigitte, d’insignifiantes paroles sur les menus incidents de cette interminable traversée du jardin : un nom inscrit à la base d’une statue, l’aspect d’un des monuments par ce jour voilé, la rencontre, au passage, d’une figure de connaissance. Cette contrainte, douloureuse pour tous les trois, quoique à des degrés inégaux, — car, chez le jeune homme, elle était du désespoir, et chez ses interlocuteurs seulement de l’anxiété — ne cessa qu’à l’arrivée dans la maison de la rue de Tournon, et lorsque, Brigitte les ayant laissés, les deux hommes se retrouvèrent face à face dans le cabinet de travail de M. Ferrand. Cette vaste et haute chambre attestait, comme la cour et comme l’escalier, que l’hôtel, aujourd’hui distribué en quelques appartements, avait été, au dix-huitième siècle, une de ces larges demeures parlementaires faites à souhait pour une famille bourgeoise, opulente et simple. La noble décoration de cette pièce : les couronnements des fenêtres et des portes, la forme de la cheminée avec son chambranle en anse de panier et la coquille de son cartel, dataient du milieu du dix-huitième siècle. Quatre grands corps de bibliothèque accentuaient, par les reliures sévères des gros livres qui les remplissaient, cet air d’autrefois. La chambre était éclairée par deux hautes fenêtres qui ouvraient sur un balcon, suspendu lui-même sur les débris d’un jardin. Une copie ancienne, peut-être une réplique, du portrait si intelligent, si humain, si français, d’Arnaud d’Andilly, par Philippe de Champaigne, était le seul objet d’art qui parât cette salle de travail, aménagée pour la méditation, et qui semblait juste à la mesure de la puissante physionomie du philosophe. Aussitôt entré, il avait fait signe à son élève de s’asseoir. Il avait pris place lui-même à son bureau et il lui avait demandé :
— « M’apportez-vous votre réponse, ou bien désirez-vous avoir devant vous quelques jours encore ? »
— « Je vous apporte ma réponse, » fit Jean Monneron. « Huit jours, quinze jours de plus n’y changeraient rien, puisque je me retrouverais dans les mêmes conditions et devant le même obstacle. »
— « Alors, si je comprends bien, c’est non, » reprit M. Ferrand, après un silence.
— « C’est non, » répéta le jeune homme, d’une voix basse, ferme et triste. « J’ai bien réfléchi, mon cher maître, bien lutté aussi, depuis ces huit jours. J’aurais tant voulu venir à vous aujourd’hui, en vous disant : Je suis prêt à me faire baptiser. Conduisez-moi chez le prêtre que vous avez choisi… Hé bien ! je ne peux pas… »
— « Je m’y attendais, » répondit M. Ferrand. Il avait, tandis que le jeune homme prononçait cette déclaration, appuyé son coude sur la tablette du bureau chargé de papiers, et, son front sur sa main, avec un air d’accablement où son interlocuteur pouvait voir à quelle profondeur ses paroles atteignaient le père et le croyant : « Si vous aviez dû répondre : oui, vous n’auriez pas hésité huit jours, pas une minute. Je ne suis pas aveugle. Je sais combien vous aimez Brigitte, et depuis longtemps. »
— « Si je l’aime !… » s’écria Jean, et, l’espèce de pitié attendrie avec laquelle son maître venait de lui parler lui ayant soudain ouvert le cœur, toutes ses émotions de cette matinée lui jaillirent soudain à la bouche en paroles passionnées : « Si je l’aime… ! » répéta-t-il. « Du moins, vous, vous ne me méconnaissez pas. Vous me plaignez… Mais lui donner mon nom, mon cher maître, vivre avec elle, toujours, fonder avec elle un foyer, travailler pour elle, auprès d’elle, par elle, essayer d’avoir un peu de talent, un peu de réputation peut-être, à cause d’elle, ah ! c’était ma vie fixée. C’était tout ce que j’ai pu souffrir déjà, réparé !… Et vous si près de moi, votre esprit si grand, si généreux, me soutenant, m’appuyant, c’était le bonheur !… Pour que j’y renonce, vous le devinez, il faut qu’il y ait un obstacle par-dessus lequel je ne peux pas passer. Monsieur Ferrand, je ne vous fait aucun reproche, remarquez, de la condition que vous m’avez imposée. Vous ne seriez pas là, que Mlle Brigitte me l’imposerait aussi, j’en suis sûr, et elle aurait raison, comme vous avez raison. Vous agissez tous deux suivant votre conscience. Je ne peux pas ne pas agir suivant la mienne, et elle ne me permet pas de me faire catholique… »
— « Donnez-moi la main, mon enfant, » dit M. Ferrand. L’accent de son ancien élève lui avait infligé une fois de plus l’émotion très particulière qui naît chez les vrais apôtres au contact de certaines âmes d’incrédules. Ils les sentent si belles, si chaudes, et, les trouvant étrangères à leurs idées, ils en souffrent. Ils voudraient communier avec ces nobles sensibilités dans une foi pareille, et, tout en se défendant d’exercer sur elles aucune pression, il faut qu’ils s’essaient à se les attirer. La tentation était trop forte et si instinctive ! Persuadé qu’il agissait uniquement pour le bonheur de sa fille, le père de Brigitte ne se doutait pas que c’était aussi le besoin de conquérir cette généreuse intelligence qui lui faisait, en ce moment même, insister, avec cette douceur prenante, qui est le don des maîtres. « J’ai bien désiré, » continua-t-il, « que votre résolution fût autre… Si j’ai accueilli votre demande comme je l’ai fait, vous l’avez compris, c’est que j’ai vu dans ce mariage toutes les chances de bonheur pour Brigitte, et c’est aussi que je vous aime beaucoup, mon enfant. Je vous l’ai prouvé à trop de reprises pour que vous en doutiez. À cause de cette amitié, et pour que vous pussiez toujours revenir chez moi sans arrière-pensée, j’ai évité avec vous, ces dernières années, les divers points où mes convictions auraient pu paraître violenter les vôtres. Cette amitié me permet aujourd’hui de vous dire : Vous faites, de votre refus à l’unique condition que j’aie posée à votre mariage, une question de conscience. Mais une question de conscience comporte un pour et un contre. Elle se discute. Vous l’avez discutée avec vous-même. Vous pouvez vous tromper, vous être créé des scrupules imaginaires, n’y avoir pas vu clair dans votre pensée. Supposez que je ne sois pas le père de Brigitte, que je sois votre vieux professeur de philosophie simplement ; que vous vous trouviez, vis-à-vis d’une famille de moi inconnue, précisément dans la situation où vous êtes vis-à-vis de la mienne, et que vous veniez me consulter. Voulez-vous me laisser vous parler comme je vous parlerais ?… Oui ?… Hé bien ! Pouvez-vous me définir, me marquer le point exact de votre scrupule ?… »
— « Le point exact ? » répondit le jeune homme. « C’est que je ne crois pas, tout simplement, et qu’accepter, que demander le baptême dans ces conditions-là, ce serait mentir, et non pas mentir par silence, comme font tant de gens, catholiques de naissance, qui, ayant perdu la foi, se marient à l’église. Ils n’ont qu’à se taire de leurs doutes, comme je comptais me taire des miens, quand je m’imaginais que la cérémonie religieuse serait pour moi ce qu’elle est pour un protestant ou pour un juif qui épouse une catholique. Elle ne le serait pas, et je me trouve dans la nécessité non plus de me taire, mais de parler. Il faut que je déclare qu’un certain système d’idées, où j’ai été élevé, est faux, — et je n’en suis pas assez sûr ; — qu’un autre, tout contraire, est vrai, et je n’en suis pas sûr davantage. Me faire catholique, c’est une profession de foi. C’est un acte positif. C’est une affirmation. Vous, mon cher maître, m’estimeriez-vous d’avoir affirmé publiquement, solennellement, ce à quoi je ne croirais pas ? »
— « Non, » répondit M. Ferrand, « mais est-il vrai que vous ne croyez pas ?… Vous le dites. C’est peut-être que vous confondez deux choses bien différentes, et qui doivent rester différentes, ce qu’un grand médecin de notre temps, qui est aussi un grand chrétien, le professeur Grasset, de Montpellier, et, depuis, un autre grand savant qui n’est pas encore chrétien, lui, mais qui comprend la croyance, Jules Soury, ont si bien résumé, quand ils ont distingué les certitudes du laboratoire et celles de l’oratoire. Cette distinction, la faites-vous vraiment ? Vous pensez que vous ne croyez pas, parce que vous ne vous trouvez pas, vis-à-vis des vérités religieuses, dans une attitude mentale pareille à celle que vous avez vis-à-vis des vérités physiques et chimiques, par exemple. Mais, moi non plus, je ne l’ai pas. Les dogmes de l’Église dont je suis le plus persuadé : le Péché originel, l’Incarnation, la Résurrection, la Présence réelle, n’ont pas pour moi la même clarté d’évidence que la loi de composition de l’eau. Qu’est-ce que cela prouve ? Que l’objet de la vérité religieuse n’est pas l’objet de la vérité scientifique, simplement, et que les facultés employées ne sont pas les mêmes… L’erreur des rationalistes, je vous l’ai dit si souvent autrefois, consiste à vouloir réduire un des types de certitude à l’autre. Prenez garde que ce ne soit votre erreur aussi, dans le cas présent. Voulez-vous une preuve que vous avez beaucoup plus de foi que vous ne le savez vous-même ? C’est que vous avez hésité, quand je vous ai répondu : « Je ne donnerai ma fille qu’à un catholique pratiquant. » Cette hésitation m’a effrayé, je vous l’ai dit. J’ai prévu que le nouvel homme en vous ne terrasserait pas l’ancien. Mais le nouveau existe, il n’y aurait pas eu lutte sans cela, et, cet homme nouveau, c’est un croyant… »
— « C’est quelqu’un qui a espéré croire, » répliqua Jean Monneron. « La distance est grande de l’un à l’autre — Oui, » continua-t-il, « si j’ai hésité, mon cher maître, c’est que tout mon cœur était le complice de cette espérance, et que ma raison, au lieu de s’y opposer, m’y incline. J’ai repassé en esprit, cette semaine, par tous les chemins où vous m’avez conduit, quand nous discutions ensemble ces problèmes. J’avoue que je n’ai rien à répondre à vos arguments, rationnellement. C’est la preuve que, ce qui me manque, c’est bien la Foi, telle que vous l’entendez, l’adhésion vivante du fond de l’être. J’admets avec vous que la Science est incapable de dépasser l’ordre des phénomènes et qu’elle se heurte, aussitôt qu’elle veut chercher le pourquoi des choses, au lieu du comment, à l’inconnaissable. J’admets que cet inconnaissable est réel, puisqu’il est à la racine de toute réalité. J’admets que, le conséquent étant enveloppé dans l’antécédent, cet inconnaissable doit posséder, virtuellement au moins, tout ce qui constitue le réel, donc, puisque nos facultés font partie du réel : l’intelligence, l’amour et la volonté. J’admets encore que ce principe d’intelligence, d’amour et de volonté, caché dans l’inconnaissable, c’est ce que le langage des simples appelle Dieu. J’admets que ce Dieu, ainsi conçu, doit s’être manifesté dans l’histoire humaine. Comme cette histoire n’est pas une attente, qu’elle est actuelle, qu’elle est présente, j’admets que cette action de l’inconnaissable y est mêlée, actuellement. J’admets que de tous les faits qui tombent sous l’observation, le christianisme est celui qui remplit le plus exactement les conditions que notre raisonnement nous montre à priori, comme ayant dû être celles d’une action divine. Je vais plus loin. Je reconnais que, des formes diverses du christianisme, la plus complète est celle qui remonte par la tradition au fondateur et à ses apôtres, c’est-à-dire le catholicisme. J’admets tout cela, mais comme une construction intellectuelle qui me reste totalement extérieure, et dont je ne me sens pas faire partie. C’est une hypothèse plus ingénieuse, plus probable, si vous voulez, que beaucoup d’autres, mais cette probabilité est pour moi — comment m’exprimer ? — une probabilité morte. Elle m’est étrangère, je vous le répète. Elle ne touche pas à ce point dernier de la personne où s’élabore la conviction. Où voyez-vous la foi là dedans ?… »
— « Où je la vois ? » répondit M. Ferrand, avec une gravité frémissante : « Dans le fait, d’abord, que vous avez dû, pour admettre seulement cette probabilité dont vous me parlez, détruire en vous tant de préjugés ! Ne dites pas que je vous ai guidé dans ce chemin. Vous m’y avez suivi. Vous m’y avez cherché. Les arguments que vous m’avez résumés vous viennent de moi, et ils me paraissent, en effet, irréfutables. Vous n’auriez pas pris la peine de même les examiner, pas plus que n’ont fait tant d’autres, — car ce n’est rien de bien nouveau, et Pascal les avait donnés, — si vous ne vous étiez senti étouffer dans les doctrines de négation où vous avez grandi. Et pourquoi y étouffiez-vous, sinon parce que des portions inconnues de vous-même avaient le besoin d’une vie religieuse ? Pourquoi vous êtes-vous tant attaché à moi, quand vous êtes entré dans ma classe ? Parce que les idées que je vous représentais, si contraires aux vôtres, réveillaient en vous des traces secrètes. Vous êtes un Français, c’est-à-dire l’héritier d’une longue lignée d’hommes et de femmes qui, pendant des siècles, ont été des catholiques. Vous vous mouvez, vous respirez dans une société imprégnée de mœurs catholiques. La langue que vous parlez, dans laquelle vous pensez, est catholique, puisqu’elle est romaine. Le catholicisme est en vous, malgré vous, dans ce que les philosophes d’aujourd’hui appelleraient votre inconscient. Vous ne pouvez pas être en accord avec le plus intime de vous-même, si vous n’êtes pas catholique. Cet accord, vous l’avez passionnément désiré depuis que vous pensez, à votre insu, comme un liquide désire son niveau et oscille jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé. Quand vous avez souhaité de fonder un foyer, sur quelle jeune fille s’est fixé votre choix ? Sur une catholique. Ce charme par lequel ma Brigitte vous a enchanté, c’est son âme, cette âme que lui a faite cette Église, dont vous dites qu’elle vous est étrangère, qu’elle vous est extérieure. Étrangère ? Oui, au « moi » factice dont vous a revêtu un enseignement qui prétend libérer la personne en la séparant de ses traditions. C’est la folie d’un jardinier qui s’imaginerait affranchir les arbres en les séparant de leurs racines !… Extérieure ?… Mais entrez-y donc, dans l’Église, et vous serez étonné de ce que vous découvrirez en vous, que vous n’y voyez pas… Vous éprouverez, ce jour-là, que se connaître soi-même, comme le conseillait la sagesse antique, c’est simplement se reconnaître… Ce qui vous est extérieur, en ce moment, c’est votre vraie personne. Mais Dieu la veut, et il l’aura. Vous avez les deux vertus dont il marque les âmes qu’il s’est choisies : l’humilité et la bonne volonté. Il vous poursuivra, jusqu’à ce qu’il vous ait conquis… »
Le philosophe s’était levé pour prononcer ces dernières paroles, où le mysticisme de sa pensée avait éclaté malgré lui. Il allait et venait dans le vaste cabinet de travail, son large visage tout éclairé par une flamme de passion religieuse aussi intense que, si au lieu d’être un simple professeur de lycée à la fin du dix-neuvième siècle, il eût été un des docteurs de la réforme catholique du dix-septième siècle, un contemporain de cet Arnauld, dont l’immobile effigie présidait à cet entretien, lequel risquera de paraître bien étrange à cette date de 1900 et à Paris. Mais l’était-il réellement ? Lorsque l’on appartient, comme les deux hommes qui causaient ainsi, à la race de ceux dont Platon disait déjà qu’ils vont à la vérité « avec toute leur âme », n’est-il pas naturel que, dans un acte aussi solennel qu’un mariage et que la création d’une famille, on ne voie pas seulement une question d’intérêts, de convenances, ni même d’attrait sentimental ? Ces idées si théoriques, semble-t-il, les avaient portés, l’un et l’autre, à un point d’émotion extrême. La voix du maître, en particulier, s’était faite presque sourde, dans son excès d’ardeur intime, pour prédire la conquête par Dieu de l’âme de son ancien élève. Son exaltation continuant, il s’arrêta devant Jean Monneron, toujours assis, et, lui posant les mains sur les épaules, le regard plongé dans son regard :
— « Comprenez-vous maintenant, » conclut-il, « pourquoi je n’accepte pas votre réponse comme définitive ? C’est moi qui veux que vous le preniez, ce nouveau délai que vous m’avez refusé. Je sais. Ce n’est pas le rôle d’un père à qui l’on vient demander sa fille, de parler ainsi. Mais nous ne sommes pas dans la convention, vous et moi. Nous sommes dans la vérité profonde. Nous avons à prendre une décision qui pèsera, vous, sur toute votre vie, moi, sur toute la vie de ma fille. Pour que cette décision soit ce qu’elle doit être, il est nécessaire que nous ne laissions rien dans l’équivoque et que la plus absolue franchise ait présidé à cet entretien… » Il s’interrompit une minute, comme s’il hésitait devant une parole bien grave. Puis, fermement : « Il faut que vous sachiez ce que vous avez pu deviner à mon attitude, à d’autres indices peut-être, oui, que vous le sachiez d’une façon positive, qui ne vous permette pas le doute : Brigitte vous aime, mon enfant. C’est au nom de ce sentiment que je vous demande de réfléchir encore avant de vous sacrifier tous deux, elle et vous, à une illusion sur vous-même dont vous resterez étonné plus tard, quand le jour se sera fait en vous complètement. Je connais ma fille et je vous connais. Elle ne changera pas plus vis-à-vis de vous que vous ne changerez vis-à-vis d’elle. Mettons donc que nous ne nous sommes rien dit aujourd’hui et que j’attends votre réponse relativement à la condition que je vous ai imposée. Vous me la donnerez, cette réponse, dans deux mois, dans trois mois, dans un an. C’est moi qui ai eu tort de fixer avec