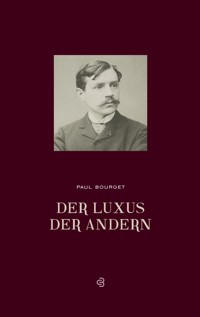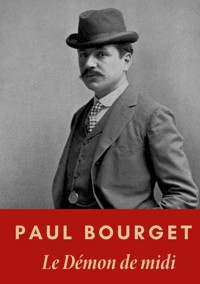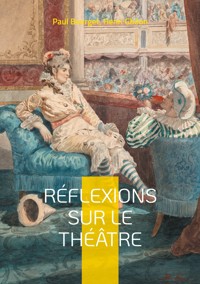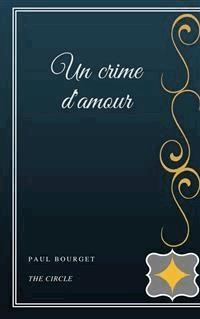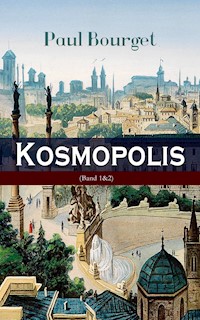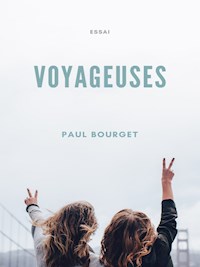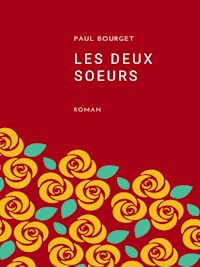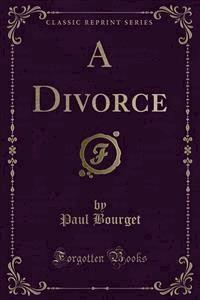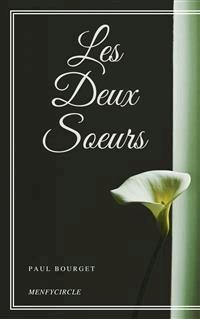1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le Disciple est un roman de Paul Bourget paru en 1889. Roman d’analyse et d’éducation pour les générations nouvelles de l’époque, le chef-d’œuvre de Paul Bourget est aussi un roman à thèse puisque l’écrivain y dénonce la responsabilité du maître à penser et accuse la science moderne de s’être substituée à la religion sans fournir de morale.
Présentation
| En 1885, le philosophe Adrien Sixte reçoit la visite d’un jeune homme de vingt ans, Robert Greslou, qui lui soumet un manuscrit d’une grande qualité. Enthousiaste dans un premier temps de l’athéisme du psychologue déterministe Sixte, Robert Greslou part en Auvergne occuper un poste de précepteur chez le marquis de Jussat – Randon et tente une application de la méthode expérimentale de son maître sur Charlotte de Jussat, jeune vierge de la noblesse auvergnate.
Deux ans plus tard, la fille du marquis, éprise du jeune homme, se rendant compte que cette liaison était pour le jeune précepteur une expérience scientifique dénuée d’amour sincère, se suicide avec la fiole de poison achetée par son amant. Robert Greslou est accusé du meurtre puis emprisonné. Ce dernier garde le silence et ne se défend pas de l’accusation portée contre lui. Depuis sa cellule, il écrit à Adrien Sixte une longue confession qui, sous forme d’analepse, constitue la première partie du roman. Le penseur est convoqué chez le juge qui se demande dans quelle mesure l’influence du philosophe a pu détruire le sens moral de son disciple…|
|Wikipédia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
À UN JEUNE HOMME
I UN PHILOSOPHE MODERNE
II L’AFFAIRE GRESLOU
III SIMPLE DOULEUR
IV CONFESSION D’UN JEUNE HOMME D’AUJOURD’HUI
I. - Mes hérédités.
II. - Mon milieu d’idées.
III. - Transplantation.
IV. - Première crise.
V. - Seconde crise.
VI. - Troisième crise.
VII. - Conclusion.
V TOURMENTS D’IDÉES
VI LE COMTE ANDRÉ
LE DISCIPLE
PAUL BOURGET
LE DISCIPLE
roman
Plon, 1899.
Raanan Éditeur
Livre 289| édition 1
À UN JEUNE HOMME
C’est à toi que je veux dédier ce livre, jeune homme de mon pays, à toi que je connais si bien quoique je ne sache de toi ni ta ville natale, ni ton nom, ni tes parents, ni ta fortune, ni tes ambitions, — rien sinon que tu as plus de dix-huit ans et moins de vingt-cinq, et que tu vas, cherchant dans nos volumes, à nous tes ainés, des réponses aux questions qui te tourmentent. Et des réponses ainsi rencontrées dans ces volumes dépend un peu de ta vie morale, un peu de ton âme ; — et ta vie morale, c’est la vie morale de la France même ; ton âme, c’est son âme. Dans vingt ans d’ici, toi et tes frères, vous aurez en main la fortune de cette vieille patrie, notre mère commune. Vous serez cette patrie elle-même. Qu’auras-tu recueilli, qu’aurez-vous recueilli dans nos ouvrages ? Pensant à cela, il n’est pas d’honnête homme de lettres, si chétif soit-il, qui ne doive trembler de responsabilité...
Tu trouveras dans le Disciple l’étude d’une de ces responsabilités-là, Puisses-tu y acquérir une preuve que l’ami qui t’écrit ces lignes possède, à défaut d’autre mérite, celui de croire profondément au sérieux de son art. — Puisses-tu trouver dans ces lignes mêmes la preuve qu’il pense à toi, anxieusement. Oui, il pense à toi, et cela depuis bien longtemps, depuis les jours où tu commençais d’apprendre à lire, alors que nous autres, qui marchons aujourd’hui vers notre quarantième année, nous griffonnions nos premiers vers et notre première page de prose au bruit du canon qui grondait sur Paris. Dans nos chambrées d’écoliers on n’était pas gai à cette époque. Les plus âgés d’entre nous venaient de partir pour la guerre, et nous qui devions rester au collège, du fond de nos classes à demi désertes nous sentions peser sur nous le grand devoir du relèvement de la Patrie.
Nous t’évoquions souvent alors, dans cette fatale année 1871, jeune Français de maintenant, — nous tous qui voulions vouer notre effort aux Lettres. Mes amis et moi, nous répétions les beaux vers de Théodore de Banville :
Vous en qui je salue une nouvelle aurore, Vous tous qui m’aimerez, Jeunes hommes des temps qui ne sont pas encore, O bataillons sacrés !
Cette aurore de demain, nous la voulions aussi rayonnante que notre aurore à nous était mélancolique et embrumée d’une vapeur de sang. Nous souhaitions mériter d’être aimés par vous, nos cadets nés de la veille, en vous laissant de quoi valoir mieux que nous ne valions nous-mêmes. Nous nous disions que notre œuvre, à nous, était de vous refaire, à vous, une France nouvelle, par notre action privée et publique, par nos actes et par nos paroles, par notre ferveur et par notre exemple, une France rachetée de la défaite, une France reconstruite dans sa vie extérieure et dans sa vie intérieure. Tout jeunes que nous fussions alors, nous savions, pour avoir appris dans nos maîtres, — et ce fut leur meilleur enseignement, — que les triomphes et les défaites du dehors traduisent les qualités et les insuffisances du dedans. Nous savions que la résurrection de l’Allemagne, au début du siècle, a été avant tout une œuvre d’âme, et nous nous rendions compte que l’Âme Française était bien la grande blessée de 1870, celle qu’il fallait aider, panser, guérir. Nous n'étions pas les seuls dans la généreuse naïveté de notre adolescence à comprendre que la crise morale était la grande crise de ce pays-ci, puisqu’en 1873 le plus vaillant de nos chefs de file, Alexandre Dumas, disait dans la préface de la Femme de Claude, s’adressant au Français de son âge comme je m’adresse à toi, mon frère plus jeune : « Prends garde, tu traverses des temps difficiles... Tu viens de payer cher, elles ne sont même pas encore toutes payées, tes fautes d’autrefois. Il ne s’agit plus d’être spirituel, léger, libertin, railleur, sceptique et folâtre : en voilà assez pour quelque temps au moins. Dieu, la nature, le travail, le mariage, l’amour, l’enfant, tout cela est sérieux, très sérieux, et se dresse devant toi. Il faut que tout cela vive ou que tu meures. »
De cette génération dont je suis, et que soulevait ce noble espoir de refaire la France, je ne peux pas dire qu’elle ait réussi, ni même qu’elle ait été assez uniquement préoccupée de son œuvre. Ce que je sais, c’est qu’elle a beaucoup travaillé, — oui, beaucoup. Sans trop de méthode, hélas ! mais avec une application continue et qui me touche quand je songe au peu qu’ont fait pour elle les hommes au pouvoir, combien nous avons tous été abandonnés à nous-mêmes, l’indifférence où nous ont tenus les malheureux qui dirigeaient les affaires et à qui jamais l’idée n’est venue de nous encourager, de nous appuyer, de nous diriger. Ah ! la brave classe moyenne, la solide et vaillante Bourgeoisie, que possède encore la France ! Qu’elle a fourni, depuis ces vingt ans, d’officiers laborieux, celle bourgeoisie, d’agents diplomatiques habiles et tenaces, de professeurs excellents, d’artistes intègres ! J’entends dire parfois : « Quelle vitalité dans ce pays ! Il continue d’aller, là où un autre mourrait... » Hé bien ! s’il va, en effet, depuis vingt ans, c’est d’abord par la bonne volonté de cette jeune bourgeoisie qui a tout accepté pour servir le pays. Elle a vu d’ignobles maîtres d’un jour proscrire au nom de la liberté ses plus chères croyances, des politiciens abominables jouer du suffrage universel comme d’un instrument de règne, et installer leur médiocrité menteuse dans les plus hautes places. Elle l’a subi, ce suffrage universel, la plus monstrueuse et la plus inique des tyrannies, — car la force du nombre est la plus brutale des forces, n’ayant même pas pour elle l’audace et le talent. La jeune bourgeoisie s’est résignée à tout, elle a tout accepté pour avoir le droit de faire la besogne nécessaire. Si nos soldats vont et viennent, si les puissances étrangères nous gardent leur respect, si notre enseignement supérieur se développe, si nos arts et notre littérature continuent d’affirmer le génie national, c’est à elle que nous le devons. Elle n’a pas de victoire à son actif, cette génération des jeunes gens de la guerre, cela est vrai. Elle n’a pas su rétablir la forme traditionnelle du gouvernement, ni résoudre les problèmes redoutables que l’erreur démocratique nous impose. Pourtant, jeune homme de 1889, ne la méprise pas. Sache rendre justice à tes aînés. Par eux la France a vécu.
Comment vivra-t-elle par toi, c’est la question qui tourmente à l’heure actuelle ceux de ces aînés qui ont gardé, malgré tout, la foi dans le relèvement du pays. Tu n’as plus, toi, pour te souvenir, la vision des cavaliers prussiens galopant victorieux entre les peupliers de la terre natale. Et de l’horrible guerre civile tu ne connais guère que la ruine pittoresque de la Cour des comptes, où les arbres poussent leur végétation luxuriante parmi les pierres roussies qui prennent de poétiques allures de palais anciens, en attendant que cette trace aussi disparaisse. Nous autres, nous n’avons jamais pu considérer que la paix de 71 eût tout réglé pour toujours… Que je voudrais savoir si tu penses comme nous ! Que je voudrais être sûr que tu n’es pas prêt à renoncer à ce qui fut le rêve secret, l’espérance consolatrice de chacun de nous, même de ceux qui n’en ont jamais parlé ! Mais non, j’en suis sûr, et que tu te sens triste quand tu passes devant l’Arc où les autres ont passé, même si c’est avec un ami, et par les beaux soirs d’été. Tu quitterais tout, gaiement, pour aller là-bas, — si, demain, il le fallait. J’en suis sûr encore. Mais ce n’est pas assez de savoir mourir. Es-tu décidé à savoir vivre ? Lorsque tu le vois, cet Arc de triomphe, et que tu te souviens de l’épopée de la Grande Armée, regrettes-tu de n’avoir pas dans tes cheveux le souffle héroïque des conscrits d’alors ? Quand tu te souviens de la Restauration et des luttes du Romantisme, éprouves-tu la nostalgie de n’avoir pas, comme ceux d’Hernani, un grand drapeau littéraire à défendre ? Sens-tu, quand tu rencontres un des maîtres d’aujourd’hui, un Dumas, un Taine, un Leconte de Lisle, une émotion à penser que tu as là devant toi un des dépositaires du génie de la race ? Quand tu lis des livres, comme ceux que nous devons écrire lorsqu’il nous faut peindre les coupables passions et leur martyre, souhaites-tu d’aimer mieux que n’ont aimé les auteurs de ces livres ? As-tu de l’idéal, enfin, plus d’idéal que nous ; de la foi, plus de foi que nous ; de l’espérance, plus d’espérance que nous ? — Si c’est oui, donne-moi la main, et laisse-moi te dire : merci. — Si c’est non ?… Si c’est non ?… — Il y a deux types de jeunes gens que je vois devant moi à l’heure présente, et qui sont devant toi aussi comme deux formes de tentations, également redoutables et funestes. — L’un est cynique et volontiers jovial. Il a, dès vingt ans, fait le décompte de la vie, et sa religion tient dans un seul mot : jouir, — qui se traduit par cet autre : réussir. Qu’il fasse de la politique ou des affaires, de la littérature ou de l’art, du sport ou de l’industrie ; qu’il soit officier, diplomate ou avocat, il n’a que lui-même pour dieu, pour principe et pour fin. Il a emprunté à la philosophie naturelle de ce temps la grande loi de la concurrence vitale, et il l’applique à l’œuvre de sa fortune avec une ardeur de positivisme qui fait de lui un barbare civilisé, la plus dangereuse des espèces. Alphonse Daudet, qui a su merveilleusement le voir et le définir, ce jeune homme moderne, l’a baptisé struggle-for-lifer, — et lui-même, ce personnage s’appelle volontiers « fin de siècle » . Il n’estime que le succès, — et dans le succès que l’argent. Il est convaincu, en lisant ce que j’écris ici, — car il me lit comme il lit toutes choses, ne fût-ce que pour être « dans le train », — que je me moque du public en traçant ce portrait, et que moi-même je lui ressemble. Il est si profondément nihiliste à sa manière, que l’idéal lui paraît une comédie chez tout autre, comme il en serait, comme il en est une chez lui, quand il juge à propos, par exemple, de se grimer en socialiste, de mentir au peuple pour avoir ses votes. Ce jeune homme-là, c’est un monstre, n’est-ce pas ? Car c’est être un monstre que d’avoir vingt-cinq ans et, pour âme, une machine à calcul au service d’une machine à plaisir. Je le redoute moins cependant pour toi que cet autre qui a, lui, toutes les aristocraties des nerfs, toutes celles de l’esprit, et qui est un épicurien intellectuel et raffiné, comme le premier était un épicurien brutal et scientifique. Ce nihiliste délicat, comme il est effrayant à rencontrer et comme il abonde ! À vingt-cinq ans, il a fait le tour de toutes les idées. Son esprit critique, précocement éveillé, a compris les résultats derniers des plus subtiles philosophes de cet âge. Ne lui parlez pas d’impiété, de matérialisme. Il sait que le mot matière n’a pas de sens précis, et il est d’autre part trop intelligent pour ne pas admettre que toutes les religions ont pu être légitimes à leur heure. Seulement, il n’a jamais cru, il ne croira jamais à aucune, pas plus qu’il ne croira jamais à quoi que ce soit, sinon au jeu amusé de son esprit qu’il a transformé en un outil de perversité élégante. Le bien et le mal, la beauté et la laideur, le vice et la vertu lui paraissent des objets de simple curiosité. L’âme humaine tout entière est, pour lui, un mécanisme savant et dont le démontage l’intéresse comme un objet d’expérience. Pour lui, rien n’est vrai, rien n’est faux, rien n’est moral, rien n’est immoral. C’est un égoïste subtil et raffiné dont toute l’ambition, comme l’a dit un remarquable analyste, Maurice Barrès, dans son beau roman de l’Homme libre, — chef-d’œuvre d’ironie auquel il manque seulement une conclusion, — consiste à « adorer son moi », à le parer de sensations nouvelles. La vie religieuse de l’humanité ne lui est qu’un prétexte à ces sensations-là, comme la vie intellectuelle, comme la vie sentimentale. Sa corruption est autrement profonde que celle du jouisseur barbare ; elle est autrement compliquée, et le beau nom d’intellectualisme dont il la pare en dissimule la férocité froide, la sécheresse affreuse. Nous le connaissons trop bien, ce jeune homme-là ; nous avons tous failli l’être, nous que les paradoxes d’un maître trop éloquent ont trop charmés ; nous l’avons tous été un jour, une heure ; nous le sommes encore dans nos mauvais moments. Et si j’ai écrit ce livre, c’est pour te montrer, enfant de vingt ans chez qui l’âme est en train de se faire, c’est pour me montrer à moi-même ce que cet égoïsme-là peut cacher de scélératesse au fond de lui.
Ne sois ni l’un ni l’autre de ces deux jeunes hommes, jeune Français d’aujourd’hui. Ne sois ni le positiviste brutal qui abuse du monde sensuel, ni le sophiste dédaigneux et précocement gâté qui abuse du monde intellectuel et sentimental. Que ni l’orgueil de la vie, ni celui de l’intelligence ne fassent de toi un cynique et un jongleur d’idées ! Dans ces temps de conscience troublée et de doctrines contradictoires, attache-toi, comme à la branche de salut, à la phrase sacrée : « Il faut juger l’arbre par ses fruits. » Il y a une réalité dont tu ne veux pas douter, car tu la possèdes, tu la sens, tu la vis à chaque minute : c’est ton âme. Parmi les idées qui t’assaillent, il en est qui rendent cette âme moins capable d’aimer, moins capable de vouloir. Tiens pour assuré que ces idées sont fausses par un point, si subtiles te semblent-elles, soutenues par les plus beaux noms, parées de la magie des plus beaux talents. Exalte et cultive en toi ces deux grandes vertus, ces deux énergies en dehors desquelles il n’y a que flétrissure présente et qu’agonie finale : l’amour et la volonté. — La science d’aujourd’hui, la sincère, la modeste, reconnait qu’au terme de son analyse s’étend le domaine de l’Inconnaissable. Le vieux Littré, qui fut presque un saint, a magnifiquement parlé de cet océan de mystère qui bat notre rivage, que nous voyons devant nous, réel, et pour lequel nous n’avons ni barque ni voile. À ceux qui te diront que derrière cet océan de mystère il y a le vide, l’abîme du noir et de la mort, aie le courage de répondre : « Vous ne le savez pas... » Et puisque tu sais, puisque tu éprouves qu’une âme est en toi, travaille à ce que cette âme ne meure pas en toi avant toi-même. — La France a besoin que nous pensions tous cela, et puisse ce livre t’aider à le penser. N’y cherche pas, ce que tu n’y trouverais point, des allusions à de récents événements. Le plan en était tracé, et une partie en était écrite quand deux tragédies, l’une Française et l’autre Européenne, sont venues attester qu’un même trouble d’idées et de sentiments remue, à l’heure présente, de hautes et d’humbles destinées. Fais-moi l’honneur de croire que je n’ai pas spéculé sur des drames qui ont fait souffrir, qui font souffrir trop de personnes. Les moralistes dont c’est le métier de chercher les causes rencontrent parfois des analogies de situations qui leur attestent qu’ils ont vu juste. Ils aimeraient mieux alors s’être trompés. Que je voudrais, moi, pour me citer en exemple, qu’il n’y eût jamais eu dans la vie réelle de personnages semblables, de près ou de loin, du malheureux Disciple qui donne son nom à ce roman ! Mais s’il n’y en avait pas eu, s’il n’y en avait pas encore, je ne t’aurais pas dit ce que je viens de te dire, jeune homme de mon pays, à qui je voudrais avoir été une fois bienfaisant, par qui je souhaite passionnément d’être aimé, — et de le mériter.
P. B.
Paris, 5 juin 1889.
I UN PHILOSOPHE MODERNE
Une légende qui n’a pas été démentie veut que les bourgeois de la ville de Kœnigsberg aient deviné qu’un événement prodigieux bouleversait l’univers civilisé, à voir simplement le philosophe Emmanuel Kant modifier la direction de sa promenade quotidienne. Le célèbre auteur de la Critique de la Raison pure avait appris le jour même que la Révolution française venait d’éclater. Quoique Paris soit peu propice à d’aussi naïfs étonnements, plusieurs habitants de la rue Guy-de-la-Brosse éprouvèrent, par un après-midi de janvier 1887, une stupeur presque pareille à constater la sortie, vers une heure, d’un philosophe moins illustre que le vieux Kant, mais aussi régulier, aussi manique dans ses faits et gestes, sans compter qu’il est plus destructif encore dans son analyse, — M. Adrien Sixte, celui que les Anglais appellent volontiers le Spencer français. Il convient d’ajouter tout de suite que cette rue Guy-de-la-Brosse, qui va de la rue de Jussieu à la rue de Linné, fait partie d’une véritable petite province bornée par le jardin des Plantes, l’hôpital de la Pitié, l’entrepôt des vins et les premières rampes de la montagne Sainte-Geneviève. C’est dire qu’elle permet ces familières inquisitions du coup d’œil, impossibles dans les grands quartiers de la ville où le va-et-vient de l’existence renouvelle sans cesse le flot des voitures et des passants. Ici ne demeurent que de petits rentiers, de modestes professeurs, des employés au Muséum, des étudiants désireux d’étudier, de tout jeunes gens de lettres qui redoutent autour de leur solitude les tentations du pays Latin. Les boutiques sont achalandées par leur clientèle, fixe comme celle d’un faubourg. Le Boulanger, le Boucher, l’Épicier, la Blanchisseuse, le Pharmacien, — tous ces noms sont prononcés au singulier par les domestiques qui vont aux emplettes. Il n’y a guère place pour une concurrence dans ce carré de maisons que dessert la ligne des omnibus de la Glacière et qu’orne une fontaine capricieusement chargée d’images d’animaux, en l’honneur du jardin des Plantes. Les visiteurs de ce jardin s’y rendent rarement par la porte qui fait face à l’ hôpital. Aussi, même dans les belles journées de printemps et quand la foule abonde sous les arbres reverdis de ce parc, asile favori des militaires et des nourrices, la rue Linné demeure calme comme d’habitude, à plus forte raison les rues avoisinantes. S’il se produit dans ce coin isolé de Paris une affluence inusitée, c’est que les portes de l’hospice de la Pitié s’ouvrent aux visiteurs des malades, et alors se prolonge sur les trottoirs un défilé de figures humbles et tristes. Ces pèlerins de misère arrivent munis de friandises destinées au parent qui souffre derrière les vieux murs grisâtres de l’hôpital, et les habitants des rez-de-chaussée, des loges et des magasins ne s’y trompent guère. Ils prennent à peine garde à ces promeneurs de hasard et toute leur attention se réserve pour les passants qui apparaissent tous les jours sur les trottoirs et à la même minute. Il y a ainsi, pour les boutiquiers et les concierges, comme pour le chasseur dans la campagne, des signes précis de l’heure et du temps qu’il fera dans les allées et venues des promeneurs de ce quartier, où résonnent parfois les appels sauvages poussés par quelque bête de la ménagerie voisine : un ara qui crie, un éléphant qui barrit, un aigle qui trompette, un tigre qui miaule. En voyant trottiner, sa vieille serviette en cuir verdi sous le bras, le professeur libre qui grignote un croissant d’un sou acheté en hâte, ces espions du trottoir savent que huit heures vont sonner. Quand le garçon du pâtissier-restaurateur sort avec ses plats couverts, ils savent qu’il est onze heures, et que le chef de bataillon retraité qui loge tout seul au cinquième étage de telle maison va déjeuner, — et ainsi de suite pour chaque instant du jour. Un changement dans la toilette des femmes qui promènent ici leurs élégances plus ou moins coquettes est noté, critiqué, interprété par vingt bouches bavardes et peu indulgentes. Enfin, pour employer une formule très pittoresque du centre de la France, les moindres faits et gestes des habitués de ces quatre ou cinq rues sont « dans les langues », et les faits et gestes de M. Adrien Sixte plus encore que ceux de beaucoup d’autres, on va comprendre pourquoi, par une simple esquisse du personnage. D’ailleurs les détails de la vie menée par cet homme fourniront aux curieux de nature humaine un document authentique sur une variété sociale assez rare, celle des philosophes de profession. Quelques échantillons nous ont été donnés de cette espèce par les anciens et plus récemment par Colerus à propos de Spinoza, par Darwin et Stuart Mill à propos d’eux-mêmes. Mais Spinoza était un Hollandais du dix-septième siècle. Darwin et Mill grandirent dans l’opulente et active bourgeoisie anglaise, au lieu que M. Sixte vivait sa vie philosophique en plein Paris de la fin du dix-neuvième siècle. J’ai connu dans ma jeunesse, et quand les études de cet ordre m’intéressaient, plusieurs individus aussi emprisonnés que lui dans l’atmosphère des spéculations abstraites. Je n’en ai pas rencontré qui m’ait mieux fait comprendre l’existence d’un Descartes dans son poêle au fond des Pays-Pas, ou celle du penseur de l’Éthique, lequel n’avait, comme on sait, d’autres distractions à ses rêveries que de fumer parfois une pipe de tabac et de faire battre des araignées.
Il y avait juste quatorze ans que M. Sixte, au lendemain de la guerre, était venu s’établir dans une des maisons de la rue Guy-de-la-Brosse, dont tous les indigènes le connaissaient aujourd’hui. C’était, à cette époque déjà lointaine, un homme de trente-quatre ans, chez lequel toute physionomie de jeunesse était comme détruite par une si complète absorption de l’esprit dans les idées, que ce visage rasé n’avait plus ni âge ni profession. Des médecins, des prêtres, des policiers et des acteurs offrent au regard, pour des raisons diverses, de ces faces froides, glabres, à la fois tendues et expressives. Un front haut et fuyant, une bouche avancée et volontaire avec des lèvres minces, un teint bilieux, des yeux malades d’avoir trop lu, et cachés sous des lunettes noires, un corps grêle avec de gros os, uniformément vêtu d’une longue redingote en drap pelucheux l’hiver, en drap mince l’été, des souliers noués de cordons, des cheveux trop longs, prématurément presque tout blancs et très fins sous un de ces chapeaux dits gibus qui se plient par une mécanique et se déforment aussitôt, — voilà sous quelles apparences se présentait ce savant, dont toutes les actions furent dès le premier mois aussi méticuleusement réglées que celles d’un ecclésiastique. Il occupait un appartement de sept cents francs de loyer, situé au quatrième, et composé d’une chambre à coucher, d’un salon de travail, d’une salle à manger grande comme une cabine de bateau, d’une cuisine, d’une chambre de bonne, le tout donnant sur le plus large horizon. Le philosophe voyait de ses fenêtres l’étendue entière du jardin des Plantes, la colline du Père-La-Chaise très au loin, dans le fond, à gauche, par delà une espèce de creux qui marquait la place de la Seine. La gare d’Orléans et le dôme de la Salpêtrière se dressaient en face de lui, et à droite la masse du cèdre noircissait sur le fouillis vert ou dépouillé, suivant la saison, des arbres du Labyrinthe. Des fumées d’usines se tordaient, sur le ciel gris ou clair, à tous les coins de ce vaste paysage, d’où s’échappait une rumeur d’océan lointain, coupée pur des sifflements de locomotive ou de bateaux. Sans doute, en choisissant cette thébaïde, M. Sixte avait cédé à une loi générale, quoique inexpliquée, de la nature méditative. Presque tous les cloîtres ne sont-ils pas bâtis dans des endroits qui permettent d’embrasser par le regard une grande quantité d’espace ? Peut-être des vues démesurées et confuses favorisent-elles les concentrations de la pensée que distrairait un détail trop voisin, trop circonstancié ? Peut-être les solitaires trouvent-ils une volupté de contraste entre leur inaction songeuse et l’ampleur du champ où se développe l’activité des autres hommes ? Quoi qu’il en soit de ce petit problème qui se rattache à cet autre, trop peu étudié : la sensibilité animale des hommes d’intelligence, il est certain que ce paysage mélancolique était depuis quinze ans le compagnon avec qui le silencieux travailleur causait le plus. Son ménage était tenu par une de ces domestiques comme en rêvent tous les vieux garçons, sans se douter que la perfection de certains services suppose chez le maître une régularité correspondante d’existence. Dès son arrivée, le philosophe avait demandé simplement au concierge une femme de charge pour ranger son appartement et un restaurant d’où il fit venir ses repas. Ces deux demandes risquaient d’aboutir aux pires conséquences : un service fait à la diable et une nourriture de poison. Elles eurent ce résultat inattendu d’introduire dans l’intérieur d’Adrien Sixte précisément la personne que rêvaient ses vœux les plus chimériques, si toutefois un abstracteur de quintessences, comme Rabelais appelle cette sorte de songeurs, garde le loisir de former des vœux.
Ce concierge — d’après les us et coutumes de tous les concierges dans les maisons à petits appartements — augmentait le revenu trop faible de sa loge au moyen d’un métier manuel. Il était cordonnier « en neuf et en vieux », disait une pancarte collée à la vitre de la fenêtre sur la rue. Parmi ces clients, le père Carbonnet — c’était son nom — comptait un prêtre domicilié rue Cavier. Ce prêtre, âgé, retiré du monde, avait pour domestique Mlle Mariette Trapenard, une femme de quarante ans environ, habituée depuis des années à tout gouverner chez son maître, avec cela restée très paysanne, sans aucune ambition de jouer à la demi-dame, rude à l’ouvrage, mais qui n’aurait voulu à aucun prix entrer dans une maison où elle se fût heurtée à une autorité féminine. Le vieux prêtre venait de mourir presque subitement dans la semaine qui précéda l’installation du philosophe rue Guy-de-la-Brosse. Le père Carbonnet, sur la feuille de location duquel le nouveau venu s’inscrivit simplement comme rentier, devina sans peine l’espèce d’hommes où classer ce M. Sixte, d’abord à la quantité de volumes qui composaient la bibliothèque du savant, puis à un racontar d’une bonne de la maison, celle d’un professeur au Collège de France domicilié au premier. — Ainsi l’attestaient les affiches blanches posées contre le mur et qui donnaient le programme des cours de ce célèbre établissement. — Dans ces phalanstères du Paris bourgeois tout devient événement. La bonne avait nommé à sa maîtresse le futur voisin du quatrième. La maîtresse l’avait nommé à son mari. Ce dernier en parla aussitôt à table en des termes que la bonne comprit assez pour démêler que le locataire « était dans les papiers, comme Monsieur ». Carbonnet n’eût pas été digne de tirer le cordon dans une loge parisienne, si sa femme et lui n’eussent éprouvé immédiatement le besoin de mettre en rapports M. Adrien Sixte et Mlle Trapenard, d’autant plus que Mme Carbonnet, vieille et quasi impotente, se trouvait elle-même déjà trop occupée par trois ménages dans la maison pour prendre encore celui-là. Le goût de l’intrigue domestique qui fleurit dans les loges, comme les fuchsias, les géraniums et les basilics, induisit donc ce couple à certifier au savant que les traiteurs du quartier cuisinaient de la gargote, qu’il n’y avait pas une seule femme de charge dont ils pussent répondre dans le voisinage, que la servante de feu M. l’abbé Vayssier était une « perle » de discrétion, d’ordre, d’économie et de talent culinaire. Bref, le philosophe consentit à voir celte gouvernante modèle. L’évidente honnêteté de la fille le séduisit et aussi, cette réflexion que cet arrangement simplifiait de beaucoup son existence, en le dispensant d’une odieuse corvée, celle de donner lui-même un certain nombre d’ordres positifs. Mlle Trapenard entra donc au service de ce maître, pour n’en plus bouger, au gage de quarante-cinq francs par mois, qui devinrent bien vite soixante. Le savant lui donnait en outre cinquante francs d’étrennes. Il ne vérifiait jamais son livre, qu’il réglait, chaque dimanche matin, sans aucune contestation. C’était elle qui avait affaire à tous les fournisseurs, sans qu’aucune remarque de M. Sixte vint la troubler dans ses combinaisons, d’ailleurs presque honnêtes. Enfin, elle régnait au logis en maîtresse absolue, situation qui excitait, comme on le pense, l’universelle envie du petit monde sans cesse en train d’aller et de venir par l’escalier commun, qu’un frotteur nettoyait tous les lundis.
— « Hein ! mademoiselle Mariette, l’avez-vous mise la main sur le bon numéro, l’avez-vous mise ?... » lui disait Carbonnet quand la bonne du philosophe s’arrêtait une minute à causer avec son interlocuteur, devenu plus vieux. Il était obligé maintenant de porter des lunettes sur son nez carré, et il ajustait avec peine ses coups de marteau sur les clous qu’il enfonçait dans des talons de bottine, la forme serrée entre ses jambes, le tablier de cuir noué autour de son corps. Depuis quelques années, il élevait un coq appelé Ferdinand, sans que personne eût jamais su le motif de ce surnom. Cette bête errait parmi les cuirs, excitant l’admiration des visiteurs par son avidité à happer des boutons de bottine. Dans ses moments de terreur, ce coq familier se réfugiait chez son maître, enfonçait une de ses pattes dans la poche du gilet et cachait sa tête sous le bras du vieux concierge : « Allons, Ferdinand, dites bonjour à Mlle Mariette... » reprenait Carbonnet. Et le coq becquetait doucement la main de la fille, et son maître continuait :
— « Je dis toujours : Ne vous désespérez pas d’une mauvaise année, il en viendra deux tout de suite, et aussi des bonnes ; elles se suivent comme Ferdinand suit les poules ; n’est-ce pas, gourgandin ? »
— « C’est vrai, » répondait Mariette, « il faut en convenir, pour un brave homme, Monsieur est un brave homme ; quoique, pour la religion, c’est un païen, qui n’est pas allé une fois à la messe depuis ces quinze ans... »
— « Y en a tant qui z’y vont, » répliquait Carbonnet, « que c’est des gaillards qui vous mènent des vies de remplaçant entre quatre et minuit (catimini)... »
Ce fragment de conversation peut être donné comme le type de l’opinion que Mlle Mariette nourrissait sur son maître. Mais cette opinion demeurerait inintelligible si l’on ne rappelait ici les travaux du philosophe et l’histoire de sa pensée. Né en 1839 à Nancy, où son père tenait une petite boutique d’horlogerie, et remarqué de bonne heure pour la précocité de son intelligence, Adrien Sixte a laissé parmi ses camarades le souvenir d’un enfant chétif et taciturne, doué d’une force de résistance morale qui éloignait dès lors la familiarité. Il fit des études d’abord très brillantes, puis moyennes, jusqu’à ce que, dans la classe de philosophie, qui portait le nom de Logique, il se distinguât par des aptitudes exceptionnelles. Son professeur, frappé de son talent de métaphysicien, voulut le décider à préparer l’examen de l’École normale. Adrien s’y refusa et déclara d’ailleurs à son père que, métier pour métier, il préférait à tous un travail manuel. « Je serai horloger comme toi ... » fut sa seule réponse aux objurgations de ce père, qui caressait, comme les innombrables artisans ou commerçants français dont les enfants fréquentent le collège, le rêve, pour son fils, d’un avenir de fonctionnaire. M. et Mme Sixte — car Adrien avait encore sa mère — ne pouvaient d’ailleurs reprocher quoi que ce fût à ce garçon qui ne fumait pas, n’allait pas au café, ne se montrait jamais avec une fille, enfin qui faisait leur orgueil, et aux volontés duquel ils se résignèrent, le cœur navré. Ils renoncèrent à ce qu’il prit aucune carrière, mais ils ne consentirent pas à le mettre en apprentissage ; et le jeune homme vécut chez eux sans autre occupation que d’étudier à sa guise. Il employa ainsi dix années à se perfectionner dans l’étude des philosophies anglaises et allemandes, dans 1es Sciences Naturelles et particulièrement dans la physiologie du cerveau, dans les Sciences Mathématiques ; enfin, il se donna, comme l’a dit de lui-même un des grands écrivains de notre époque, cette « violente encéphalite », cette espèce d’apoplexie de connaissances positives qui fut le procédé d’éducation de Carlyle et de Mill, de M. Taine et de M. Renan, de presque tous les maîtres de la philosophie moderne. En 1808, le fils du petit horloger de Nancy, âgé alors de vingt-neuf ans, publia un gros volume de 500 pages intitulé : Psychologie de Dieu, qu’il n’envoya pas à plus de quinze personnes, mais qui eut la fortune inattendue d’un scandaleux retentissement. Ce livre, écrit dans la solitude de la pensée la plus intègre, présentait ce double caractère d’une analyse critique, aiguë jusqu’à la cruauté, et d’une ardeur dans la négation, exaltée jusqu’au fanatisme. Moins poète que M. Taine, incapable d’écrire la magnifique préface de l’Intelligence et le morceau sur l’universel phénoménisme ; moins desséché que M. Ribot, qui préludait déjà par ses Psychologues anglais à la belle série de ses études, sa Psychologie de Dieu alliait à la fois l’éloquence de l’un à la pénétration de l’autre, et elle avait la chance, non cherchée, de s’attaquer directement au problème le plus passionnant de la métaphysique. Une brochure d’un évêque très en vue, une allusion indignée d’un cardinal dans un discours au Sénat, un article foudroyant du plus brillant critique spiritualiste dans une célèbre Revue, suffirent pour désigner l’ouvrage aux curiosités de la jeunesse, sur laquelle passait un vent de révolution, symptôme avant-coureur des bouleversements prochains. La thèse de l’auteur consistait à démontrer la production nécessaire de « l’hypothèse-Dieu » par le fonctionnement de quelques lois psychologiques, rattachées elles-mêmes à quelques modifications cérébrales d’un ordre tout physique. Cette thèse était établie, appuyée, développée avec une âpreté d’athéisme qui rappelait les fureurs de Lucrèce contre les croyances de son temps. Il arriva donc au solitaire de Nancy que son œuvre, conçue et composée comme dans une cellule, fut du premier coup mêlée d’une manière tapageuse à la bataille des idées contemporaines. On n’avait pas rencontré, depuis des années, une pareille puissance d’idées générales mariée à une telle ampleur d’érudition, ni une si riche abondance de points de vue unie à un si audacieux nihilisme. Mais, tandis que le nom de l’écrivain devenait célèbre à Paris, ses parents, ceux qui vivaient auprès de lui sans le connaître, ceux qui l’avaient élevé, demeuraient atterrés de son succès. Quelques articles de journaux catholiques désespéraient Mme Sixte. Le vieil horloger tremblait de perdre sa clientèle dans l’aristocratie nancéenne. Toutes les misères de la province crucifièrent le philosophe, qui allait prendre le parti de quitter sa famille, quand l’invasion allemande et l’épouvantable naufrage national détournèrent de lui l’attention de ses compatriotes et de ses parents. Ces derniers moururent au printemps de 1871. Dans l’été de cette même année, Adrien Sixte perdit encore une tante, et c’est ainsi qu’à l’automne de 1872, ayant réglé toute sa fortune, il vint s’établir à Paris. Ses ressources consistaient, grâce à l’héritage de son père et à celui de cette tante, dans huit mille francs de rente placés en viager. Il était résolu à ne pas se marier, à ne jamais aller dans le monde, à n’ambitionner ni honneurs, ni places, ni réputation. Toute la formule de sa vie tenait dans ce mot : penser.
Pour mieux définir cet homme d’une qualité si rare que cette esquisse d’après nature risquera de paraître invraisemblable au lecteur peu familiarisé avec la biographie des grands manipulateurs d’idées, il est nécessaire de donner un aperçu des journées de ce puissant travailleur. Été comme hiver, M. Sixte s’asseyait à sa table dès six heures du matin, lesté seulement d’une tasse de café noir. À dix heures, il déjeunait, opération sommaire et qui lui permettait de franchir à dix heures et demie la porte du jardin des Plantes. Il se promenait là jusqu’à midi, poussant quelquefois sa flânerie vers les quais et du côté de Notre-Dame. Un de ses plaisirs favoris consistait dans de longues séances devant les cages des singes et la loge de l’éléphant. Les enfants et les servantes qui le voyaient rire, comme il riait, silencieusement et longuement, aux férocités et aux cynismes des macaques et des ouistitis, ne soupçonnaient guère les misanthropiques pensées que ce spectacle soulevait dans le savant qui comparait en lui-même la comédie humaine à la comédie simiesque, comme il comparait à notre folie habituelle la sagesse de l’animal si noble qui fut le roi du globe avant nous. Vers midi, M. Sixte rentrait, et, de nouveau, il travaillait jusqu’à quatre heures. De quatre à six il recevait, trois fois la semaine, des visiteurs qui étaient presque toujours des étudiants, des maîtres occupés aux mêmes études que lui, des étrangers attirés par une renommée aujourd’hui européenne. Trois autres fois il sortait et faisait les quelques visites indispensables. À six heures il dinait, sortait encore, allant cette fois le long du jardin fermé jusqu’à la gare d’Orléans. À huit heures il rentrait, réglait sa correspondance ou lisait. À dix heures toute lumière s’éteignait chez lui. Cette existence monastique avait son repos hebdomadaire du lundi, le philosophe ayant observé que le dimanche déverse sur la campagne un flot encombrant de promeneurs. Ces jours-là, il partait de grand matin, montait dans un train de banlieue et ne rentrait que le soir. Il ne s’était pas une fois, durant ces quinze ans, départi de cette régularité absolue. Pas une fois il n’avait accepté une invitation à manger dehors, ni pris place dans une salle de spectacle. Il ne lisait jamais un journal, s’en rapportant pour le service de ses publications à son éditeur, et ne remerciant jamais d’un article. Son indifférence politique était si complète qu’il n’avait jamais retiré sa carte d’électeur, Il convient d’ajouter, pour fixer les traits principaux de cette figure singulière, qu’il avait rompu tout rapport avec sa famille, et que cette rupture se fondait, comme les moindres actes de cette vie, sur une théorie. Il avait écrit dans la préface de son second livre : Anatomie de la volonté, cette phrase significative : « Les attaches sociales doivent être réduites à leur minimum pour celui qui veut connaître et dire la vérité dans le domaine des sciences psychologiques. » Par un motif semblable, cet homme, si doux qu’il n’avait pas fait trois observations à sa servante depuis quinze ans, s’interdisait systématiquement la charité. Il pensait sur ce point comme Spinoza, qui a écrit dans le livre quatrième de l’Éthique : « La pitié, chez un sage qui vit d’après la raison, est mauvaise et inutile. » Ce Saint Laïque, comme on l’eût appelé aussi justement que le vénérable Émile Littré, haïssait dans le Christianisme une maladie de l’humanité. Il en donnait ces deux raisons, d’abord que l’hypothèse d’un père céleste et d’un bonheur infini avait développé à l’excès dans l’âme le dégoût du réel et diminué la puissance d’acceptation des lois de la nature, — ensuite qu’en établissant l’ordre social sur l’amour, c’est-à-dire sur la sensibilité, cette religion avait ouvert la voie aux pires caprices des doctrines les plus personnelles. Il ne se doutait point d’ailleurs que sa fidèle domestique lui cousait des médailles bénites dans tous ses gilets, et son inadvertance à l’endroit de l’univers extérieur était si complète qu’il faisait maigre les vendredis et autres jours prescrits par l’Église, sans apercevoir cet effort caché de la vieille fille pour assurer le salut d’un maitre dont elle disait quelquefois, reproduisant, sans le savoir elle-même, un mot célèbre :
— « Le bon Dieu ne serait pas le bon Dieu, s’il avait le cœur de le damner. »
Ces années d’un labeur continu dans cet ermitage de la nie Guy-de-la-Brosse avaient produit, outre cette Anatomie de la volonté, une Théorie des passions, en trois volumes, dont la publication aurait été plus scandaleuse encore que celle de la Psychologie de Dieu, si l’extrême liberté de la presse et du livre depuis tantôt dix ans n’avait habitué les lecteurs à des audaces de description que la tranquille férocité technique d’un savant ne saurait égaler. Dans ces deux livres se trouvait précisée la doctrine de M. Sixte, qu’il est indispensable de résumer ici, en quelques traits généraux, pour l’intelligence du drame auquel cette courte biographie sert de prologue, Avec l’école critique issue de Kant, l’auteur de ces trois traités admet que l’esprit est impuissant à connaitre des causes et des substances, et qu’il doit seulement coordonner des phénomènes. Avec les psychologues anglais, il admet qu’un groupe parmi ces phénomènes, celui qui est cliqueté sous le nom d’âme, peut être l’objet d’une connaissance scientifique, à la condition d’être étudié d’après une méthode scientifique. Jusqu’ici, comme on voit, il n’y a rien dans ces théories qui les distingue de celles que MM. Taine, Ribot et leurs disciples ont développées dans leurs principaux travaux. Les deux caractères originaux des recherches de M. Sixte saut ailleurs. Le premier réside dans une analyse négative de ce qu’Herbert Spencer appelle l’Inconnaissable. On sait que le grand penseur anglais admet que toute réalité repose sur un arrière-fonds qu’il est impossible de pénétrer ; par suite, il faut, pour employer la formule de Fichte, comprendre cet arrière-fonds comme incompréhensible. Mais, comme l’atteste fortement le début des Premiers Principes, pour M. Spencer cet Inconnaissable est réel. Il vit, puisque nous vivons de lui. De là il n’y a qu’un pas à concevoir que cet arrière-fonds de toute réalité enveloppe une pensée, puisque notre pensée en sort ; un cœur, puisque notre cœur en dérive. Beaucoup d’excellents esprits entrevoient dès aujourd’hui une réconciliation probable de la Science et de la Religion sur ce terrain de l’Inconnaissable. Pour M. Sixte, c’est là une dernière forme de l’illusion métaphysique et qu’il s’est acharné à détruire avec une énergie d’argumentation que l’on n’avait pas admirée à ce degré depuis Kant.
— Son second titre d’honneur, comme psychologue, consiste dans un exposé très nouveau et très ingénieux des origines animales do la sensibilité humaine. Grâce à une lecture immense et à une connaissance minutieuse des Sciences Naturelles, il a pu tenter pour la genèse des formes de la pensée le travail que Darwin a essayé pour la genèse des formes de la vie. Appliquant la loi de l’évolution aux divers faits qui constituent le cœur humain, il a prétendu montrer que nos plus raffinées sensations, nos délicatesses morales les plus subtiles, comme nos plus honteuses déchéances, sont l’aboutissement dernier, la métamorphose suprême d’instincts très simples, transformation eux-mêmes des propriétés de la cellule primitive ; en sorte que l’univers moral reproduit exactement l’univers physique et que le premier n’est que la conscience douloureuse ou extatique du second. Cette conclusion, présentée à titre d’hypothèse, à cause de son caractère métaphysique, sert de terme d’arrivée à une merveilleuse série d’analyses, parmi lesquelles il convient de citer deux cents pages sur l’amour, d’une hardiesse presque plaisante sous la plume d’un homme très chaste, sinon vierge. Mais le même Spinoza n’a-t-il pas donné une théorie de la jalousie qu’aucun romancier moderne n’a égalée en brutalité ? Et Schopenhauer ne rivalise-t-il pas d’esprit avec Chamfort dans ses boutades contre les femmes ? Il est presque inutile d’ajouter que le déterminisme le plus complet circule d’une extrémité à l’autre de ces livres. On doit à M. Sixte quelques phrases qui traduisent avec une extrême énergie cette conviction que tout est nécessaire dans l’âme, même l’illusion que nous sommes libres : « Tout acte,» a-t-il écrit, « n’est qu’une addition. Dire qu’il est libre, c’est dire qu’il y a dans un total plus qu’il n’y a dans les éléments additionnés. Cela est aussi absurde en psychologie qu’en arithmétique. » Et ailleurs : « Si nous connaissions vraiment la position relative de tous les phénomènes qui constituent l’univers actuel, — nous pourrions, dès à présent, calculer avec une certitude égale à celle des astronomes le jour, l’heure, la minute où l’Angleterre par exemple évacuera les Indes, où l’Europe aura brûlé son dernier morceau de houille, où tel criminel, encore à naître, assassinera son père, où tel poème ; encore à concevoir, sera composé. Tout l’avenir tient dans le présent comme toutes les propriétés du triangle tiennent dans sa définition... » Le fatalisme mahométan ne s’est pas exprimé avec une précision plus absolue.