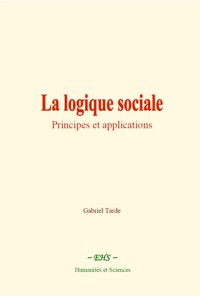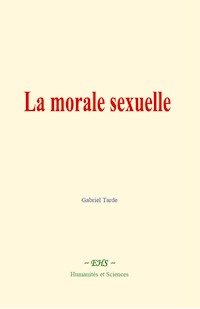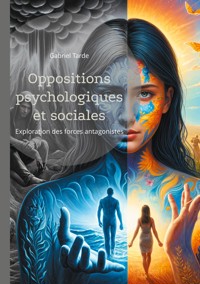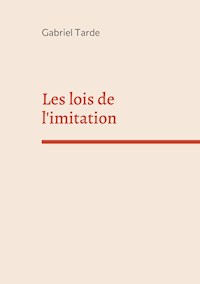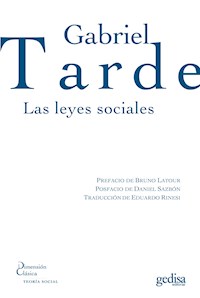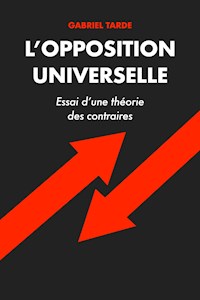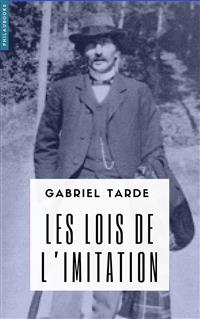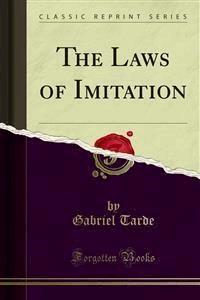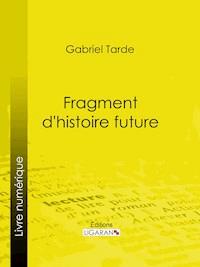Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les diverses études qu'on va lire sont des fragments de psychologie collective ainsi entendue. Un lien étroit les unit. Il a paru nécessaire de rééditer ici, pour la mettre à sa vraie place, l'étude sur les foules, qui figure en appendice à la fin du volume. Le public, en effet, objet spécial de l'étude principale, est une foule dispersée, où l'influence des esprits les uns sur les autres est devenue une action à distance, à des distances de plus en plus grandes".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’expression psychologie collective ou psychologie sociale est souvent comprise en un sens chimérique qu’il importe avant tout d’écarter. Il consiste à concevoir un esprit collectif, une conscience sociale, un nous, qui existerait en dehors ou au-dessus des esprits individuels. Nous n’avons nul besoin, à notre point de vue, de cette conception mystérieuse pour tracer entre la psychologie ordinaire et la psychologie sociale – que nous appellerions plus volontiers inter-spirituelle – une distinction très nette. Pendant que la première, en effet, s’attache aux rapports de l’esprit avec l’universalité des autres êtres extérieurs, la seconde étudie, ou doit étudier, les rapports mutuels des esprits, leurs influences unilatérales et réciproques – unilatérales d’abord, réciproques après. Il y a donc entre les deux la différence du genre à l’espèce ; mais l’espèce ici est d’une nature si singulière et si importante qu’elle veut être détachée du genre et traitée par des méthodes qui lui soient propres.
Les diverses études qu’on va lire sont des fragments de psychologie collective ainsi entendue. Un lien étroit les unit. Il a paru nécessaire de rééditer ici, pour la mettre à sa vraie place, l’étude sur les foules, qui figure en appendice à la fin du volume. Le public, en effet, objet spécial de l’étude principale, est une foule dispersée, où l’influence des esprits les uns sur les autres est devenue une action à distance, à des distances de plus en plus grandes. Enfin, l’Opinion, résultante, de toutes ces actions à distance ou au contact, est aux foules et aux publics ce que la pensée est au corps, en quelque sorte. Et si, parmi ces actions d’où elle résulte, on cherche quelle est la plus générale et la plus constante, on s’aperçoit sans peine que c’est ce rapport social élémentaire, la conversation, tout à fait négligé par les sociologues.
Une histoire complète de la conversation chez tous les peuples et à tous les âges serait un document de science sociale du plus haut intérêt ; et il n’est pas douteux que si, malgré les difficultés d’un tel sujet, la collaboration de nombreux chercheurs venait à bout de les surmonter, il se dégagerait du rapprochement des faits recueillis à cet égard dans les races les plus distinctes, un nombre considérable d’idées générales propres à faire de la conversation comparée une véritable science, à mettre non loin de la religion comparée ou de l’art comparé – ou même de l’industrie comparée, autrement dit de l’Économie politique.
Mais, bien entendu, je n’ai pu prétendre, en quelques pages, tracer le dessin d’une science pareille. À défaut d’informations suffisantes pour l’esquisser même, je n’ai pu qu’indiquer son futur emplacement, et je serais heureux si, étant parvenu à donner le regret de son absence, je suggérais à quelque jeune travailleur le désir de combler cette grande lacune.
G. TARDE.
Mai 1901.
Non seulement la foule est attirante et appelle irrésistiblement son spectateur, mais son nom exerce un prestigieux attrait sur le lecteur contemporain, et certains écrivains sont trop portés à désigner par ce mot ambigu toutes sortes de groupements humains. Il importe de faire cesser cette confusion et, notamment, de ne pas confondre avec la foule le Public, vocable susceptible lui-même d’acceptions diverses, mais que je vais tâcher de préciser. On dit : le public d’un théâtre, le public d’une assemblée quelconque ; ici, public signifie foule. Mais cette signification n’est pas la seule ni la principale, et, pendant que son importance décroît ou reste stationnaire, l’âge moderne, depuis l’invention de l’imprimerie, a fait apparaître une espèce de public toute différente, qui ne cesse de grandir, et dont l’extension indéfinie est l’un des traits les mieux marqués de notre époque. On a fait la psychologie des foules ; il reste à faire la psychologie du public, entendu en cet autre sens, c’est-à-dire comme une collectivité purement spirituelle, comme une dissémination d’individus physiquement séparés et dont la cohésion est toute mentale. D’où procède le public, comment il naît, comment il se développe ; ses variétés ; ses rapports avec ses directeurs ; ses rapports avec la foule, avec les corporations, avec les États ; sa puissance en bien ou en mal, et ses manières de sentir ou d’agir : voilà ce que nous nous proposons de rechercher dans cette étude.
Dans les sociétés animales les plus basses, l’association consiste surtout en un agrégat matériel. À mesure qu’on s’élève sur l’arbre de la vie, la relation sociale devient plus spirituelle. Mais si les individus s’éloignent au point de ne plus se voir ou restent éloignés ainsi au-delà d’un certain temps très court, ils ont cessé d’être associés. – Or, la foule, en cela, présente quelque chose d’animal. N’est-elle pas un faisceau de contagions psychiques essentiellement produites par des contacts physiques ? Mais toutes les communications d’esprit à esprit, d’âme à âme, n’ont pas pour condition nécessaire le rapprochement des corps. De moins en moins cette condition est remplie quand se dessinent dans nos sociétés civilisées des courants d’opinion. Ce n’est pas dans des rassemblements d’hommes sur la voie publique ou sur la place publique, que prennent naissance et se déroulent ces sortes de fleuves sociaux, ces grands entraînements qui emportent d’assaut maintenant les cœurs les plus fermes, les raisons les plus résistantes, et se font consacrer lois ou décrets par les parlements ou les gouvernements. Chose étrange, les hommes qui s’entraînent ainsi, qui se suggestionnent mutuellement ou plutôt se transmettent les uns aux autres la suggestion d’en haut, ces hommes-là ne se coudoient pas, ne se voient ni ne s’entendent : ils sont assis, chacun chez soi, lisant le même journal et dispersés sur un vaste territoire. Quel est donc le lien qui existe entre eux ? Ce lien, c’est, avec la simultanéité de leur conviction ou de leur passion, la conscience possédée par chacun d’eux que cette idée ou cette volonté est partagée au même moment par un grand nombre d’autres hommes. Il suffit qu’il sache cela, même sans voir ces hommes, pour qu’il soit influencé par ceux-ci pris en masse, et non pas seulement par le journaliste, inspirateur commun, qui lui-même est invisible et inconnu, et d’autant plus fascinateur.
Le lecteur n’a pas conscience, en général, de subir cette influence persuasive presque irrésistible, du journal qu’il lit habituellement. Le journaliste, lui, aurait plutôt conscience de sa complaisance envers son public dont il n’oublie jamais la nature et les goûts. – Le lecteur a encore moins conscience : il ne se doute absolument pas de l’influence exercée sur lui par la masse des autres lecteurs. Elle n’en est pas moins incontestable. Elle s’exerce à la fois sur sa curiosité qui devient d’autant plus vive qu’il la sait ou la croit partagée par un public plus nombreux ou plus choisi, et sur son jugement qui cherche à s’accorder avec celui de la majorité ou de l’élite, suivant les cas. J’ouvre un journal que je crois du jour, et j’y lis avec avidité certaines nouvelles ; puis je m’aperçois qu’il date d’un mois, ou de la veille, et il cesse aussitôt de m’intéresser. D’où provient ce dégoût subit ? Les faits racontés n’ont-ils rien perdu de leur intérêt intrinsèque ? Non, mais nous nous disons que nous sommes seuls à les lire, et cela suffit. Cela prouve donc que notre vive curiosité tenait à l’illusion inconsciente que notre sentiment nous était commun avec un grand nombre d’esprits. Il en est d’un journal de la veille ou de l’avant-veille, comparé à celui du jour, comme d’un discours lu chez soi comparé à un discours entendu au milieu d’une immense foule.
Quand nous subissons à notre insu cette invisible contagion du public dont nous faisons partie, nous sommes portés à l’expliquer par le simple prestige de l’actualité. Si le journal du jour nous intéresse à ce point, c’est qu’il ne nous raconte que des faits actuels, et ce serait la proximité de ces faits, nullement la simultanéité de leur connaissance par nous et par autrui qui nous passionnerait à leur récit. Mais analysons bien cette sensation de l’actualité qui est si étrange et dont la passion croissante est une des caractéristiques les plus nettes de la vie civilisée. Ce qui est réputé « d’actualité », est-ce seulement ce qui vient d’avoir lieu ? Non, c’est tout ce qui inspire actuellement un intérêt général, alors même que ce serait un fait ancien. A été « d’actualité », dans ces dernières années, tout ce qui concerne Napoléon ; est d’actualité tout ce qui est à la mode. Et n’est pas « d’actualité » ce qui est récent, mais négligé actuellement par l’attention publique détournée ailleurs. Pendant toute l’affaire Dreyfus, il se passait en Afrique ou en Asie des faits bien propres à nous intéresser, mais on eût dit qu’ils n’avaient rien d’actuel. – En somme, la passion pour l’actualité progresse avec la sociabilité dont elle n’est qu’une des manifestations les plus frappantes ; et comme le propre de la presse périodique, de la presse quotidienne surtout, est de ne traiter que des sujets d’actualité, on ne doit pas être surpris de voir se nouer et se resserrer entre les lecteurs habituels d’un même journal une espèce d’association trop peu remarquée et des plus importantes.
Bien entendu, pour que cette suggestion à distance des individus qui composent un même public devienne possible, il faut qu’ils aient pratiqué longtemps, par l’habitude de la vie sociale intense, de la vie urbaine, la suggestion à proximité. Nous commençons, enfants, adolescents, par ressentir vivement l’action des regards d’autrui, qui s’exprime à notre insu dans notre attitude, dans nos gestes, dans le cours modifié de nos idées, dans le trouble ou la surexcitation de nos paroles, dans nos jugements, dans nos actes. Et c’est seulement après avoir, pendant des années, subi et fait subir cette action impressionnante du regard, que nous devenons capables d’être impressionnés même par la pensée du regard d’autrui, par l’idée que nous sommes l’objet de l’attention de personnes éloignées de nous. Pareillement, c’est après avoir connu et pratiqué longtemps le pouvoir suggestif d’une voix dogmatique et autoritaire, entendue de près, que la lecture d’une affirmation énergique suffit à nous convaincre, et que même la simple connaissance de l’adhésion d’un grand nombre de nos semblables à ce jugement nous dispose à juger dans le même sens. La formation d’un public suppose donc une évolution mentale et sociale bien plus avancée que la formation d’une foule. La suggestibilité purement idéale, la contagion sans contact, que suppose ce groupement purement abstrait et pourtant si réel, cette foule spiritualisée, élevée, pour ainsi dire, au second degré de puissance, n’a pu naître qu’après bien des siècles de vie sociale plus grossière, plus élémentaire.
Il n’y a pas de mot, en latin ni en grec, qui réponde à ce que nous entendons par public. Il y en a pour désigner le peuple, l’assemblée des citoyens armés ou non armés, le corps électoral, toutes les variétés de foules. Mais quel est l’écrivain de l’antiquité qui a songé à parler de son public ? Aucun d’eux n’a jamais connu que son auditoire, dans ces salles louées pour des lectures publiques où les poètes contemporains de Pline le Jeune rassemblaient une petite foule sympathique. Quant aux lecteurs épars de manuscrits copiés à la main, tirés à quelques dizaines d’exemplaires, ils n’avaient point conscience de former un agrégat social, comme à présent les lecteurs d’un même journal ou, parfois, d’un même roman à la mode. Au Moyen Âge, y avait-il un public ? Non, mais il y avait des foires, des pèlerinages des multitudes tumultueuses où couraient des émotions pieuses ou belliqueuses, des colères ou des paniques. Le public n’a pu commencer à naître qu’après le premier grand développement de l’invention de l’imprimerie, au XVIe siècle. Le transport de la force à distance n’est rien, comparé à ce transport de la pensée à distance. La pensée n’est-elle pas la force sociale par excellence ? Songez aux idées-forces de M. Fouillée. Alors, on a vu, nouveauté profonde et d’incalculable effet, la lecture quotidienne et simultanée d’un même livre, la Bible, édité pour la première fois à des millions d’exemplaires, donner à la masse unie de ses lecteurs la sensation de former un corps social nouveau, détaché de l’Église. Mais ce public naissant n’était encore lui-même qu’une Église à part, avec laquelle il se présentait confondu, et c’est l’infirmité du protestantisme, d’avoir été à la fois un public et une Église, deux agrégats régis par des principes différents et de nature inconciliable. Le public comme tel ne s’est dégagé un peu nettement que sous Louis XIV. Mais, à cette époque, s’il y avait des foules aussi torrentielles que maintenant et aussi considérables aux couronnements des princes, aux grandes fêtes, aux émeutes provoquées par de périodiques famines, le public ne se composait guère que d’une étroite élite d’« honnêtes gens » lisant leur gazette mensuelle, lisant surtout des livres, un petit nombre de livres écrits pour un petit nombre de lecteurs. Encore ces lecteurs étaient-ils pour la plupart rassemblés à Paris, sinon à la cour.
Au XVIIIe siècle, ce public grossit rapidement et se fragmente. Je ne crois pas qu’avant Bayle il ait existé un public philosophique distinct du grand public littéraire ou commençant à s’en détacher. Car je n’appelle pas public un groupe de savants unis, il est vrai, malgré leur dispersion en diverses provinces ou divers États, par la préoccupation des recherches semblables et la lecture des mêmes écrits, mais si peu nombreux qu’ils entretiennent tous entre eux des relations épistolaires et puisent dans ces rapports personnels le principal aliment de leur communion scientifique. Un public spécial ne se dessine qu’à partir du moment, difficile à préciser, où les hommes adonnés aux mêmes études ont été en trop grand nombre pour pouvoir se connaître ainsi personnellement, et n’ont senti se nouer entre eux les liens d’une certaine solidarité que par d’impersonnelles communications d’une fréquence et d’une régularité suffisantes. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un public politique naît, grandit, et bientôt, dans ses débordements, il absorbe, comme un fleuve ses affluents, tous les autres publics, littéraire, philosophique, scientifique. Cependant, jusqu’à la Révolution, la vie de public a peu d’intensité par elle-même et ne prend d’importance que par la vie de foule à laquelle elle se rattache encore, par l’animation extrême des salons et des cafés.
De la Révolution date l’avènement véritable du journalisme, et, par suite, du public, dont elle a été la fièvre de croissance. Ce n’est pas qu’elle n’ait suscité des foules aussi, mais cela n’a rien qui la distingue des guerres civiles du passé, au XIVe, au XVIe siècle, sous la Fronde même. Les foules frondeuses, les foules ligueuses, les foules cabochiennes, n’étaient ni moins redoutables, ni peut-être moins nombreuses que celles du 14 juillet et du 10 août. Car une foule ne saurait grossir au-delà d’un certain degré, marqué par les limites de la voix et du regard, sans se fractionner aussitôt ou sans devenir incapable d’une action d’ensemble, action toujours la même, d’ailleurs : barricades, pillages de palais, massacres, démolitions, incendies. Rien de plus monotone que ces manifestations séculaires de son activité. Mais ce qui caractérise 1789, ce que le passé n’avait jamais vu, c’est cette pullulation de journaux, avidement dévorés, qui éclosent à cette époque. Si beaucoup sont mort-nés, quelques-uns donnent le spectacle d’une diffusion inouïe. Chacun de ces grands et odieux publicistes, Marat, Desmoulins, le père Duchesne, avait son public, et l’on peut considérer les foules incendiaires, pillardes, meurtrières, cannibales, qui ont ravagé la France alors, du nord au midi, de l’est à l’ouest, comme des excroissances, des éruptions malignes de ces publics, auxquels leurs malfaisants échansons – menés en triomphe au Panthéon après leur mort – versaient tous les jours l’alcool vénéneux des mots vides et violents. Ce n’est pas que les émeutes fussent composées exclusivement, à Paris même, à plus forte raison en province et dans les campagnes, de lecteurs de journaux ; mais ceux-ci en étaient toujours le levain, sinon la pâte. Les clubs aussi, les réunions de café, qui ont joué un rôle si important pendant la période révolutionnaire, sont nés du public, tandis que, avant la Révolution, le public était plutôt l’effet que la cause des réunions de cafés et de salons.
Mais le public révolutionnaire était surtout parisien ; au-delà de Paris, il rayonnait faiblement. Arthur Young, dans son fameux voyage, est frappé de voir les feuilles publiques si peu répandues dans les villes mêmes. Il est vrai que la remarque s’applique aux débuts de la Révolution ; un peu plus tard, elle perdrait beaucoup de sa justesse. Jusqu’à la fin, cependant, l’absence de communications rapides a opposé un obstacle insurmontable à l’intensité et à la large propagation de la vie de public. Comment des journaux, qui n’arrivent que deux ou trois fois par semaine, et huit jours après leur apparition à Paris, pourraient-ils donner à leurs lecteurs du midi la sensation d’actualité et la conscience d’unanimité simultanée, sans lesquelles la lecture d’un journal ne diffère pas essentiellement de celle d’un livre ? Il était réservé à notre siècle, par ses procédés de locomotion perfectionnée et de transmission instantanée de la pensée à toute distance, de donner aux publics, à tous les publics, l’extension indéfinie dont ils sont susceptibles et qui creuse entre eux et les foules un contraste si marqué. La foule est le groupe social du passé ; après la famille, elle est le plus antique de tous les groupes sociaux. Elle est, sous toutes ses formes, debout ou assise, immobile ou en marche, incapable de s’étendre au-delà d’un faible rayon ; quand ses meneurs cessent de la tenir in manu, quand elle cesse d’entendre leur voix, elle s’échappe. Le plus vaste auditoire qu’on ait vu est celui du Colisée ; encore n’excédait-il pas cent mille personnes. Les auditoires de Périclès ou de Cicéron, ceux même des grands prédicateurs du Moyen Âge, d’un Pierre l’Ermite ou d’un saint Bernard, étaient sans doute bien inférieurs. Aussi ne voit-on pas que la puissance de l’éloquence, soit politique, soit religieuse, ait sensiblement progressé dans l’antiquité ou au Moyen Âge. Mais le public est indéfiniment extensible, et comme, à mesure qu’il s’étend, sa vie particulière devient plus intense, on ne peut nier qu’il ne soit le groupe social de l’avenir. Ainsi s’est formée, par un faisceau de trois inventions mutuellement auxiliaires, imprimerie, chemin de fer, télégraphe, la formidable puissance de la presse, ce prodigieux téléphone qui a si démesurément grossi l’ancien auditoire des tribuns et des prédicateurs. Je ne puis donc accorder à un vigoureux écrivain, le Dr Le Bon, que notre âge soit « l’ère des foules ». Il est l’ère du public ou des publics, ce qui est bien différent.
Jusqu’à un certain point, un public se confond avec ce qu’on appelle un monde, « le monde littéraire », le « monde politique », etc., à cela près que cette dernière idée implique, entre les personnes qui font partie du même monde, un contact personnel, un échange de visites, de réceptions, qui peut ne pas exister entre les membres d’un même public. Mais de la foule au public la distance est immense, comme on le voit déjà, quoique le public procède en partie d’une espèce de foule, de l’auditoire des orateurs.
Entre les deux, il est bien d’autres différences instructives, que je n’ai pas encore indiquées. On peut appartenir en même temps, et de fait on appartient toujours simultanément, à plusieurs publics comme à plusieurs corporations ou sectes ; on ne peut appartenir qu’à une seule foule à la fois. De là l’intolérance beaucoup plus grande des foules et, par suite, des nations où domine l’esprit des foules, parce que l’être y est pris tout entier, irrésistiblement entraîné par une force sans contrepoids. Et de là, l’avantage attaché à la substitution graduelle des publics aux foules, transformation qui s’accompagne toujours d’un progrès dans la tolérance, sinon dans le scepticisme. Il est vrai que d’un public surexcité, comme il arrive souvent, jaillissent parfois des foules fanatiques qui se promènent par les rues en criant vive ou à mort n’importe quoi. Et, en ce sens, le public pourrait être défini une foule virtuelle. Mais cette chute du public dans la foule, si elle est dangereuse au plus haut degré, est en somme assez rare ; et, sans examiner si ces foules nées d’un public ne sont pas un peu moins brutales, malgré tout, que les foules antérieures à tout public, il reste évident que l’opposition de deux publics, toujours prêts à se fusionner sur leurs frontières indécises, est un bien moindre danger pour la paix sociale que la rencontre de deux foules opposées.
La foule, groupement plus naturel, est plus asservie aux forces de la nature ; elle dépend de la pluie ou du beau temps, de la chaleur ou du froid ; elle est plus fréquente l’été que l’hiver. Un rayon de soleil la rassemble, une averse la dissipe. Bailly, quand il était maire de Paris, bénissait les jours de pluie, et s’attristait en voyant s’éclaircir le ciel. Mais le public, groupement d’un ordre supérieur, n’est pas soumis à ces variations et à ces caprices du milieu physique, de la saison ou même du climat. Non seulement la naissance et la croissance, mais les surexcitations même du public, maladies sociales apparues en ce siècle et d’une gravité toujours grandissante, échappent à ces influences.
C’est en plein hiver qu’a sévi dans toute l’Europe la crise la plus aiguë de ce genre, à notre connaissance, celle de l’affaire Dreyfus. A-t-elle été plus passionnée au midi qu’au nord, à l’instar des foules ? Non, c’est plutôt en Belgique, en Prusse, en Russie qu’elle a agité les esprits. – Enfin, l’empreinte de la race est bien moins profonde sur le public que sur la foule. Et il n’en peut être autrement, en vertu de la considération suivante.
Pourquoi, en effet, un meeting anglais diffère-t-il si profondément d’un club français, un massacre de septembre d’un lynchage américain, une fête italienne d’un couronnement du tsar où deux cent mille moujiks rassemblés ne s’émeuvent pas de la catastrophe qui fait périr trente mille d’entre eux ? Pourquoi, d’après la nationalité d’une foule, un bon observateur peut-il prédire, presque à coup sûr, comment elle agira, – beaucoup plus sûrement qu’il ne prédirait la manière d’agir de chacun des individus qui la composent – et pourquoi, malgré les plus grandes transformations survenues dans les mœurs et les idées de la France ou de l’Angleterre depuis trois ou quatre siècles, les foules françaises de notre temps, boulangistes ou antisémites, rappellent-elles par tant de traits communs les foules de la Ligue ou de la Fronde, comme les foules anglaises d’aujourd’hui celles du temps de Cromwell ? Parce que, dans la composition d’une foule, les individus n’entrent que par leurs similitudes ethniques, qui s’additionnent et font masse, non par leurs différences propres, qui se neutralisent, et que, dans le roulement d’une foule, les angles de l’individualité s’émoussent mutuellement au profit du type national qui se dégage. Il en est ainsi malgré l’action individuelle du meneur ou des meneurs qui se fait toujours sentir, mais toujours contrebalancée par l’action réciproque des menés.
Or, l’influence que le publiciste exerce sur son public, si elle est beaucoup moins intense à un instant donné, est, par sa continuité, bien plus puissante que l’impulsion brève et passagère imprimée à la foule par son conducteur ; et, de plus, elle est secondée, jamais combattue, par l’influence beaucoup plus faible que les membres d’un même public exercent les uns sur les autres, grâce à la conscience de l’identité simultanée de leurs idées ou de leurs tendances, de leurs convictions ou de leurs passions, quotidiennement attisées par le même soufflet de forge.
On a pu contester, à tort, mais non sans une spécieuse apparence de raison, que toute foule ait un meneur, et, de fait, c’est souvent elle qui mène son chef. Mais qui contestera que tout public a son inspirateur, et parfois son créateur ? Ce que Sainte-Beuve dit du génie, que « le génie est un roi qui crée son peuple », est surtout vrai du grand journaliste. Combien voit-on de publicistes créer leur public ! À la vérité, pour qu’Édouard Drumont suscitât l’antisémitisme, il a fallu que sa tentative d’agitation répondît à un certain état d’esprit disséminé parmi la population ; mais, tant qu’une voix ne s’élevait pas, retentissante, qui prêtât une expression commune à cet état d’esprit, il restait purement individuel, peu intense, encore moins contagieux, inconscient de lui-même. Celui qui l’a exprimé l’a créé comme force collective, factice, soit, réelle néanmoins. Je sais des régions françaises où l’on n’a jamais vu un seul juif, ce qui n’empêche pas l’antisémitisme d’y fleurir, parce qu’on y lit les journaux antisémites. L’état d’esprit socialiste, l’état d’esprit anarchiste, n’étaient rien non plus, avant que quelques publicistes fameux, Karl Marx, Kropotkine et autres, les eussent exprimés et mis en circulation à leur effigie. On comprend facilement, d’après cela, que l’empreinte individuelle du génie de son promoteur soit plus marquée sur un public que le génie de la nationalité, et que l’inverse soit vrai de la foule. On comprend aussi, de la même manière, que le public d’un même pays, en chacune de ses branches principales, apparaisse transformé en très peu d’années quand ses conducteurs se sont renouvelés, et que, par exemple, le public socialiste français d’à présent ne ressemble en rien à celui du temps de Proudhon – pendant que les foules françaises de tout genre gardent leur même physionomie reconnaissable à travers les siècles.
On objectera peut-être que le lecteur d’un journal dispose bien plus de sa liberté d’esprit que l’individu perdu et entraîné dans une foule. Il peut réfléchir à ce qu’il lit, en silence, et, malgré sa passivité habituelle, il lui arrive de changer de journal, jusqu’à ce qu’il ait trouvé celui qui lui convient ou qu’il croit lui convenir. D’autre part, le journaliste cherche à lui plaire et à le retenir. La statistique des abonnements et des désabonnements est un excellent thermomètre, souvent consulté, qui avertit les rédacteurs de la ligne de conduite et de pensée à suivre. Une indication de cette nature a motivé, dans une affaire fameuse, la volte-face subite d’un grand journal, et cette palinodie n’est pas exceptionnelle. Le public réagit donc parfois sur le journaliste, mais celui-ci agit continuellement sur son public. Après quelques tâtonnements, le lecteur a choisi son journal, le journal a trié ses lecteurs, il y a eu mutuelle sélection, d’où mutuelle adaptation. L’un a mis la main sur un journal à sa convenance, qui flatte ses préjugés ou ses passions, l’autre sur un lecteur à son gré, docile et crédule, qu’il peut diriger facilement moyennant quelques concessions à son parti pris, analogues aux précautions oratoires des anciens orateurs. L’homme d’un seul livre est à craindre, a-t-on dit ; mais qu’est-ce auprès de l’homme d’un seul journal ! Et cet homme, c’est chacun de nous au fond, ou peu s’en faut. Voilà le danger des temps nouveaux. Loin, donc, d’empêcher l’action du publiciste d’être finalement décisive sur son public, la double sélection, la double adaptation qui fait du public un groupe homogène, bien connu de l’écrivain et bien maniable, lui permet d’agir avec plus de force et de sûreté. – La foule est, en général, bien moins homogène que le public : elle se grossit toujours de beaucoup de curieux, de demi-adhérents qui ne tardent pas à être momentanément gagnés et assimilés, mais qui ne laissent pas de rendre malaisée une direction commune de ces éléments incohérents.
On pourra contester cette homogénéité relative, sous prétexte que « nous ne lisons jamais le même livre » de même que « nous ne nous baignons jamais dans le même fleuve ». Mais, outre que ce paradoxe antique est fort discutable, est-il aussi vrai de dire que nous ne lisons jamais le même journal ? On pensera peut-être que, le journal étant plus bariolé que le livre, l’adage cité est encore plus applicable à celui-là qu’à celui-ci. En fait, cependant, tout journal a son clou, et ce clou, de plus en plus mis en relief, fixe l’attention de la totalité des lecteurs, hypnotisés par ce point brillant. Au fond, malgré sa bigarrure d’articles, chaque feuille a sa couleur voyante qui lui est propre, sa spécialité, soit pornographique, soit diffamatoire, soit politique, soit toute autre, à laquelle tout le reste est sacrifié et sur laquelle son public se jette avidement. En le prenant par cet appât, le journaliste selon son cœur le mène où il veut.
Autre considération. Le public, après tout, n’est qu’une espèce de clientèle commerciale, mais une espèce très singulière et qui tend à éclipser le genre. Or, déjà le fait d’acheter les mêmes produits dans des magasins de même ordre, de se faire habiller chez la même faiseuse ou le même tailleur, de fréquenter le même restaurant, établit entre les personnes d’un même monde un certain lien social et suppose entre elles des affinités que ce lien resserre et accentue. Chacun de nous, en achetant ce qui répond à ses besoins, a plus ou moins vaguement conscience d’exprimer et de développer par là son union avec la classe sociale qui s’alimente, s’habille, se satisfait en tout d’une manière à peu près analogue. Le fait économique, seul remarqué des économistes, se complique donc d’un rapport sympathique qui mériterait aussi d’attirer leur attention. Ils ne considèrent les acheteurs d’un produit, d’un service, que comme des rivaux qui se disputent l’objet de leur désir ; mais ce sont aussi et surtout des congénères, des semblables qui cherchent à fortifier leur similitude et à se distinguer de ce qui n’est pas eux. Leur désir se nourrit du désir d’autrui, et, dans leur émulation même, il y a une secrète sympathie qui demande à s’accroître. Mais combien le lien qui se noue, par la lecture habituelle d’un même journal, entre ses lecteurs, est plus intime encore et plus profond ! Ici, personne ne songerait à parler de concurrence, il n’y a qu’une communion d’idées suggérées, et la conscience de cette communion – mais non de cette suggestion, qui est pourtant manifeste.
De même qu’il y a, pour tout fournisseur, deux sortes de clientèle, une clientèle fixe et une clientèle flottante, il y a aussi deux sortes de public pour les journaux ou les revues : un public stable, consolidé, et un public flottant, instable. La proportion de ces deux publics est très inégale d’une feuille à l’autre ; pour les vieilles feuilles, organe des vieux partis, le second ne compte pas ou compte à peine, et je conviens qu’ici l’action du publiciste est singulièrement entravée par l’intolérance de la maison où il est entré et d’où une dissidence affichée le chasserait. Elle est, en revanche, tout autrement durable et pénétrante quand elle parvient à s’exercer là. Remarquons, du reste, que les publics fidèles et traditionnellement attachés à un journal tendent à disparaître, de plus en plus remplacés par des publics plus mouvants, sur lesquels la prise du journaliste de talent est bien plus aisée, sinon plus solide. On peut gémir, à bon droit sur cette évolution du journalisme, car les publics fermes font les publicistes honnêtes et convaincus, comme les publics capricieux font les publicistes légers, versatiles, inquiétants : mais il semble bien qu’elle soit à présent irrésistible, malaisément réversible, et l’on voit les perspectives de puissance sociale grandissante qu’elle ouvre aux hommes de plume. Il se peut qu’elle asservisse de plus en plus aux caprices de leur public les publicistes médiocres, mais, à coup sûr, elle soumet de plus en plus au despotisme des grands publicistes leur public subjugué. Ceux-ci, bien plus que les hommes d’État, même supérieurs, font l’opinion et mènent le monde. Et, quand ils se sont imposés, quel trône solide est le leur ! Comparez à l’usure si rapide des hommes politiques, même des plus populaires, le règne prolongé et indestructible des journalistes de haute marque, qui rappelle la longévité d’un Louis XIV ou le succès indéfini des comédiens et des tragédiens illustres. Il n’est pas de vieillesse pour ces autocrates.
Voilà pourquoi il est si malaisé de faire une bonne loi sur la presse. C’est comme si l’on avait voulu réglementer la souveraineté du Grand Roi ou de Napoléon. Les délits de presse, les crimes de presse même, sont à peu près impunissables comme l’étaient les délits de tribune dans l’antiquité et les délits de chaire au Moyen Âge.