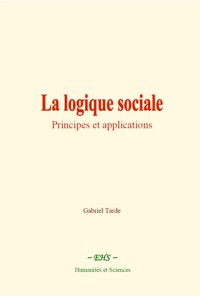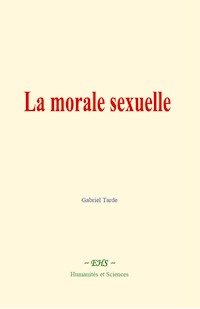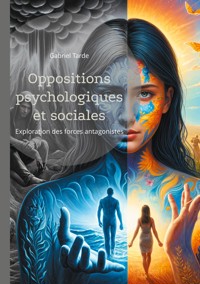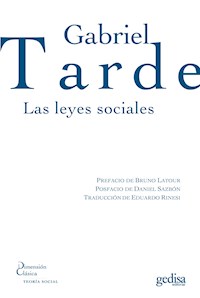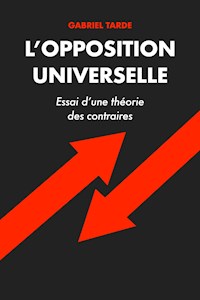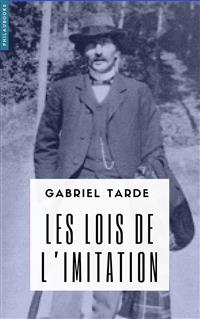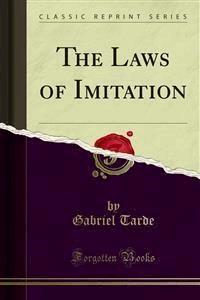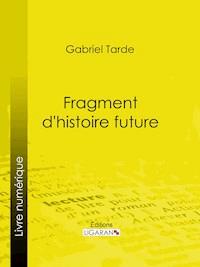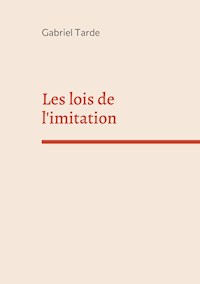
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans l'ombre de Durkheim, Gabriel Tarde n'a peut-être pas eu la place qu'il méritait. Fondateur de la sociologie moderne et précurseur de la psychologie sociale, il nous permet pourtant de mieux comprendre les phénomènes de groupes ou les faits de masse en replaçant l'individu au centre de son analyse reposant tout entière sur le principe des Lois de l'Imitation. « La lecture des Lois de l'imitation, pour qui s'intéresse à l'histoire de la sociologie française, produit l'effet d'une démystification. L'ouvrage, dans la diffusion critique qui trop souvent se substitua à l'examen attentif de ses thèses, semble avoir fait l'objet d'un faux procès. Et plus encore, on est conduit à se demander si la grande opposition entre Tarde et Durkheim, dont on sait qu'elle alimente le débat sociologique à la fin du XIXème et dans les premières décennies du XXème siècle, ne repose pas en définitive sur un profond malentendu. » Sommaire : Chapitre I. La Répétition universelle ; Chapitre II. Les similitudes sociales et l'imitation ; Chapitre III. Qu'est-ce qu'une société ? ; Chapitre IV. Qu'est-ce que l'histoire ? L'archéologie et la statistique ; Chapitre V. Les lois logiques de l'imitation ; Chapitre VI. Les influences extra-logiques ; Chapitre VII. Les influences extra-logiques (suite). La Coutume et la Mode ; Chapitre VIII. Remarques et corollaires...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Chapitre I. La Répétition universelle
I. Régularité inaperçue des faits sociaux à un certain point de vue. Leurs analogies avec les faits naturels. Les trois formes de la Répétition universelle: ondulation, génération, imitation. Science sociale et philosophie sociale. Sociétés animales.
II. Trois lois analogues en physique, en biologie, en sociologie. Pourquoi tout est nombre et mesure.
III et IV Analogies entre les trois formes de la Répétition. Elles impliquent une tendance commune à une progression géométrique. - Réfractions linguistiques, mythologiques, etc. - Interférences heureuses ou malheureuses d'imitation. Interférences-luttes et interférences-combinaisons (inventions). Esquisse de logique sociale.
V. Différences entre les trois formes de la Répétition. Génération, ondulation libre. Imitation, génération à distance. Abréviation des phases embryonnaires.
Chapitre II. Les similitudes sociales et l'imitation
I. Similitudes sociales qui n'ont point l'imitation et similitudes vivantes qui n'ont point la génération pour cause. Distinction des
analogies
et des
homologies
en sociologie comparée comme en anatomie comparée. Arbre généalogique des inventions, dérivant d'inventions-mères. Propagation lente et inévitable des exemples, même à travers des peuples sédentaires et clos.
II. Y a-t-il une loi des civilisations qui leur impose un chemin commun ou du moins un terme commun, et, par suite, des similitudes croissantes, même sans imitation ? Preuves du contraire.
Chapitre III. Qu'est-ce qu'une société ?
I. Insuffisance de la notion économique ou même juridique: sociétés animales. Ne pas confondre nation et société. Définition.
II. Définition du type social
III. La
socialité
parfaite. Analogies biologiques. Les agents cachés, et peut-être originaux, de la répétition universelle.
IV. Une idée de Taine. La contagion de l'exemple et la suggestion. Analogies entre l'état social et l'état hypnotique. Les grands hommes. L'intimidation, état social naissant.
Chapitre IV. Qu'est-ce que l'histoire ? L'archéologie et la statistique
I et II. Distinction entre l'anthropologiste et l'archéologue. Ce dernier, inconsciemment, se place à notre point de vue. Stérilité d'invention propre aux temps primitifs. Imitation extérieure et diffuse, dès les plus hauts temps. Ce que nous apprend l'archéologie.
III. Le statisticien voit les choses, au fond, comme l'archéologue: il s'occupe exclusivement des éditions imitatives, tirées de chaque invention ancienne ou récente. Analogies et différences.
IV et V. Ce que devrait être la statistique; ses
desiderata
. Interprétation de ses courbes, à savoir de ses côtes, de ses plateaux et de ses descentes, fournie par notre point de vue. Tendance de toutes idées et de tous besoins à se répandre suivant une progression géométrique. Rencontre, concours et lutte de ces tendances. Exemples. Le besoin de paternité et ses variations. Le besoin de liberté et autres. Loi empirique générale; trois phases; importance de la seconde.
VI et VII. Les tracés de la statistique et le vol d'un oiseau. L’œil et l'oreille considérés comme des enregistrements numériques d'ondulations éthérées ou sonores, statistiques figurées de l'univers. Rôle futur probable de la statistique. Définition de l'histoire.
Chapitre V. Les lois logiques de l'imitation
Pourquoi, dans les inventions en présence, les unes sont imitées, les autres non. Raisons d'ordre naturel et d'ordre social, et parmi celles-ci, raisons logiques et influences extra-logiques. Exemple linguistique.
I. Ce qui est imité, c'est croyance ou désir, antithèse fondamentale. La formule spencérienne. Le progrès social et la méditation individuelle. Le besoin d'invention et le besoin de critique ont même source. Progrès par
substitution
et progrès par
accumulation
d'inventions.
II.
Le duel logique.
Tout n'est que
duels
ou
accouplements
d'inventions en histoire. L'un dit toujours
oui
et l'autre
non
. Duels linguistiques, législatifs, judiciaires, politiques, industriels, artistiques. Développements. Chaque duel est double, chaque adversaire affirmant sa thèse en même temps qu'il nie celle de l'autre. Moment où les
rôles se renversent
. Duel individuel et duel social. - Dénouement: trois issues possibles.
III.
L'accouplement logique.
Ne pas confondre la période d'accumulation qui précède la période de substitution avec celle qui la suit. Distinction entre la
grammaire
et le
dictionnaire
linguistiquement, religieusement, politiquement, etc. Le dictionnaire se grossit
plus aisément
que la grammaire ne se perfectionne.
Autres considérations
Chapitre VI. Les influences extra-logiques
Caractères différents de l'imitation. - I. Sa précision et son exactitude croissantes; cérémonies et procédures. - II. Son caractère conscient ou inconscient. - Puis, marche de l'imitation :
1
o
Du dedans au dehors de l'homme
. - Diverses fonctions physiologiques comparées au point de vue de leur transmissibilité par l'exemple. Obéissance et crédulité primitives. Dogmes transmis avant rites. Admiration précédant envie. Idées communiquées avant expressions; buts communiqués avant moyens. Explication des survivances par cette loi. Son universalité. Son application à l'imitation féminine même.
2
o
Du supérieur à l'inférieur
. - Exceptions à cette loi, sa vérité comparable à celle qui régit le rayonnement de la chaleur. - I. Exemples. La
martinella
et le
carroccio
. Les Phéniciens et les Vénitiens. Utilité des aristocratie. - II. Hiérarchie ecclésiastique et ses effets. - III. C'est le plus supérieur, parmi les moins distants, qui est imité.
Distance
au sens social. - IV. En temps démocratique, les noblesses sont remplacées par les grandes villes, qui leur ressemblent en bien et en mal. - V. En quoi consiste la
supériorité sociale
: en caractères internes ou externes qui favorisent l'exploitation des inventions à un moment donné. - VI. Application au problème des origines du système féodal.
Chapitre VII. Les influences extra-logiques (suite). La Coutume et la Mode
Âges de
coutume
où le modèle ancien, paternel ou patriotique, a toute faveur; âges de
mode
, où l'avantage est souvent au modèle nouveau, exotique. Par la
mode
, l'imitation s'affranchit de la génération. Rapports de l'imitation et de la génération semblables à ceux de la génération et de l'ondulation. - Passage de la coutume à la mode, puis retour à la coutume élargie. Application de cette loi:
I.
Aux langues.
Le rythme de la diffusion des idiomes. Formation des langues romanes. Caractères et résultats des transformations indiquées.
II.
Aux religions.
Toutes vont de l'exclusivisme au prosélytisme, puis se recueillent. Reproduction de ces trois phases dès les plus hauts temps. Culte de l'étranger, et non pas seulement de l'ancêtre, dès lors. L'étranger bestial adoré. Pourquoi les dieux très anciens sont
zoomorphiques
. La faune divine. Le culte, espèce de domestication supérieure. - Spiritualisation des religions qui se répandent par mode. Effets moraux. Importance sociale des religions.
III.
Aux gouvernements.
Double origine des États, la famille et la horde. En chaque État, deux partis, celui de la coutume et celui de la mode, dès les temps les plus anciens. Fréquence du fait des familles royales de sang étranger. - Le fief, invention propagée par engouement; de même, la monarchie féodale ; de même, la monarchie moderne. Libéralisme et cosmopolitisme. Nationalisation finale des importations étrangères. Comment se sont formés les États-Unis. - Auguste, Louis XIV, Périclès. - Critique de l'antithèse de Spencer, militarisme et industrialisme, comparée à celle de Tocqueville, aristocratie et démocratie.
IV.
Aux législations.
Évolution juridique. Droit coutumier et droit législatif. Droit très multiforme et très stable en temps de coutume, très uniforme et très changeant en temps de mode. Propagation des chartes de ville en ville. L'
Ancien Droit
de Sumner Maine. Le rythme des trois phases appliqué à la procédure criminelle. Caractères successifs de la législation. Classification.
V.
Aux usages et aux besoins (économie politique).
Multiformité et stabilité des usages; puis uniformité et rapide changement. La production et la consommation, distinction universellement applicable. Partout transmissibilité plus rapide des besoins de consommation que des besoins de production. Conséquences de cette vitesse inégale. Débouché
ultérieur
aux âges de coutume, débouché extérieur aux âges de mode. L'industrie au moyen âge. Ordre des formes successives de la grande industrie. Le prix de mode et le prix de coutume. Caractères successifs imprimés au monde économique et aux aspects sociaux comparés, par les changements de l'imitation. Raison de ces changements.
VI.
Aux morales et aux arts.
Devoirs, inventions originales au début. Élargissement graduel du public moral et du public artistique. L'art de coutume né du métier, professionnel et national ; l'art de mode, inutile et exotique. Morale de mode et morale de coutume. Probabilité pour l'avenir. – Le phénomène historique des
Renaissances
, soit morales, soit esthétiques.
Chapitre VIII. Remarques et corollaires
Résumé et complément. Toutes les lois de l'imitation ramenée à un même point de vue. – Corollaires.
I. Le passage de l'
unilatéral
au
réciproque
. Exemples: du décret au contrat; du dogme à la libre-pensée; de la chasse humaine à la guerre; de la courtisanerie à l'urbanité. Nécessité de ces transformations.
II. Distinction du réversible et de l'irréversible en histoire. Ce qui est irréversible par suite des lois de l'imitation, et ce qui l'est par suite des lois de l'invention. Un mot à ce dernier sujet. Changements irréversibles du costume même, dans une certaine mesure. Les grands Empires de l'avenir. - L'individualisme final.
Présentation
Gabriel de Tarde
Parmi les grands noms de la sociologie de la fin du XIXe siècle, celui de Tarde attire peu l'attention des spécialistes, encore moins celle du grand public. On s'en souvient surtout en référence à Durkheim, auquel il opposa une conception de la société qui restitue une place fondamentale aux initiatives individuelles et à leurs trajectoires.
Or la lecture des Lois de l'imitation, le grand ouvrage de Tarde plusieurs fois réédité de son vivant, modifie considérablement cette appréciation. On y découvre une pensée originale, à la fois riche et forte, qui sans se réduire à un individualisme convenu, s'interroge sur la genèse de la société à partir de ses composantes réelles. Ces composantes sont moins les individus que les courants d'imitations qui se diffusent à travers eux. La société selon Tarde est un niveau de réalité dont le propre est de fonctionner à l'imitativité généralisée ; imitativité à laquelle notre époque fournit des moyens de plus en plus diversifiés et efficaces, dont nous ne saisissons qu'encore obscurément les implications.
Préface de la deuxième édition
mai 1895
Depuis la première édition de ce livre, j'en ai publié la suite et le complément sous le titre de Logique sociale.
Par là je crois avoir déjà répondu implicitement à certaines objections que la lecture des Lois de l'imitation avait pu faire naître. Il n'est cependant pas inutile de donner à ce sujet quelques brèves explications.
On m'a reproché çà et là « d'avoir souvent appelé imitation des faits auxquels ce nom ne convient guère ». Reproche qui m'étonne sous une plume philosophique. En effet, lorsque le philosophe a besoin d'un mot pour exprimer une généralisation nouvelle, il n'a que le choix entre deux partis : ou bien le néologisme, s'il ne peut faire autrement, ou bien, ce qui vaut beaucoup mieux sans contredit, l'extension du sens d'un ancien vocable. Toute la question est de savoir si j'ai étendu abusivement - je ne dis pas au point de vue des définitions de dictionnaire, mais d'après une notion plus profonde des choses - la signification du mot imitation.
Or, je sais bien qu'il n'est pas conforme à l'usage ordinaire de dire d'un homme, lorsque, à son insu et involontairement, il reflète une opinion d'autrui ou se laisse suggérer une action d'autrui, qu'il imite cette idée ou cet acte. Mais, si c'est sciemment et délibérément qu'il emprunte à son voisin une façon de penser ou d'agir, on accorde que l'emploi du mot dont il s'agit est ici légitime. Rien, cependant, n'est moins scientifique que cette séparation absolue, cette discontinuité tranchée, établie entre le volontaire et l'involontaire, entre le conscient et l'inconscient. Ne passe-t-on pas par degrés insensibles de la volonté réfléchie à l'habitude à peu près machinale ? Et un même acte change-t-il absolument de nature pendant ce passage ? Ce n'est pas que je nie l'importance du changement psychologique produit de la sorte ; mais, sous son aspect social, le phénomène est resté le même. On n'aurait le droit de critiquer comme abusif l'élargissement de la signification du mot en question que si, en l'étendant, je l'avais déformé et rendu insignifiant. Mais je lui ai laissé un sens toujours très précis et caractéristique : celui d'une action à distance d'un esprit sur un autre, et d'une action qui consiste dans une reproduction quasi photographique d'un cliché cérébral par la plaque sensible d'un autre cerveau 1. Est-ce que si, à un certain moment, la plaque du daguerréotype devenait consciente de ce qui s'accomplit en elle, le phénomène changerait essentiellement de nature ? - J'entends par imitation toute empreinte de photographie inter-spirituelle, pour ainsi dire qu'elle soit voulue ou non, passive ou active. Si l'on observe que, partout où il y a un rapport social quelconque entre deux êtres vivants, il y a imitation en ce sens (soit de l'un par l'autre, soit d'autres par les deux, comme, par exemple, quand on cause avec quelqu'un en parlant la même langue, en tirant de nouvelles épreuves verbales de très anciens clichés), on m'accordera qu'un sociologue était autorisé à mettre en vedette cette notion.
À bien plus juste titre on pourrait me reprocher d'avoir étendu outre mesure le sens du mot invention. Il est certain que j'ai prêté ce nom à toutes les initiatives individuelles, non seulement sans tenir compte de leur degré de conscience - car souvent l'individu innove à son insu, et à vrai dire, le plus imitateur des hommes est novateur par quelque côté - mais encore sans avoir égard le moins du monde au plus ou moins de difficulté et de mérite de l'innovation. Ce n'est pas que je méconnaisse l'importance de ce dernier point de vue, et telles inventions sont si faciles à concevoir qu'on peut admettre qu'elles se sont présentées d'elles-mêmes presque partout, sans nul emprunt, dans les sociétés primitives, et que l'accident de leur apparition ici ou là pour la première fois importe assez peu. D'autres découvertes, au contraire, sont tellement ardues que l'heureuse rencontre d'un génie qui les atteint peut être regardée comme une chance singulière entre toutes et d'une importance majeure. Eh bien, malgré tout, je crois qu'ici même j'ai eu raison de faire à la langue commune une violence légère en qualifiant inventions ou découvertes les innovations les plus simples, d'autant mieux que les plus aisées ne sont pas toujours les moins fécondes, ni les plus malaisées les moins inutiles. - Ce qui est réellement abusif, en revanche, c'est l'acception élastique prêtée par beaucoup de sociologues naturalistes au mot hérédité, qui leur sert à exprimer pêle-mêle avec la transmission des caractères vitaux par génération, la transmission d'idées, de mœurs, de choses sociales, par tradition ancestrale, par éducation domestique, par imitation-coutume. Au surplus, ce qu'il y a peut-être de plus facile en fait de conception, c'est un néologisme tiré du grec. Au lieu de dire invention ou imitation, j'aurais pu forger, sans beaucoup de peine, deux mots nouveaux. - Mais laissons là cette petite chicane sans intérêt.
- Ce qui est plus grave, on m'a parfois taxé d'exagération dans l'emploi des deux notions dont il s'agit. Reproche un peu banal, il est vrai, et auquel tout novateur doit s'attendre, alors même qu'il aurait péché par excès de réserve dans l'expression de sa pensée. Soyez sûrs que, lorsqu'un philosophe grec s'avisa de dire que le soleil était peut-être bien aussi grand que le Péloponnèse, ses meilleurs amis furent unanimes à reconnaître qu'il y avait quelque chose de vrai au fond de son ingénieux paradoxe, mais qu'évidemment il exagérait. - En général, on n'a pas pris garde à la fin que je me proposais et qui était de dégager des faits humains leur côté sociologique pur, abstraction faite, par hypothèse, de leur côté biologique, inséparable pourtant, je le sais fort bien, du premier. Mon plan ne m'a permis que d'indiquer sans grand développement, les rapports des trois formes principales de la répétition universelle, notamment de l'hérédité avec l'imitation. Mais j'en ai assez dit, je crois, pour ne laisser aucun doute sur ma pensée, au sujet de l'importance de la race et du milieu physique.
En outre, dire que le caractère distinctif de tout rapport social, de tout fait social, est d'être imitatif, est-ce dire, comme certains lecteurs superficiels ont paru le croire, qu'il n'y ait à mes yeux d'autre rapport social, d'autre fait social, d'autre cause sociale, que l'imitation ? Autant vaudrait dire que toute fonction vivante se réduit à la génération et tout phénomène vivant à l'hérédité, parce que, en tout être vivant, tout est engendré et héréditaire. Les relations sociales sont multiples, aussi nombreuses et aussi diverses que peuvent l'être les objets des besoins et des idées de l'homme et les secours ou les obstacles que chacun de ces besoins et chacune de ces idées prête ou oppose aux tendances et aux opinions d'autrui, pareilles ou différentes. Au milieu de cette complexité infinie, il est à remarquer que ces rapports sociaux si variés (parler et écouter, prier et être prié, commander et obéir, produire et consommer, etc.) se ramènent à deux groupes : les uns tendent à transmettre d'un homme à un autre, par persuasion ou par autorité, de gré ou de force, une croyance ; les autres, un désir. Autrement dit, les uns sont des variétés ou des velléités d'enseignement, les autres sont des variétés ou des velléités de commandement. Et c'est précisément parce que les actes humains imités ont ce caractère dogmatique ou impérieux que l'imitation est un lien social ; car ce qui lie les hommes, c'est le dogme 2 ou le pouvoir. (On n'a vu que la moitié de cette vérité, et on l'a mal vue, quand on a dit que la caractéristique des faits sociaux était d'être contraints et forcés. C'est méconnaître ce qu'il y a de spontané dans la plus grande part de la crédulité et de la docilité populaires.)
- Ce n'est donc point, je crois, par exagération que j'ai péché dans ce livre ; - aussi l'ai-je fait réimprimer sans nulle suppression -. C'est par omission plutôt. Je n'y ai point parlé d'une forme de l'imitation qui joue un grand rôle dans les sociétés, surtout dans les sociétés contemporaines; et je m'empresse de combler ici cette lacune. Il y a deux manières d'imiter, en effet : faire exactement comme son modèle, ou faire exactement le contraire. De là la nécessité de ces divergences que Spencer constate, mais n'explique pas, par sa loi de la différenciation progressive. On ne saurait rien affirmer sans suggérer, dans un milieu social tant soit peu complexe, non seulement l'idée qu'on affirme, mais aussi la négation de cette idée. Voilà pourquoi le surnaturel, en s'affirmant à l'apparition des théologies, suggère le naturalisme qui est sa négation (voir Espinas à ce sujet); voilà pourquoi le spiritualisme, en s'affirmant, donne l'idée du matérialisme; la monarchie, en s'établissant, l'idée de la république, etc.
Nous dirons donc, avec plus de largeur maintenant, qu'une société est un groupe de gens qui présentent entre eux beaucoup de similitudes produites par imitation ou par contre-imitation. Car les hommes se contre-imitent beaucoup, surtout quand ils n'ont ni la modestie d'imiter purement et simplement, ni la force d'inventer; et, en se contre-imitant, c'est-à-dire en faisant, en disant tout l'opposé de ce qu'ils voient faire ou dire, aussi bien qu'en faisant ou disant précisément ce qu'on fait ou ce qu'on dit autour d'eux, ils vont s'assimilant de plus en plus. Après la conformité aux usages en fait d'enterrement, de mariages, de cérémonies, de visites, de politesses, il n'y a rien de plus imitatif que de lutter contre son propre penchant à suivre ce courant et d'affecter de le remonter. Au moyen âge déjà, la messe noire est née d'une contre-imitation de la messe catholique. - Dans son ouvrage sur l'expression des émotions, Darwin accorde avec raison une grande place au besoin de contre-exprimer.
Quand un dogme est proclamé, quand un programme politique est affiché, les hommes se classent en deux catégories inégales : ceux qui s'enflamment pour, et ceux qui s'enflamment contre. Il n'y a pas de manifestation qui n'aille recrutant des manifestants et qui ne provoque la formation d'un groupe de contre-manifestants. Toute affirmation forte, en même temps qu'elle entraîne les esprits moyens et moutonniers, suscite quelque part, dans un cerveau né rebelle, ce qui ne veut pas dire né inventif, une négation diamétralement contraire et de force à peu près égale. Cela rappelle les courants d'induction en physique. - Mais les uns comme les autres ont le même contenu d'idées et de desseins, ils sont associés quoique adversaires ou parce que adversaires. Distinguons bien entre la propagation imitative des questions et celle des solutions. Que telle solution se propage ici et telle autre ailleurs, cela n'empêche pas le problème de s'être propagé ici comme ailleurs. N'est-il pas clair qu'à chaque époque, parmi les peuples en relations fréquentes, surtout à notre époque, parce que jamais les relations internationales n'ont été plus multiples, l'ordre du jour des débats sociaux et des débats politiques est partout le même ? Et cette similitude n'est-elle pas due à un courant d'imitation explicable lui-même par des besoins et des idées répandues par contagions imitatives antérieures? N'est-ce pas pour cette cause que les questions ouvrières en ce moment sont agitées dans toute l'Europe ? - À propos d'une idée quelconque mise en avant par la presse, chaque jour, je le répète, le public se partage en deux camps : ceux qui « sont de cet avis » et ceux qui « ne sont pas de cet avis ». Mais ceux-ci, pas plus que ceux-là, n'admettent qu'on puisse se préoccuper, en ce moment, d'autre chose que de la question qui leur est ainsi posée et imposée. Seuls, quelques sauvages esprits, étrangers, sous leur cloche à plongeur, au tumulte de l'océan social où ils sont plongés, ruminent çà et là des problèmes bizarres, absolument dépourvus d'actualité. Et ce sont les inventeurs de demain.
Il faut bien prendre garde à ne pas confondre avec l'invention la contre-imitation, sa contrefaçon dangereuse. Ce n'est pas que celle-ci n'ait son utilité. Si elle alimente l'esprit de parti, l'esprit de division belliqueuse ou pacifique entre les hommes, elle les initie au plaisir tout social de la discussion, elle atteste l'origine sympathique de la contradiction même, par la raison que les contre-courants mêmes naissent du courant. - Il ne faut pas confondre non plus la contreimitation avec la non-imitation systématique, dont j'aurais dû aussi parler dans ce livre. La non-imitation n'est pas toujours un simple fait négatif. Le fait de ne pas s'imiter, quand on n'est pas en contact - en contact social, par la possibilité pratique des communications - est un rapport non-social simplement; mais le fait de ne pas imiter tel voisin qui nous touche nous met avec lui sur un pied de relations réellement anti-sociales. L'obstination d'un peuple, d'une classe d'un peuple, d'une ville ou d'un village, d'une tribu de sauvages isolés sur un continent civilisé, à ne pas copier les vêtements, les mœurs, le langage, les industries, les arts, qui constituent la civilisation de leur voisinage, est une continuelle déclaration d'antipathie à l'adresse de cette forme de société, qu'on proclame étrangère absolument et à tout jamais ; et, pareillement, quand un peuple se met, avec un parti pris systématique, à ne plus reproduire les exemples de ses ancêtres, en fait de rites, d'usages, d'idées, c'est là une véritable dissociation des pères et des fils, rupture du cordon ombilical entre la vieille et la nouvelle société. La non-imitation volontaire et persévérante, en ce sens, a un rôle épurateur, assez analogue à celui que remplit ce que j'ai appelé le duel logique. De même que celui-ci tend à épurer l'amas social des idées et des volontés mélangées, à éliminer les disparates et les dissonances, à faciliter de la sorte l'action organisatrice de l'accouplement logique; ainsi, la non-imitation des modèles extérieurs et hétérogènes permet au groupe harmonieux des modèles intérieurs d'étendre, de prolonger, d'enraciner en coutume l'imitation dont ils sont l'objet; et, par la même raison, la non-imitation des modèles antérieurs, quand le moment est venu d'une révolution civilisatrice, fraie la voie à l'imitation-mode, qui ne trouve plus d'entrave à son action conquérante.
Cette opiniâtreté invincible - momentanément invincible - de nonimitation, a-t-elle pour cause unique ou principale, comme l'école naturaliste était portée à le penser il y a quelques années encore, la différence de race? Pas le moins du monde. D'abord, quand il s'agit de la non-imitation des exemples paternels, aux époques révolutionnaires, il est clair que la cause indiquée ne saurait être mise en avant, puisque la génération nouvelle est de même race que les générations antérieures dont elle rejette les traditions. Puis, s'il s'agit de la nonimitation de l'étranger, l'observation historique montre que cette résistance aux influences du dehors est très loin de se proportionner aux dissemblances des caractères physiques qui séparent les peuples. De toutes les nations conquises par Rome, il n'en était pas de plus rapprochées d'elle par le sang que les populations d'origine grecque; et ce sont précisément les seules qui ont échappé à la propagation de sa langue, à l'assimilation de sa culture et de son génie. Pourquoi ? Parce que seules, en dépit de la défaite, elles avaient pu et dû garder leur tenace orgueil, l'indélébile sentiment de leur supériorité. En faveur de l'idée que les races distinctes étaient imperméables pour ainsi dire à des emprunts réciproques, un des plus forts arguments qu'on pouvait citer il y a trente ans encore était la clôture hermétique opposée par les peuples de l'Extrême-Orient, Japon ou Chine, à toute culture européenne. Mais dès le jour assez récent où les Japonais, si éloignés de nous par le teint, les traits, la constitution corporelle, ont senti, pour la première fois, que nous leur étions supérieurs, ils ont cessé d'arrêter le rayonnement imitatif de notre civilisation par l'écran opaque d'autrefois; ils l'ont appelé au contraire de tous leurs vœux. Et il en sera de même de la Chine, si jamais elle s'avise de reconnaître à certains égards, - non à tous égards, je l'espère pour elle - que nous l'emportons sur elle. On objecterait en vain que la transformation du Japon dans le sens européen est plus apparente que réelle, plus superficielle que profonde, qu'elle est due à l'initiative de quelques hommes intelligents, suivis par une partie des classes supérieures, mais que la grande masse de la nation reste réfractaire à cette pénétration de l'étranger. - Objecter cela, ce serait ignorer que toute révolution intellectuelle et morale, destinée à refondre profondément un peuple, commence toujours de la sorte. Toujours une élite a importé des exemples étrangers peu à peu propagés par mode, consolidés en coutume, développés et systématisés par la logique sociale. Quand le christianisme est entré pour la première fois chez un peuple germain, slave ou finnois, il y a débuté de même. Rien de plus conforme aux « lois de l'imitation ».
Cela veut-il dire que l'action de la race sur le cours de la civilisation soit niée par ma manière de voir ? En aucune façon. J'ai dit qu'en passant d'un milieu ethnique à un autre milieu ethnique le rayonnement imitatif se réfracte; et j'ajoute que cette réfraction peut être énorme, sans qu'il en résulte une conséquence tant soit peu contraire aux idées développées dans le présent livre. Seulement, la race, telle qu'elle se montre à nous, est un produit national, où se sont fondus, au creuset d'une civilisation spéciale, diverses races préhistoriques, croisées, broyées, assimilées. Car chaque civilisation donnée, formée d'idées de génie provenant d'un peu partout et harmonisées logiquement quelque part, se fait à la longue sa race ou ses races où elle s'incarne pour un temps; et il n'est pas vrai, à l'inverse, que chaque race se fasse sa civilisation. Cela signifie, au fond, que les diverses races humaines, bien différentes en cela des diverses espèces vivantes, sont collaboratrices autant que concurrentes; qu'elles sont appelées, non pas seulement à se combattre et à s'entre-détruire pour le plus grand profit d'un petit nombre de survivants, mais à s'entr'aider dans l'exécution séculaire d'une œuvre sociale commune, d'une grande société finale, dont l'unité aura été le fruit de leur diversité même.
Les lois de l'hérédité, si bien étudiées par les naturalistes, ne contredisent donc en rien nos « lois de l'imitation ». Elles les complètent plutôt, et il n'est pas de sociologie concrète qui puisse séparer ces deux ordres de considérations. Si je les sépare ici, c'est, je le répète, parce que l'objet propre de ce travail est la sociologie pure et abstraite. D'ailleurs, je ne laisse pas d'indiquer leur place aux considérations biologiques que je néglige de parti pris, parce que je les réserve à de plus compétents que moi. Et cette place est triple. D'abord, en faisant naître expressément la nation de la famille, - car la horde, primitive aussi, est faite des émigrés ou des bannis de la famille - j'ai affirmé clairement que, si le fait social est un rapport d'imitation, le lien social, le groupe social, est à la fois imitatif et héréditaire. En second lieu, l'invention, d'où je fais tout découler socialement, n'est pas à mes yeux un fait purement social dans sa source : elle naît de la rencontre du génie individuel, éruption intermittente et caractéristique de la race, fruit savoureux d'une série d'heureux mariages, avec des courants et des rayonnements d'imitation qui se sont croisés un jour dans un cerveau plus ou moins exceptionnel. Admettez, si vous le voulez, avec M. de Gobineau, que les races blanches sont seules inventives, ou, avec un anthropologiste contemporain, que ce privilège appartient exclusivement aux races dolichocéphales, cela importe peu à mon point de vue. Et même je pourrais prétendre que cette séparation radicale, vitale, établie ainsi entre l'inventivité de certaines races privilégiées et l'imitativité de toutes est propre à faire ressortir - un peu abusivement, ce serait le cas de le dire - la vérité de ma manière de voir. - Enfin, en ce qui concerne l'imitation, non seulement j'ai reconnu l'influence du milieu vital où elle se propage en se réfractant, comme je l'ai dit plus haut, mais encore, en posant la loi du retour normal de la mode à la coutume, de l'enracinement coutumier et traditionnel des innovations, n'ai-je pas donné encore une fois à l'imitation pour soutien nécessaire l'hérédité ? Mais on peut accorder au côté biologique des faits sociaux la plus haute importance sans aller jusqu'à établir entre les diverses races, supposées primitives et pré-sociales, une cloison étanche qui rende impossible toute endosmose ou exosmose d'imitation. Et c'est la seule chose que je nie. Entendue en ce sens abusif et erroné, l'idée de race conduit le sociologue qui la prend pour guide à se représenter le terme du progrès social comme un morcellement de peuples murés, embastionnés, clos les uns aux autres et en guerre les uns avec les autres éternellement. Aussi rencontre-t-on généralement cette variété de naturalisme associée à l'apologie du militarisme. Au contraire, les idées d'invention, d'imitation et de logique sociale, choisies comme fil conducteur, nous amènent à la perspective plus rassurante d'un grand confluent futur - sinon, hélas ! prochain - des humanités multiples en une seule famille humaine, sans conflit belliqueux. Cette idée du progrès indéfini, si vague et si tenace, ne prend un sens clair et précis qu'à ce point de vue. Des lois de l'imitation, en effet, découle la nécessité d'une marche en avant vers un grand but lointain, de mieux en mieux atteint, quoique à travers des reculs apparents mais passagers, à savoir - sous forme impériale ou sous forme fédérative, n'importe - la naissance, la croissance, le débordement universel d'une société unique. Et, de fait, on me permettra de remarquer que, parmi les prédictions de Condorcet relatives aux progrès futurs, les seules qui se soient trouvées justes - par exemple concernant l'extension et le nivellement graduels de la civilisation européenne - sont des conséquences des lois dont il s'agit. Mais s'il avait eu égard à ces lois, il aurait donné à sa pensée une expression plus exacte à la fois et plus précise. Quand il prédit, notamment, que l'inégalité des diverses nations ira diminuant, c'est dissemblance sociale qu'il aurait dû dire et non inégalité : car, entre les plus petits et les plus grands États, la disproportion de forces, d'étendue, de richesse même, va en augmentant, au contraire, ce qui n'empêche pas les progrès incessants de l'assimilation internationale. Est-il bien sûr même que, à tous égards, l'inégalité entre les individus doive diminuer sans cesse, comme l'a prédit aussi l'illustre philosophe? Leur inégalité en fait de lumières et de talents? Nullement. En fait de bien-être et de richesses ? C'est douteux. Il est vrai que leur inégalité en fait de droits a tout à fait disparu ou achèvera avant peu de disparaître; mais pourquoi ? Parce que la ressemblance croissante des individus entre lesquels toutes les barrières coutumières de l'imitation réciproque ont été rompues, et qui s'entreimitent de plus en plus librement, soit, mais de plus en plus nécessairement, leur fait sentir avec une force croissante, et irrésistible à la fin, l'injustice des privilèges.
Entendons-nous bien cependant sur cette similitude progressive des individus. Loin d'étouffer leur originalité propre, elle la favorise et l'alimente. Ce qui est contraire à l'accentuation personnelle, c'est l'imitation d'un seul homme, sur lequel ou se modèle en tout; mais quand, au lieu de se régler sur quelqu'un ou sur quelques-uns, on emprunte à cent, à mille, à dix mille personnes considérées chacune sous un aspect particulier, des éléments d'idée ou d'action que l'on combine ensuite, la nature même et le choix de ces copies élémentaires, ainsi que leur combinaison, expriment et accentuent notre personnalité originale. Et tel est peut-être le bénéfice le plus net du fonctionnement prolongé de l'imitation. On pourrait se demander jusqu'à quel point la société, ce long rêve collectif, ce cauchemar collectif si souvent, vaut ce qu'elle coûte de sang et de larmes, si cette discipline douloureuse, ce prestige illusoire et despotique, ne servait précisément à affranchir l'individu en suscitant peu à peu du plus profond de son cœur son élan le plus libre, son regard le plus hardi jeté sur la nature extérieure et sur lui-même, et en faisant éclore partout, non plus les couleurs d'âme voyantes et brutales d'autrefois, les individualités sauvages, mais des nuances d'âme profondes et fondues, aussi caractérisées que civilisées, floraison à la fois de l'individualisme le plus pur, le plus puissant, et de la sociabilité consommée.
G. T.
Mai 1895.
1 Ou du même cerveau, s'il s'agit de l'imitation de soi-même ; car la mémoire et l'habitude, qui en sont les deux branches, doivent être rattachées, pour être bien comprises, à l'imitation d'autrui, la seule dont nous nous occupons ici. Le psychologique s'explique par le social, précisément parce que le social naît du psychologique.
2 Le dogme, c'est-à-dire toute idée, religieux ou non, politique par exemple, ou toute autre, qui s'implante dans l'esprit de chaque associé par pression ambiante.
Avant-propos de la première édition, 1890
Dans ce livre, j'ai essayé de dégager, avec le plus de netteté possible, le côté purement social des faits humains, abstraction faite de ce qui est en eux simplement vital ou physique. Mais, précisément, il s'est trouvé que le point de vue à la faveur duquel j'ai pu bien marquer cette différence, m'a montré entre les phénomènes sociaux et les phénomènes d'ordre naturel les analogies les plus nombreuses, les plus suivies, les moins forcées. Il y a de longues années déjà que j'ai énoncé et développé çà et là, dans la Revue philosophique, mon idée principale - « clef qui ouvre presque toutes les serrures », a eu l'obligeance de m'écrire un de nos plus grands historiens philosophes ; - et, comme le plan de cet ouvrage était dès lors dans ma pensée, plusieurs des articles dont il s'agit ont pu sans peine entrer dans sa composition sous forme de chapitres 3. Je n'ai fait que les rendre de la sorte, en les refondant, à leur destination première. Les sociologistes qui m'ont fait l'honneur, parfois, de remarquer ma manière de voir, pourront maintenant, s'ils le jugent à propos, la critiquer en connaissance de cause et non d'après des fragments détachés. Je leur pardonnerai d'être sévères pour moi s'ils sont bienveillants pour mon idée, ce qui n'aurait rien d'impossible. Elle peut, en effet, avoir à se plaindre de moi, comme la semence de la terre. Mais je souhaite, en ce cas, que, par suite de cette publication, elle tombe dans un esprit mieux préparé que le mien à la mettre en valeur.
J'ai donc tâché d'esquisser une sociologie pure. Autant vaut dire une sociologie générale. Les lois de celle-ci, telle que je la comprends, s'appliquent à toutes les sociétés actuelles, passées ou possibles, comme les lois de la physiologie générale à toutes les espèces vivantes, éteintes ou concevables. Il est bien plus aisé, je n'en disconviens pas, de poser et de prouver même ces principes, d'une simplicité égale à leur généralité, que de les suivre dans le dédale de leurs applications particulières; mais il n'en est pas moins nécessaire de les formuler.
Par philosophie de l'histoire, au contraire, et par philosophie de la nature, on entendait jadis un système étroit d'explication historique ou d'interprétation scientifique, qui cherchait à rendre raison du groupe entier ou de la série entière des faits de l'histoire ou des phénomènes naturels, mais présentés de telle sorte que la possibilité de tout autre groupement et de toute autre succession fût exclue. De là l'avortement de ces tentatives. Le réel n'est explicable que rattaché à l'immensité du possible, c'est-à-dire du nécessaire sous condition, où il nage comme l'étoile dans l'espace infini. L'idée même de loi est la conception de ce firmament des faits.
Certes, tout est rigoureusement déterminé, et la réalité ne pouvait être différente, ses conditions primordiales et inconnues étant données. Mais pourquoi celles-ci et non d'autres? Il y a de l'irrationnel à la base du nécessaire. Aussi, dans le domaine physique et le domaine vivant, comme dans le monde social, le réalisé semble n'être qu'un fragment du réalisable. Voyez le caractère épars et morcelé des cieux, avec leur dissémination arbitraire de soleils et de nébuleuses; l'air bizarre des faunes et des flores; l'aspect mutilé et incohérent des sociétés qui se juxtaposent, pêle-mêle d'ébauches et de ruines. Sous ce rapport, comme à tant d'autres égards que je signalerai en passant, les trois grands compartiments de la réalité se ressemblent trop bien.
Un chapitre de ce livre, celui qui est intitulé les lois logiques de l'imitation, n'y est placé que comme pierre d'attente d'un ouvrage ultérieur, destiné à compléter celui-ci. Si j'avais donné au sujet tous les développements qu'il comporte, ce volume n'aurait pas suffi.
Les idées que j'émets pourraient fournir, je crois, des solutions nouvelles aux questions politiques ou autres qui nous divisent maintenant. Je n'ai pas cru devoir les déduire, et la classe de lecteurs à laquelle je m'adresse ne me reprochera pas d'avoir négligé cet attrait d'actualité. Je ne l'aurais pu, d'ailleurs, sans sortir des limites de mon travail.
- Encore un mot, pour justifier ma dédicace. Je ne suis ni l'élève, ni le disciple même de Cournot. Je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais je tiens pour une chance heureuse de ma vie de l'avoir beaucoup lu au sortir du collège; j'ai souvent pensé qu'il lui a manqué uniquement d'être né anglais ou allemand et d'avoir été traduit dans un français fourmillant de solécismes pour être illustre parmi nous; surtout, je n'oublierai jamais que, dans une période néfaste de ma jeunesse, malade des yeux, devenu par force unius libri, je lui dois de n'être pas tout à fait mort de faim mentale. Mais on se moquerait de moi, à coup sûr, si je ne me hâtais d'ajouter qu'à ce sentiment démodé de gratitude intellectuelle auquel j'obéis, s'en joint un autre, beaucoup moins désintéressé. Si mon livre - éventualité qu'un philosophe en France doit toujours prévoir, même après n'avoir eu encore qu'à se louer de la bienveillance du public - était mal accueilli, ma dédicace m'offrirait à propos un sujet de consolation. En songeant, alors, que Cournot, ce Sainte-Beuve de la critique philosophique, cet esprit aussi original que judicieux, aussi encyclopédique et compréhensif que pénétrant, ce géomètre profond, ce logicien hors ligne, cet économiste hors cadres, précurseur méconnu des économistes nouveaux, et pour tout dire, cet Auguste Comte épuré, condensé, affiné, a toute sa vie pensé dans l'ombre et n'est pas même très connu depuis sa mort, comment oserais-je un jour me plaindre de n'avoir pas eu plus de succès ?
3 Ce sont les chapitres premier, troisième, quatrième et cinquième, modifiés ou amplifiés. Le premier a été publié en septembre 1882, le troisième en 1884, le quatrième en octobre et novembre 1883, le cinquième en 1888. - Je n'ai pas cru devoir reproduire ici bien d'autres articles sociologiques publiés dans le même recueil, mais destinés à une révision ultérieure. Dans un autre ouvrage (La Philosophie pénale), j'ai développé l'application de mon point de vue au côté criminel et pénal des sociétés comme je l'avais essayé déjà dans ma Criminalité comparée.
Chapitre I
La répétition universelle
I
Régularité inaperçue des faits sociaux à un certain point de vue.
Leurs analogies avec les faits naturels. Les trois formes de la Répétition universelle: ondulation, génération, imitation. Science sociale et philosophie sociale. Sociétés animales.
Y a-t-il lieu à une science, ou seulement à une histoire et tout au plus à une philosophie des faits sociaux ? La question est toujours pendante, bien que, à vrai dire, ces faits, si l'on y regarde de près et sous un certain angle, soient susceptibles tout comme les autres de se résoudre en séries de petits faits similaires et en formules nommées lois qui résument ces séries. Pourquoi donc la science sociale est-elle encore à naître ou à peine née au milieu de toutes ses sœurs adultes et vigoureuses ? La principale raison, à mon avis, c'est qu'on a ici lâché la proie pour l'ombre, les réalités pour les mots. On a cru ne pouvoir donner à la sociologie une tournure scientifique qu'en lui donnant un air biologique, ou, mieux encore, un air mécanique. C'était chercher à éclaircir le connu par l'inconnu, c'était transformer un système solaire en nébuleuse non résoluble pour le mieux comprendre. En matière sociale, on a sous la main, par un privilège exceptionnel, les causes véritables, les actes individuels dont les faits sont faits, ce qui est absolument soustrait à nos regards en toute autre matière. On est donc dispensé, ce semble, d'avoir recours pour l'explication des phénomènes de la société à ces causes, dites générales, que les physiciens et les naturalistes sont bien obligés de créer sous le nom de forces, d'énergies, de conditions d'existence et autres palliatifs verbaux de leur ignorance du fond clair des choses.
Mais les actes humains considérés comme les seuls facteurs de l'histoire! Cela est trop simple. On s'est imposé l'obligation de forger d'autres causes sur le type de ces fictions utiles qui ont ailleurs cours forcé, et l'on s'est félicité d'avoir pu prêter ainsi parfois aux faits humains vus de très haut, perdus de vue à vrai dire, une couleur tout à fait impersonnelle. Gardons-nous de cet idéalisme vague ; gardons-nous aussi bien de l'individualisme banal qui consiste à expliquer les transformations sociales par le caprice de quelques grands hommes. Disons plutôt qu'elles s'expliquent par l'apparition, accidentelle dans une certaine mesure, quant à son lieu et à son moment, de quelques grandes idées, ou plutôt d'un nombre considérable d'idées petites ou grandes, faciles ou difficiles, le plus souvent inaperçues à leur naissance, rarement glorieuses, en général anonymes, mais d'idées neuves toujours, et qu'à raison de cette nouveauté je me permettrai de baptiser collectivement inventions ou découvertes. Par ces deux termes j'entends une innovation quelconque ou un perfectionnement, si faible soit-il, apporté à une innovation antérieure, en tout ordre de phénomènes sociaux, langage, religion, politique, droit, industrie, art. Au moment où cette nouveauté, petite ou grande, est conçue ou résolue par un homme, rien n'est changé en apparence dans le corps social, comme rien n'est changé dans l'aspect physique d'un organisme où un microbe soit funeste, soit bienfaisant, est entré ; et les changements graduels qu'apporte l'introduction de cet élément nouveau dans le corps social semblent faire suite, sans discontinuité visible, aux changements antérieurs dans le courant desquels ils s'insèrent. De là, une illusion trompeuse qui porte les historiens philosophes à affirmer la continuité réelle et fondamentale des métamorphoses historiques. Leurs vraies causes pourtant se résolvent en une chaîne d'idées très nombreuses à la vérité, mais distinctes et discontinues, bien que réunies entre elles par les actes d'imitation, beaucoup plus nombreux encore, qui les ont pour modèles.
Il faut partir de là, c'est-à-dire d'initiatives rénovatrices, qui, apportant au monde à la fois des besoins nouveaux et de nouvelles satisfactions, s'y propagent ensuite ou tendent à s'y propager par imitation forcée ou spontanée, élective ou inconsciente, plus ou moins rapidement, mais d'un pas régulier, à la façon d'une onde lumineuse ou d'une famille de termites. La régularité dont je parle n'est guère apparente dans les faits sociaux, mais on l'y découvrira si on les décompose en autant d'éléments qu'il y a en eux, dans le plus simple d'entre eux, d'inventions distinctes combinées, d'éclairs de génies accumulés et devenus de banales lumières : analyse, il est vrai, fort difficile. Tout n'est socialement qu'inventions et imitations, et celles-ci sont les fleuves dont celles-là sont les montagnes; rien de moins subtil, à coup sûr, que cette vue; mais, en la suivant hardiment, sans réserve, en la déployant depuis le plus mince détail jusqu'au plus complet ensemble des faits, peut-être remarquera-t-on combien elle est propre à mettre en relief tout le pittoresque et, à côté, toute la simplicité de l'histoire, à y révéler des perspectives ou aussi bizarres qu'un paysage de rochers ou aussi régulières qu'une allée de parc. - C'est de l'idéalisme encore si l'on veut, mais de l'idéalisme qui consiste à expliquer l'histoire par les idées de ses acteurs et non par celles de l'historien.
Tout d'abord, à considérer sous cet angle la science sociale, on voit la sociologie humaine se rattacher aux sociologies animales (pour ainsi parler) comme l'espèce au genre : espèce très singulière et infiniment supérieure aux autres, soit, fraternelle pourtant. Dans son beau livre sur les Sociétés animales, qui est fort antérieur à la première édition du présent ouvrage, M. Espinas dit expressément que les travaux des fourmis s'expliquent fort bien par le principe « de l'initiative individuelle suivie d'imitation ». Cette initiative est toujours une innovation, une invention égale aux nôtres en hardiesse d'esprit. Pour avoir l'idée de construire un arceau, un tunnel ici ou là, ici plutôt que là, une fourmi doit être douée d'un penchant novateur qui égale ou dépasse celui de nos ingénieurs perceurs d'isthmes ou de montagnes. Entre parenthèses, il suit de là que l'imitation de ces initiatives si neuves par la masse des fourmis dément d'une manière éclatante le prétendu misonéisme des animaux 4. C'est bien souvent que M. Espinas, dans ses observations sur les sociétés de nos frères inférieurs, a été frappé du rôle important qu'y joue l'initiative individuelle. Chaque troupeau de bœufs sauvages a ses leaders, ses têtes influentes. Les perfectionnements de l'instinct des oiseaux, d'après le même auteur, s'expliquent par « une invention partielle, transmise ensuite de génération en génération par l'enseignement direct ». Si l'on songe que les modifications de l'instinct se rattachent probablement au même principe que les modifications de l'espèce et la genèse de nouvelles espèces, peut-être sera-t-on tenté de se demander si le principe de l'invention imitée, ou de quelque chose d'analogue physiologiquement, ne serait pas la plus claire explication possible du problème toujours pendant des origines spécifiques? Mais laissons cette question et bornons-nous à constater que, animales ou humaines, les sociétés se laissent expliquer par cette manière de voir.
En second lieu, et c'est là la thèse spéciale du présent chapitre, de ce point de vue on voit l'objet de la science sociale présenter une analogie remarquable avec les autres domaines de la science générale et se réincorporer ainsi, pour ainsi dire, au reste de l'univers dans le sein duquel il faisait l'effet d'un corps étranger.
En tout champ d'études, les constatations pures et simples excèdent prodigieusement les explications. Et par tout ce qui est simplement constaté, ce sont les données premières, accidentelles et bizarres, prémisses et sources d'où découle tout ce qui est expliqué. Il y a ou il y a eu telles nébuleuses, tels globes célestes, de telle masse, de tel volume, à telle distance; il y a telles substances chimiques; il y a tels types de vibrations éthérées, appelés lumière, électricité, magnétisme ; il y a tels types organiques principaux, et d'abord il y a des animaux, et il y a des plantes ; il y a telles chaînes de montagnes, appelées les Alpes ou les Andes, etc. Quand ils nous apprennent ces faits capitaux d'où se déduit tout le reste, l'astronome, le chimiste, le physicien, le naturaliste, le géographe font-ils œuvre de savants proprement dits? Non, ils font un simple constat et ne diffèrent en rien du chroniqueur qui relate l'expédition d'Alexandre ou la découverte de l'imprimerie. S'il y a une différence, nous le verrons, elle est tout à l'avantage de l'historien. Que savons-nous donc au sens savant du mot? On répondra sans doute : les causes et les fins; et quand nous sommes parvenus à voir que deux faits différents sont produits l'un par l'autre ou collaborent à un même but, nous appelons cela les avoir expliqués. Pourtant, supposons un monde où rien ne se ressemble ni ne se répète, hypothèse étrange, mais intelligible à la rigueur; un monde tout d'imprévu et de nouveauté, où, sans nulle mémoire en quelque sorte, l'imagination créatrice se donne carrière, où les mouvements des astres soient sans période, les agitations de l'éther sans rythme vibratoire, les générations successives sans caractères communs et sans type héréditaire. Rien n'empêche de supposer malgré cela que chaque apparition dans cette fantasmagorie soit produite et déterminée même par une autre, qu'elle travaille même à en amener une autre. Il pourrait y avoir des causes et des fins encore. Mais y aurait-il lieu à une science quelconque dans ce monde-là ? Non ; et pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'y aurait ni similitudes ni répétitions.
C'est là l'essentiel. Connaître les causes, cela permet de prévoir parfois; mais connaître les ressemblances, cela permet de nombrer et de mesurer toujours, et la science, avant tout, vit de nombre et de mesure. Du reste, essentiel ne signifie pas suffisant. Une fois son champ de similitudes et de répétitions propres trouvé, une science nouvelle doit les comparer entre elles et observer le lien de solidarité qui unit leurs variations concomitantes. Mais, à vrai dire, l'esprit ne comprend bien, n'admet à titre définitif le lien de cause à effet, qu'autant que l'effet ressemble à la cause, répète la cause, quand, par exemple, une ondulation sonore engendre une autre ondulation sonore, ou une cellule une autre cellule pareille. Rien de plus mystérieux, dira-t-on, que ces reproductions-là. C'est vrai ; mais, ce mystère accepté, rien de plus clair que de telles séries. Et chaque fois que produire ne signifie point se reproduire, tout devient ténèbres pour nous 5.
Quand les choses semblables sont les parties d'un même tout ou jugées telles, comme les molécules d'un même volume d'hydrogène, ou les cellules ligneuses d'un même arbre, ou les soldats d'un même régiment, la similitude prend le nom de quantité et non simplement de groupe. Quand, autrement dit, les choses qui se répètent demeurent annexées les unes aux autres en se multipliant, comme les vibrations caloriques ou électriques, qui, en s'accumulant dans l'intérieur d'un corps, l'échauffent ou l'électrisent de plus en plus, ou comme les formations de cellules similaires qui se multiplient dans le corps d'un enfant en train de grandir, ou comme les adhésions à une même religion par la conversion des infidèles, la répétition alors s'appelle accroissement et non simplement série. En tout ceci, je ne vois rien qui singularise l'objet de la science sociale.
Intérieures ou extérieures, d'ailleurs, quantités ou groupes, accroissements ou séries, les similitudes, les répétitions phénoménales sont les thèmes nécessaires des différences et des variations universelles, les canevas de ces broderies, les mesures de cette musique. Le monde fantasmagorique que je supposais tout à l'heure serait, au fond, le moins richement différencié des mondes possibles. Combien dans nos sociétés le travail, accumulation d'actions calquées les unes sur les autres, n'est-il pas plus rénovateur que les révolutions ! Et qu'y a-t-il de plus monotone que la vie émancipée du sauvage comparée à la vie assujettie de l'homme civilisé ? Sans l'hérédité, y aurait-il un progrès organique possible ? Sans la périodicité des mouvements célestes, sans le rythme ondulatoire des mouvements terrestres, l'exubérante variété des âges géologiques et des créations vivantes aurait-elle éclaté ?
Les répétitions sont donc pour les variations. Si l'on admettait le contraire, la nécessité de la mort - problème jugé presque insoluble par M. Delbœuf dans son livre sur la matière brute et la matière vivante - ne se comprendrait pas; car, pourquoi la toupie vivante, une fois lancée, ne tournerait-elle pas éternellement? Mais, si les répétitions n'ont qu'une raison d'être, celle de montrer sous toutes ses faces une originalité unique qui cherche à se faire jour, dans cette hypothèse la mort doit fatalement survenir avec l'épuisement des modulations exprimées. - Remarquons en passant, à ce propos, que le rapport de l'universel au particulier, aliment de toute la controverse philosophique du moyen âge sur le nominalisme et le réalisme, est précisément celui de la répétition à la variation. Le nominalisme est la doctrine d'après laquelle les individus sont les seules réalités qui comptent; et par individus il faut entendre les êtres envisagés par leur côté différentiel. Le réalisme, à l'inverse, ne considère comme dignes d'attention et du nom de réalité, dans un individu donné, que les caractères par lesquels il ressemble à d'autres individus et tend à se reproduire dans d'autres individus semblables. L'intérêt de ce genre de spéculation apparaît quand on songe que le libéralisme individualiste en politique est une espèce particulière de nominalisme, et que le socialisme est une espèce particulière de réalisme.
Toute répétition, sociale, organique ou physique, n'importe, c'està-dire imitative, héréditaire ou vibratoire (pour nous attacher uniquement aux formes les plus frappantes et les plus typiques de la Répétition universelle), procède d'une innovation, comme toute lumière procède d'un foyer; et ainsi le normal, en tout ordre de connaissance, parait dériver de l'accidentel. Car, autant la propagation d'une force attractive ou d'une vibration lumineuse à partir d'un astre, ou celle d'une race animale à partir d'un premier couple, ou celle d'une idée, d'un besoin, d'un rite religieux, dans toute une nation, à partir d'un savant, d'un inventeur, d'un missionnaire, sont à nos yeux des phénomènes naturels et régulièrement ordonnés, autant l'ordre en partie informulable dans lequel ont apparu ou se sont juxtaposés les foyers de tous ces rayonnements, par exemple, les diverses industries, religions, institutions sociales, les divers types organiques, les diverses substances chimiques ou masses célestes, nous surprend toujours par son étrangeté. Toutes ces belles uniformités ou ces belles séries, - l'hydrogène identique à lui-même dans l'infinie multitude de ses atomes dispersés parmi tous les astres du ciel, ou l'expansion de la lumière d'une étoile dans l'immensité de l'espace; le protoplasme identique à lui-même d'un bout à l'autre de l'échelle vivante, ou la suite invariable d'incalculables générations d'espèces marines depuis les temps géologiques ; les racines verbales des langues indo-européennes identiques dans presque toute l'humanité civilisée, ou la transmission remarquablement fidèle des mots, de la langue cophte des anciens Égyptiens à nous, etc. - toutes ces foules innombrables de choses semblables et semblablement liées, dont nous admirons la cœxistence ou la succession également harmonieuses, se rattachent à des accidents physiques, biologiques, sociaux dont le lien nous déroute.
Encore ici, l'analogie se poursuit entre les faits sociaux et les autres phénomènes de la nature. Si cependant les premiers, considérés à travers les historiens et même les sociologistes, nous font l'effet d'un chaos, tandis que les autres, envisagés à travers les physiciens, les chimistes, les physiologistes, laissent l'impression de mondes fort bien rangés, il n'y a pas à en être surpris. Ces derniers savants ne nous montrent l'objet de leur science que par le côté des similitudes et des répétitions qui lui sont propres, reléguant dans une ombre prudente le côté des hétérogénéités et des transformations (ou transsubstantiations) correspondantes. Les historiens et les sociologistes, à l'inverse, jettent un voile sur la face monotone et réglée des faits sociaux, sur les faits sociaux en tant qu'ils se ressemblent et se répètent, et ne présentent à nos yeux que leur aspect accidenté et intéressant, renouvelé et diversifié à l'infini. S'il s'agit des Gallo-Romains, l'historien même philosophe n'aura point l'idée, immédiatement après la conquête de César, de nous promener pas à pas dans toute la Gaule pour nous montrer chaque mot latin, chaque rite romain, chaque commandement, chaque manœuvre militaire, à l'usage des légions romaines, chaque métier, chaque usage, chaque service, chaque loi, chaque idée spéciale enfin et chaque besoin spécial importés de Rome, en train de rayonner progressivement des Pyrénées au Rhin et de gagner successivement, après une lutte plus ou moins vive contre les anciennes idées et les anciens usages celtiques, toutes les bouches, tous les bras, tous les cœurs et tous les esprits gaulois, copistes enthousiastes de César et de Rome. Certainement, s'il nous fait faire une fois cette longue promenade, il ne nous la fera pas refaire autant de fois qu'il y a de mots ou de formes grammaticales dans la langue romaine, qu'il y a de formalités rituelles dans la religion romaine ou de manœuvres apprises aux légionnaires par leurs officiers instructeurs, qu'il y a de variétés de l'architecture romaine, temples, basiliques, théâtres, cirques, aqueducs, villas avec leur atrium, etc., qu'il y a de vers de Virgile ou d'Horace enseignés dans les écoles à des millions d'écoliers, qu'il y a de lois dans la législation romaine, qu'il y a de procédés industriels et artistiques transmis fidèlement et indéfiniment d'ouvrier à apprentis et de maître à élèves dans la civilisation romaine. Pourtant, ce n'est qu'à ce prix qu'on peut se rendre un compte exact de la dose énorme de régularité que les sociétés les plus agitées contiennent.
Puis, quand le christianisme aura apparu, le même historien se gardera bien, sans nul doute, de nous faire recommencer cette ennuyeuse pérégrination à propos de chaque rite chrétien qui se propage dans la Gaule païenne non sans résistance, à la manière d'une onde sonore dans un air déjà vibrant. - En revanche, il nous apprendra que, à telle date, Jules César a conquis la Gaule, et qu'à telle autre date tels saints sont venus prêcher la doctrine chrétienne dans cette contrée. Il nous énumérera peut-être aussi les divers éléments dont se composent la civilisation romaine ou la foi et la morale chrétiennes, introduites dans le monde gaulois. Le problème alors se posera pour lui de comprendre, de présenter sous un jour rationnel, logique, scientifique, cette superposition bizarre du christianisme au romanisme, ou mieux de la christianisation graduelle à la romanisation graduelle; et la difficulté ne sera pas moindre d'expliquer rationnellement, dans le romanisme et le christianisme pris à part, la juxtaposition étrange de lambeaux étrusques, grecs, orientaux et autres, fort hétérogènes eux-mêmes, qui constituent l'un, et des idées juives, égyptiennes, byzantines, fort peu cohérentes d'ailleurs, même dans chaque groupe distinct, qui constituent l'autre. C'est cependant cette tâche ardue que le philosophe de l'histoire se proposera; il ne croira pas pouvoir l'éluder s'il veut faire œuvre de savant, et il se fatiguera le cerveau à faire de l'ordre avec ce désordre, à chercher la loi de ces hasards et la raison de ces rencontres. Il vaudrait mieux chercher comment et pourquoi il sort parfois de ces rencontres des harmonies, et en quoi celles-ci consistent. Nous l'essaierons plus loin.
En somme c'est comme si un botaniste se croyait tenu à négliger tout ce qui concerne la génération des végétaux d'une même espèce